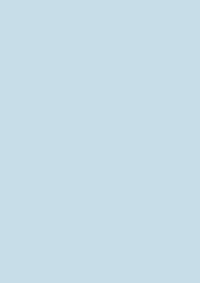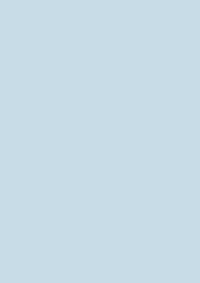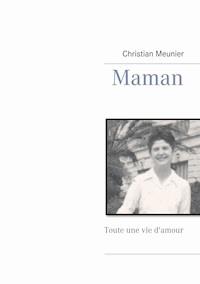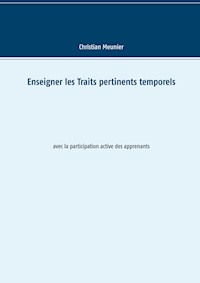
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
En s'appuyant d'une part sur les traits pertinents temporels pour la théorie grammaticale et sur la grammaire participative pour ce qui est des principes didactiques et pédagogiques, l'auteur montre comment aborder l'enseignement de l'emploi des temps grammaticaux au moyen des traits pertinents temporels. L'enseignante ou l'enseignant de français langue étrangère découvrira ainsi une nouvelle approche beaucoup plus systématique de cet enseignement. Un site web dédié à cette problématique, www.theorie-des-temps, pilote et soutient des activités en groupes et offre des exercices corrigés et expliqués par l'ordinateur pour permettre à l'apprenant de participer activement à son apprentissage..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autres ouvrages du même auteur :
→
eGrammaire BoD 2014 ISBN : 978-2-322-08398-5
→
Grammaire participative BoD 2015 ISBN : 2015 978-2-322-08403-6
→
Petit guide de la Phonétique corrective BoD ISBN : 978-2-322-08399-2
→
Apprendre à enseigner les temps simples du passé BoD ISBN : 978-2-322-08461-6
Avec Gérard Meunier
→
OrthoFle Le guide du professeur d’orthographe Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2017 ISBN : 979-1-094-11308-0
Avec Jean Piètre-Cambacédes
→
La Conception du temps en français, anglais, allemand Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2017 ISBN : 979-1-094-11309-7
Théorie des Temps grammaticaux fondée sur les Traits pertinents temporels BoD 2015 ISBN : 978-2-0978-2-322-091348
Site d’accompagnement de cet ouvrage : www.theorie-des-temps.com
Sites auxiliaires :
www.la-grammaire-du-fle.com
http://www.la-conception-du-temps.com/
www.orthofle.eu
www.editions-du-fle.fr
Pour le FLE niveau débutants ou faux débutants
www.lesconet.fre
Table des Matières
1 Avant-Propos
Cet ouvrage accompagne la Théorie des temps grammaticaux fondée sur les traits pertinents temporels {Meunier 2018}.
1.1 Principe
Son but est de proposer à l’enseignante1 une méthode pour enseigner les temps et modes du français dans une optique FLE.
Cet ouvrage se place dans la droite ligne de notre Grammaire participative {Meunier 2015}
En incitant la participation active des apprenants seuls, en groupes ou en plénum à leur propre apprentissage.
En soutenant cet apprentissage par l’utilisation d’un site internet,
www.theorie-des-temps.com
, qui met à la disposition de l’ensemble enseignante/apprenants des documents, des pistes de réflexion dynamiques, des exercices et des tests autocorrigés accompagnés qu’un cahier de l’apprenant téléchargeable sur le site susnommé.
En outre, il est possible à des apprenants en totale autonomie d’utiliser le site pour un travail d’approche seuls ou en groupes.
1.2 Public visé
Ce système s’adresse avant tout à des enseignantes et des apprenants dans le cadre du FLE. Évidemment, il devrait pouvoir intéresser également les enseignantes, les futures enseignantes de toutes origines ainsi que les apprenants francophones.
Il vise aussi par son site web les apprenants en autonomie complète.
1.3 Organisation du travail
1.3.1 Travail en cours
Le travail proposé ici comporte un certain nombre de phases :
Une phase permettant la formation d’une grammaire intuitive de base par l’écoute et la répétition d’un certain nombre de phrases ou mini-textes exemples ciblés.
Une phase de découverte des problèmes en solitaire, en groupes ou en plénum, en utilisant le cahier de l’apprenant, avec le soutien de l’ordinateur et sous le contrôle de l’enseignante.
Une phase d’exercices, de tests et de fixation des connaissances découvertes et acquises.
Éventuellement une phase de rédaction consistant à une présentation du problème succincte susceptible d’alimenter un exposé, une bibliothèque de classe ou un site de présentation sur la toile présentant le travail des groupes.
1.3.2 Travail en autonomie
L’apprenant en autonomie peut suivre le cours seul, selon l’ordre qui lui est proposé.
Il retrouvera :
Un rappel de la grammaire cognitive.
Un exercice d’entraînement à la grammaire intuitive pour chaque Tpt à partir de Tpt3.
Des explications du problème.
Des phases de réflexion / découverte.
Des exercices autocorrigés.
Des tests autocorrigés.
Une aide à l’organisation de son apprentissage.
1.3.3 Contact
Que l’apprenant appartienne à un cours ou qu’il travaille en autonomie, il peut ressentir le besoin
de contacter d’autres apprenants, en utilisant le forum du site.
De consulter un enseignant en utilisant la fiche de contact.
1.4 Structure du système
Le système concerne aussi bien les apprenants que les enseignantes. Il se répartit sur le travail en classe d’une part, et celui qui nécessite l’emploi d’un ordinateur.
Le but est de permettre aux apprenants de découvrir et de décrire eux-mêmes les problèmes qui se posent à eux en travaillant alternativement en groupes, seuls ou en plénum, sous le contrôle de l’enseignante.
Les apprenants, dont le travail sera soutenu par l’ordinateur et le cahier des apprenants d’une part, et piloté par leur enseignante qui les aidera, les guidera dans leurs réflexions et les encouragera si besoin est, apprendront ainsi à travailler ensemble à la résolution commune d’un problème, à discuter, à expliquer, à négocier avec les autres, pour augmenter leur savoir et leur savoir-faire. Ils gagneront ainsi à la fois une confiance en eux-mêmes, et l’habitude de travailler en équipe, chacun jouant son rôle et apportant sa pierre à l’édifice.
1.5 Qu’entendons-nous par traits pertinents temporels ?
Un trait pertinent temporel (Tpt) est un paramètre linguistique qui peut prendre plusieurs valeurs, et qui sert , seul ou en combinaison avec d’autres, à déterminer le choix d’un temps grammatical.
Voici un exemple et les Tpt qui jouent un rôle dans le choix du temps et la compréhension.
Exemple
Tpt
Tpt1
période →passé
Tpt2
TptProc avant TptLocu →passé
Toute sa vie, Paul fuma deux
Tpt3
balise temporelle →toute sa vie
paquets de cigarettes par jour.
Tpt6
fenêtre fermée →passé simple
Tpt7
Partie utile totalité
Tpt8
Durée du procès : durée indéterminée
Tpt9
Degré de probabilité : certain
Tpt10
Valeur : valeur de base du passé simple
1.6 Pourquoi utiliser les traits pertinents temporels (Tpt) ?
Traditionnellement, on enseigne l’emploi des temps en présentant les problèmes mode par mode, puis temps par temps. On y ajoute parfois les aspects, qui ne sont pas forcément les mêmes d’un auteur à l’autre, et les modalités.
Nous préférons les présenter par des traits pertinents temporels, afin que les apprenants comprennent le fonctionnement des temps de l’intérieur, et puissent suivre le même trait pertinent et son influence à travers les temps.
1.7 Comment allons-nous faire ?
Nous allons répartir l’étude des traits pertinents temporels sur 12 chapitres, un par Tpt, à travers les temps..
1.8 Rappelons les 12 Tpt et leur valeurs :
1.9 Comment allons-nous nous y prendre ?
Nous allons suivre pour chaque chapitre le plan suivant :
Plan d’un chapitre
Il s’agit là d’une version maximale et optimale, telle que l’on pourrait l’envisager à l’université, dans les cours de grammaire pour futurs enseignantes.
Pour des lycéens ou des étudiants ne se destinant pas au professorat, il faudra sans doute prévoir un programme plus modeste et abandonner sans doute le dernier point ( rédaction d’un rapport et implémentation sur un site).
1.10 Grammaire intuitive, grammaire cognitive
La grammaire intuitive
: c’est celle que les enfants acquièrent au contact de leurs proches avant d’aller à l’école, la correction étant assurée par l’entourage, mais pour laquelle on ne formule aucune règle. On se contente de phrases simples, agrémentées de relatives et de circonstancielles simples.
La grammaire cognitive
qui s’apprend à l’école, avec des règles. L’enseignante profite de l’occasion pour revenir sur la grammaire intuitive afin d’en préciser les règles, et d’en ajouter de nouvelles sur l’emploi des temps, la phrase complexe et certaines structures telles que l’hypothèse, l’accord du participe, certaines conjugaisons entre autres.
1 La plupart des enseignants de français étant des femmes, c’est donc aux enseignantes que nous nous adresserons. Les enseignants hommes devront se sentir visés eux aussi .
2 Étude du Tpt 1
2.1 Pour l’enseignante
2.1.1 Rappels grammaticaux
S’appuyant sur {Priscien 525}, Le Dona françois de Barton, reconnaît trois temps de base : Le présent, le passé et le futur.
Nous les reprenons sous le nom d’époques. Elles sont représentées sur notre graphique :
→ L’époque du présent que le temps produit de façon continue, tandis qu’il envoie le présent précédent dans le passé.
→ Celle du passé, qui abrite tous les procès qui ne sont plus actuels, et qui constituent une immense archive.
→ L’époque du futur, qui abrite les espoirs, les intentions des locuteurs. Comme les procès qu’elle est censée contenir sont, selon les cas, probables (futur simple) ou bien ont peu ou pas du tout de chances de se produire (conditionnel), nous les représentons dans une sorte de brouillard, qui doit nous rappeler que le futur n’existe pas encore, et que quand le procès se sera réalisé, il sera d’abord au présent, puis au passé.
Il va de soi que tous les temps sont touchés par Tpt1 (= Époque). Le locuteur va essayer de replacer les procès décrits dans le présent, le futur ou encore le passé, son interlocuteur (auditeur ou lecteur).
2.1.2 Le repère temporel lié à la locution (Tpt2)
Ce Tpt gère les repères de base. Ceux-ci sont au nombre de deux :
Celui de la locution (TPTLocu) : c’est le moment où le locuteur parle ou écrit. C’est le point de référence le plus important.
Celui du procès (TPTProc) : c’est le moment où le procès dont il est question se déroule.
Ils sont employés de deux façons :
La forme de base, telle que définie ci-dessus
Le trait pertinent temporel (TPT) en translation, pour lequel TptLocu subit une translation..
2.1.3 Rapports entre TptLocu et TptProc
Règle : Définition de la période selon les repères de base.
Il va : Les deux repères TPTLocu et TPTProc2 ont lieu en même temps. Le procès est au présent.
Il est allé : TPTProc1 est antérieur à TPTLocu. Le procès est à un temps du passé.
Il ira : TPTProc 3 est postérieur à TPTLocu. Le procès est à un temps du futur.
2.2 Travail et recherche des apprenants
2.2.1 Travailler sur la grammaire intuitive
Pour habituer l’apprenant à entendre et à utiliser certaines structures, ici, celles qui lient certaines balises temporelles à certains temps, on pourra faire faire cet exercice avec les vingt exemples qui suivent.
L’enregistrement se trouve sur internet à l’adresse www.theorie-des-temps.com, à la rubrique apprenants/Tpt1.
On procédera en trois étapes :
Écoute des exemples sans autre support que le son.
Écoute avec répétition (en appuyant sur « pause » après chaque phrase, puis, sur « démarrer » pour écouter la phrase suivante.
Écoute avec lecture aussi simultanée que possible, en essayant d’imiter le locuteur.
Répétez les phrases suivantes :
1
La Terre
tourne
autour du Soleil.
2
La Lune
tourne
autour de la Terre.
3
Aujourd’hui, nous
visitons
Marseille.
4
Cette semaine, les Martin
font
une croisière.
5
Ce matin,
j’ai
rendez-vous avec Paul.
6
Le lundi, je
suis
toujours fatigué.
7
Tous les lundis, les ouvriers
sont
fatigués du weekend.
8
Hier, il
pleuvait
sur Londres.
9
Autrefois, on
mangeait
avec les mains.
10
Aujourd’hui, on
se sert
d’une fourchette.
11
Au Moyen-Âge, on
a construit
des cathédrales.
12
Les Romains
ont construit
des ponts et des aqueducs.
13
Hier, il
a plu.
14
Aujourd’hui, il
neige.
15
Demain, il
gèlera.
16
Demain, il
fera
jour.
17
Je te
l’apporterai
demain.
18
Pour les prochaines vacances, nous
irons
en Autriche.
19
Si demain il pleut, nous irons au cinéma.
20
Si demain il pleuvait, nous irions au cinéma.
2.2.2 Temps et balises temporelles
Étudiez les exemples suivants.
Identifiez les temps qui se trouvent liés à chaque étape. Dites si c’est étonnant ou non.
Remarque : les solutions (en vert) figurent dans la version « enseignante », mais pas dans la version destinée aux apprenants, tirée du « carnet de recherche de l’apprenant », téléchargeable sur le site parallèle (www.theorie-des-temps.com)
Époque
Exemples
Temps du verbe souligné
Présent
La Terre a une circonférence à l’équateur de 40 000
km.
Il est absent. Il sera malade. Mon voisin
habiterait
le Groenland depuis l’année dernière. Je veux
qu’il vienne
me voir tout de suite. Il va
voir
sa tante. Les voisins
seraient
en croisières.
Indicatif présent Indicatif présent Cond. présent Subj. présent Indicatif présent Cond. présent
Passé
Hier, il
a remporté
le Grand Prix d’Angleterre. En 1815, Napoléon
perd
la bataille de Waterloo. Il
est allé
voir sa tante hier. Il voulait qu’elle
vienne
le voir dimanche prochain. Elle voulait qu’il
vînt
le voir. La mère de Charlemagne
aurait eu
un pied plus grand que l’autre.
Passé composé Indicatif présent Passé composé Subj. présent Subj. imparfait Cond. Passé 1
Futur
Dans une semaine,
on fêtera
Pâques. L’année prochaine, je
pars
pour l’Australie. Je lui dirai demain qu’il
aille
voir son professeur. Sa mère veut qu’elle
aille
chez l’ostéopathe dès demain. Il
ira
voir sa tante. Dans trois jours.
Futur simple Indicatif présent Subj. Présent Subj. Présent Futur simple
Reportez ce que vous avez trouvé dans le tableau suivant :
Passé
Présent
Futur
Présent de l’indicatif
x
x
x
Imparfait de l’indicatif
x
x
Futur simple
x
x
Conditionnel présent
x
x
Conditionnel passé 1
x
Subjonctif présent
x
x
x
Qu’en déduisez-vous pour la correspondance entre l’emploi des temps et les époques ?
Un même temps peut couvrir plusieurs époques. Il faudra alors avoir recours à la balise, s’il y en a une, ou au contexte pour identifier la bonne époque.
Il faudra donc faire l’effort de replacer le procès dans le temps si l’on veut connaître l’époque où il s’est passé. Il faut éviter de se laisser influencer par le temps lui-même. Nous allons devoir apprendre à reconnaître la situation dans laquelle le procès a lieu, en recherchant les balises temporelles ou tout autre élément capable d’éclairer la situation.
Attention ! Lorsque le temps contredit la balise, c’est la balise qui l’emporte.
2.2.3 Travail de recherche sur le Tpt1
2.2.3.1 Les temps
Le moment où le locuteur parle détermine le repère de la locution (TptLocu).
Pour chacun des exemples, et par rapport à TptLocu, trouvez l’époque à laquelle a lieu le procès dont on parle.
Présent
Passé
Futur
1.
Elle
mange
souvent des fraises.
x
2.
Hier, elle
a mangé
une banane.
x
3.
Demain, elle
mangera
de l’ananas.
x
4.
Tous les jours, la télévision nous
montre
des horreurs.
x
5.
Autrefois, on
mangeait
avec les mains.
x
6.
Demain, nous
irons
voir le panda au zoo.
x
7.
J’aime
la mayonnaise.
x
8.
Les poules
n’ont
pas de dents.
x
9.
Il y a deux jours, il
neigeait
encore.
x
10.
Les SDF
vivent
dans la rue.
x
Qu’est-ce qui nous permet de déterminer l’époque ? Le temps Une balise Les deux
2.2.3.2 Les balises temporelles
Cherchez dans les phases suivantes l’époque correspondante. Dans la colonne « ? », écrivez « T » si c’est le temps, « B » si c’est la balise, 2 si ce sont les deux solutions qui nous indiquent l’époque..
Présent
Passé
Futur
?
1.
Philippe Auguste
remporte
la bataille de Bouvines en 1214.
x
B
2.
Moi, je
prends
l’Eurostar demain pour aller à Londres.
x
B
3.
Autrefois, les gens
mangeaient
avec les mains.
x
2
4.
Si demain il
pleut,
nous resterons à la maison.
x
B
5.
Si jeudi prochain il
neigeait,
nous irions faire du ski.
x
B
6.
Je veux qu’il
vienne
nous voir demain.
x
B
7.
Il n’a pas fait ses devoirs aujourd’hui. Il
sera
malade.
x
B
8.
Il n’a pas voulu que je lui
serve
du pastis hier soir.
x
2
9.
Mireille
vivrait
maintenant dans une maison de retraite.
x
B
10.
La Terre
tourne
autour du Soleil.
x
T
On peut voir que les temps peuvent nous tromper, puisqu’un futur peut se retrouver dans l’époque du présent, un présent dans celle du futur, et que le subjonctif peut se retrouver n’importe où.
Nous allons au cours de nos recherches, apprendre à interpréter les balises et à reconnaître les temps qui posent des problèmes.
2.3 Travail en plenum de confrontation des résultats. Présentation des travaux, discussion et négociation sur la mise au point d’une description commune.
2.4 Phase d’exercices
Exercice n°1. Trouvez l’époque des procès soulignés.
Présent
Passé
Futur
1.
Il
pleuvait
sur Nantes.
x
2.
C’était
la nuit.
x
3.
La jeune fille
rentrait
chez elle.
x
4.
Demain, les syndicats rencontreront le président.
x
5.
Ils
auront déjà vu
la ministre avant.
x
6.
En France, on
part
à la retraite à 62 ans.
x
7.
Les Allemands
prennent
la leur à 67 ans.
x
8.
Qui
vivra,
verra.
x
9.
Le temps,
c’est
de l’argent.
x
10.
Il
avait fait
des bêtises dans sa jeunesse
x
Passons maintenant à l’étude des balises.
Interprétez les balises en trouvant à quelle époque elles renvoient
Présent
Passé
Futur
1.
Lundi prochain.
x
2.
Mardi dernier
x
3.
Vendredi en huit.
x
4.
Dans quinze jours
x
5.
Il y a quinze jours
x
6.
Dans deux semaines
x
7.
Désormais
x
8.
Il y a quelques jours
x
9.
Maintenant
x
10.
Tous les jours
x
x
x
2.5 Test final
2.5.1 Théorie
Complétez en utilisant le terme correspondant. Choisissez les réponses dans la liste suivante :
Après, avant, en même temps, futur, locution, passé, présent, procès.
Le repère de base est le moment de la locution (01). Nous l’appelons TptLocu.
Nous appelons TptProc le moment où a lieu le procès( 02).
Lorsque TptProc est antérieur à TptLocu, l’époque du procès est le passé (03).
Lorsque TptProc est postérieur à TptLocu, l’époque du procès est le futur (04). Lorsque TptProc est simultané à TptLocu, l’époque du procès est le présent (05). Antérieur veut dire« qui a lieu avant (06). Postérieur veut dire« qui a lieu après (07). Simultanéité veut dire « qui a lieu en même temps (08).
2.5.2 Pratique
Interprétez les temps et les balises et trouvez l’époque correspondant aux procès soulignés
Déterminer l’époque par l’érude des balises
Présent
Passé
Futur
1.
J’aime les bananes.
x
2.
Toto aimait beaucoup les marrons.
x
3.
Tu aimeras sûrement mes confitures.
x
4.
Dans quinze jours, tu pars pour les Seychelles.
x
5.
Il y a deux jours, ma sœur s’est mariée.
x
6.
Je viens te voir dans une quinzaine de jours.
x
7.
Le lundi, ma mère faisait de la purée.
x
8.
Le lundi, tu apporteras le journal à Mémé.
x
9.
Les voitures fabriquées le lundi sont moins fiables.
x
10.
Tous les jours, tu le regretteras
x
2.6 Test final
Faites le test final sur l’ordinateur.
Choisissez l’époque du verbe colorié
Passé
Présent
Futur
1. Ce matin, le soleil
s'est levé
à 6h57. [1]
X
2. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il
sera
fatigué. [2]
X
3. Pendant sa jeunesse, il
habitait
à Milan. [3]
x
x
4. Je veux qu'il
vienne
me voir dès demain. [4]
x
5. Il n'a pas écrit à sa mère. Ils
seront
fâchés. [5]
x
6. Dans quinze jours, ma fille
passe
son concours. [6]
x
7. Il y a quinze jours, il
a couru
le cent mètres en 10 secondes. [7]
x
8. La Lune
tourne
autour de la Terre en 28 jours. [8]
x
9. Dans 21 jours, nous
partons
pour Paris. [9]
x
10. Il y a 50 ans, on
était
en mai 68. [10]
x
11. Si tu avais voulu, tu
aurais pu
avoir le poste. [11]
x
12. Elle peut aller voir la D.R.H. demain, si elle
veut
[12]
13. Ma mère
aime
l'opéra. [13]
x
x
14. Ma grand-mère, elle,
préférait
le théâtre. [14]
x
15. S'il devait neiger au mois de juillet, je
serais
très étonné. [15]
16. Si ma tante avait des moustaches, ce
serait
mon oncle. [16]
x
x
17. Dans combien de temps est-ce que tu
penses
venir me voir? [17]
18. Il y a combien de jours que tu
es
à la retraite? [18]
x
19. Il y a combien de temps qu'il
est sorti
de prison ? [19]
x
20. Le directeur
ferait
du judo. [20]
x
x
Remarques
2.7 Faites le bilan
Lisez bien l’appréciation écrite au bas des corrections Comparez vos résultats avec les autres groupes.
2.8 Travail facultatif
Choix d’un groupe responsable de la rédaction d’un rapport écrit, à distribuer à tous les participants. Éventuellement, implémentation sur un site web.
3 Étude du Tpt 2
3.1 Rappel grammatical
Nous connaissons les deux repères de base :
TptLocu
, qui correspond au moment de la locution.
TptProc
, qui correspond au moment où se déroule le procès.
Le Tpt2 s’occupe du lien entre les deux repères de base. En outre, il comprend la translation que l’on fait effectuer, pour rendre le texte plus vivant au Tpt1 vers le passé ou le futur.
3.1.1 Topogramme du Tpt2
Notons :
Tout procès qui se déroule en même temps que TptLocu (TptLocu=TptProc) se replace dans la période du présent.
Tout procès qui se déroule avant TptLocu (TptProc <TptLocu) se replace dans la période du passé.
Tout procès qui se déroule après TptLocu (TptLocu<TptProc) se replace dans la période du futur.
Nous devons maintenant étudier une manipulation stylistique qui nous fait déplacer en translation le TptLocu véritable vers le passé ou vers le futur .
3.1.2 TPTLocu en translation.
Pour rendre un procès plus vivant, lorsqu’il devrait être dans le passé ou dans le futur, on fait glisser artificiellement le TPT marquant le locution, et l’on emploie de ce fait un nouveau TPTLocu’ (= TPTLocu prime), de telle façon que TPTLocu’ et TPTProc deviennent simultanés, ce qui justifie alors l’emploi du présent :
Vers le passé : En 1214, Philippe-Auguste remporte la bataille de Bouvines.
Vers le futur : Dans trois ans, je pars pour l’Australie.
La translation est le plus souvent annoncée par une balise (date, durée etc.) qui permet de positionner le procès dont on parle dans le temps.
En 1214
, translation par précision de la date.
Dans trois ans
: translation par précision de la durée qui nous sépare du procès.
Nous aurons aussi :
Ou encore :
3.1.3 Algorithme d’emploi
Règle sous forme d’algorithme
Prérequis Connaître la conjugaison du présent de l’indicatif
→Trouvez l’époque en comparant le trait pertinent temporel de la locution et celui du procès
Les poules marchent sur 2 pattes.Madame regarde la télévision.Elle a mangé à 17 h.Elle se couchera après le film.→ Utilisez l’algorithme pour trouver les solutions.
Nous aurons donc à nous préoccuper de savoir si lorsque le locuteur parle, il n’effectue pas une translation vers le passé ou vers le futur. Celle-ci se reconnaît à condition que l’on puisse situer TPTProc dans le temps. Des balises temporelles telles que « en 1214 » ou « demain », comparées au temps utilisé, nous aideront à contrôler si le locuteur déplace son discours dans le temps ou non.
3.1.4 Approfondissons le cas du TptLocu et du PptProc
Pour mieux comprendre le problème, nous allons avoir recours à une image.
Pour plus de détails, consultez notre ouvrage {Meunier 2018}
3.1.4.1 Tout est en mouvement
Si l’on réfléchit au temps qui fabrique du présent tout en repoussant le présent actuel dans le passé, le locuteur n’est pas sur un endroit immobile, il est en mouvement . Les événements dont ils parlent sont eux aussi en mouvement.
On utilise souvent la métaphore du locuteur qui regarde passer le fleuve du temps, assis sur la berge. Nous préférons recourir à une autre image : celle du bateau qui avance toujours dans le même sens, et qui ne peut jamais ralentir ni faire demi-tour. Il avance donc régulièrement, sans à coup, à sa vitesse de croisière.
Vous pouvez admirer notre yacht, équipé d’un hélicoptère placé sur la plateforme arrière, qui avance sur l’eau du fleuve, mais plus vite qu’elle. La limite entre le futur et le présent est située à sa proue (l’avant du bateau où se trouve l’étrave qui fend l’eau ), et la limite entre présent et passé à sa poupe, (l’arrière du bateau qui laisse le sillage derrière lui). Le locuteur est à bord et voit défiler l’eau du fleuve et les berges. Il est prisonnier de ce système et s’achemine, transporté par le bateau du temps, vers son destin, lequel est situé dans le futur.
Cette image correspond donc bien au temps qui avance à vitesse constante toujours dans le même sens. Le bateau ne peut pas remonter le temps.
3.1.4.2 Précisons les repères de base dans cette optique
TptLocu correspond au moment que vit le locuteur sur le bateau lorsqu’il produit la locution..
TptProc correspond au moment où le procès que le locuteur évoque a lieu.
3.1.4.3 Peut-on remonter ou descendre le temps plus loin que le moment présent ?
Bien sûr, nous ne pouvons pas réellement remonter le temps ni aller plus vite que lui. Cela n’est possible que par la pensée. Nous utilisons alors notre esprit, dans la métaphore, l’hélicoptère qui peut quitter le bateau et remonter le fleuve-temps ou le redescendre, rejoindre le bateau et même le dépasser, étant plus rapide que lui. Rien ne nous empêche en outre de modifier le passé par la pensée, d’intervenir dans le futur sur les événements. Mais attention ! La réalité, c’est le mouvement du bateau, et nous ne pouvons pas intervenir réellement ni sur le passé, ni sur l’avenir. En revanche, nous pouvons intervenir au moment présent, dans la limite de nos possibilités.
3.1.4.4 Le fil de la locution
Une fois qu’on a remonté le temps, on peut suivre des événements et en parler :
Paul sortait de chez lui. Il reçut une peau de banane sur la tête.
Dès que nous sommes remontés au jour où s’est passée notre histoire, nous faisons demi-tour et nous suivons le fil de la discussion dans le sens du temps, mais à la vitesse qui nous convient.
Le repère TptProc accompagne l’hélicoptère, qui suit lui-même le fil de la locution.
Comme déjà dit, notre bateau est équipé d’un hélicoptère temporel symbolique, qui permet de remonter le temps, alors que le bateau, lui, n’en a pas le droit.
Nous-mêmes, nous sommes comme le bateau : nous ne pouvons pas remonter physiquement le temps. Mais nous pouvons le faire dans notre tête et dans nos discours ou récits par l’hélicoptère temporel, qui nous permet de nous déplacer dans le temps dans tous les sens, en échappant pour un moment au bateau qui nous emporte. Alors que le bateau nous permet de constater les procès présents dont nous avons connaissance, comme le reporteur qui commente en direct un match de football, suivant l’ordre chronologique, et ne pouvant s’échapper que pour peu de temps au flot des procès qui se succèdent.
L’attaquant de l’Olympique de Marseille court vers la surface de réparation, la traverse, tire à ras du sol et envoie le ballon au fond des filets, après avoir driblé le dernier défenseur.
Nous suivons de près l’ordre chronologique, pressés par les procès qui se succèdent rapidement, mais nous arrivons à remonter le temps en précisant « après avoir driblé le dernier défenseur» , déplacement très modeste car le présent en pleine évolution dynamique n’attend pas et nous risquerions de manquer un événement si nous remontions trop loin dans le temps.
En revanche, lorsque nous sommes dans notre hélicoptère temporel, nous survolons des faits passés, donc inertes, et nous pouvons, en remontant et en redescendant le temps, établir des comparaisons, montrer des évolutions parallèles, convergentes ou divergentes, bref, analyser et expliquer des groupes de procès. Évidemment, il faut que nous en ayons connaissance, parce qu’on les a vécus ou parce qu’on nous en a parlé.
Hitler, comme Napoléon en son temps, s’est cassé les dents lors de sa tentative d’envahir la Russie sur les défenseurs russes (soviétiques pour Hitler), soutenus par le général Hiver. Pour l’un, ce fut la Bérézina contre les Russes, pour l’autre, Stalingrad contre les Soviétiques.
Ici, nous établissons un rapprochement par-delà le temps entre deux faits historiques semblables : l’invasion napoléonienne et son homologue hitlérienne.
Dans notre hélicoptère temporel, nous sommes mobiles, nous n’avons pas de limites, et nous pouvons butiner à droite ou à gauche pour rassembler les éléments que nous connaissons de notre analyse.
Lorsque nous explorons le futur ou le passé dans notre engin volant, nous employons les temps du futur, ou ceux du passé selon les cas.
3.1.4.5 Notion de translation
Pour rendre un procès plus vivant, alors qu’il a lieu dans le passé ou qu’il est attendu dans le futur, on fait glisser artificiellement le TPT marquant la locution, et l’on emploie de ce fait un nouveau TPTLocu’ (= TPTLocu prime), de telle façon que TPTLocu’ et TPTProc deviennent simultanés, ce qui justifie alors l’emploi du présent :
Vers le passé : En 1214, Philippe-Auguste remporte la bataille de Bouvines.
Vers le futur : Dans trois ans, je pars pour l’Australie.
La translation est le plus souvent annoncée par une balise (date, durée etc.) qui permet de positionner le procès dont on parle dans le temps.
En 1214
, translation par précision de la date.
Dans trois ans
: translation par précision de la durée qui nous sépare du procès.
Nous aurons aussi :
Ou encore :
3.1.4.6 Rapports entre temps réel et temps grammaticaux.
Le temps grammatical fait partie de l’attirail qui nous permet de relater par oral ou par écrit les divers procès qui nous intéressent.
Les temps grammaticaux nous permettent de parler en nous déplaçant, dans notre tête, dans tous les sens, à notre convenance. Si l’on quitte le bateau dans le sens de la marche, par l’avant, nous nous déplaçons dans le futur, et nous imaginerons un avenir supposé, qui ne sera pas forcément le nôtre.
Si on le quitte dans le sens inverse, par l’arrière, on explorera le passé qui, lui, a vraiment eu lieu, et l’on retrouvera tous les procès qui se sont déroulés, placés le long de l’axe du temps, à l’endroit correspondant au moment où ils ont eu lieu.
Voici, en gros, comment s’articulent les modes et temps principaux :
Les trois périodes correspondent donc :
Pour le passé, à un départ vers l’avant.
Pour le présent, à un voyage dans le bateau, sans hélicoptère, au fil du temps.
Pour le passé, à un départ vers l’arrière.
Les temps simples du passé de l’indicatif ou du futuro-conditionnel permettent de replacer le procès dans le temps.
Les temps composés replacent un procès par rapport à un autre procès. Le temps simple sert de point de fixation. Le temps composé replace le procès par rapport à ce point de fixation vers le passé et exprime l’antériorité.
Lorsque le procès se situe chronologiquement après ce point, on emploie un futur, un conditionnel ou un subjonctif : vu du point de fixation, le procès est dans le futur. Sa réalisation n’est pas certaine. Mais nous, qui remontons le temps, nous savons que tous ces procès que nous survolons ont eu lieu, et dans quel ordre, ce que les contemporains de l’époque ne pouvaient pas savoir.
3.1.4.7 Remarques sur le conflit entre balise et temps du procès
Nous avons déjà eu l’occasion de voir qu’il pouvait y avoir conflit entre la période désignée par la balise temporelle et celle désignée par le temps grammatical du procès. Nous allons voir comment se comporter dans de tels cas.
3.1.4.7.1 En cas de conflit
Raisonnons sur deux exemples :
Hier, Paul est allé au cinéma voir Amélie Poulain. (1)
Il y a une semaine, je rencontre Paul au cinéma. (2)
Dans l’exemple (1), la balise hier se réfère au passé. Le procès aller au cinéma est au passé composé (ici, remplaçant du passé simple) et se réfère également au passé. Les deux éléments sont donc concordants. Le procès a vraiment eu lieu hier, dans le passé. Il n’y a donc pas de problème.
Dans l’exemple (2), en revanche, il y a conflit, car la balise il y a une semaine se réfère au passé, alors que le procès je rencontre, est au présent, et se réfère donc au moment présent. Que faire ?
Règle 1
Eh bien, lorsqu’il y a conflit de période entre la balise temporelle et le temps grammatical du procès, c’est la balise qui a priorité. Le temps grammatical utilisé est à prendre comme moyen stylistique pour exprimer une nuance particulière.
C’est le cas pour l’exemple n° 2.
3.1.4.7.2 Lorsque la balise est équivoque
Voici maintenant trois exemples supplémentaires concernant le cas où la balise est équivoque, c’est-à-dire qu’elle peut avoir plusieurs signification entraînant des interprétations différentes.
Dans les trois cas, nous avons la même balise temporelle (du 1erjuillet au 31 août). Cependant, dans l’exemple 1, on nous dit que cette phrase se rapporte à l’année actuelle 2012, donc, au moment présent, ce que l’on voit au temps utilisé : le présent. Dans le cas n°2, la phrase se réfère à l’année passée 2012. Ceci se voit au temps utilisé, l’imparfait, qui est un temps du passé. Enfin, le cas n° 3 se rapporte à l‘année 2034, qui se situe dans le futur, ce qui concorde avec le temps utilisé, le futur simple.
Notons que la balise du 1er juillet au 31 août est incapable de nous dire quelle période est concernée. Dans ce cas, c’est le temps qui assure la fonction permettant de replacer le procès dans son époque.
Règle 2
Lorsque la balise temporelle est équivoque, c’est-à-dire qu’elle peut avoir plusieurs significations et ne peut donc pas nous aider à reconnaître l’époque, c’est le temps qui a priorité. La balise est ainsi à comprendre dans le sens du verbe.
Nous allons démontrer le fonctionnement balises / temps dans un algorithme. Il suffit de prendre chaque exemple et de suivre l’algorithme.
Les solutions se trouvent rassemblées sous l’algorithme. Les « oui » et « non » correspondent aux réponses à donner aux questions qui nous sont posées.
Dispensable de commencer en haut, et de suivre le chemin rigoureusement. Les sauts sont interdits.
Ex : Hier, Paul est allé voir Amélie Poulain.
3.1.4.7.3 Règle générale
Résumons le problème dans un algorithme.