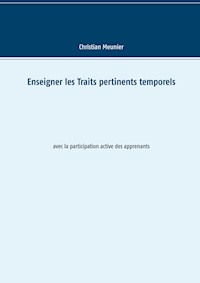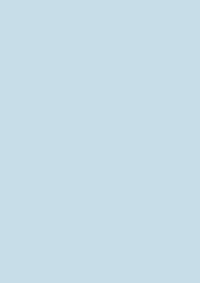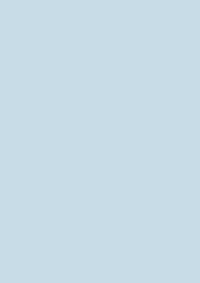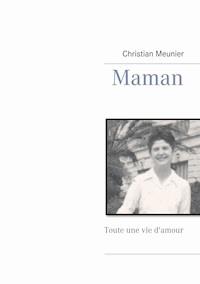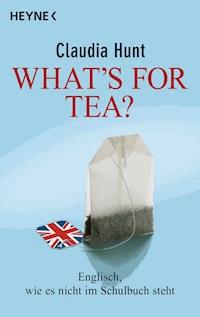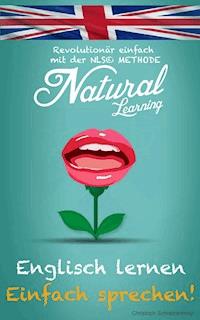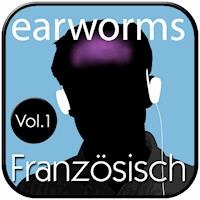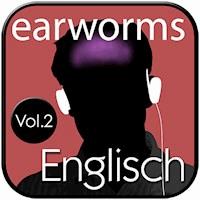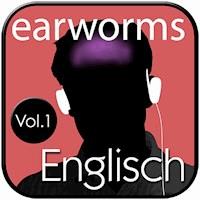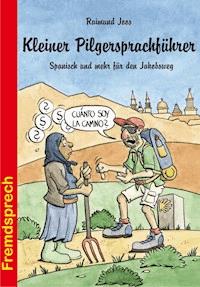Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fremdsprachen
- Sprache: Französisch
L'imparfait et le passé simple sont des temps concurrents qui se partagent l'époque du passé.I ls sont en distribution complémentaire, chacun assurant une partie des fonctions . Cela fait des siècles que l'on enseigne leur emploi. Pourtant, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, car les règles sont fausses. Comme l'emploi des temps est en grande partie géré par la grammaire intuitive de chacun, le francophone n'a pas besoin d'en connaître les règles. S'appuyant sur eGrammaire et sur la Grammaire participative et sur un site web, cet ouvrage s'adresse aux enseignants, leur offrant des règles vérifées par l'usage . Il encourage le travail des apprenants en groupes pour les amener à comprendre et à découvrir les règles. Un cahier de l'apprenant, téléchargeable sur Internet, canalise leurs réflexions. Le site fournit aussi les exercices auto-corrigés. Christian Meunier est né à Paris en 1947. Après des études à l'université d'Aix-Marseille en allemand, phonétique et linguistique générale, il a enseigné le F.L.E., au Tchad ( 1972-1973), en RFA et au Centre des Langues de l'Université libre de Berlin (1975-2006). Il a exercé la profession d'enseignant pendant 36 ans, et il a été responsable informatique de son institut pendant 25 ans. . Dans le cadre du projet européen LESCOnet ,qu'il a dirigé, il a participé à la création d'un site d'apprentissage du français (lesconet.eu). Il est l'auteur de nombreux livres accompagnés d'un site : eGrammaire, Grammaire participative, Phonétique corrective, Orthographe et Conception du Temps en français, anglais et allemand .Il est aussi l'auteur de plusieurs logiciels d'ELAO (enseignement des langues assisté par ordinateur) et de sites d'apprentissage du F.L.E.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autres ouvrages du même auteur :
→ eGrammaire BoD 2014 ISBN : 978-2-322-08398-5
→ Grammaire participative BoD 2015 ISBN : 2015 978-2-322-08403-6
→ Petit guide de la Phonétique corrective BoD ISBN : 978-2-322-08399-2
Avec Gérard Meunier
→ OrthoFle Le guide du professeur d’orthographe Bookelis 2017 ISBN : 9791094113080
Avec Jean Piètre-Cambacédes
→ La Conception du temps en français, anglais, allemand Bookelis 2017 ISBN : 9791094113097
Table des matières
Avant Propos
Emploi des temps simples du passé
2.1 Les mauvaises explications traditionnelles
2.1.1 Les règles traditionnelles
2.1.2 Où est le problème ?
2.1.3 Comment cela est-il possible ?
2.1.4 D’où viennent ces mauvaises règles
2.1.5 Les temps et la pragmatique.
2.2 La règle de base
2.2.1 Action A et Action B
2.2.2 A est finie lorsque B commence.
2.2.3 A n’est pas finie lorsque B commence.
2.2.4 Et l’action B ?
2.3 Ordre chronologique et ordre du texte.
2.3.1 L’ordre du texte est aussi l’ordre chronologique
2.3.2 L’ordre du texte n’est pas l’ordre chronologique
2.3.3 Imparfait / passé simple et flexibilité.
2.3.4 Réfléchissons sur un exemple
2.3.5 Comment l’auditeur, ou le lecteur, rétablit-il le véritable ordre chronologique ?
2.3.6 Que faire lorsqu’une action est la dernière ?
2.4 Actions individuelles et trains d’actions
2.4.1 Actions individuelles
2.4.2 Trains d’actions
2.4.3 Récapitulons les règles en tenant compte des actions individuelles et des trains
2.5 Autrefois / Aujourd’hui
2.6 Tout dépend du verbe
2.6.1 Attention au sens des verbes
2.6.2 Les verbes bascules
2.6.3 Sens particulier du verbe devoir suivi de l’infinitif
2.7 Tout dépend de la conjonction (ou de la préposition)
2.7.1 Et (puis)
2.7.2 Depuis / cela faisait ...que / il y avait ... que
2.7.3 Quand / Lorsque
2.7.4 Quand / lorsque et l'antériorité
2.7.5 Chaque fois que/ toutes les fois que
2.7.6 Pendant que/ tandis que / alors que
2.7.7 comme
2.8 Raisons contextuelles
2.8.1 Notions de contexte
2.9 Notions de déroulement
2.9.1 Notions de non-dit
2.9.2 Ne pas savoir / croire introduisant une excuse
2.10 Emplois stylistiques
2.11 Emplois grammaticaux de l’imparfait et du passé composé.
Les temps simples du passé pour l’enseignant
3.1 Les prérequis
3.1.1 La règle de base
3.1.2 La règle de base générale
3.1.3 Règle de base générale
3.2 Interpréter les cas selon la règle de base
3.2.1 Autrefois / aujourd’hui
3.2.2 Quand tout dépend du verbe
3.2.3 Quand tout dépend de la conjonction ou de la préposition
3.2.4 Raisons contextuelles
3.3 Emploi stylistique
3.4 Emploi grammatical
3.5 Boîte à outil du professeur
Pour faire les exercices
1. Avant-Propos
L’imparfait et le passé simple (remplacé par le passé composé à l’oral) sont des temps concurrents, qui se partagent le champ du passé. Ils sont en distribution complémentaire, chacun assurant une partie des fonctions, et excluant l’autre de son domaine.
Il est donc nécessaire de voir comment fonctionne le binôme.
Cela fait des siècles que l’on explique l’emploi des temps du passé. Comme les Français se servent de leur grammaire intuitive, celle que l’on acquiert au contact de ses parents et de ses proches avant de commencer tout apprentissage conscient de la grammaire explicite à l’école, ils n’ont aucun besoin de règles explicites pour choisir le bon temps. Les règles utilisées par les enseignants sont malheureusement douteuses, et ne parviennent pas à expliquer comment se répartissent les deux temps simples du passé. On s’en rend compte lorsque l’on tente d’enseigner ce problème à des étrangers qui, eux, ne possèdent pas cette grammaire implicite et ont absolument besoin de règles explicites pour bien comprendre comment fonctionne le système.
Cet ouvrage s’adresse aux enseignants et futurs enseignants de FLE et, indirectement, à leurs apprenants.
L’ouvrage se compose de deux grandes parties.
→ Une partie explicative de l’emploi en concurrence du passé simple et de l’imparfait.
→ Une partie pédagogique destinée aux enseignants, qui présente le problème, propose une démarche et tout le matériel pédagogique nécessaire au travail en groupe, individuel ou tous ensemble dans la classe. Ce matériel comprend des explications, des pistes de réflexion et des exercices corrigés. L’enseignant peut télécharger sur un site dédié et distribuer pour chaque problème un « cahier de l’apprenant », qui lui permettra de diriger le travail de ses apprenants, recherche des règles dans des activités canalisées, exercices. On trouvera sur le site également les exercices autocorrigés.
Le système proposé, qui s’appuie sur le contenu du livre eGrammaire, fournit des règles cohérentes, développées à l’Université libre de Berlin (Freie Universität Berlin) et expérimentées avec de bons résultats pendant plusieurs dizaines d’années dans des cours donnés à des élèves professeurs et à des étudiants préparant un séjour d’études dans une université francophone.
La partie pédagogique s’appuie sur le livre Grammaire participative, dont la philosophie est de faire participer les apprenants à leur propre apprentissage. L’élève comprend mieux et avec plus de plaisir ce qu’il découvre par lui-même, en groupes, seul ou dans la classe réunie. Le rôle du professeur est de diriger les réflexions, de canaliser les énergies, de contrôler et de préciser l’apprentissage.
Vous trouverez :
Pp → à → une « boîte à outils du professeur » dont vous pourrez vous servir en cours pour expliquer les différents problèmes posés par l’emploi différencié du passé simple et de l’imparfait.
P. → : comment trouver les exercices autocorrigés sur Internet.
Théorie
2. Emploi des temps simples du passé
Avant de présenter les règles telles que nous les concevons, nous allons revenir sur la façon traditionnelle d’expliquer le fonctionnement des temps simples du passé, pour mettre un terme à son emploi.
Ensuite, nous verrons comment les deux temps simples du passé se répartissent les tâches, et comment ils s’emploient :
dans les indépendantes,
dans les subordonnées de temps,
Nous fournirons une analyse, et nous encouragerons à de nouveaux automatismes, fondés sur cette analyse.
2.1 Les mauvaises explications traditionnelles
Bien sûr, tout le monde connaît les règles de l'emploi de l'imparfait et du passé simple. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'habitude, d'état, de description, voire d'action longue. Nous allons donc commencer par discuter de ces règles que nous qualifierons de traditionnelles.
2.1.1 Les règles traditionnelles
→ Commençons par l'habitude
Lorsqu'une action exprime une habitude, on la met à l'imparfait.
M. Dupont fumait 50 cigarettes par jour. Il mourut d'un cancer au poumon.
Mme Durand fuma toute sa vie 50 cigarettes par jour.
Voilà deux habitudes semblables, l’une à l’imparfait, l’autre au passé simple.
→ L'état:
Lorsqu'un verbe décrit un état, on le met à l'imparfait.
Charlemagne était un grand empereur : il étendit son autorité sur toute l'Europe de l'Ouest.
Philippe Auguste fut un grand roi. Il remporta la bataille de Bouvines, scellant ainsi l'unité nationale.
Voilà maintenant deux états, le premier à l’imparfait, le second au passé simple.
→ La description :
Lorsqu'on décrit, on emploie l'imparfait.
Pierre portait des moustaches, et avait la raie au milieu.
Dès qu'il eut l'âge d'homme, et jusqu'à sa mort, Paul porta des moustaches, et eut la raie au milieu.
Voilà deux descriptions très semblables, l’une à l’imparfait, l’autre au passé simple. Je vois bien que vous vous impatientez. Allez, encore un petit effort.
→ Actions longues, actions brèves.
Une action longue se met à l'imparfait, alors qu'une action brève se met au passé simple.
La touriste nageait depuis dix secondes lorsqu’elle fut dévorée par un requin.
Cette planète mit plusieurs millions d'années pour se former.
Alors là, c’est le pompon ! Voilà une action brève à l’imparfait, et une extrêmement longue au passé simple !
Je vois bien que le moment est venu de vous fournir des explications, avant que vous ne jetiez cette grammaire par la fenêtre.
Toutes les règles que j'ai eu le plaisir de vous fournir se retrouvent, quelquefois au mot près, dans les livres de grammaire traditionnels. Mais comme j'ai l'esprit de contradiction, je me suis permis de donner pour chaque règle deux exemples, l'un confirmant cette règle, l'autre l'infirmant. Et pour brouiller les pistes, je me suis permis de mettre l'action brève à l'imparfait, alors que vous trouverez la longue au passé simple, en parfaite contradiction avec la règle connue que je vous ai donnée.
Vous vous dites, évidemment, que ces exemples sont faux. Eh bien vous avez tort. Tous ces exemples sont corrects. Ce sont les règles qui sont douteuses.
En effet :
on trouve des habitudes à l'imparfait, mais aussi au passé simple.
il y a des états à l'imparfait, mais d'autres, au passé simple.
il y a des descriptions à l'imparfait, d'autres au passé simple.
il y a au passé simple des actions brèves, mais aussi des longues,
et il y a des actions longues à l'imparfait, d'autres enfin au passé simple.
Ainsi, il faut bien admettre que les règles que nous avons énoncées ne nous serviront à rien, puisqu'il est toujours possible de trouver un exemple pour les confirmer, mais aussi un autre pour les infirmer. Pour prendre un exemple simple, admettons que vous donniez à un martien de passage sur la terre une règle pour savoir si un humain est une femme ou un homme.
Règle n° 1:
Un humain qui a les cheveux courts est un homme, alors que dans le cas contraire, c'est une femme.
Cette règle est exacte dans de nombreux cas. Mais dans le cas de Jeanne d'Arc, qui avait les cheveux courts, ou dans celui de Jésus, qui avait les cheveux longs, cette règle est inexacte.
Vous pouvez vous creuser la tête pour trouver une règle plus juste :
Règle n° 2
Un humain qui a les cheveux courts est le plus souvent un homme, mais peut parfois être une femme, alors qu'un humain qui a les cheveux longs est le plus souvent une femme, même si, parfois, ce peut être un homme.
Cette règle est évidemment exacte. Vous, qui savez reconnaître une femme d'un homme grâce à une autre méthode, vous pourrez certainement prouver que cette règle est juste. Mais le pauvre martien, qui ne connaît pas "la petite différence entre hommes et femmes", va se servir de votre règle pour savoir s'il a affaire à une femme ou à un homme. Vous pouvez vous douter qu'il aura des problèmes.
2.1.2 Où est le problème ?
Nous venons de mettre le doigt sur le problème. Le francophone est semblable au terrien : il a d'autres critères pour choisir entre le passé simple et l'imparfait. Le non-francophone, lui, se retrouve dans le rôle du martien : il compte sur la règle pour résoudre le problème.
2.1.3 Comment cela est-il possible ?
Le francophone apprend à faire la différence entre les deux temps au fur et à mesure qu'il apprend sa langue maternelle. Comme il est constamment corrigé par ses parents, ses frères, ses sœurs, et ses professeurs, il finit par acquérir de façon inconsciente une expérience qui lui permettra de résoudre le problème chaque fois qu'il se posera. Avant même d'apprendre à écrire, l'enfant francophone fait la différence entre l'imparfait et le passé composé dans le cadre de la grammaire implicite, celle que l’on apprend sans règle. Ce n'est que vers l'âge de 10 à 12 ans qu'il emploiera le passé simple, qu’il aura appris à l’école.
C’est bien plus tard, en classe de quatrième, alors que les élèves ont 13 à 14 ans, que le programme de grammaire apporte (enfin) l'explication qui manquait sur l'emploi de ces temps. Comme les jeunes francophones n'ont jusqu'alors jamais eu besoin de cette explication (habitude, état, etc.), ils sont ravis d'apprendre comment le système fonctionne. Cependant, ils continueront à appliquer la méthode inconsciente qui était la leur jusqu'à présent, méthode qui, elle, fonctionne parfaitement.
L'élève francophone n'a donc pas besoin de ces règles pour choisir entre le passé simple et l'imparfait.
Le germanophone, lui, apprend à l'école le présent. Un an après, il apprend le passé composé, et ne fera la connaissance de l'imparfait que plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard.
Ceci représente le premier problème, car le germanophone apprend à parler du passé avec un seul temps, le passé composé. Or, dans sa langue maternelle, il fait la même chose. Il ne dispose que d'un seul temps pour couvrir les domaines de l'imparfait/passé simple. L'allemand a bien deux temps, le prétérit et le parfait :
Wir gingen ins Kino.
Wir sind ins Kino gegangen.
Mais la différence entre les deux n'est qu'une différence de style, pas de temps. Ainsi, l'habitude allemande, qui est correcte en allemand, est transférée au français, où elle ne fonctionne pas.
Contrairement au francophone, qui a appris, dès le début, à manipuler deux temps complémentaires, et qui a besoin de faire une différence entre eux, le germanophone ne ressent pas du tout ce besoin. Il emploie donc indifféremment l'un ou l'autre, et produit ainsi des phrases dont il ne contrôle pas la signification.
* Il mourut et cria. (Impossible de crier une fois qu’on est mort)
* Quand il a fait beau, il allait se baigner. (On a l’impression qu’il se met à faire beau quand il va se baigner, comme si la météorologie attendait sa sortie.)
Pour remédier à ce problème, l'enseignant va lui apprendre les fameuses règles dont nous venons de parler plus haut. Comme elles sont inexactes, le pauvre élève a toutes les chances de se tromper.
2.1.4 D’où viennent ces mauvaises règles
Il faudrait donc apprendre aux non-francophones des règles exactes, afin qu'ils aient une chance de faire juste. Et le problème est donc de faire naître chez le non-francophone cette vision des choses, propre au francophone, qui va lui permettre d'avoir le besoin, même s'il est artificiel, de faire une différence, comme le fait un francophone, entre ces deux temps.
Avant de passer à une nouvelle explication de la différence entre ces deux temps, nous allons quand-même nous poser quelques questions sur ces règles traditionnelles, et en particulier, celle de savoir si ceux qui les ont découvertes, et les générations de professeurs et d'élèves qui les ont utilisées, et même qui les utilisent encore, étaient des ignorants, ou des gens myopes.
Les règles traditionnelles sont-elles idiotes ?
Je me doute bien que vous vous demandez si je ne suis pas un petit peu trop vaniteux. Vous pensez sûrement que tant de gens n'ont pas pu se tromper, et que l'humanité francophone ne m'attendait pas pour être sauvée. Bien entendu, il faut rester modeste. En effet, les professeurs francophones qui enseignaient ses règles n'avaient pas de problèmes, puisque ni eux, ni leurs élèves n'en avaient besoin.
Les enseignants allemands qui expliquaient ces règles à leurs élèves allemands n'avaient pas non plus de problèmes, puisque les élèves et les enseignants appliquaient les mêmes règles, sans remarquer leurs fautes.
En ce qui me concerne, j'ai enseigné ces règles à plusieurs générations d'élèves et d'étudiants. Ceux-ci les ont donc appliquées. Malheureusement, le résultat m'est apparu bien souvent comme décevant. Cela donnait à peu près la discussion suivante:
Étudiante : «M. Dupont fumait toute sa vie 100 cigarettes par jour.
Prof : — Ah, non ! La bonne réponse est : fuma.
Étudiante : Mais pourquoi, puisque c’est une habitude ? »
Voilà une règle bien gênante, puisqu’elle contredit mon sens de la langue, qui, lui, m’amène à employer le passé simple.
Bien entendu, c'est le sens de la langue qui a priorité ! Alors, que vais-je expliquer à cette étudiante ?
« C'est autre chose... » ou pire encore : « Tu verras, quand tu seras plus grande ! »
« Non ! C’est une autre sorte d’habitude. »
Heureusement, l'étudiante a accepté mon explication, qui n’en était pourtant pas une. Suis-je un mauvais enseignant, incapable d’expliquer un fait grammatical de la langue que j’enseigne ?
Si j'ai l'esprit un peu critique, je ne pourrai pas me contenter de cette explication. Il va falloir en trouver une autre, si possible, une qui fonctionne.
Mais même si l'on décide de trouver d'autres règles, on peut bien se demander sur quoi ces règles traditionnelles se fondent. En fait, elles reposent sur un fond de vérité. Pour bien me faire comprendre, je vais vous raconter une petite histoire.
Je vous sens frémir d'horreur. Il est évident que M. Duchmol est encore vivant. La preuve, c'est qu'il est là, assis sur son siège, et qu'il a l'air en bonne santé. Mais le fonctionnaire n'a pas tort ! Ces chiffres traînent dans tous les livres de statistiques sur l'espérance de vie des Français !
Alors, qui a raison ? Tous les deux ! Sauf que, même si, selon les statistiques, M. Duchmol devrait être mort, il n'en est pas moins réellement vivant. Et l'essentiel, c'est qu'il soit réellement vivant.
Le fonctionnaire applique des règles statistiques. Ces règles sont valables pour une moyenne d'individus, mais pas pour un individu en particulier. Ce n'est pas parce que les hommes vivent en moyenne 72 ans que M. Durand, Pierre et Paul atteindront cet âge !
La preuve :
M. Dupont est mort de rire à l'âge de 122 ans,
Paul est mort dans un accident de moto à 93 ans,
et Pierre est mort étouffé par sa sucette à l'âge d'un an.
Les règles de l'imparfait / passé simple ont une valeur statistique, même si l'on ne les a pas chiffrées exactement. Ainsi, étant donné que leur durée augmente leurs chances qu’une nouvelle action démarre avant leur fin, une habitude, un état, une description ou une action longue ont plus de chances de se retrouver à l'imparfait qu'une action brève.
Mais ce n’est pas une obligation car lorsque vous devez choisir, dans un cas précis, le temps correct, ces règles ne serviront à rien :
Ex : Toute sa vie, et du matin au soir, Paul mit les doigts dans son nez.
Même si Paul a une (mauvaise) habitude, et même si une habitude a plus de chances de se mettre à l'imparfait, c'est le passé simple qu'il faudra employer dans ce cas-ci.
J'espère que vous avez compris, à présent, pourquoi ces règles, qui ont un sens d'un point de vue statistique, ne servent à rien pour choisir le temps qui convient. Alors, quelles sont les vraies règles, celles que l'on peut utiliser ?
Eh bien, ce n'est pas si facile à expliquer, car ces règles, en fait, n'ont rien de grammatical. Même si on en parle en grammaire, elles ne relèvent pas de ce domaine, mais bien plutôt de la pragmatique.
2.1.5 Les temps et la pragmatique.
Laissez-moi vous poser une question indiscrète. Que voyez-vous sur l’image ci-contre ??
Les Français y verront un cochon, certains Allemands, un porte-bonheur (Schwein haben), un chien y verra une collection de côtelettes, certaines femmes, le symbole des hommes (les hommes sont tous des cochons), et une truie (une dame cochon) un jeune playboy. En fait, tout est question de point de vue. Chacun a sa façon de voir ce qui l'entoure. Ceci est également le cas pour l'emploi des temps. Les Français, qui ont appris à décrire ce qui les entoure en français, ont une façon commune de voir le temps passé, façon qu'ils expriment par l'emploi concurrent de l'imparfait et du passé simple. Les Allemands ont une autre façon de voir le passé. Cette façon est bonne lorsqu'ils parlent allemand, mais inadaptée lorsqu'ils parlent français. Autrement dit, quand vous parlez français, vous devez changer de peau, ou en tout cas de cerveau, et vous transformer en Français, au moins pour l'emploi des temps du passé.
La façon de voir d'une communauté linguistique qui s'exprime dans sa langue relève de la pragmatique, qui sera pour nous le domaine de la linguistique qui s'occupe de la façon de voir les choses et de les décrire du locuteur, conforme à la vision que sa langue lui donne de la réalité qui l'entoure. Nous allons à présent essayer de cerner cette façon de voir.
2.2 La règle de base
2.2.1 Action A et Action B
Lorsque l’on parle de deux actions, l’une A, celle qui commence la première, et l’autre B, celle qui commence la deuxième, ce qui intéresse les Français, c’est de savoir si, lorsque commence l’action B, l’action A est finie ou non.
2.2.2 A est finie lorsque B commence.
Sur l’image A, Jonas est dans son bain. Le téléphone est tranquille. Sur l’image B, Jonas a disparu. L’action A de se baigner, qui commence la première, est donc terminée lorsque l’action B, le téléphone sonne, commence.
Nous écrirons donc :
Jonas se baigna. Le téléphone (sonna).
Règle 1.
Lorsque l’action A, celle qui commence la première, est terminée au moment où l’action B commence, cette action A se met au passé simple (au passé composé à l’oral ou dans un style moyen).
L’action A, celle qui commence la première, est terminée avant que la seconde ne commence. Quand le téléphone se met à sonner, Jonas a fini de se baigner. Si l’on applique la règle, on mettra le verbe au passé simple : Jonas se baigna.