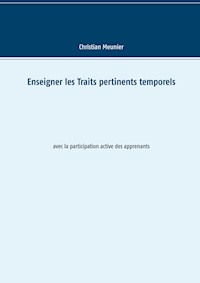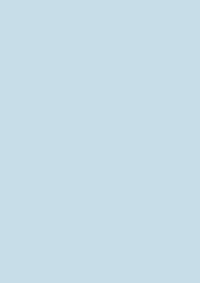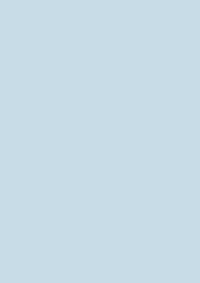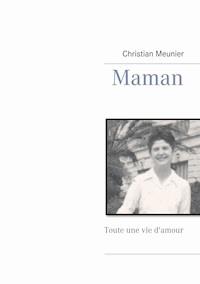Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'oral est l'enfant pauvre de la grammaire. Il suffit de consulter la plupart des ouvrages de grammaire, les plus connus pour constater que la phonétique, et en particulier sa composante l'intonation, joue un rôle particulièrement modeste. Cet ouvrage a pour but principal de montrer l'importance de la prosodie, et en particulier de l'intonation, pour l'enseignement et la langue française. Après une étude de la prosodie, nous verrons l'influence qu'elle exerce sur la grammaire, tant à l'oral qu'à l'écrit. Vous trouverez les exemples enregistrés sur le site www.la-grammaire-du-fle.com à la rubrique "outils" de la Phonétique corrective.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
8. Table des matières
Avant-Propos
Du phonème au texte
2.1 Les phonèmes
2.1.1 Le continuum oral
2.1.2 Les voyelles
Les consonnes
2.1.3 L’API
2.2 Les syllabes
2.2.1 Le principe des syllabes
2.2.2 Les différents types de syllabes :
2.2.2.1 Syllabes du type V
2.2.2.2 Syllabes du type CV
2.2.2.3 Syllabes du type VC
2.2.2.4 Syllabes du type VCC
2.2.2.5 Syllabes du type CVC
2.2.2.6 Syllabes du type CCV
2.2.2.7 Autres types de syllabes (exemples)
2.2.3 Le découpage en syllabes
2.2.4 Principe de translation des consonnes
2.2.4.1 L’élision grammaticale du [ ə] ou du [a]
2.2.4.1.1 A l’oral :
2.2.4.1.2 La langue écrite nous propose l’utilisation de l’apostrophe
2.2.4.2 On peut être amené à élider soi-même des [ə] dans certains cas
2.2.5 Les liaisons
2.2.6 Les liaisons à valeur syntaxique
2.2.6.1 Singulier/pluriel
2.2.6.2 Masculin / féminin [-/t]
2.2.6.3 Genre et nombre
2.2.6.4 Personne et nombre
2.2.7 Les liaisons à glissando
2.2.8 Les nombres
2.2.8.1 Un / une
2.2.8.2 Deux, trois (liaison devant voyelle ou h muet)
2.2.8.3 Quatre (liaison devant voyelle ou h muet)
2.2.8.4 Cinq, sept, huit, dix-sept, dix-huit
2.2.8.5 Neuf, dix-neuf (neuf étudiants), (dix) neuf ans)
2.2.8.6 Six, dix
2.2.8.7 Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize (quatre-vingt- +/ soixante-)
2.2.8.8 Vingt
2.2.8.9 Trente, quarante, cinquante, soixante
2.2.8.10 soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix
2.2.8.11 Mil / Mille
2.2.9 Adjectifs masculins devant voyelle
2.3 Les monèmes
2.4 Les mots phoniques
2.5 Les phrases
2.6 Les textes
L’intonation
3.1 Petit historique d’une étude sur l’intonation
3.2 Les paramètres de base
3.2.1 La fréquence du F
0
→ La hauteur
3.2.1.1 Pour trouver le niveau 2 :
3.2.1.2 Pour trouver les autres niveaux :
3.2.1.2.1 Le niveau 3 :
3.2.1.2.2 Le niveau 1 :
3.2.1.2.3 Le niveau 4 :
3.2.1.2.4 Le niveau 5 :
3.2.1.3 Explications sur la représentation des niveaux
3.2.2 L’intensité du F
0
→ L’accent
3.2.3 La durée des phonèmes / des syllabes
3.2.4 La régularité syllabique du français
3.2.5 Notre système graphique pour représenter l’intonation
3.3 L’intonation non-marquée
3.3.1 Intonation non-marquée et forme affirmative
3.3.1.1 Les formes de base
3.3.1.2 Le mot phonique du sujet
3.3.1.3 Le mot phonique du verbe
3.3.1.4 Les compléments circonstanciels
3.3.1.5 Salade de compléments
3.3.1.6 Les parenthèses basses
3.3.1.7 Récapitulatif de l’affirmative
3.3.1.7.1 Que l’intonation était produite par l’activité des cordes vocales
3.3.1.7.2 Que l’affirmative correspondait aux caractéristiques suivantes :
3.3.2 Intonation et forme interrogative / interro-négative
3.3.2.1 Comme une interrogative totale si elle porte sur la totalité d’une information, juste pour savoir si elle est exacte ou non :
3.3.2.2 Comme une interrogative partielle si elle porte sur une partie d’une information, juste pour en savoir plus sur cette partie :
3.3.2.3 L’interrogative sans mot interrogatif
3.3.2.4 L’interrogative avec mot interrogatif
3.3.2.4.1 Au début
3.3.2.4.2 A la fin
3.3.2.5 La parenthèse haute
3.4 L’intonation marquée
3.4.1 Principe de l’intonation marquée
3.4.2 La mise en doute
3.4.3 L’évidence
3.4.4 La surprise / indignation
3.4.5 L’accent d’insistance
L’influence de la prosodie sur la grammaire
4.1 Rôle de l’intonation à l’oral et à l’écrit
4.1.1 Influence sur l’oral
4.1.2 Influence sur l’écrit
4.2 L’affirmative
4.2.1 Les mots phoniques
4.2.1.1 Le découpage en mots phoniques
4.2.1.2 Les syllabes dans le mot phonique
4.2.1.3 Élision du [ ə ] (et du [ a ] dans les déterminants
4.2.1.4 Élision du i dans « si »
4.2.1.5 Les déplacements de consonnes
4.2.1.5.1
A caractère technique
4.2.1.5.2
A caractère grammatical
4.2.1.5.3 Les liaisons spéciales
4.2.1.5.4 Les adjectifs à double version au masculin / singulier
4.3 L’interrogative
4.3.1 L’interrogative orale et l’interrogative écrite
4.3.2 Les deux types d’interrogation : totale / partielle
4.3.2.1 L’interrogation totale
4.3.2.2 L’interrogation partielle
4.3.2.3 La répartition des mots phoniques
4.3.2.3.1 L’interrogative totale
4.3.2.3.2 L’interrogative partielle
4.3.2.3.3 La parenthèse haute
4.3.3 Les problèmes de pronoms
4.3.4 Quelques variantes courantes
4.3.4.1 Voix et autorité
4.3.4.2 Les variantes selon les minorités
4.3.4.3 Dans l’interrogation, atteindre le niveau 4 est nécessaire et suffisant
4.3.4.4 Le cas de « est-ce-que »
4.3.4.5 Réflexions sur l’interrogation par l’intonation
4.4 Le discours rapporté : discours indirect
4.4.1 Le discours indirect à l’affirmative :
4.4.2 Le discours indirect à l’interrogative
4.4.2.1 Est-ce que
4.4.2.2 Le bon choix des expressions de temps
4.4.2.3 Les conjonctions et pronoms interrogatifs
4.4.2.3.1 Rappel
4.4.2.3.2 Discours indirect
4.4.3 L’intonation des deux formes de discours
4.4.3.1 Affirmative
4.4.3.2 Interrogative
4.5 La mise en relief
4.5.1 L’accent d’insistance
4.5.2
La mise en relief par
c’est que / c’est qui
4.5.2.1 Mise en relief et pronoms personnels
4.5.2.2 Lorsque l’antécédent est
ce, rien, quelque chose
4.5.2.3 Mise en relief et simple présentation
4.6 Les déterminants
4.6.1 Articles
4.6.2 Démonstratifs
4.6.3 Possessifs
4.7 Les pronoms personnels
4.7.1 Pronoms accentués
4.7.2 Impératif et pronoms
4.8 Problèmes de relatives
4.8.1 Relative et ponctuation
4.8.1.1 Raisonnons sur l’écrit
4.8.1.2 Raisonnons maintenant sur l’oral
4.8.2 Lorsque l’antécédent est
ce
,
rien
,
quelque chose
4.9 Le groupe verbal
4.9.1 Rappelons les temps du français :
4.9.2 Le groupe verbal
4.9.3 Le verbe et sa valence
4.9.3.1 La conjugaison
4.9.3.1.1 Les semi-consonnes
4.9.3.1.2 Radical en {c} ou {g}
4.9.3.1.3 Verbe en [y] dont la conjugaison a évolué
4.9.3.1.4 Verbes dont le radical se termine par {e}
4.9.3.1.5 La dernière syllabe du radical a pour seule voyelle {e} et on redouble la consonne
4.9.3.1.6 La dernière syllabe du radical a pour seule voyelle {e} . l’orthographe ne change pas
4.9.3.1.7 La dernière syllabes du radical a pour seule voyelle {é} : seule la prononciation change
4.9.3.1.8 La dernière voyelle du radical se prononce [e], l’orthographe est {é}
4.9.3.1.9 La dernière syllabes du radical se prononce [e], l’orthographe étant {ei}
4.10 Impératif et pronoms
Ressemblances et différence entre oral et écrit
5.1 Codage des pensées en texte oral, puis, écrit
5.1.1 L’histoire
5.1.2 Le codage en texte oral
5.1.3 Le codage en texte écrit
5.1.4 Décodage des textes oraux en pensées
5.2 Caractéristiques de l’oral et de l’écrit
5.2.1 Découpage en mots phoniques
5.2.2 Vocabulaire
5.2.3 Syntaxe
5.2.3.1 Oral
5.2.3.2 Écrit
5.2.4 Pragmatique et culture générale
5.2.4.1 Pragmatique
5.2.4.2 Culture générale
5.2.5 Différences écrit / oral
Comment intégrer tout cela dans votre enseignement ?
6.1 Revoyons le contenu de cet ouvrage
6.2 Les buts de cet ouvrage
6.3 Les moyens que cet ouvrage met au service des enseignantes et enseignants de FLE
6.4 Comment procéder ?
6.4.1 Utiliser le site www.la-grammaire-du-fle
6.4.2 Utiliser les ouvrages écrits
6.4.2.1 Grammaire du FLE :
6.4.2.2 Phonétique corrective :
6.5 N’hésitez pas à joindre l’auteur sous
Bibliographie
Autres ouvrages du même auteur :
→ eGrammaire BoD 2014 ISBN : 978-2-322-08398-5
→ Grammaire participative BoD 2 015 ISBN : 2 015 978-2-322-08403-6
→ Petit guide de la Phonétique corrective BoD ISBN : 978-2-322-08399-2
→ Apprendre à enseigner les temps simples du passé BoD ISBN : 978-2-322-08461-6
Avec Gérard Meunier
→ OrthoFle Le guide du professeur d’orthographe Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2017 ISBN : 979-1-094-11308-0
Avec Jean Piètre-Cambacédes
→ La Conception du temps en français, anglais, allemand Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2017 ISBN : 979-1-094-11309-7
→ Théorie des Temps grammaticaux fondée sur les Traits pertinents temporels BOD ISBN-978-2-322-09134-8
→ Enseigner les Traits pertinents temporels BOD ISBN-978-2-322-09151-5
→ Unifier l’emploi des Temps par l’utilisation des Traits pertinents temporels BOD ISBN-978-2-322-16516-2
→ Enseigner la Valence verbale BOD ISBN-978-2-322-12841-9
1. Avant-Propos
Chacun sait que le français est une langue. Mais bizarrement, rares sont ceux qui font un rapprochement entre la langue en tant que système linguistique et la langue en tant qu’organe de la parole.
L’école fait un grand usage de l’écrit sous la forme de livres, de cahiers destinés à contenir les notes prises par les élèves ou de feuilles de copies qui contiennent les devoirs ou les contrôles des apprenants.
Le téléphone portable, dont on aurait pu penser qu’il favoriserait l’usage de la langue orale, sert le plus souvent à établir un lien par écrit avec les réseaux sociaux, qui encouragent à expédier des SMS ou de simples prises de position sur des forums.
La lecture de ces écrits montre les énormes difficultés que pose la langue écrite par rapport à la langue parlée. Voici un exemple tiré d’un forum sur le chanteur Johnny Hallyday.
Re: Rentre chez toi
FUENTESle Lun 9 Jan - 21: 34
ben si, il reste quand même un inéditpuisque ila été édité que pour l'ocasionde l'emission hally-day part johnny passer sur canal +!!
secd est en vente uniquement au fan club et pas dans lecomerce!
donc il reste inédit!
pour moi, il ne sera plusconcidérercomme un inédit quandontl'integreradans le bercy 92 encomerce!
pour l'instantsen'est pas le cas!
ontpouvais pensserqu'ilaller êttre intégrerdans le bercy 92 du coffret live 2003,bennon!
Celui qui a produit ce texte et qui nous pardonnera si nous ne citons pas son nom aurait eu zéro s’il s’était agi d’une dictée. Il a tendance à ne pas redoubler des consonnes qui devraient l’être (*ocasion, *comerce), ou à redoubler des consonnes qui ne devraient pas l’être (*pensser, *êttre). Il se trompe de nature de mot (*se cd au lieu de ce cd, *se n’est pas au lieu de ce n’est pas), conjugue un pronom (on l’intégrera/on pouvait penser) comme si c’était un verbe (*ont), confond le participe (sera considéré/allait être intégré) avec l’infinitif *sera considérer/ *allait être intégrer), conjugue mal (on pouvait / *on pouvais), et il ne sait pas distinguer le participe passé (après un auxiliaire) intégré de l’infinitif intégrer.
Mais si ce texte est lu à haute voix, l’auditeur ne remarquera à l’oreille que deux erreurs : *puisque il[pɥiskəil] au lieu de puisqu’il[pɥiskil], et, à condition de faire la liaison [ʁ]aller être intégré[a-lɛ-ʁɛ-tʁɛ̃-te-gʁe] au lieu de allait être intégré[a-lɛ-tɛ-tʁɛ̃-te-gʁe]. La grande majorité des fautes passent donc inaperçues à l’oral.
On remarque à cette occasion que le français écrit est beaucoup plus complexe que l’oral, justement à cause des consonnes redoublées ou non, des nombreuses lettres écrites qui ne sont pas prononcées, des accords nombreux qui sont inaudibles à l’oral, des diverses formes conjuguées complexes qui s’écrivent différemment alors qu’elles sont lues de façon identique (j’interpelle [-ɛl]- / nous interpellons [-əl-], etc.
Le français oral est la langue de base, celle que les enfants apprennent intuitivement, au contact de leurs parents et de tous ceux qui les entourent. Ils acquièrent ainsi une grammaire intuitive qui leur servira à maîtriser le français oral nécessaire à leur existence, jusqu’au moment où ils apprendront à lire et à écrire, et où ils commenceront à apprendre la grammaire cognitive, qui leur enseignera les pronoms, les accords dont celui du participe, les conjugaisons et l’emploi des voix, des modes et des temps, la construction des compléments et des subordonnées, le discours indirect etc.
L’oral, qui est donc la langue de base, est aussi celle de la pensée. Lorsque l’on essaie d’argumenter dans sa tête, on le fait comme si on parlait. Évidemment, plus on avance dans les études, plus l’oral dont on dispose est évolué. Mais il n’en demeure pas moins que l’on apprend à penser et à réfléchir en même temps qu’on apprend le français oral.
C’est cette même langue orale qui nous permet d’appréhender le monde autour de nous. Apprendre une autre langue, c’est apprendre à voir les choses sous un autre angle. Quand le Français dit « L’habit ne fait pas le moine. » l’Allemand dit « Kleider machen Leute. » (« Les habits font les gens. ») Et en fait, ils ont raison tous les deux : Ce n’est pas parce que quelqu’un est habillé en moine qu’il en est forcément un (vision des Français), mais en revanche, si on veut tromper des gens, on attirera plus leur confiance si on est habillé en moine, ou en policier, que si on est habillé comme tout un chacun (vision des Allemands).
La langue orale est donc d’une importance primordiale. Pourtant, si l’on regarde dans les livres de grammaire les plus connus, on constatera que la phonétique, et l’intonation en particulier, sont réduites à la portion congrue. On trouve même des livres de chercheurs en intonation dans lesquels aucun exemple n’est écrit en écriture phonétique, ce qui amène à raisonner sur de l’écrit, ce qui est bizarre pour une étude sur l’intonation, phénomène touchant l’oral. Il est donc temps que l’on aborde la grammaire sous un autre angle et que l’on accorde à la prosodie, et en particulier à sa composante l’intonation, l’attention qu’elles méritent.
Nous nous proposons ici de présenter la prosodie du français sous un angle didactique, tenant compte des phonèmes, des syllabes, des monèmes, de la décomposition en mots phoniques ainsi que de l’intonation, et de montrer son influence tant sur le français oral que sur le français écrit, tant dans la grammaire intuitive que dans la grammaire cognitive. Nous traiterons aussi bien du décodage (compréhension orale) que du codage (production orale).
Cet ouvrage est fait avant tout pour sensibiliser les enseignantes et les enseignants à l’importance de l’utilisation de la prosodie, y compris sa composante intonation, dans l’enseignement du FLE en particulier, de la grammaire du français tout court au sens large.
L’enseignante et l’enseignant intéressés trouveront sur notre site www.la-grammaire-du-fle.com une formation en phonétique corrective pour les enseignantes et les enseignants de FLE, ainsi qu’un apprentissage théorique et pratique de la prononciation (compréhension et production orales) pour les apprenants.
Cette formation en phonétique corrective vient compléter notre petit guide {Meunier 2015a}.
2. Du phonème au texte
→ Définitions
Le dictionnaire de la linguistique {Larousse 2012, p. 385} donne de la prosodie la définition suivante :
«Le terme prosodie se réfère à un domaine de recherche vaste et hétérogène, comme le montre la liste des phénomènes qu’il évoque : accent, ton, quantité, syllabe, jointure, mélodie, intonation, emphase, débit, rythme, métrique etc. Les éléments prosodiques présentent la caractéristique commune de ne jamais apparaître seuls et de nécessiter le support d’autres signes linguistiques. Leur étude exige donc leur extraction du corps vivant de la langue bien que le contrôle neuronal des faits prosodiques soit en partie indépendant des autres faits linguistiques qui leur servent de support.»
Nous allons donner ici une définition de la prosodie et celle de l’intonation qui se limite aux éléments du langage qui nous intéressent pour notre étude.
Nous comprenons par
intonation
l’ensemble des phénomènes suprasegmentaux dus à l’activité des cordes vocales et couvrant :
Les variations de la
hauteur
(nombre de vibrations par seconde en Hz).
L’
intensité
de ces variations (en dB) et la répartition des accents toniques (syllabes accentuées) qui en découle.
La
durée
des phonèmes et des syllabes (en ms).
Notre vision de la prosodie comprend
L’intonation,
L’agencement des phonèmes en syllabes,
Le découpage en mots phoniques
→ L’objet de notre étude
Nous étudierons l’action de la prosodie et ses rapports avec la grammaire du FLE.
Étant donné l’importance de l’oral dans l’enseignement et l’apprentissage des langues, il est difficile d’être un bon enseignant, ou une bonne enseignante de FLE sans connaissances dans les domaines du système phonique et de la prosodie, particulièrement de sa composante l’intonation.
Il est nécessaire de bien en posséder les bases pour enseigner le système, pour assurer une bonne compréhension et une bonne production au niveau oral. En outre, il faut pouvoir reconnaître et bien identifier les fautes des apprenants, et pouvoir les corriger ad hoc, ou dans un traitement que l’on aura mis au point, comprenant des exercices de compréhension, puis de production. Il faudra alors prévoir des exercices d’application directe, puis des exercices de transfert dépaysants, où l’apprenant oubliera qu’il fait des exercices de phonétique, tout en appliquant les règles apprises.
On trouvera plus de détails sur les principes de la correction phonétique dans Meunier 2 015 (Petit guide de la Correction phonétique). Ce qui nous intéresse ici, c’est l’effet de la phonétique sur la grammaire du français.
→Partons d’un exemple à la recherche de tous ses constituants :
Des tomates poussent dans le vieux jardin.
Écrivons cette phrase en API comme nous avons l’intention de l’écrire plus tard :
[ de-to-mat / pus-dɑ̃-lə-vjø-ʒaʁ-dɛ̃ //]
Nous allons ensuite en extraire les constituants :
Les phonèmes (22)
Les voyelles
(9)
[ e, o, a, u, ɑ̃, ə, ø, a, ɛ̃ ]
Les consonnes
(12)
[d, t, m, t, p, s, d, l, v, ʒ, ʁ, d ]
Les semi-consonnes
(1)
[ j ]
Les syllabes (9)
[ de, to, mat, pus, dɑ̃, lə, vjø, ʒaʁ, dɛ̃ ]
Les monèmes (7)
[ de, tomat, pus, dɑ̃, lə, vjø, ʒaʁdɛ̃ ]
Les mots phoniques (2)
Sujet
(1)
[ de-to-mat/ ]
Verbe
(1)
[ pus-dɑ̃-lə-vjø-ʒaʁ-dɛ̃// ]
Phrase (1)
[ de-to-mat / pus-dɑ̃-lə-vjø-ʒaʁ-dɛ̃ / /]
Étudions maintenant ces éléments.
2.1 Les phonèmes
Les phonèmes constituent l’unité de seconde articulation (la première étant le monème, soit le lexème et le morphème).
Nous avons dans notre exemple vingt-deux phonèmes que l’on peut classer dans les trois séries bien connues :
Les voyelles :
[e, o, a, u, ɑ̃, ə, ø, a, ɛ̃ ]
Les consonnes :
[ d, t, m, p, s, l, v, ʒ, ʁ ]
Les semi-consonnes (ou semi-voyelles).
[ j ]
2.1.1 Le continuum oral
En réalité, la réalisation orale constitue un continuum qui ne s’interrompt que dans deux cas :
Lorsque le phonème est une consonne occlusive sourde (
[p]
,
[t]
,
[k]
), tant que l’air est empêché de sortir pas les lèvres
[p]
, la pointe de la langue contre les alvéoles
[t]
, ou le dos de la langue contre le palais
[k]
, avant l’explosion déclenchée lorsque l’obstacle cède.
À la fin d’un mot phonique, avant que le locuteur ne passe au mot phonique suivant.
Le premier problème, pour l’auditeur, est celui d’identifier les sons.
Ceux-ci peuvent être répartis en trois catégories :
Les voyelles :
[ i, e, ɛ, a, y, ø, œ, ə, u, o, ɔ, ɑ, ɛ̃,
,
ɔ̃, ɑ̃ ]
Les consonnes :
[ p, t, k, b, d, g, m, n, ɲ, f, s, ʃ, v, z, ʒ, ʁ, l ]
Les semi-consonnes (ou semi-voyelles).
[ w, ɥ, j ]
2.1.2 Les voyelles
Les voyelles sont des phonèmes prononcés sans obstacle. Les cordes vocales vibrent, et le son sort sans obstacle de la bouche. C’est la position de la langue, celle des lèvres et l’utilisation éventuelle des fosses nasales qui déterminent les formants (les sommets de vibration) des voyelles et assure la différence entre elles.
On dessine un trapèze pour montrer à quel endroit la pointe de la langue ou son dos s’approche le plus du haut de la cavité buccale.
Toutes les voyelles situées au-dessus de la ligne verte sont prononcées avec une projection des lèvres en avant. On les nomme arrondies. Cette avancée a pour résultat de rendre plus grave le formant n°2 du phonème, ce qui aide à distinguer les voyelles arrondies de celles qui ne le sont pas.
Lorsque l’air passe par les fosses nasales en plus de la cavité buccale, un formant nasal se forme, qui donne à la voyelle son caractère de nasale. L’air sort alors par la bouche et par le nez en même temps.
Les consonnes
Ce sont des phonèmes qui sont prononcés avec un obstacle.
Lorsque l’obstacle est
total