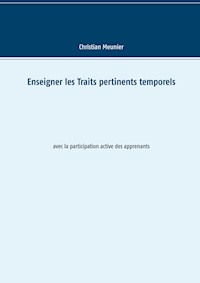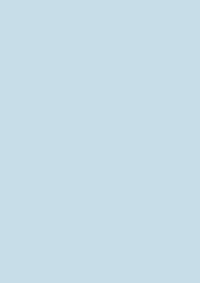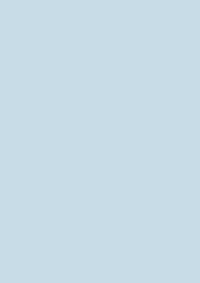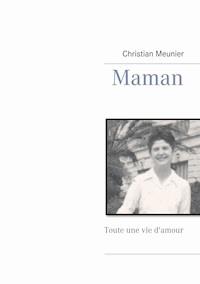Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
eGrammaire est un système d'apprentissage et d'enseignement de la grammaire composé de trois modules : > Un site internet, www.egrammaire.com, contenant des unités explicatives, des exercices et des tests autocorrigés. > Un livre, celui que vous avez en mains, qui contient la théorie de la grammaire. > un livre "la Grammaire participative", destiné aux enseignants et leur permettant d'enseigner la grammaire en faisant participer les apprenants. Ce livre contient quelques points originaux : > une intégration systématique du système phonique et de l'intonation, marquée et non marquée, dans l'explication des phénomènes grammaticaux. > une utilisation systématique de la valence du verbe pour expliquer la construction du groupe verbal autour du verbe et de sa valence. >une approche nouvelle de l'explication des temps simples du passé (imparfait, passé simple, passé composé). > une explication en système, pas à pas, fondée sur un dialogue avec le lecteur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Petit Guide de la traduction systématique CMV Berlin 1986 ISBN 3-89283-001-0
Grammaire raisonnée Le Verbe CMV Berlin 1987 ISBN-3-89283-003-7
Einführung in das Programmieren eines Personal Computers : eine Einführung für Sprachdozenten und Sprachstudenten CMV Berlin 1987
eGrammaire Editions du FLE 2014 ISBN 9-10-94113-00-4
Grammaire participative Editions du FLE 2015 ISBN 9-10-94113-03-5
Petit guide pratique de la phonétique corrective Editions du FLE 2015 ISBN 9-10-94113-06-6
Orthofle Guide du professeur d’OrthographeEditions du FLE 2017 ISBN 9-10-94113-08-0
La conception du temps Editions du FLE 2017 ISBN 9-10-94113-09-7
Vous qui voulez travailler votre grammaire, vous trouverez sur le site www.egrammaire.com tous les tests, tous les exercices corrigés par l’ordinateur, tous les conseils nécessaires pour apprendre, apprendre à apprendre et gérer votre motivation. Inscrivez-vous. L’utilisation est gratuite.
Vous pouvez aussi, sans inscription, et en vous aidant de ce livre, faire les exercices dans la rubrique exercices seuls de ce même site.
TABLE des MATIERES
Grammaire... Vous avez dit «grammaire»?
1.1 Les domaines linguistiques abordés par la grammaire
1.2 Notions de règles
1.3 Des règles? Pour qui?
1.4 Qu'allons-nous faire ?
1.5 eGrammaire
1.6 Enseigner la Grammaire du français pas à pas
Le système phonique et l'intonation du français
2.1 Les organes participant à la parole
2.2 Le système phonique du français
2.3 L'intonation du français
La forme affirmative
3.1 Définitions: l'affirmative
3.2 Phrase simple / Phrase complexe
3.3 La position des divers éléments de la forme affirmative
L'interrogative
4.1 Définitions
4.2 Le choix des mots interrogatifs
La forme négative
5.1 Définition
5.2 Différentes négations
5.3 Place des négations dans la phrase
5.4 Cas particuliers
5.5 Une faute un peu particulière : *pour pas que
La mise en relief
6.1 Définitions
6.2 Les différentes méthodes
Les articles
7.1 Définitions
7.2 L'article défini
7.3 L'article indéfini
Le démonstratif
8.1 Définitions
8.2 Les adjectifs démonstratifs
8.3 Les pronoms démonstratifs
Les Possessifs
9.1 Qu'est-ce qu'un possessif?
9.2 Adjectif ou pronom?
9.3 Les adjectifs possessifs
9.4 Les pronoms possessifs
9.5 Cas particuliers
L’indéfini
10.1 Définition
10.2 Les différents indéfinis
L’adjectif qualificatif
11.1 Emploi des adjectifs qualificatifs
11.2 Les formes de l'adjectif
11.3 Problèmes d'accord
11.4 La place de l'adjectif épithète
11.5 Les degrés de l'adjectif qualificatif
L’adverbe
12.1 Définition
12.2 Formation
12.3 Emploi
12.4 Les degrés de l’adverbe
Les adjectifs numéraux
13.1 Définitions
13.2 Les adjectifs numéraux cardinaux
13.3 Nombres et calculs
13.4 Pour ceux qui veulent en savoir plus
Le nom
14.1 Définition
14.2 Caractéristiques des noms
14.3 Les fonctions du nom
Le pronom personnel
15.1 Principe
15.2 Les pronoms personnels par familles dans un emploi classique
15.3 Cas particuliers :
Le groupe verbal
16.1 Les voix, le mode, les temps
16.2 La valence
16.3 Les compléments circonstanciels
Formation des temps et conjugaisons
17.1 Les temps de base
17.2 Les temps composés
17.3 Le passif
Emploi des temps de l’indicatif
18.1 Notions d’antériorité, de postériorité et de simultanéité
18.2 Emploi du présent
18.3 Emploi du futur simple
18.4 Emploi du passé simple / passé composé
18.5 Emploi de l’imparfait
18.6 L’emploi des temps composés
18.7 Conclusion
Emploi des temps simples du passé
19.1 Les mauvaises explications traditionnelles
19.2 La règle de base
19.3 Ordre chronologique et ordre du texte
19.4 Actions individuelles et trains d’actions
19.5 Autrefois / Aujourd’hui
19.6 Tout dépend du verbe
19.7 Tout dépend de la conjonction (ou de la préposition)
19.8 Raisons contextuelles
19.9 Notions de déroulement
19.10 Emplois stylistiques
19.11 Emplois grammaticaux de l’imparfait et du passé composé
Le Conditionnel
20.1 Définition
Le conditionnel est un mode, comme l’indicatif et le subjonctif
20.2 Formation et Conjugaison
20.3 Emploi du conditionnel
Le Subjonctif
21.1 Définition
Le subjonctif est un mode, comme l’indicatif et le conditionnel
21.2 Conjugaison
21.3 Emploi du subjonctif
L’impératif
22.2 Formation et Conjugaison
22.3 Emploi de l’impératif
22.4 Les à-côtés de l’impératif
L’infinitif
23.1 Définition
23.2 Formation
23.3 Emploi de l’infinitif
Les participes
24.1 Définition
24.2 Formation
24.3 Emploi du participe
L’accord du participe passé
25.1 Principe
25.2 Accord du participe passé conjugué avec l’auxiliaire être
25.3 Accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire
avoir
25.4 Cas des verbes pronominaux
Les complétives
26.1 Définition
26.2 La complétive par si
26.3 La complétive par que
26.4 Autres complétives par que
Le discours rapporté
27.1 Définitions
27.2 Le discours indirect : choix des conjonctions
27.3 Le discours indirect : modification des temps
27.4 Le discours indirect : problèmes annexes
27.5 Comment introduire le discours indirect
27.6 Et le discours semi-direct ?
La Subordonnée relative
28.1 Définitions
28.2 Les pronoms relatifs:
28.3 Comment construire sa relative
28.4 Le subjonctif dans la relative
Les Subordonnées circonstancielles
Les Subordonnées circonstancielles de temps
30.1 L'antériorité
30.2 La postériorité
30.3 La simultanéité
Les Subordonnées de Cause
31.1 Définitions
31.2 Les subordonnées de cause
31.3 Les formes équivalentes marquant la cause
31.4 Les temps dans la subordonnée de cause antérieure
Les Subordonnées de Conséquence
32.1 Définitions
32.2 Les subordonnées de conséquence
Les Subordonnées de But
33.1 Définition
33.2 Les subordonnées de but (finales)
33.3 Les formes de remplacement
Les Subordonnées de Concession
34.1 Définition
34.2 Les subordonnées de concession
34.3 Les modes dans les subordonnées de concession
34.4 Les façons équivalentes d'exprimer la concession
Les Subordonnées de Condition
35.1 Définition
35.2 Les subordonnées de condition et leurs conjonctions
35.3 Formes de remplacement
Les Subordonnées de Comparaison
36.1 Définition
36.2 Les subordonnées de comparaison
36.3 Formes équivalentes
36.4 Moins / plus que ou moins / plus de
Grammaire... Vous avez dit «grammaire»?
Avant de se lancer dans l'étude d'une grammaire, il serait bon de se demander ce que l'on va y trouver.
Pour beaucoup de gens, la chose est claire: une langue se compose d'un vocabulaire et d'une grammaire. Le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots, et la grammaire, c'est la façon de s'en servir. Comme dirait Cyrano, c'est un peu court, jeune homme!
Nous n'allons pas essayer de définir ce qu'est une grammaire, mais plutôt ce que nous voulons mettre dans la nôtre.
1.1 Les domaines linguistiques abordés par la grammaire
Je suppose que vous avez besoin d'une grammaire pour avoir une description du français. Vous voulez savoir comment le français fonctionne, afin de pouvoir comprendre, mais aussi parler ou écrire cette langue correctement. Dans ce cas, considérez-vous comme mon invitée... Vous vous étonnez que je m'adresse à une femme? Étant donné que la majorité des gens qui s'occupent de l'enseignement des langues sont des femmes, que la majorité des étudiants de français sont en fait des étudiantes, vous conviendrez avec moi que j'ai plus de chance de m'adresser à une femme qu'à un homme. Je me permettrai donc de m'adresser à une lectrice... Et si vous êtes de sexe masculin, faites l'effort que doivent faire les femmes que l'on appelle hommes (homo sapiens) pour vous identifier à ma lectrice...
Partons, si vous le voulez bien, du principe que notre grammaire doit décrire le fonctionnement du français.
Pour fonctionner, une langue a bien sûr besoin d'unités de sens. Le linguiste appelle la plus petite unité de sens un lexème, ou un morphème lorsqu'il a un sens grammatical.
Par exemple, chat est un lexème, qui représente l'animal bien connu, alors que un est un morphème, puisqu'il a une dimension grammaticale
un masculin / singulier
qui s'ajoute à ses valeurs lexicales:
Bien sûr, vous vous dites: « Mais... Ce sont des mots...». Ce n'est pas tout à fait vrai. Prenons l'exemple chaton. C'est un mot. Mais vous pouvez reconnaître deux parties:
Vous retrouvez d'ailleurs le lexème -on dans d'autres mots:
un caneton → un petit canard
un girafon → une petite girafe mâle
un ânon → un petit âne
un garçon → un petit gars
-> Mais ces lexèmes / morphèmes sont eux-mêmes constitués d'unités plus petites, qui ne signifient rien par elles-mêmes, mais qui servent à construire les unités porteuses de sens, et que l'on appelle, pour l'oral, des phonèmes, et pour l'écrit, des lettres.
Ainsi, le lexème pot est constitué des 2 phonèmes /po/, et des 3 lettres {pot}.
Nous avons donc deux sortes d'unités de base:
Les unités porteuses de sens: lexèmes / morphèmes.
Les unités non porteuses de sens, servant à construire ces unités porteuses de sens : les phonèmes à l’oral, les lettres à l’écrit.
Vous pourriez, chère lectrice, être tentée de penser que cela se fait grâce aux règles syntaxiques. N'allez pas plus vite que la musique.
Admettons que je veuille décrire l'image suivante:
Un homme court dans la rue.
Comment expliquer cette phrase?
J'utilise les lexèmes: homme courir dans rue
Pourquoi est-ce que j'emploie les lexèmes homme, courir et rue? J'ai recours pour cela à des règles sémantiques: il faut connaître la signification des lexèmes pour utiliser celui qui convient.
Pourquoi est-ce que j'emploie le lexème dans, et non pas, par exemple, sur, comme n'importe quel germanophone le ferait?
Pour l'expliquer, il faut avoir recours à des règles de pragmatique.
« Qu'est-ce donc que cela? », vous demandez-vous. Eh bien c'est très simple: les Français ont une certaine façon de voir ce qui les entoure.
Pour un Français, voici une rue, avec des maisons de chaque côté. La rue et les murs constituent un volume, dans lequel l’homme se trouve : Il est donc dans la rue.
Et voilà une route, avec des arbres ou non, mais sans mur.. La route n’est pas un volume, mais un ruban, une simple surface. Les voitures roulent donc sur la route.
Ainsi, la rue est la version pour la ville, alors que la route est celle de la campagne.
Et voilà une Straße pour un Germanophone. Les maisons et les murs ne sont pas importants et ne font pas partie de la Straße. Celle-ci est donc considérée comme une surface sur laquelle on marche.
Le même lexème sert d’ailleurs pour la campagne, puisque l’important, c’est la partie horizontale, sur laquelle on se déplace. S’il veut faire la différence, le Germanophone dira, pour la route, Landstraße, qui serait une rue / route à la campagne.
«Qui a raison?» demanderez-vous? Le Français en français, et l'Allemand en allemand, puisque chacun présente les choses comme sa langue lui permet de les voir. On apprend à penser en même temps que l’on apprend à parler notre langue maternelle, et notre façon de penser est souvent enfermée dans la langue et a du mal à franchir ses limites, ce qui rend difficile l’acquisition d’une nouvelle langue.
Comment expliquer maintenant le morphème « la »?
Il faut avoir recours à la syntaxe: les lexèmes substantifs ont une caractéristique syntaxique nommée genre. Ici, le lexème rue est féminin. On pourrait être tenté de dire qu'il s'agit là d'une caractéristique de sens. Mais comme une rue n'a pas de sexe, elle pourrait aussi bien être masculine, comme un boulevard ou un cours méridional.
Par exemple, une table est féminine en français, alors qu'elle est masculine en allemand (der Tisch). De même que la chaise (der Stuhl).
Mais il faut aussi avoir recours à la sémantique. En effet, si l'on dit la au lieu de une, c'est parce qu'il n'y a ici qu'une seule rue. Elle est donc définie par le fait qu’elle est unique de sa sorte, devant moi. En outre, tout le monde peut la voir.
Comment expliquer cet?
D'abord, il va falloir avoir recours à la sémantique, pour expliquer que l'on montre l'homme. Donc, on emploiera un démonstratif. Ensuite, on aura recours à la syntaxe pour expliquer pourquoi on emploie un masculin.
Et enfin, il faudra avoir recours à la phonétique, donc à la prononciation pour expliquer le t de cet.
Nous aurons ensuite recours à nouveau à la syntaxe pour expliquer l'ordre des mots, et pour expliquer la conjugaison du verbe courir.
Il ne nous reste plus qu'à résumer quelles catégories de la linguistique nous avons utilisées pour décrire cette modeste phrase:
la syntaxe,
la sémantique,
la phonétique et
la pragmatique.
Vous ne serez donc pas surprise, chère lectrice, que nous ayons recours à ces quatre domaines dans cet ouvrage. Cela ne veut pas dire que nous allons envisager tous les aspects de ces sciences. Nous nous contenterons de prendre ce dont nous avons besoin, et de butiner, comme les abeilles, pour faire notre miel grammatical.
1.2 Notions de règles
Pour montrer le fonctionnement du système qu'est la langue française, nous nous servons de règles. Certains voient les règles de grammaire comme un mode d'emploi. Pour faire marcher un appareil, on lit le mode d'emploi, et on fait ce qui est inscrit. Si on le suit fidèlement, on doit arriver à le faire fonctionner.
En fait, les règles ressemblent plutôt à une recette de cuisine: prenez un œuf, séparez le jaune du blanc... Il ne reste plus qu'à suivre la recette, et l'on obtient le plat désiré. Si vous avez déjà fait la cuisine d'après un livre, vous avez sûrement déjà fait la même expérience que moi:
On vous dit de prendre 250 g de beurre. Résultat: la pâte vous colle aux doigts. Vous êtes obligée de rajouter 100 g de farine pour que la pâte soit présentable. Moralité: 200 g auraient suffi.
On vous dit de mettre au four à feu doux pendant 30 mn. Résultat: le gâteau n'est pas cuit... ou il est brûlé, si vous avez une autre façon de comprendre feu doux.
Les règles de grammaire sont très semblables aux recettes de cuisine:
Certaines sont justes et marchent bien (accord du participe conjugué avec être, conjugaisons)
d'autres sont imprécises (article partitif, choix des pronoms relatifs)
d'autres encore sont fausses (emploi des temps du passé)
d'autres enfin n'ont pas encore été formulées, parce que personne ne s'est jamais posé de question sur le sujet.
En outre, il existe une multitude de règles, mais on ne voit pas toujours comment elles fonctionnent les unes par rapport aux autres, lesquelles ont priorité, ni dans quel ordre il faut les appliquer.
Le devoir d'une grammaire est donc de fournir pour chaque problème envisagé des règles précises, qui présentent le problème sous la forme d'un système. Il faut que l'on montre comment les règles fonctionnent les unes par rapport aux autres, et en particulier, en cas de contradiction entre règles, laquelle a la priorité.
1.3 Des règles? Pour qui?
Pour faire une grammaire, il faut savoir à qui l'on s'adresse.
quel est le niveau des lectrices? Les débutantes ont d'autres problèmes que les avancées, ou que les spécialistes.
s'adresse-t-on à des gens dont le français est la langue maternelle, ou à des non-francophones?
1.3.1 Quand on apprend sa langue maternelle, on a plusieurs avantages
On ne connaît encore aucune langue: on peut donc apprendre à penser et à parler en même temps. La pensée est donc conforme à la langue. Pour la pragmatique, il n'y a rien de mieux.
On a le temps. Le petit Français met plusieurs années à apprendre les bases de sa langue. Il est constamment corrigé par ses parents, il fait ses expériences linguistiques, voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas aux résultats, il a l'occasion de s'exercer constamment. L’école, plus tard, précisera les choses en s’appuyant sur l’acquis oral, et en ouvrant la porte du code écrit.
On peut donc apprendre sa langue de façon intuitive, au début même, sans aucune grammaire, et on n'aura recours à la grammaire que pour affiner ses connaissances.
1.3.2 En revanche, l'étranger, lui, a appris à penser avant d'utiliser le français
La langue maternelle, avec laquelle on a appris à penser, est toujours présente, et rien ne se fait sans elle.
Il ne pourra pas apprendre de façon intuitive, car il n'est plus innocent, sa langue maternelle déformant sa façon de voir, faussant son analyse de la langue étrangère. En outre, il faut faire vite. Il a donc besoin de règles de grammaire pour gagner du temps, et sa connaissance du français sera plus cognitive, plus consciente.
1.3.3 Faire une grammaire pour des non-francophones, cela revient
à savoir quels problèmes se posent aux étrangers auxquels on enseigne la langue.
à présenter ces problèmes en système, avec des règles précises et si possible justes.
à savoir établir des ponts entre les divers problèmes, pour montrer la langue entière comme système.
pour expliquer, il faut raisonner avec la lectrice, lui montrer le chemin qui mène aux explications, discuter avec elle les problèmes qui se posent et les résoudre avec elle. L'idéal serait bien sûr de faire une grammaire qui se lise comme un roman, et qui explique comme un traité de mathématique... Voilà deux objectifs quelque peu contradictoires...
1.4 Qu'allons-nous faire ?
1.4.1 D'abord, parlons de notre public.
→ Cette grammaire s’adresse à des non francophones ayant au minimum 5 de français, (niveau B2 / C1 du Cadre européen commun de Référence pour les langues) et en particulier:
aux élèves révisant la grammaire pour leur équivalent du baccalauréat (Abitur, Maturat, Humanités, etc.),
aux étudiantes ou étudiants de français en cours d'études,
aux enseignantes et enseignants de français.
→ Elle s’adresse aussi à des francophones, en particulier:
aux étudiantes et étudiants en Français Langue étrangère (FLE)
aux enseignantes et enseignants de FLE.
aux étudiants se préparant au concours d’orthophoniste.
1.4.2 Qu'offre-t-elle ?
Elle se propose de présenter la langue française en tant que système. Pour cela, on montrera une série de problèmes grammaticaux d'ordre général, que l'on systématisera, et l'on montrera les interactions qui lient ces divers domaines.
Le problème majeur de l'enseignement du français langue étrangère (FLE) est que l'apprentissage de la grammaire a lieu de façon morcelée, les éléments grammaticaux apparaissant séparés, au gré de l'enseignement. Selon les dires de mes étudiantes, les enseignantes, sauf quelques rares exceptions, ne prennent pas la peine, dès qu'un phénomène grammatical a été complètement vu en X épisodes, de faire une pause dans leur enseignement pour faire le bilan, systématiser les connaissances.
Le résultat immédiat de cette façon de procéder est que l'élève conçoit la grammaire du français comme une accumulation de petites règles de portée minime, accompagnées d'une multitude d'exceptions, alors que, très souvent, il existe des règles générales, phonétiques par exemple, qui expliquent très bien ce qui semble être une multitude d'exceptions. Mais pour systématiser, encore faut-il connaître ces règles. Il faut donc fournir aux élèves et aux enseignantes un outil qui leur permette de montrer comment fonctionne le français, et qu'il y a plus de règles que d'exceptions, le tout étant de connaître ces règles.
1.4.3 Comment allons-nous procéder ?
1.4.3.1 L’étendue de cet ouvrage
Il aurait évidemment été possible d'étudier un certain nombre de grammaires, et d'en faire la synthèse, afin de construire la grammaire la plus complète sur le marché.
En ce qui nous concerne, nous procéderons différemment.
Le but d'un enseignant est de transmettre son savoir à ses élèves, pour qu'ils atteignent son niveau, et qu'ils disposent, au début de leur carrière, du savoir qu'il a acquis lui-même au cours de nombreuses années d'apprentissage, d'enseignement et de réflexions. Partant sur de telles bases, l'élève doué aura ainsi un bagage lui permettant, un jour, de dépasser son maître.
Nous partons du principe que l'élève doit acquérir une grammaire utilisable tous les jours. Nous ne rechercherons donc pas la petite bête, le détail pittoresque. Nous n'irons pas chercher tous les détails. Nous voulons donner à notre lectrice, ou à notre lecteur, les grandes lignes, l'essentiel. Nous irons cependant dans le détail, chaque fois qu'il le faudra.
Cette grammaire sort donc directement d’une tête d’enseignant. Cela ne veut pas dire que nous ayons tout inventé. Bien au contraire, beaucoup d'éléments nous ont été fournis par l'enseignement de nos enseignantes et enseignants, qui le tenaient eux-mêmes de leurs propres enseignants. Mais il est aujourd'hui difficile d'accorder des titres de maternité ou de paternité. Citons donc:
- tous mes enseignants, de la maternelle à l'université, qui ont assuré les bases de mes connaissances et de ma capacité de réflexion, et en particulier Mme Arène, institutrice de CE2 à Nice, et M. Riche, instituteur de CM2 à Alger, qui ont éveillé mon intérêt pour la grammaire. (Eh oui, c’est une vieille histoire…)
- mes élèves du CES de Frévent dans le Pas-de-Calais, du Lycée Ahmed Mangué de Sahr, au Tchad, du Lycée Euregio de Bocholt (Allemagne), à qui j'ai eu la grande joie d'expliquer la grammaire,
- mes étudiantes et étudiants de la Freie Universität de Berlin, qui m'ont forcé, pendant 31 ans, à améliorer mes méthodes et mes connaissances.
Chacune de ces personnes a participé à sa manière à l'élaboration de cet ouvrage.
Si l'on part donc du principe que le savoir se transmet, nous ferons une différence entre le savoir assimilé et le savoir à consulter.
Le savoir assimilé
est celui que l'on a en tête, et qui est disponible à tout moment. C'est en gros celui qui est lié à la parole. Chaque individu se forme son propre français, qui lui permet de réaliser une certaine performance. Nous appellerons l'ensemble de ce savoir individuel
parole
. C'est sur cette parole que nous voulons agir, afin de permettre à nos élèves de réaliser des performances honnêtes.
Le savoir à consulter
est l'ensemble de toutes les connaissances possibles sur le français. Pour avoir une idée de ce savoir, jetez un coup d'oeil sur le rayon de français de la bibliothèque universitaire de votre université. Il n'est évidemment pas question d'acquérir un tel savoir au cours de vos années d'études. On peut même se demander si toute une vie suffirait. De toute façon, ce savoir reste disponible, tant que la bibliothèque existera, et nous pourrons donc aller le consulter en cas de besoin. D'ailleurs, ce savoir grandit tous les jours, puisque la langue française évolue, et que des études constantes viennent enrichir ce savoir.
Vous comprendrez donc que nous voulons vous présenter un savoir qui rentre dans une tête moyenne, et contenant les éléments nécessaires, pas plus, mais pas moins.
1.4.3.2 Les moyens employés
Nous allons essayer de construire ce savoir en discutant et en raisonnant ensemble. Pour cela, nous allons franchir des étapes. Si donc vous voulez que nous apprenions ensemble, il faudra lire le chapitre entier, en commençant par la première ligne, et en vous arrêtant à la dernière.
Comme l'enseignement de la grammaire est réputé austère et difficile, nous essaierons de garder le contact en préférant employer des termes simples, plutôt que des mots compliqués, la compréhension du problème nous semblant avoir priorité sur la façon de le nommer.
Nous avons pour habitude de choisir des exemples frappants, qui manquent quelquefois de délicatesse, mais qui ont prouvé, dans l'enseignement, leur force d’impact. Nous nous excusons donc par avance pour toutes les jambes cassées, les morts ou adultères qui viendront illustrer nos divers exemples.
Nous serons souvent amenés à raconter de petites histoires, à faire des rapprochements qui vous paraîtront bizarres, mais qui ont déjà subi, avec quelque succès, l'épreuve de l'enseignement.
Enfin, nous aurons quelquefois recours à des illustrations ou des graphiques destinés à faciliter l'explication, selon les conseils de NAPOLÉON, qui disait, parait-il, qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long discours.
1.4.3.3 Comment se servir de cette grammaire
Tout dépend, bien sûr, de ce que vous voulez obtenir.
Si vous voulez avoir une vue d'ensemble du français, sans négliger les détails, nous vous conseillons de commencer par la première ligne, et de vous arrêter à la dernière. Prenez votre temps. Lisez les explications, essayez de les comprendre, suivez le raisonnement pas à pas. Lorsqu'on fait référence à une illustration, regardez-la chaque fois que le texte s'y rapporte.
Si vous voulez comprendre un problème, reportez-vous au chapitre qui le traite, et tâchez de le lire du début à la fin. Comme les explications se fondent sur un raisonnement, il est très important de suivre celui-ci pas à pas.
Si vous voulez approfondir un détail, vous pouvez aller sur le site
www.egrammaire.com
faire les tests, les exercices corrigés par le site, et utiliser les outils mis à votre disposition. Avec ce livre comme support d’apprentissage, vous pouvez faire les exercices directement (
Exercices seuls
).
1.4.3.4 Pourquoi cet ouvrage est-il en français ?
Une grammaire du FLE s'adresse par définition à des enseignants de français, donc, à des gens qui comprennent le français, mais aussi à des élèves de français langue étrangère (F.L.E).
Lorsque ces étudiants sont en France, ils viennent de plusieurs communautés linguistiques différentes, et le français est la seule langue qui leur soit commune.
Ces élèves peuvent aussi se trouvent souvent à l'étranger, où ils font partie d'une communauté linguistique unique (anglophone en Angleterre, germanophone en Allemagne, etc.), et l'on peut se demander pourquoi on ne ferait pas une grammaire en allemand, une autre en français, profitant de l'occasion pour faire une étude contrastive du français et de leur langue maternelle.
Notre expérience nous a toujours montré qu'une étude contrastive, pour intéressante qu'elle soit, n'apportait que rarement un plus à l'enseignement.
D'abord, si l'on veut apprendre la langue comme un système, on ne peut que comparer deux systèmes entre eux. Or, les gens de langue maternelle, s'ils ont une vision intuitive de leur langue, l'ignorent en tant que système. En effet, si vous demandez à un Français qui n’enseigne pas le F.L.E. de vous expliquer l'article partitif, vous serez surprise de voir qu'il ne sait pas du tout de quoi vous parlez. En effet, seuls les étrangers ont des problèmes avec l'article partitif. Moralité: Le Français ne sachant pas qu'il y a là un problème, il ne pourra pas vous expliquer comment cela fonctionne. Et si vous voulez faire une comparaison entre le français et l'allemand, vous allez être obligée d'expliquer sa propre langue au Français, lequel aura du mal à vous croire si vous n’êtes pas de langue maternelle française.
Si donc, pour montrer à des Allemands la différence entre le français et l'allemand, il faut leur expliquer l'allemand et le français, il n'est plus question de gagner du temps! Sans oublier que les élèves allemands ne sont pas d'accord entre eux lorsqu'on leur demande comment cela fonctionne dans leur langue, chacun ayant une expérience différente par rapport à elle.
D'ailleurs, si vous voulez expliquer le français, vous n'avez pas besoin d'une autre langue. Lefrançais s'explique très bien en français. À condition que les apprenants aient un niveau suffisant
Notre expérience personnelle nous amène aussi à nous méfier des explications données en allemand sur le français. En effet, on utilise trop souvent des termes inadéquats. Par exemple, de nombreux enseignants ont tendance à nommer le complément d'objet direct accusatif, et le complément d'attribution datif.
Par exemple:
Paul montre ses photos de vacances à sa grand-mère.
dire que ses photos est un accusatif et que grand-mère est un datif ne correspond pas du tout aux réalités françaises. En effet, le français est sensible aux constructions sans préposition, et à celles avec préposition.
En allemand, en revanche, il existe des cas, et ces cas peuvent s'employer avec ou sans préposition. On aura ainsi:
ich danke dir (je te remercie): datif sans préposition
ich gehe zu dir (je viens te voir): datif avec préposition (zu)
ich sehe dich (je te vois): accusatif sans préposition
ich denke an dich (je pense à toi): accusatif avec préposition (an).
Le résultat, c'est que les élèves associent datif à la préposition à, ce qui les amènera à dire:
* je remercie à ma mère
et autres "joyeusetés" de ce genre.
On peut évidemment employer un terme français, même en allemand, pour décrire le français, mais on peut encore mieux le faire directement en français.
En outre, raisonner en français habituera la lectrice à l'argumentation française. Or, suivre une argumentation, et savoir argumenter soi-même, cela peut être considéré comme un but appréciable. D'autant plus que la répétition d'expressions, de tournures, des articulateurs employés par l'auteur finit par s'imprimer dans l'esprit de la lectrice.
Enfin, il n’est pas pensable de faire une grammaire en plusieurs langues, pour des raisons tout bêtement économiques.
Nous tenons donc absolument à expliquer le français en français, mais nous n'hésiterons pas à faire référence à d'autres langues que nous connaissons lorsque nous l'estimerons utile.
1.4.3.5 Quels domaines seront traités ?
1.5 eGrammaire
La grammaire que vous avez sous les yeux rassemble toute la théorie utilisée sur le site www.egrammaire.com. Vous retrouverez donc sur ce site les mêmes exemples et les mêmes explications.
Pourtant, si vous voulez vraiment apprendre ou réviser la grammaire française dans sa totalité en autonomie, nous vous conseillons fortement et chaleureusement d’utiliser ce site pour profiter des tests et des exercices corrigés, des aides à l’apprentissage (apprendre à apprendre et gestion de la motivation), du forum de discussion des apprenants et du contact avec un enseignant
Cette version écrite vous permettra de lire en toute tranquillité sans avoir besoin d’utiliser d’ordinateur ou de tablette. Elle vous servira de version de référence, et vous aurez de plus l’ensemble du savoir en un bloc, les chapitres étant disséminés sur le site.
Et puis, qui sait, vous la lirez peut-être comme un roman…
1.6 Enseigner la Grammaire du français pas à pas
Cette grammaire se double d’un autre ouvrage destiné aux enseignantes et enseignants de F.L.E., et leur présentant une méthode leur permettant de mieux enseigner la grammaire en faisant participer de façon active les apprenants, et intitulé :
Enseigner la Grammaire du français pas à pas.
Cet ouvrage s’appuie sur la théorie grammaticale du site eGrammaire et sur tous ses exercices auto corrigés.
Il est fondé sur une approche participative des apprenants, leur proposant des feuilles de route guidant leurs recherches en groupes, leur permettant de découvrir eux-mêmes, en confrontant leurs résultats, et avec l’aide ponctuelle et fédératrice de leur enseignante, le fonctionnement du système que constitue la langue française.
Les problèmes sont par ailleurs exposés aux enseignantes, et les exercices corrigés et commentés.
Enseigner la Grammaire du français pas à pas suit la même progression qu’eGrammaire. Les deux ouvrages, soutenus par le site, constituent les trois volets d’un triptyque traitant de la grammaire du français, dans l’optique du FLE. Ces trois volets sont complémentaires, et défendent une même vision de la grammaire.
2. Le système phonique et l'intonation du français
Avant de décrire le système phonique du français, il va falloir revoir quels sont les organes qui servent à former ces sons, et que l'on appelle organes phonateurs, ainsi que ceux qui participent à l'audition et à la compréhension.
Ensuite, il nous faudra voir quelles méthodes on emploie pour former les consonnes et les voyelles. Nous donnerons ensuite une description de ces sons, et nous montrerons quelles difficultés ils posent à des élèves non francophones.
2.1 Les organes participant à la parole
Nous nous occuperons d'abord des organes articulateurs, et puis, plus succinctement, des organes auditifs.
2.1.1 Les organes phonateurs
Les organes participant à la phonation, outre le cerveau et le système nerveux, sont:
les poumons, fournisseurs d'air,
les bronches et la trachée-artère,
le larynx, qui contient les cordes vocales,
le pharynx, carrefour de plusieurs voies,
les fosses nasales et le nez,
la langue, en particulier la pointe et le dos,
les alvéoles, le palais dur, le palais mou (appelé aussi voile du palais), la luette,
les dents,
les lèvres.
Vous avez sans doute quelques petits problèmes avec l'anatomie en langue française : nous allons représenter tout cela sur un schéma. Cependant, comme les poumons, les bronches et la trachée-artère sont de simples fournisseurs d'air, et qu'ils fonctionnent de la même façon pour chacun des sons, nous nous limiterons aux organes supra-glottaux, c'est-à-dire ceux qui sont situés au-dessus des cordes vocales.
Imaginez que, d'un coup d'épée, nous coupions une personne de haut en bas: nous obtiendrons ce que l'on appelle une coupe sagittale du genre de celle-ci:
Pour faire plus savants, nous aurons besoin d'employer les adjectifs correspondant à ces organes. Voici un tableau qui vous permettra de retrouver l'adjectif correspondant aux organes ou aux parties anatomiques cités:
Organes ou parties anatomiques
adjectif correspondant
(au féminin)
cordes vocales
sonore (contraire: sourd)
fosses nasales et nez
nasale
langue pointe
dos
apicale (apico-)
dorsale (dorso-)
lèvres
dents
alvéoles
palais dur
voile du palais
luette
pharynx
larynx
labiale
dentale
alvéolaire
palatale
vélaire
uvulaire
pharyngale
laryngale
Les cordes vocales sont capables de vibrer. Elles vibrent environ à 100 Hz (vibrations par seconde) chez les hommes, 200 Hz pour les femmes et 300 Hz pour les enfants.
Le voile du palais est très important. Outre le fait qu'il vibre chez certains dormeurs, provoquant alors un ronflement intempestif, il est capable de se soulever, fermant alors le passage vers le nez, ou de s'abaisser, ce qui permet alors à une partie de l'air de passer par le nez. Dans ce dernier cas, et si les cordes vocales vibrent, les fosses nasales vont également entrer en vibration, et le son sera nasal.
Nous reparlerons des organes ci-dessus lorsque nous décrirons les divers phonèmes.
2.1.2 Les organes responsables de l'audition
Outre le cerveau et le système nerveux (ici, nerf auditif), l'organe responsable de l'audition est bien évidemment l'oreille (au nombre de deux, comme vous vous en doutez ).L'oreille se compose de:
l’oreille externe
l’oreille moyenne
l’oreille interne
contenues dans un os, le rocher.
L'oreille externe se compose du pavillon, du conduit auditif externe, et du tympan.
L'oreille moyenne se compose de la caisse du tympan, dans laquelle se trouve la chaîne des osselets, la trompe d'Eustache, qui communique avec le rhinopharynx, et la paroi interne, qui communique avec l'oreille interne par la fenêtre ovale (où se rattache l'étrier) et la fenêtre ronde.
L'oreille interne, qui se compose, entre autres, du labyrinthe membraneux (membrane basilaire, membrane de Reisner, canal cochléaire) et des canaux semi-circulaires, ces derniers étant responsables de l'équilibre.
Pour rester simple, disons que le son pénètre dans l'oreille par l'oreille externe. Il fait vibrer le tympan. Celui-ci ne peut vibrer que si la pression est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'équilibre est rétabli par l'ouverture de la trompe d'Eustache, qui a lieu lorsque l'individu déglutit (lorsqu'il avale sa salive).
La vibration du tympan est transmise par la chaîne des osselets à l'oreille interne, par l'intermédiaire de la fenêtre ovale.
Les osselets transmettent le mieux les fréquences autour de 2000 Hz. C'est ce qui explique pourquoi c'est de 1000 à 3000 Hz que l'oreille est le plus sensible , alors qu'elle est capable de percevoir les sons de 16 à 16000 Hz, cette limite supérieure s'abaissant avec l'âge.
Les osselets transmettent le mieux les fréquences autour de 2000 Hz. C'est ce qui explique pourquoi c'est de 1000 à 3000 Hz que l'oreille est le plus sensible , alors qu'elle est capable de percevoir les sons de 16 à 16000 Hz, cette limite supérieure s'abaissant avec l'âge.
Le phénomène de l'audition est très complexe, et encore incomplètement connu. Notons que le décodage des vibrations en influx nerveux a lieu dans l'oreille interne.
Celle-ci est sensible aux variations d'intensité (son plus ou moins fort), de fréquence (son plus ou moins aigu) et de durée (son plus ou moins long).
L'oreille ne perçoit pas de la même façon les sons venus de l'extérieur, qui lui parviennent par l'oreille externe, portés par l'air ambiant, et les sons produits à l'intérieur, qui sont transmis par le rocher.
Ainsi, le locuteur entend sa voix par l'intérieur, alors qu'il entend celle des autres par l'extérieur. C'est ce qui explique que l'on soit si étonné lorsqu'on entend pour la première fois sa propre voix, enregistrée, et qui parvient donc pour la première fois à l'oreille par la voie aérienne.
L'oreille ne sert pas qu'à écouter les autres. Lorsque le locuteur parle, ses oreilles contrôlent en permanence sa production, permettant d'ajuster la voix lorsque l'articulation sort des normes.
Cette correction a du mal à s'établir lorsque la personne chante, alors qu'elle écoute une chanson avec son baladeur. L'oreille entend à la fois la voix de son propriétaire par la voie interne, et celle de la vedette (plus la musique) par la voie externe, ce qui la désoriente et explique pourquoi son propriétaire chante particulièrement faux.
Maintenant que nous avons fait connaissance avec les organes, nous allons voir comment ils fonctionnent.
2.2 Le système phonique du français
2.2.1 Les phonèmes du français
Nous allons considérer deux aspects: les phonèmes, et l'intonation.
Définitions
:
Par phonème, nous entendons un son de la parole, c'est-à-dire une unité linguistique de deuxième articulation. Un phonème représente la plus petite unité orale du langage, dénuée de sens. Les phonèmes servent à construire des unités de première articulation, qui sont les plus petites unités porteuses de sens (lexèmes, morphèmes, etc.).
Les phonèmes se divisent en deux grandes catégories: les consonnes et les voyelles, auxquelles nous ajouterons les semi-consonnes, qui sont des voyelles réalisées comme des consonnes.
Tout le monde croit savoir ce qu'est une consonne. Pourtant, rares sont ceux qui peuvent en donner une définition.
Notre définition des consonnes et des voyelles
Nous appellerons consonne un phonème qui est prononcé avec un obstacle. Une voyelle sera alors un phonème prononcé sans obstacle.
2.2.2 Les consonnes
2.2.2.1 Description des consonnes du français
Voyelles et consonnes
Lorsque l’on veut produire des sons, on a le choix entre deux méthodes de base :
on peut
faire vibrer les cordes vocales
, et la bouche reste assez ouverte pour que
l'air puisse sortir sans être gêné
. C'est le cas lorsque l'on prononce [a] ou [i]. L'air sort sans obstacle, et l'on produit donc
une voyelle
.
on peut aussi
mettre un obstacle sur le chemin de l'air
. L'obstacle gêne alors l'air. Cet air produit un bruit de frottement [s] (obstacle partiel), ou une explosion [p] (obstacle total). Comme il y a création d'obstacle, nous avons affaire à
une consonne
.
on peut bien sûr également combiner les deux méthodes en ayant un obstacle, accompagné de la vibration des cordes vocales. C'est le cas lorsque l'on prononce [b] ou [z].
La solution voyelle est celle qui produit la plus forte intensité. Si vous voulez, dans la rue, attirer l'attention de quelqu'un, il vaudra mieux produire une voyelle qu'une consonne.
Eh! Houhou! et au téléphone Allo!
En revanche, si nous allons ensemble au cinéma, et que je discute un peu trop pendant le film, vous me ferez taire discrètement en disant:
chut [∫t] où le [y] n'est pas prononcé.
Il y a plusieurs façons de réaliser un obstacle: la méthode utilisée s'appellera mode d'articulation.
Le lieu d'articulation, lui, décrit l'endroit où l'obstacle est réalisé. Cet endroit dépend de l'organe utilisé.
Pour décrire une consonne, on précisera: - son mode d'articulation
Le mode d'articulation
La première façon de réaliser un obstacle, c'est d'empêcher l'air de passer complètement. L'air s'accumule alors derrière l'obstacle, la pression augmente, et lorsqu'elle atteint une valeur suffisante, l'obstacle cède, et l'air sort brusquement en produisant une explosion. On appellera une consonne produite de cette façon une occlusive
obstacle total → occlusive
Il y a, en français, plusieurs occlusives:
Les occlusives du français
sourdes:
[p],[t],[k]
poutoicou
sonores:
[b],[d],[g]
bondesgars
nasales:
[m],[n],[]
moinoschampignon
La seconde façon est de réaliser un passage étroit, si étroit que l'air ne peut passer qu'en frottant fortement sur les parois. L'air produit des tourbillons, et le tout produit un bruit.
On appellera une consonne produite ainsi une constrictive.
obstacle partiel → constrictive
Il y a plusieurs constrictives en français:
Les constrictives du français
sourdes:
[f],[s],[∫]
fousoichou
sonores:
[v],[z],[],[]
volzoojoueroue
Pour certaines autres consonnes, un organe capable de vibrer (la pointe de la langue, ou la luette) s'oppose au passage de l'air. Le courant d'air repousse l'obstacle, mais celui-ci, tendu, se met à vibrer. On appelle ces consonnes des vibrantes.
Le français en connaît deux:
Les vibrantes du français
sonore
[r],[R]
r
oue
La première, qui fait vibrer la pointe de la langue, correspond au /r/ des paysans ou gendarmes de comédie, la seconde au /r/ qui vibre lorsque l'on est énervé, et que l'on dit « J'en ai marre! », beaucoup d'air sortant de la bouche et faisant vibrer la luette.
Enfin, une consonne est réalisée au moyen d'un obstacle partiel, placé de telle façon que l'air sort par les côtés de cet obstacle. Avant la fin de la réalisation, l'obstacle cède, produisant un léger bruit. Cette consonne se nomme latérale. Il s'agit de la consonne:
La latérale du français
sonore
[l]
l
ibe
ll
u
l
e
le lieu d'articulation
Les consonnes sont classées également selon l'endroit où se réalise l'obstacle. Voici un schéma de la cavité buccale, et l'adjectif correspondant à l'endroit où l'obstacle est formé:
Labiale, dentale, labiodentale, alvéolaire, palatale, vélaire, uvulaire, pharyngale, laryngale
En combinant la langue et le lieu :
Apico-alvéolaire, dorso-palatale,
Et avec la participation des fosses nasales :
Nasale (contraire : orale)
Parmi les consonnes, nous aurons:
1. des bilabiales: l'obstacle est formé par les deux lèvres:
bilabiales
sourde
sonore
nasale
[p] pou
[b] bout
[m] mou
2. des labiodentales: la lèvre inférieure vient toucher les dents supérieures
labiodentales
sourde
sonore
nasale
[f] fou
[v] vous
3. des apico-alvéolaires: la pointe de la langue entre en contact (occlusives, vibrante, latérale) avec les alvéoles, ou s'en approche (constrictives)
apico-alvéolaires
sourdes
sonores
nasale
occlusives
[t] tout
[d] doux
[n] nous
constrictives
[s] sou
[z] zoo
vibrante
[r] roue
latérale
[l] loue
4. des palatales: la langue vient toucher le palais, ou s'en rapproche.
pré-palatale: la langue se rapproche de la partie avant du palais
médiopalatale: la langue se rapproche de la partie médiane du palais
postpalatale: la langue se rapproche de la partie postérieure du palais
palatales
sourdes
sonores
nasale
occlusives
postpalatales
[k] coup
[g] goût
médiopalatales
[] vi
gn
e
constrictives
prépalatales
[∫] chou
[] joue
5 . des vélaires:le dos de la langue vient toucher le voile du palais
vélaires
sourde
sonore
nasale
[k] coup
[g] goût
Les phonèmes [k] et [g] sont des palatales devant des voyelles articulées à l'avant de la bouche, comme [i], et des vélaires devant des voyelles articulées à l'arrière, comme [u].
6. des uvulaires: le dos de la langue se rapproche de la luette:
uvulaires
sourde
sonores
nasale
constrictive
[] roue
vibrante
[R] roue
Voici les consonnes replacées sur leur point d'articulation:
Les occlusives
sourde
sonore
Orale
nasale
1
p
b
m
3
t
d
N
4 a
4 c
k
g
7
?
Les constrictives
sourde
sonore
2
f
v
3
s
z
4
∫
j
6
Les vibrantes et la latérale
vibrantes
latérale
3
r
l
6
R
2.2.2.1.1 Quels sont les problèmes posés par les consonnes?
2.2.2.1.1.1 Problèmes des occlusives
Sourdes /sonores
Le premier problème vient du fait que les différentes langues n'ont pas la même façon d'articuler les occlusives sourdes:
Sur ce schéma, vous voyez /pa/ observé sur un oscilloscope. Ce document se lit de gauche à droite.
Au début, la courbe est plate. C'est le moment où, la bouche étant fermée, l'air s'accumule derrière les lèvres. La courbe quitte tout à coup la ligne zéro, et une vibration a lieu: elle représente la voyelle [a].
Le premier battement de cette vibration est l'explosion du [p]. Rien de bien enthousiasmant pour l'instant.
Regardez à présent le document n° 2. Il représente aussi /pa/, mais prononcé par un Allemand. Vous reconnaissez le début plat, la vibration du [a], mais l'explosion du [p] est beaucoup plus forte que pour le français, et entre l'explosion et la voyelle, on dénote une dépression, un trou assez important. A quoi est due cette différence?
Le Français:
ferme les lèvres et les cordes vocales
presse l'air contenu dans les poumons. Cet air presse contre les cordes vocales. Sous la pression, le larynx remonte légèrement. La pression de l'air placé entre les cordes vocales et les lèvres augmente légèrement.
ouvre les lèvres. L'air enfermé entre les cordes vocales et les lèvres sort en explosant. Comme la pression est faible, l'explosion l'est aussi. Comme les cordes vocales sont fermées, elles sont tendues, et peuvent se mettre à vibrer instantanément.
L'Allemand:
ferme les lèvres, mais laisse les cordes vocales ouvertes.
presse l'air contenu dans les poumons. Cet air passe entre les cordes vocales et vient presser contre les lèvres. La pression de l'air est forte, car les poumons ont de la force.
ouvre les lèvres. L'air sort en explosant. Comme la pression est forte, l'explosion l'est aussi. Comme les cordes vocales sont ouvertes, elles ne sont pas encore tendues. Elles se tendent donc pour vibrer. Pendant le temps qu'elles mettent à se tendre, de l'air continue à sortir. Les cordes vocales, en se fermant, créent un obstacle partiel, si bien que l'air produit un bruit. Ce bruit n'est autre qu'un souffle s'apparentant au [h], et qui représente cette aspiration caractéristique des langues germaniques.
Ce problème ne serait pas très important si ce [h] ne faisait pas partie d'un système.
Il est banal de dire qu'en français, les consonnes sourdes et sonores s'opposent. Par exemple, poisson et boisson ne s'opposent que par le [p], qui est sourd, et le [b], qui est sonore. Tout le reste est identique. Nous savons en effet que [b] est un [p] sonore. L’oscillogramme n°3 le montre bien: pour [ba], la ligne n'est plus plate: il y a une vibration, qui correspond à l'activité des cordes vocales.
La différence entre [p] et [b] est donc fondamentalement une différence sourde / sonore.
Notons aussi deux différences annexes:
la constrictive sourde est prononcée avec plus d'énergie que la sonore.
la constrictive sourde est plus longue que la sonore. En effet, la phase où la pression d'air augmente ne peut durer très longtemps si les cordes vocales vibrent, puisque, pour chaque vibration, un peu d'air franchit le larynx. L'air s'accumulant entre le larynx et les lèvres, la pression au-dessus des cordes vocales finit par être aussi élevée que la pression au-dessous, ce qui finit par bloquer le mouvement des cordes vocales, qui ne peuvent plus se soulever.
Si vous regardez maintenant l’oscillogramme n° 4, réalisation allemande de [b], vous verrez qu'il n'y a pas de vibrations avant l'explosion de l'occlusive.
Ainsi, le /b/ est réalisé sans vibration des cordes vocales. Ce /b/ allemand est donc un /p/ français.
En fait, il y a des Allemands qui réalisent les occlusives sonores comme les Français, d'autres, les plus nombreux, les réalisant sourdes. Donc, pour les Allemands:
La différence fondamentale entre /p/ et /b/, c'est que [p] est réalisé avec un souffle [ph], alors que /b/ est réalisé sans souffle, [b] ou [p].
Nous avons trois réalisations concurrentes:
son produit
identifié par les Français comme
par les Allemands comme
[p
h
]
/p/
/p/
[p]
/p/
/b/
[b]
/b/
/b/
Vous voyez sans peine le problème qui se pose pour le [p], que les Français identifient comme un /p/, alors que les Allemands l'identifient comme un /b/.
Si une Allemande (ou encore une Autrichienne ou une Suissesse alémanique) commande une bière dans un café, et qu'elle ne parle pas trop bien le français, elle peut très bien commander: [ynpjεR], ce qui amènerait le garçon à comprendre: une pierre. Heureusement, les pierres ne font pas partie des boissons disponibles, si bien qu'il ne s'en rendra sans doute pas compte.
Le problème serait différent si cette cliente de café travaillait sur un chantier, où se trouvent aussi bien des pierres que des bières.
Le problème révèle toute son ampleur si l'on essaie de trouver d'autres exemples:
bon / pontrade / ratepoisson / boisson
et si l'on sait que la différence entre sourdes et sonores n'existe guère pour les constrictives allemandes, le problème devient encore plus inquiétant:
ils sont ←→ ils ont / poisson ←→ poison / cadeau ←→ gâteau / cou ←→ goût / car ←→ gare
Le //, comme Champagne
Le phonème / / n'est pas très important, puisqu'il a une fréquence d'emploi de 1/10 000 (on en prononce un tous les 10 000 phonèmes).
Pourtant, il nous intéresse car c'est un bon exemple de tricherie.
// est une consonne occlusive médiopalatale sonore nasale. Dans la phase d'occlusion, la pointe de la langue se place contre les dents inférieures, et c'est le dos de la langue qui vient toucher le palais dur.
Les étrangers ne disposant pas de ce phonème vont le réaliser en deux étapes:
comme il s'agit d'une nasale, ils prononcent d'abord /n/ (pointe de la langue contre les alvéoles.
Et comme il s'agit d'une palatale, ils rajoutent la constrictive palatale /j/.
Cette tricherie n'est pas bien méchante. Il est d'ailleurs bien difficile de distinguer, à l'oreille, la copie de l'original. Il y a d’ailleurs des Français qui trichent aussi. Comme ils ont appris « sur le tas », ils répètent ce qu’ils croient entendre, et s’ils croient entendre /nj/, ils répètent /nj/. Si personne ne les corrige, ils vont persister dans leur erreur.
Problèmes du coup de glotte
Le coup de glotte / ? / est une consonne occlusive sourde laryngale. Cela signifie que l'occlusion est faite par la fermeture des cordes vocales, comme quand on veut tousser.
En allemand, il n'y a pas de mot qui commence, oralement parlant, par une voyelle. En effet, un mot comme Aachen (=Aix-la-Chapelle) se prononce /?a:xn/.
Le français n'utilise le coup de glotte que dans un cas spécial: lorsqu'il veut produire une voyelle très forte. Par exemple, si un enfant traverse devant un autobus, on va crier: « attention! » en faisant précéder le /a/ d'un coup de glotte, ce qui lui donnera une amplitude beaucoup plus grande.
Dans les autres cas, le français ignore le coup de glotte. Cela lui pose d'ailleurs des problèmes lorsqu'il y a contact entre deux voyelles, que l'on nomme hiatus. Le passage d'une voyelle à une autre est difficile, car on entend toutes les positions prises par la langue passant de la position de la première voyelle à la position de la deuxième.
Pour éviter ce choc, la langue a recours à plusieurs méthodes:
élision d'une voyelle
:
*le éléphant→l'éléphant
*la auto→l'auto
réveil d'une consonne latente:
(d'une consonne qui dort)
il pleut → pleut-illes→les âmes
[ ilplø ] → [ pløtil ][ le ]→[ lezam ]
insertion d'une consonne:
il va→va-t-il
[ilva]→[vatil]
En revanche, le locuteur allemand, qui va utiliser un coup de glotte, même en français, n'aura pas besoin de faire de liaison, puisqu'il place, devant les mots qui commencent par une voyelle, la consonne [?]. Il évitera donc de faire les liaisons, ce qui est incompatible avec un bon apprentissage du français.
Ainsi, le locuteur allemand dira sans sourciller [ilaRiv]pour [ilzaRiv], mettant un pluriel au singulier.
Vous avez déjà compris que nous retrouverons tous ces problèmes dans divers autres chapitres.
2.2.2.1.1.2 Problèmes des constrictives
La constrictive palatale //
Si pratiquement toutes les langues disposent de la constrictive palatale sourde /∫/, beaucoup moins disposent de son équivalent sonore //.
Les Allemands, par exemple, n'en ont pas, même s'ils ont emprunté au français le mot génie, que la plupart prononcent *[∫eni].
Un grand nombre d'Allemands apprenant le français ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à un son inconnu. Le crible de la langue maternelle fonctionne alors en rapprochant ce phonème de [∫].
Pourtant, on a affaire quelquefois à des apprenants qui ont fait de l'anglais, et qui remarquent rapidement qu'il s'agit de la sonore correspondant à [∫].
Malheureusement, l'anglais ne connaît ce son qu'en combinaison avec [d], comme dans le mot judge, qui se prononce []e].
Alors, jus deviens [], ou jeu [dø].
sourdes et sonores
Le problème des sourdes / sonores, que nous avons largement abordé à propos des occlusives, touche aussi les constrictives.
[s]
→
[z]
la rose
→
la rosse
le poison
→
le poisson
le frison
→
le frisson
l'alaise
→
la laisse
cessons
→
saison
Le problème est encore plus grave lorsqu'il atteint les liaisons, surtout celles qui traduisent le pluriel:
[ z ]
→
[ s ]
elles aiment
→
elles sèment
elles ont
→
elles sont
elles envoient
→
elles s'envoient
problèmes du /r /
Le /r/ est un problème pour les anglophones, qui ont un /r/ à un seul battement, qui font qu'on les reconnait de loin. Mais le /r/ placé après voyelle, en fin de syllabe, est encore plus problématique.
En effet, les anglophones et les germanophones réalisent le /r/ en position finale comme une voyelle, ou, après un /a/ ou un /o/, se contentent d'allonger la voyelle.
En français, le /r/ vocalique est inconnu, et l’auditeur ne le remarque même pas. Cela revient à ignorer tous les /r/ après voyelle.
Par exemple, le mot porte devient alors [po:t], que le Français identifie comme pote (=ami, en langage familier), le mot sorte devient [so:t], sotte, etc.
Cette faute est d'autant plus ennuyeuse que, selon les statistiques, le /r/ est le son le plus employé du français, et qu'il se retrouve mêlé à la conjugaison (sortirent), et dans les terminaisons féminines d'adjectifs (fière, primesautière) et de noms de métiers (boulangère, couturière, meunière), sans compter les mots masculins en -eur...
2.2.2.2 Les voyelles
On représente en général le système des voyelles par un trapèze.
Leur position sur le trapèze correspond en gros à la position du sommet de la langue, c'est-à-dire le point de la langue le plus élevé au moment de l'articulation.
Or, dans la nature, un son ne se compose pas d'une seule vibration. le F0 s'accompagne de toute une famille, les harmoniques, dont la valeur est celle du fondamental, multipliée par la suite des nombres entiers positifs.
Voici un tableau montrant la fréquence des harmoniques en fonction du fondamental
Au sortir du larynx, la vibration des cordes vocales ressemble donc au schéma suivant. On remarquera que plus l'harmonique a une fréquence élevée, plus son amplitude (intensité) est faible.
Ce matériau sonore va être déformé par les organes phonateurs. Selon la forme (position de la langue), la longueur (lèvres en avant ou non), le volume laissé à l'air (langue en haut, ou en bas de la cavité buccale), et l'ouverture ou non du passage vers les cavités nasales (voile du palais abaissé ou non), certains harmoniques seront amplifiés, d'autres étouffés, d'autres enfin resteront tels quels, si bien que le son qui sort des organes phonateurs sera très différent du son produit par les cordes vocales, et pourra avoir des réalisations très diverses.
Voici ce qui reste à la sortie pour deux voyelles, /i/ et /a/.
Pour des raisons de commodité, nous ne montrons que les harmoniques de 200 à 3000 Hz, ce qui, d'ailleurs, suffit pour décrire les voyelles.
Les formants de [i] sont très éloignés l'un de l'autre. C'est pour cette raison que l'on dit que [i] est une voyelle diffuse. En revanche, les formants de la voyelle [a] étant très rapprochés, celle-ci est dite compacte. Les formants des autres voyelles se situent entre les valeurs de celles-ci.
On notera:
→ que les voyelles [i], [y] et [u] sont fermées (la langue s'approchant assez du palais, pas assez cependant pour que se forme un obstacle).
→ que les voyelles mi-ouvertes / mi-fermées marchent par couple, une plutôt fermée, l'autre plutôt ouverte:
version fermée
version ouverte
[e] et
[
ε
] air
[
ø
] œufs
[œ] œuf
[o] pot
[] port
→ que les Français du midi n'ont pas la même façon d'employer ces voyelles:
nord
midi
la paix
[
pε
]
[pe]
veule
[
vøl
]
[
vœlә
]
pauvre
[povR]
[pvR
e
]
→ que les voyelles [y], [E], [oe], [u], [o], [] sont arrondies, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées les lèvres projetées en avant.
→ Le français dispose d'un e muet /ә /, même si, souvent, il est élidé. Ce n'est pas le cas de l'italien, ni de l'espagnol, par exemple.
→ parlons rapidement des deux versions du a, [a] et [α]. Ma grand-mère Lucie, parisienne, faisait encore la différence entre le [a] de patte, et le [a] de pâte.
De nos jours, le [α] arrière ne se trouve plus que dans certaines régions (région de Reims), où il remplace [a], ou dans la catégorie des snobs (« Quelle génération, ma chère!»).
→ Enfin, le français dispose de quatre nasales.
Il s'agit en fait de voyelles pour lesquelles la langue se place comme certaines voyelles orales connues, et pour lesquelles, en plus, le voile du palais s'abaisse. Un peu d'air passe alors par le nez, et les fosses nasales se mettent à vibrer, créant un formant nasal de 500 Hz environ, qui va gêner la formation du F2.
Voici donc les voyelles nasales. Cette nasalité est marquée par le signe diacritique [~]:
[ ] bain, main, teint, thym, examen
[ õ ] mon, bombe
[ ] un, brun
[ ã ] an, dent, ambre, faon, Rouen, Saëns
On notera que certaines régions de France, telle la région parisienne, remplacent systématiquement [ ] par [ ].
Enfin, on ne peut oublier de signaler que, dans le midi de la France, on ignore systématiquement les voyelles nasales. On les remplace par leur correspondante orale, et on ajoute l'appendice nasal [ŋ].
bouton: [butoŋ] au lieu de [butõ]
2.2.2.3 Les semi-voyelles
Les semi-voyelles, ou semi-consonnes, sont en fait des voyelles que l'on réalise, dans certaines conditions, en consonnes.
Il n'y a que 3 voyelles susceptibles d'être réalisées en consonnes. Il s'agit des voyelles les plus fermées, à savoir: [i], [y] et [u].
Les semi-voyelles viennent du fait que le Français déteste le contact entre deux voyelles. Nous en avons parlé en examinant les problèmes de la liaison.
Lorsque deux voyelles se suivent, et que la première est une des trois voyelles fermées, la langue monte un peu plus haut qu'elle ne le devrait, et se rapproche de la voûte du palais. Le passage devient alors étroit, et il se forme un obstacle. Au son produit par les cordes vocales s'ajoute alors un bruit. Nous avons donc affaire à une consonne.
oui
lui
Louis
yeux
[wi]
[li]
[lwi]
[jø]