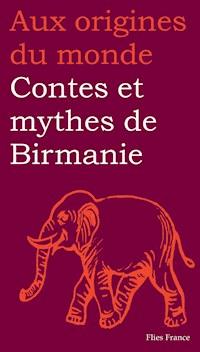Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Flies France Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aux origines du monde
- Sprache: Französisch
Un florilège de mythes, de contes et de légendes permet de pénétrer dans l'imaginaire de Chine
Jadis vivait un khan que tout le monde appelait le khan volant. Durant sa jeunesse, il s'était enamouré d'une jeune fille très belle, une fée, ressemblant à la lune. Ses yeux brillaient comme l'or. Le khan la chercha dans le monde entier sans parvenir à la trouver. D'un magicien, il apprit de voler en l'air. Il chercha sa beauté dans le ciel durant trente ans, en vain. En désespoir de cause, il la fit dessiner et peindre selon ses indications. Il cacha le tableau dans une salle du trésor de son palais. Il se dit : "Pour moi, cela suffit. Me voilà d'âge mûr. Il est temps que je fonde un foyer". Il épousa une autre femme, qui lui donna un enfant du nom de Jiangde Bator ("le preux"). Ayant atteint quinze-seize ans, ce garçon devint un hardi gars. Sans pareil ! Un jour, il eut un éclair. S'il fouillait les salles du trésor de son père ? Il se mit à examiner les quarante salles. Il en fouilla trente-neuf. Mais pour la quarantième, pas de clef. Il fouilla, tortura la serrure en vain. Il appela sa mère, la supplia de lui trouver la clef.
À PROPOS DE LA COLLECTION
« Aux origines du monde » (à partir de 12 ans) permet de découvrir des contes et légendes variés qui permettent de comprendre comment chaque culture explique la création du monde et les phénomènes les plus quotidiens. L’objectif de cette collection est de faire découvrir au plus grand nombre des contes traditionnels du monde entier, inédits ou peu connus en France. Et par le biais du conte, s’amuser, frissonner, s’évader… mais aussi apprendre, approcher de nouvelles cultures, s’émerveiller de la sagesse (ou de la malice !) populaire.
DANS LA MÊME COLLECTION
•
Contes et légendes de France
•
Contes et légendes de Laponie
•
Contes et légendes du Japon
•
Contes et légendes d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche
•
Contes et récits des Mayas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Sources
La plupart des contes traduits ici proviennent d’une revue intitulée Minjian wenxue (Littérature (orale) populaire) publiée à Pékin à partir des années 1970. La plupart des contes étiologiques concernant les animaux ont été regroupés dans une publication intitulée : Zhongguo dongwu gushi ji, Shanghai, 1980.
Les contes étiologiques spécifiquement chinois (de l’ethnie han, majoritaire en Chine, 92 % de la population totale) sont relativement rares. Depuis toujours, les Han sont friands d’histoires de fantômes, ou relatant des phénomènes extraordinaires, chuanqi, que nous évoquerons en annexe. Les contes oraux racontés encore actuellement sont surtout trouvés parmi les minorités ethniques (plus de cent millions de citoyens chinois) du sud et de l’ouest du pays. Tous les textes ont été traduits du chinois, sauf quelques contes que j’ai traduits du paiwan (ethnie de Formose, n° 44, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 93) et du mongol (n° 64, 65, 66). Les contes xasak(e), sont traduits du chinois : c’est donc une double traduction. La graphie du mot khazak peut intriguer. Nous utilisons khazak pour le peuple, xazak (transcription partielle du pinyin : ce devrait être en fait hasake) pour les contes traduits du chinois. Il existe encore les graphies kazakh (du Larousse) et qazaq (Dor, Rémy, Manuel de qazaq, Paris, Inalco, 1997), que nous écartons ici.
Principes de traduction
Les onomatopées, intraduisibles, sont conservées dans la transcription pinyin. Elles émaillent les récits oraux, et ce serait dénaturer les contes que de les omettre. La traduction est un compromis entre le style familier, et le style académique. Le contraste entre les deux styles peut provoquer des moments de jouissance comique. Les contes paiwan sont traduits très près du texte, ce qui peut donner une impression bizarre au lecteur. Nous avons voulu ainsi préserver leur authenticité. Les autres contes, traduits du chinois, à part les contes han, sont en réalité une seconde traduction (car ils ont été dits à l’origine dans les langues des minorités ethniques). La traduction en est d’autant plus éloignée de l’original. Si l’on considère le texte chinois, il est pauvre lexicalement, et ne recule jamais devant les répétitions. Ces traits ne peuvent pas être conservés en français, où l’on évite les répétitions, quitte à puiser dans un réservoir de synonymes. J’ai donc eu l’impression, en traduisant, de passer mon temps à ajouter des couleurs à un film en blanc et noir. Je me suis amusé… J’espère que le lecteur ne s’ennuiera pas.
Contes étiologiques
Astres
1.Origine du soleil et de la lune
Cette histoire s’est passée il y a très longtemps, après que soleil et lune eurent été dévorés par une ogresse. Sur une très haute montagne vivaient une mère et ses deux filles. La mère, âgée d’une trentaine d’années, avait très bon cœur. La fille aînée, nommée Apei, avait douze ans. La cadette, nommée Aniu, avait six ans. Chaque jour, la mère disait à ses filles :
— Jadis, il y avait un soleil et une lune. C’était le bon temps. Le jour, soleil brillait ; la nuit, lune ronde luisait. Chaque jour, soleil et lune prodiguaient chaleur et clarté aux humains. Ceux-ci les vénéraient, mais une ogresse aux mille métamorphoses et dix mille avatars avala lune et soleil. Dès lors, le ciel s’obscurcit. Tout devint sombre : on ne distinguait plus les humains des ombres. Les esprits de toutes sortes étaient virulents, faisaient des vagues, apparaissant afin de nuire aux humains, et de leur infliger toutes sortes de blessures. La vie devint amère. On ne trouvait plus de méthode pour gagner sa vie. On semait en tâtonnant dans le noir. Les cultures ne poussaient pas bien.
La mère, poussant de longs soupirs, ajoutait :
— Si quelqu’un pouvait aller tuer cette ogresse, afin de ressusciter soleil et lune, comme ce serait chouette !
La mère racontait souvent ce conte, et les filles l’aimaient beaucoup. C’était leur favori. Elles appréciaient le travail de soleil et de lune, qui jadis, offraient chaque jour lumière et chaleur aux humains ; elles détestaient l’ogresse, se juraient de devenir à leur tour soleil et lune, afin de rendre aux humains chaleur et lumière.
Dès lors, les deux sœurs aidèrent encore davantage leur mère et plus joyeusement. Malgré son jeune âge, la cadette aimait imiter son aînée, apprenant à balayer, faire le feu, nourrir les poulets, garder les canards. La mère les félicitait :
— Si vous travaillez ainsi chaque jour, pour sûr que vous pourrez devenir soleil et lune !
Mais un soir que la mère était allée chercher de l’eau dans un seau qu’elle portait sur son dos, elle fut dévorée par Milaominao, une ogresse fort rusée, qui voulait aussi dévorer les deux filles. Elle prit la forme de leur mère, et se pointa à leur maison, portant le seau d’eau sur son dos. Arrivée à la porte, l’ogresse, avec une drôle de voix, demanda l’accès :
— Mili mili, « petites ! », votre maman est revenue.
Impatiente de revoir sa mère, la cadette allait ouvrir la porte, mais l’aînée sentit que cette voix ne ressemblait pas à la voix maternelle. Elle retint la cadette, et dit vers la porte :
— Vous n’êtes pas notre maman. Montrez d’abord votre patte par la fente.
L’ogresse passa sa main, qui parut toute noire et rugueuse. Les filles la tâtèrent : la main était glacée. Elle comprirent que ce ne n’était pas la main de leur maman : les doigts semblaient griffés et brisés ; le sang coulait à terre.
— Sur les mains de maman, il n’y a pas de sang ! s’exclamèrent-elles.
L’ogresse, se voyant démasquée, étendit les doigts, les frotta dans le tas de cendres plusieurs fois, les montra à nouveau, disant :
— Regardez ! il n’y a pas de sang sur mes doigts.
Mais les filles s’écrièrent aussitôt :
— Il n’y a pas de cendre sur les doigts de maman.
L’ogresse était perplexe : comment entrer dans la chambre avec ou sans tromperie ? Elle réfléchissait, quand elle entendit la cadette dire imprudemment :
— Si c’était maman, elle serait entrée par le trou du mur.
A ces mots, l’ogresse, ravie, leva la tête, jeta un coup d’œil à droite. Sous l’auvent, il y avait en effet un trou dans le mur. Elle s’y glissa, appela les filles :
— Fifilles ! celle d’entre vous à qui c’est le tour ce soir de dormir avec maman, qu’elle se lave vite les pieds !
L’aînée avait des doutes. Mais la cadette, cette naïve, comment pouvait-elle savoir que dans la chambre se trouvait une ogresse ? Alors, elle cria :
— C’est mon tour ! et elle dit à l’aînée de l’aider à se laver les pieds. L’aînée, oyant la différence entre la voix de sa mère et cette voix-là, avait des soupçons. Mais elle ne trouvait pas le moyen de persuader sa cadette de ne pas croire l’être qui se cachait dans la chambre. Elle lui lavait les pieds, et, en même temps, elle les oignait de crottes de poulet (que les ogresses abhorrent). Exprès, elle faisait traîner en longueur les opérations. Mais la naïve cadette cria :
— Maman ! grande sœur ne me lave pas bien les pieds ! Elle les enduit de crottes de poulet ! Cela pue !
L’ogresse vit bien qu’Apei était très intelligente, et l’avait devinée. Elle se domina pourtant, persuada Apei de ne pas jouer de farces à Aniu, et de se hâter de lui laver les panards. Apei, à bout de ressources, termina vite sa tâche. L’ogresse dit à Apei, d’un ton comminatoire :
— Demain, tu devras aller couper du bois, alors, couche-toi tôt !
En réalité, l’ogresse avait dans son cœur un plan bien enfoui. C’était d’attendre minuit, que les deux mômes soient bien endormies. D’abord, dévorer Aniu ; et plus tard Apei.
Et en effet, Aniu sombra dans le sommeil, tout d’une masse. Afin de duper Apei, l’ogresse feignit un sommeil de mort, et poussait de longs ronflements.
Mais Apei n’osait pas du tout se livrer au sommeil. Elle dressait l’oreille, aux aguets, essayant de savoir ce qui se passait à l’étage. Mais c’était quand même un enfant : après une journée entière à garder le bétail, elle était bien lasse. La nuit s’était approfondie. Apei ferma involontairement les yeux et se mit à rêver qu’elle était dans la montagne, en train de fendre du bois. Son cœur battait : poupou ! Elle suait à grosses gouttes. Elle se retourna : un vieillard haut et maigre, au large visage rose, la barbe tombant jusqu’à terre, lui apparut. Il avait sur le dos un manteau de paille ; dans les mains, une canne tordue. Il dit :
— N’as-tu pas peur, de couper le bois, toute seule dans la montagne ?
— Je n’ai pas peur ! répondit Apei d’un ton résolu.
— Dans cette montagne, rôdent souvent des tigres !
— J’ai un coutelas, interrompit Apei, sans attendre que le vieux termine sa phrase.
— Ma fille, tu es courageuse. Avec ton intelligence et ta hardiesse, pour sûr que tu pourras te rendre maîtresse de l’ogresse qui a gobé soleil et lune.
Entendant ces deux syllabes : ogresse, Apei fit un bond de frayeur. Elle voulut encore demander quelque chose. Mais elle sentit soudain une bouffée de vent bleu-noir, et le vieillard devint invisible. A son réveil, Apei était couverte de sueur, et son cœur battait fort : poupou !
— Est-ce encore un rêve ? se demanda-t-elle Non ! c’est bien ce que le vieux m’a dit. Il est venu nous porter secours. Ce n’est pas une tigresse qui dort avec Aniu. Mais il est fort possible que ce soit une ogresse.
Tandis qu’elle réfléchissait, elle entendit soudain des bruits : kabakaba, provenant de l’étage. Elle cria :
— Maman ! que manges-tu ?
— Rien, ton oncle m’a donné quelques pois grillés. Je grignote, voilà tout !
Apei se mit à réfléchir : « De coutume, maman ne se met pas à grignoter à la minuit ! » Soudain elle sentit quelque chose qui tombait sur le dos de son nez. Quelque chose de frais et humide. Elle tâta : c’était du sang ! Apei alla jeter encore un coup d’œil vers l’étage. Horrible vision : le visage de sa « mère », telle une laie, en train de croquer les doigts et les orteils de la petite Aniu ! Alors, pour Apei, tout s’éclaira : sa maman avait été positivement dévorée par la croquemitaine.
C’est sûr qu’Apei voulait maintenant venger sa mère et sa sœur cadette, donc, tuer cette ogresse au plus vite. Soudain, les viscères d’Aniu dégoulinèrent, gulugulu, tout près d’Apei. Avalant ses larmes, Apei enveloppa soigneusement les entrailles fumantes et sanglantes de sa sœur ; puis, elle voulut ouvrir la porte pour sortir. Mais ouvrir la porte, c’était se faire découvrir par l’ogresse. Il fallait trouver un prétexte :
— Maman, je vais faire pipi !
Entendant ces mots, la croquemitaine se hâta. Elle n’avait pas fini de dévorer la cadette. Elle voulait l’empêcher de sortir, mais craignit de laisser révéler sa vraie forme. Alors, l’ogresse voulut gourmander Apei par de simples paroles. Elle répondit comme si de rien n’était :
— Fais donc pipi au pied du lit !
— Maman, au pied du lit réside le dieu du lit !
— Eh bien ! fais pipi derrière le foyer !
— Derrière le foyer réside le dieu du foyer.
— Alors, fais pipi derrière la porte !
— Mais derrière la porte habite le dieu des portes. Maman, ne l’as-tu pas dit déjà ? Là où résident les dieux, interdit de pisser !
L’ogresse est à bout d’arguments. Elle se dit, avec indulgence, que la petite ne pourra pas échapper à ses monstrueuses pattes. Alors, d’une voix dolente, elle acquiesce en ces termes :
— Eh bien ! reviens vite ! et prends garde d’attraper froid !
Apei ouvrit la porte et s’enfuit bien loin. Jusqu’où s’enfuir ? Elle hésitait, quand le vieillard chenu au visage rose apparut devant elle, comme pour lui montrer la voie. Apei le suivit en hâte jusqu’à une fontaine. Là poussait un poirier sauvage, sur lequel Apei grimpa aussitôt. Elle sentit une bouffée d’air bleu-noir : le vieillard avait disparu.
Le lendemain matin, l’ogresse arriva près de la fontaine, lava le crâne d’Aniu. Sans le faire exprès, Apei laissa tomber de la salive, et l’ogresse l’aperçut :
— Enfant, où es-tu ? dit l’ogresse, observant Apei, la tête dressée, et laissant pendre une longue langue rouge sombre.
— Je cueille des fruits ! répondit Apei d’une voix soumise.
— Ah ! des fruits sûrement délicieux ! Donnes-en d’abord à goûter à maman, dit l’ogresse, extraordinairement alléchée.
— Maman ! attrape avec ta gueule !
Apei grimpa encore plus haut, cueillit une grosse poire toute rouge. La goule, l’ogresse goulue bava trois pieds de long de bave. Apei visa la gueule sanglante et grand ouverte de l’ogresse, et, de toutes ses forces, y lança le fruit. Sous le choc, l’ogresse eut les yeux qui lui sortirent de la tête, et resta sans réaction. Cette fois-ci, Apei enfonça une branche au fond de la gorge de l’ogresse, qui en creva.
Une fois morte, l’ogresse se transforma en un épais buisson d’épineux, xunma, très piquants, qui entoura entièrement l’arbre où Apei était juchée. Elle voulait faire mourir Apei sur son arbre. Tandis qu’Apei se trouvait dans cette situation critique, arriva un vieillard qui venait puiser de l’eau. Ce vieux n’avait pas la face rose, ni la longue barbe blanche qu’avait l’autre. Mais il portait un manteau de paille et s’appuyait sur un bâton tordu. Toute joyeuse, Apei lui dit :
— Vieux pépé, prête-moi ton manteau de paille. Je l’étalerai par terre. Alors, je me prosternerai devant toi, pour être ta petite-fille ! Tu m’adopteras.
— J’ai déjà une petite-fille, dit le vieux.
— Eh bien, je deviendrai ta seconde petite-fille.
— J’en ai une seconde aussi.
— Eh bien, je serai la troisième.
Et ainsi de suite jusqu’à dix.
— Eh bien, je serai la dixième.
Apei s’était juré de se faire adopter par le vieux. Celui-ci, voyant qu’elle avait le cœur sincère, étendit tout souriant son manteau de paille à terre.
Apei sauta. Considérant le vieux de près, elle vit qu’il avait autant de compassion que celui qu’elle avait vu en rêve. Elle avait confiancè en sa bonté. Elle lui raconta ses malheurs. Le vieux dit qu’il savait tout. Apei demanda :
— Pépé ! de ma cadette dévorée par l’ogresse, il ne me reste que le cœur. As-tu le moyen de la ressusciter ?
— Oui-da, dit le vieux, lissant sa barbe.
Un moment après, Apei s’adressa encore au vieux :
— Pépé, ma cadette, est-elle vivante ?
Le vieux lui répond d’un air majestueux et ému :
— Enfant, celle qui a essayé de te tuer, c’est justement l’ogresse qui a avalé soleil et lune. Mais ta cadette vit. Vois si tu peux la retrouver. Si tu la retrouves, toutes deux, vous pourrez devenir soleil et lune.
— Mais où est ma cadette ?
Apei, en Imagination, se représentait sa cadette, et, d’émotion, versait des cascades de larmes.
— Suis donc le bouvier ! dit le vieux calmement.
Apei avait encore envie de lui demander des explications, mais le vieillard puiseur d’eau avait disparu, sans laisser l’ombre d’une trace.
Alors Apei partit vers le bouvier, à la recherche d’Aniu. Le bouvier lui dit :
— Je n’ai pas vu ta cadette. Mais il vient juste de venir quelqu’un. Nous lui avons sacrifié un bœuf. Mais il ne mange pas de viande de bœuf. Il ne boit pas de bouillon de bœuf. Pipe (en crâne de bœuf) au bec, s’appuyant sur un bâton recourbé en corne de buffle, balayant l’air avec une queue de vache, il est parti avec le gamin qui garde les canards.
Alors, Apei partit en quête du gardien des canards.
— Avez-vous vu ma cadette ?
— Pas vu ! Seulement, tout à l’heure, quelqu’un est venu : nous lui avons sacrifié un canard, mais il n’absorbait ni la viande ni le bouillon de canard. Pipe (en tête de canard) au bec, s’appuyant sur un bâton torve en patte de canard, balayant l’air d’une queue de canard, il s’en est allé, suivant les gardiens des poulets.
Alors, Apei alla trouver les gardiens des poulets :
— Avez-vous vu ma cadette ?
— Pas vu. Seulement, il est venu tout à l’heure quelqu’un. Nous lui avons sacrifié un poulet. Mais il ne mangeait pas de viande de poulet, ne buvait pas de bouillon de poulet. Pipe (en tête de poulet) au bec, s’appuyant sur un bâton tordu en patte de poulet, balayant l’air ou le sol d’une queue de poulet, il est parti vers la mer.
Apei avait déjà traversé neuf montagnes et neuf fleuves. Sa robe était en lambeaux, ses pieds couverts d’ampoules. Mais pour retrouver sa sœur du côté de la mer lointaine, il fallait passer soixante-dix-sept monts, grands monts, et traverser soixante-dix-sept grands fleuves.
Apei était épuisée. Elle suspendit ses pas. Elle s’assit, et aussitôt s’endormit. « Continue à chercher ! » se disait-elle. « Ne dors pas ! » Elle rêvait à cet amour de sœur cadette, à leur serment commun : devenir soleil et lune. Afin de rendre lumière et chaleur à l’humanité ! Ne pas trahir l’espoir de leur mère. Alors, son corps s’emplit d’une ardeur, d’une énergie incroyable. Elle pensa que si elle allait jusqu’à l’horizon, là où la mer et le ciel se rejoignent, elle retrouverait nécessairement sa cadette.
Apei, assoupie un instant sur un rocher, s’éveilla, se sentit plus légère qu’une plume. Alors, elle ne distingua plus le jour de la nuit, elle marcha sans arrêt soixante-dix-sept jours, passa soixante-dix-sept monts, traversa soixante-dix-sept rivières, et enfin, atteignit le rivage marin.
Arrivée là, elle rencontra un très gros crapaud, et lui demanda :
— As-tu vu ma cadette ?
Le grand crapaud lui dit :
— Chut ! ne ris pas ! Laisse-moi boire la mer, cul sec ! et tu verras ta sœur !
Le crapaud rampa jusqu’au bord de la mer, pencha sa tête dans l’eau. En un rien de temps, il but, assécha la mer. Merveille ! la tête d’Aniu surgit, petit à petit. Puis ses hanches, ses pieds apparurent.
Apei la tira vers la rive et l’étreignit très fort :
— Sœurette ! que faisais-tu là ? J’ai eu bien du mal à te retrouver.
Aniu, essuyant ses larmes, dit à Apei :
— Grande sœur ! je te croyais morte. Je ne sais comment, plus je marchais, plus j’allais loin.
Voyant les yeux gonflés, rougis de son aînée, son visage tout griffu, elle enlaça fort le corps d’Apei :
— Grande sœur, devenons pour de bon soleil et lune ! je ne veux plus être loin de toi.
Apei essuya les larmes d’Aniu et dit :
— Sœurette, je resterai éternellement avec toi.
— Aînée, à ton avis, quel sera mon rôle ?
— Fais la lune ! La lune est comme ton cœur : pure comme perle.
— Faire la lune ? marcher de nuit ? cela m’effraye ! dit Aniu.
— Eh bien ! fais le soleil !
— Non ! grande sœur ! tu en es plus capable que moi. Fais le soleil, toi ! Moi, je ne ferai pas le soleil. Si je marche en plein jour, les hommes me verront, j’aurai honte.
Mais Apei connaissait bien la timidité de sa cadette : elle avait peur du noir. Eclairer en pleine nuit, cela demandait de la personnalité. Elle incita Aniu à devenir soleil :
— Tu donneras chaleur et lumière aux hommes. Ils t’en respecteront davantage. Je vais t’accrocher des aiguilles d’or qui leur piqueront les yeux s’ils veulent te dévisager.
Voilà l’origine de la lune et du soleil.
2.Le mariage du bouvier céleste
Jadis vivaient deux frères. L’aîné était marié. Le cadet, célibataire, travaillait toute la journée. Au petit déjeuner, il mangeait une soupe aigre. A midi, du riz fermenté. Quand le cadet était absent, l’aîné et sa femme se régalaient de plats savoureux.
Un jour, aux champs, le cadet avait labouré jusqu’à la mi-journée. La vache lui dit ces mots :
— Bouvier ! tu ne rentres pas manger ?
— Hélas, si je rentre tôt comme ça, ils vont m’injurier.
— Ha ! mais si tu as envie de rentrer, rentre donc !
— Comment cela ?
— Ne t’en fais pas. Au sud du champ, il y a un gros rocher. Labourons jusque-là. Casse le soc sur le roc. Alors, rentre à la maison !
Aussitôt dit, aussitôt fait. Peng ! voilà le soc en pièces, ayant donné sur le roc ! Et le bouvier de rentrer au logis.
Sa belle-sœur était en train de mitonner une galette. Le voyant rappliquer, elle s’écrie :
— Eh cadet, viens vite manger ! j’avais justement l’intention d’envoyer t’appeler.
Mais son frère aîné dit :
— Comment ! tu rentres si tôt du boulot !
— Le soc s’est brisé sur le roc.
L’aîné reste coi. Le cadet enfourne sa pitance. Le lendemain, il retourne au labour-labeur. Midi sonne. La vache l’interpelle :
— Bouvier ! midi ! l’heure du repas !
— Aujourd’hui, je ne rentre pas.
— N’aie pas peur ! Rentre donc !
— Comment faire ?
— Trois fois rien ! Du côté nord du champ, il y a un grand rocher. Labourons jusque-là. Tu casseras la charrue, et tu pourras rentrer.
Sitôt dit, sitôt fait. La vache fonce contre le roc, par-devant par-derrière, et crac ! voilà la charrue par terre !
Le cadet s’en revient au logis. A sa vue, sa belle-sœur l’enguirlande :
— Vilain diable sans tête ! te voilà revenu encore pour bâfrer !
Et l’aîné de renchérir :
— Pourquoi rentres-tu si tôt ?
— J’ai cassé la charrue.
— Heng ! alors c’est comme ça. Hier tu casses le soc sur le roc ! aujourd’hui la charrue ! Inutile que tu laboures désormais. Séparons-nous.
Le bouvier engloutit en silence des petits pâtés.
Le troisième jour, il alla labourer au champ. Midi sonne. La vache :
— Bouvier ! aujourd’hui, il y a des gâteaux à l’huile. Tu ne rentres pas à la maison ?
— Pas moyen. Hier, ils m’ont dit d’aller me faire voir ailleurs.
— N’aie crainte ! Rentre donc ! Cela n’a pas d’importance !
— Comment cela ?
— Va ! allons contre le roc du sud, y porter le timon.
La vache courut vers le roc, et locha ! voilà le timon cassé. La vache dit :
— Coupe donc cette plante grimpante qui retient la charrue, l’arrête-bœuf ! Après avoir mangé, tu diras ceci en te tournant vers moi :
La vache n’a pas mangé cette planteMoi je n’ai pas mangé de ce riz aigreLa vache aime brouter l’herbe lugenMoi j’aime les gâteaux à l’huile.
Si ta belle-sœur veut la séparation, dis-lui que tu veux seulement prendre la vache, la charrette cassée et la corde à nœuds.
Le voyant rentrer, la belle-sœur l’agonit d’injures :
— Diable sans cervelle ! te voilà encore revenu !
L’aîné, la main crispée sur le timon cassé, étouffait de colère. Mais ils n’allaient pas jeter au feu les gâteaux à l’huile. Le bouvier mangea sans un mot. Sa belle-sœur se taisait. Ayant fini son repas, le bouvier sortit dans la cour, et, se tenant devant la vache, il psalmodia ceci :
La vache n’a pas mangé cette planteMoi je n’ai pas mangé de ce riz aigreLa vache aime brouter l’herbe lugenMoi j’aime les gâteaux à l’huile.
Sa belle-sœur le vilipenda en ces termes :
— Diable sans cervelle ! ah ! tu sais parler ! on serait mieux sans toi !
L’aîné sortit chercher des gens pour le chasser. La belle-sœur lui demanda :
— Cadet ! que veux-tu en partage ?
— Moi, je ne veux que la charette cassée, la vache et la corde.
— Ah ! tu ne veux pas emporter ce riz ?
— Non !
Le bouvier, sans attendre le retour de son aîné, cria à la vache :
— Hue ! nous partons !
Et les voilà partis. Une fois sortis du village, le bouvier demanda :
— Quelle direction allons-nous emprunter ?
— Droit au sud.
Alors, ils filèrent droit vers le sud, marchèrent longtemps. La nuit tomba. Devant une montagne coulait un fleuve aux eaux limpides. La vache dit au bouvier :
— Voici une profusion d’eau et d’herbe. Lâche-moi ici. Quant à toi, repose-toi là-bas sur ce grand roc bleu.
La vache se mit à paître çà et là, kemanman, l’herbe verte. Mais le bouvier crevait de faim sur son rocher.
— Holà la vache ! tu t’abreuves et te rassasies. Et moi, j’ai la dalle en pente ! Tu m’avais dit de ne pas emporter de riz.
La vache, à ces mots, kelingkeling, lui dit :
— Tu as faim ? Derrière la colline se trouve un épicier. Mets le repas sur mon compte !
Le bouvier alla manger un bon repas. A la fin, on lui demanda :
— Sur quel compte on le met ?
— Sur celui de la vache !
A son retour, la vache lui demanda :
— As-tu bien dîné ?
— Bien merci !
— Demain, c’est le sept du septième mois. La porte céleste du sud s’ouvrira. Les petites-filles de la reine-mère vont descendre ici laver leur linge. Toi, reste ici ! Compte-les bien d’est en ouest. Observe bien la septième ! C’est la tisserande. Dérobe la robe qu’elle aura mise à sécher. Il ne faut pas la lui rendre ! Quand tu la lui rendras, appelle-moi trois fois, je viendrai.
Le bouvier ne dormit pas de la nuit, tendu dans l’attente. Il regardait de tous ses yeux. La porte céleste du sud s’ouvrit, huala huala, en grinçant. Une compagnie de colombes blanches s’envola, descendit jusqu’à la rivière, se posa. Alors, ces colombes devinrent de belles jeunes filles. Assises sur les rochers de la rive, elles lavèrent leurs robes. Le bouvier repéra bien la septième, et lui subtilisa sa robe, qu’elle avait mise à sécher. La tisserande lui réclama sa robe :
— Rends-moi ma robe ! pourquoi as-tu dérobé ma robe ?
Le bouvier ne la lui rendit en aucune façon. Toutes les filles avaient déjà leur linge sec, et se préparaient à rentrer au ciel. En chœur, elles s’écriaient :
— Septième sœur ! tu rentres ou non ? rentre vite !
— Ma robe a disparu. Comment pourrais-je rentrer ? répondait la pauvre petite.
Les six sœurs se métamorphosèrent en colombes, et s’envolèrent vers la porte céleste du sud. En se retournant, elles hurlaient :
— Septième sœur ! rentre vite ! la porte céleste va se fermer. Rentre vite !
Le portier du ciel au visage rubicond hurla :
— La porte céleste méridionale va fermer ! rentrez vite !
La tisserande déclara :
— Je ne rentre pas, ferme donc !
La porte alors se ferma en crissant : huala huala. De son côté, devant le bouvier sur son rocher passa la tisserande, qui lui dit :
— Marions-nous, et rends-moi ma robe.
Le bouvier ne voulait pas la lui rendre. La tisserande dit :
— Il fait froid sous les étoiles ! nous serions mieux sous un toit !
Le bouvier répliqua :
— Je ne vois même pas une planche ici. Comment s’abriter ? Tu n’as qu’à rester assise comme ceci.
— Ne t’en fais pas ! reste assis ! ferme bien les yeux !
La tisserande tira un foulard à fleurs de son baluchon, l’ouvrit, l’étala, souffla doucement sur sa tête. Aussitôt une belle maison apparut à ses yeux.
— Ouvre les yeux maintenant ! dit la tisserande.
Le bouvier, à ce spectacle, battit des mains. Ils s’installèrent dans la maison.
Le temps passa. Voilà qu’ils ont à présent une fille de six ans et un garçon de trois ans. Un jour, la tisserande dit ceci :
— Les enfants sont grands. Ma robe, que tu as cachée sous la dalle, doit être pourrie. Rends-la moi vite !
Le bouvier se dit : « C’est vrai, les enfants sont grands ! autant la lui rendre ! » Et il lui rendit la robe. La nuit même, vers minuit, la tisserande se leva furtivement, laissa le bébé à son mari. Quand le bouvier ouvrit les yeux, au-dessus de lui, les étoiles brillaient. Il étendit la main, sentit une dalle fraîche et humide. Sa femme avait disparu. Le bébé criait et réclamait du lait. Le bouvier se souvint alors que sa vache lui avait recommandé de l’appeler trois fois, dès qu’il aurait rendu la robe. Comment avait-il pu l’oublier ? Il vit la vache rappliquer, lui meuglant ce discours :
— Tu vois ! elle est partie. Tu n’as pas pris garde à mes conseils.
— Hélas, j’ai eu un moment d’oubli.
— Alors, maintenant, tu vas me tuer.
— Quoi ! toi ! ma bienfaitrice ! je devrais te tuer ?
— Oui ! tue-moi sans barguigner. Cela fait, tu allumeras un feu. Tu feras brûler mes os. Tu écorcheras mon cuir. Tu t’en revêtiras. Tu tresseras deux paniers. Dans l’un tu mettras le garçon, dans l’autre la fille. Alors, tu fermeras les yeux, tu iras à la recherche de ton épouse vers la porte céleste du sud. Le gardien en est un lion d’or. Quand il cherchera à te dévorer, tu diras :
— Tai ! n’aie pas cette audace ! je suis ton septième gendre ! je ne suis pas un bébé à tablier rouge.
Alors, le lion d’or se couchera. Quand tu arriveras à la deuxième porte, un lion d’argent te sautera dessus pour te dévorer. Alors tu lui diras :
— Halte ! n’aie pas l’audace ! Je suis ton septième gendre, et pas un bébé à tablier rouge !
Le lion d’argent aussi se couchera. Quand tu arriveras à la troisième porte, un démon ricanant voudra t’assaillir de ses dents pointues de loup. Tu lui diras :
— Tai ! halte ! je suis ton septième gendre, et non pas un bébé à tablier rouge !
Il n’attaquera pas. A ce moment, ta belle-mère sortira pour te faire bon accueil. Tu entreras dans sa demeure, et tu verras les sept fées assises sur le lit de terre kang. Tu seras incapable de reconnaître ton épouse. Alors, tu poseras le bébé par terre, tu le verras se précipiter vers sa mère pour têter son lait.
Le bouvier se conforma à ces instructions. Vêtu de sa peau de vache, il franchit les portes célestes, reconnut son épouse. Sa belle-mère trouva pour le couple une maisonnette. Ils habitèrent là un certain temps. Le beau-père détestait son gendre, et voulait se mesurer avec lui. Ce jour-là, la tisserande dit au bouvier :
— Demain, mon père veut se mesurer avec toi. Il va se cacher et te demandera de le trouver. Cherche bien, cherche dans le palais. Enfin, cherche au pied du mur du sud. Sur le mur, tu verras une punaise puante : c’est papa.
Le lendemain matin, le vieux appelle son gendre :
— Alors, beau-fils ! on joue ?
— Vous, un vieillard et moi un jeune ! faut-il vraiment jouer ensemble ?
— Ne crains rien ! Jouons à cache-cache. Je me cache, tu me cherches. Si tu me trouves, tu ne subiras aucun mal. Si tu ne me trouves pas, je te croquerai. Allons-y !
Le vieillard se changea en punaise et se tapit au coin du mur sud. Le bouvier se mit à chercher partout, et en vain. Mais à la fin, il pinça la punaise au coin du mur méridional :
— Vieux chenapan de beau-papa ! est-ce toi ? Si ce n’est pas toi, je t’écrase ! Ah ! quelle puanteur !
— C’est moi ! c’est moi ! Ne m’écrase pas ! Tu as failli m’arracher mes deux tresses !
— Tu ne me mangeras pas ?
— Non ! promis ! Tu peux t’en retourner.
Le bouvier rentra au logis. La tisserande lui dit :
— Demain, papa va encore te faire jouer à cache-cache. Il va se transformer en un grand fruit rouge, et se cacher dans le coffre à habits de maman. Tu le trouveras facilement.
Le lendemain matin, le vieux beau-père vient encore l’appeler :
— Beau-fils, jouons ! Je me cache et tu me cherches !
Le bouvier accepta, commença à chercher devant, derrière, dans la toiture. Personne ! Il alla dans le gynécée, ouvrit le coffre à habits, vit un fruit rouge enveloppé dans un tissu rouge. Il le saisit et dit :
— Beau-papa, est-ce toi ? Ce zigoto ! Si ce n’est pas toi, je n’en ferai qu’une bouchée. Quelle bonne odeur, quel fumet ! quel arôme !
— C’est moi, c’est moi ! Lâche-moi donc ! Tu vas finir par m’arracher la barbe.
— Tu ne me mangeras pas ?
— Mais non ! rentre vite !
Le bouvier rentra au logis. La tisserande lui dit :
— Demain, papa va te dire de te cacher.
— Grand comme je suis, comment pourrais-je me cacher ?
— N’aie crainte, je vais t’enseigner une métamorphose.
Le lendemain matin, le vieux beau-père vient encore l’appeler :
— Gendre, jouons à cache-cache ! cette fois, c’est moi qui cherche.
— D’accord !
Le bouvier s’accroupit, se changea en aiguille à broder. Sa femme sauta sur le lit kang, ramassa l’aiguille et se mit à broder.
Elle dit innocemment :
— Papa ! il est caché ! cherche !
Le vieux chercha partout. En vain. Rien à faire ! Le gendre restait introuvable. Rentrant chez lui, il dit à sa vioque :
— Ce gendre est introuvable. Il peut me trouver, mais moi, je ne peux pas le trouver.
Quant à la tisserande, elle prit l’aiguille, la jeta à terre : le bouvier se dressa brusquement en poussant ce cri : teng ! La tisserande lui dit :
— Demain, mon père va t’imposer une course : tu cours et lui, il te poursuit.
— Pourra-t-il me rattraper ?
— Hélas ! il court bien plus vite que toi ! Va vite dans mon grenier ! Prends un boisseau de riz rouge. Prends ces baguettes rouges, prends-en une poignée. Sur ma tête, cette épingle d’or, prends-la aussi. Demain, quand la course aura commencé, attends que je crie : « Trace devant toi un trait ! », alors, avec l’épingle, trace le trait !
Le lendemain matin, le beau-père rappliqua :
— Mon gendre ! aujourd’hui, nous allons concourir : tu cours, je poursuis. Si je te rattrape, je te mange ; sinon, tu es libre !
Le bouvier accepta et se précipita dans la course. Le parâtre se lança à sa poursuite. Le bouvier, tout en courant, jeta une paire de baguettes, puis deux grains de riz rouge. Le beau-père ramassa les objets et se remit à courir en jurant :
— Ce maudit beau-fils qui me vole mes affaires alors qu’il va mourir !
Le bouvier épuisa petit à petit ses ressources en baguettes et en grains de riz. Il n’avait plus rien à jeter.
La tisserande lui cria :
— Trace vite un trait !
La belle-mère lui cria :
— Trace vite un trait !
Le bouvier vit que beau-papa était tout près de lui. Il traça un trait derrière lui avec l’épingle d’or. Ce trait devint aussitôt le Fleuve céleste (Voie lactée) qui le sépara de son épouse et de ses marmots. Ils restèrent à pleurer de part et d’autre du fleuve.
La belle-maman ramena sa fille et ses petits-enfants. Le beau-papa s’en retourna. Le bouvier resta au-delà du fleuve. Le sept du septième mois seulement, ils peuvent se retrouver. Ce jour-là, au matin, les oiseaux s’envolent ; la belle-mère du bouvier tisse un pont de plumes avec des plumes de pies bariolées, pies sauvages, bailingzi, hirondelles mongoles. Chaque 7 juillet, la nuit, on peut voir un pont qui traverse la Voie lactée ; c’est le pont qui permet la rencontre du bouvier (Altaïr de l’Aigle) et de la tisserande (Véga de la Lyre).
Animaux
3.Le moineau ivre
Un moineau mangeait d’habitude les grains des paysans à l’époque où ils étaient mis à sécher. Une fois rassasié, il allait par-dessus le marché, chier sur l’aire. Un jour, un paysan avait étalé sur l’aire à battre le grain du marc de riz ayant servi à faire de l’alcool. Il s’était retiré dans une paillote. Une volée de moineaux arriva, se mit à picorer en sautillant. Chacun s’enivra, et ils furent tous attrapés par les paysans.
L’un d’entre eux, qui n’avait pas assez mangé de marc et n’était pas complètement paf, se percha sur un sophora, et, à moitié gris, se mit à chanter :
Je n’ai pas peur du cielJe n’ai pas peur de la terreAprès le phénix, je suis le plus fort.
Sur l’arbre, les cigales et les petites hirondelles se sauvèrent. Le moineau se remit à chanter. Une pie se percha sur l’arbre, le moineau l’affronta ; la pie comprit qu’il était ivre, et s’envola sans y prendre garde. Le moineau encore plus gai, chantait à tue-tête et dansait comme un fou.
Peu après, la nouvelle selon laquelle le moineau s’était emparé du sophora se répandit partout dans le monde. Le pigeon tacheté alla voir si c’était vrai. Le moineau, sans attendre que le pigeon se soit caché, se mit à lui becqueter la tête, et le pigeon tacheté n’eut rien de mieux à faire que de s’envoler et d’aller se percher sur un jujubier. Le moineau crut que le pigeon avait peur de lui, et se mit à chanter :
Je ne crains pas le ciel.
Le pigeon tacheté sur son jujubier rigolait, et alla trouver le busard jaune, et lui dit :
— Grand frère busard, sur ce sophora perche un moineau qui empêche tout oiseau de venir s’y percher : cigales, hirondelles, pies n’osent pas. Il leur donne toujours des coups de bec. Moi, à peine avais-je atterri sur cet arbre, il m’a fait tomber plus de dix plumes, et il chante à tue-tête.
— Que chante-t-il ?
— Il chante : « Je ne crains ni ciel ni terre ; je suis le plus fort après le phénix ».
A peine avait-il dit ces mots, que le busard se fâcha, ouvrit ses ailes, prit son essor, vola jusqu’au sophora, suivi du pigeon tacheté, de la pie, de l’hirondelle et de la cigale. Le moineau était en train de chanter sa joie, quand le busard fondit sur lui, lui asséna un grand coup de toutes ses forces. Le moineau mort de peur s’enfuit dans un buisson d’épineux. Le busard le poursuivit jusqu’au buisson, mais il était trop gros pour y pénétrer, et ne put attraper le moineau. Il resta à l’entrée du buisson, criant sa fureur contre le moineau : à la fin des fins, vas-tu me dire qui est le plus fort, toi ou moi ?
— Je ne suis pas le plus fort ; c’est toi le plus fort, et tu es le plus grand après le phénix, répond le moineau d’une voix tremblotante.
— Pauvre petit-fils de tortue, cesseras-tu de déraisonner ?
— Pardon ! c’est que j’avais mangé du marc d’alcool de riz !
Tout en parlant, ses yeux larmoyaient. Le busard lui fit les gros yeux, lui cracha dessus, lui décocha une bordée d’insultes, et s’envola.
Une fois le busard parti, le moineau n’osait toujours pas piper mot dans son buisson d’épineux, ni en sortir. L’hirondelle, la pie, le pigeon tacheté riaient en chœur comme des fous et la cigale criait : chiya, chiya, ce qui signifie « Honte ! honte ! » en chinois.
4.Le faisan doré, le lapin, le singe, l’éléphant mangent des fruits
Jadis, il y avait un lapin, un faisan, un singe et un éléphant qui s’étaient juré amitié. Comme le faisan doré savait voler, il grimpa une fois jusqu’au trente-troisième ciel, où il happa une graine. Une graine d’arbre de dix mille ans, qui donnait des fruits en toute saison. Le lapin, très malin, connaissait la valeur de cette graine. Il la planta. Le singe savait qu’elle donnerait des fruits, et il lui mit du fumier. L’éléphant avait envie de manger de ces fruits, c’est pourquoi chaque jour, il puisait avec sa trompe de l’eau au fleuve pour l’arroser. Grâce à tous ces soins, l’arbre poussa très vite et donna des fruits. Le faisan doré vole à la cime, voit des fruits mûrs, et pense : c’est moi qui ai apporté la graine ; voilà ma récompense ; je puis maintenant en profiter. Alors tous les jours, il vole au sommet de l’arbre, et grignote les fruits à sa guise.
Quant au singe, sachant grimper, il montait à l’arbre quand il voulait manger. Une fois repu, il redescendait. L’éléphant était trop gros, mais avec sa trompe, il attrapait des fruits. Le lapin était chocolat : il ne pouvait pas grimper, et bondissait en vain au pied de l’arbre. L’odeur des fruits atteignait sa narine, lui mettait l’eau à la bouche. L’arbre poussait toujours plus haut. L’éléphant ne pouvait plus atteindre les fruits avec sa trompe. Il se mit à se disputer avec les autres. L’éléphant dit au faisan et au singe :
— Ce n’est pas juste. L’arbre a beaucoup grandi. Il n’y a que vous deux qui puissiez en manger les fruits. Mais pour nous autres, rien à faire. C’est quand même nous qui l’avons fumé et arrosé. Le lapin, pas content, dit :
— Ce n’est vraiment pas juste. Je n’ai pas mangé un seul fruit ; juste quelques feuilles tombées de l’arbre.
Mais le faisan et le singe continuaient à manger seuls sans tenir compte des récriminations des deux autres. Ceux-ci allèrent trouver un sage, lui demandant de juger l’affaire. Le sage dit :
— Il ne faut pas vous battre tous les quatre. Sur terre, à l’origine, cette sorte d’arbre n’existait pas. D’où vient-il ? comment a-t-il poussé ? Dites-le moi ! Alors, je pourrai trouver moyen de vous mettre d’accord.
Le faisan doré dit :
— Monsieur le sage, en effet, cet arbre n’existait pas en ce bas monde. C’est moi qui suis allé en prendre une graine au trente-troisième ciel. Comment n’aurais-je pas ma récompense d’en manger les fruits ?
Le lapin dit :