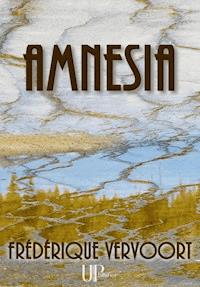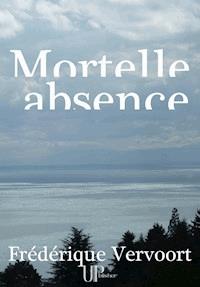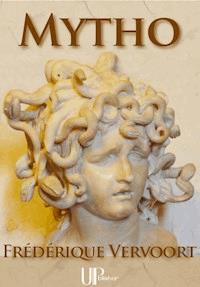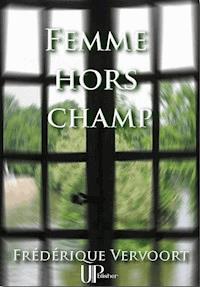Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Contre-jour est l’autopsie méthodique d’une relation passionnelle, foutraque, aux fondations dangereusement branlantes. C’est une fable féroce de Frédérique Vervoort qui renvoie le coup de foudre à sa réalité première : une décharge électrique aveuglante, irrésistible, dévastatrice.
Simon rencontre Chloé. Par hasard. Lui, plutôt pas mal, agent immobilier, quadragénaire marié. Elle, célibataire dans la vingtaine, riche oisive, belle à en crever. Ils se cherchent, ils se trouvent. Simon quitte Noémie, Justine, Liège, sa femme, sa fille, sa ville. Il s’installe à Paris, avec et chez Chloé. Rapide ? Il le pense, mais à plus de quarante piges, si on peut refaire sa vie en (beaucoup) plus grand, on fonce d’abord, on réfléchit ensuite…
L’histoire, c’est Simon qui la raconte, en voix off. Il a le sens de la formule, n’omet rien des évènements et des interrogations qui l’assaillent. Sa passion physique, quasi animale le grise et balaie toutes ses objections. Seule une voix de femme, dans la coulisse, troue son récit de répliques lapidaires, cinglantes, cruelles.
Avec une minutie balzacienne, Frédérique Vervoort met à nu la vie d’un naïf « coincé entre un passé sans gloire et un futur nébuleux ». Son style rapide, nerveux, les nombreux dialogues plongent le lecteur au cœur même du récit.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Maître-assistante à la Haute École Charlemagne en Belgique,
Frédérique Vervoort réside à Liège. Franco-belge, elle demeure attachée à l'héritage culturel de ses deux pays d´origine.
L'écriture la passionne depuis toujours, mais c'est seulement maintenant qu'elle prend le temps de s'y consacrer et de partager avec les lecteurs ce qui n'était, jusqu'alors, qu'un plaisir personnel.
Ses romans et nouvelles nous plongent dans une atmosphère intimiste et mystérieuse. Suspense garanti pour ce remarquable auteur qui marche sur les traces de Simenon.
Retrouvez Frédérique Vervoort dans ses romans
Mortelle absence,
Le jeu de la poupée,
Femme hors champ,
Amnesia,
Mater dolorosa, son recueil de nouvelles
Mytho et dans ses nouvelles
La Voisine,
Voie lactée et
En attendant Claire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contre-jour
Frédérique Vervoort
UPblisher.com
DU MÊME AUTEUR
Mortelle absence, roman, Éditions UPblisher 2012
Le jeu de la poupée, roman, Éditions UPblisher 2014
Mytho, nouvelles, Éditions UPblisher 2014
Femme hors champ, roman, Éditions UPblisher 2016
Amnesia, roman, Éditions UPblisher 2017
Mater dolorosa, roman, Éditions UPblisher 2019
1.
— Je n’ai rien voulu de ce qui est arrivé, dit-elle.
Mais c’est trop facile. Et sans doute faux.
Je ne crois pas en la bonté de la nature humaine. En son innocence. Cela n’a rien à voir avec des fables de serpent, de pomme, ou de type cloué sur une croix. Cela n’a rien à voir non plus avec les convulsions de l’histoire, quoique… Trouvez-moi un continent (le nôtre par exemple), où cinq décennies d’affilée – ce n’est pas beaucoup à l’échelle du Big Bang – les humains se sont regardés avec tendresse et fraternité, sans l’ombre d’une arrière-pensée de traîtrise ou de domination ? Bien sûr on peut trouver des parenthèses enchantées, des instants suspendus d’irénisme… Des velléités de prospérité, d’altruisme. Mais gare au carnage qui vient. Au prochain massacre. À la prochaine invasion qui débouchera sur l’inévitable bain de sang, social, économique, ou spectaculairement médiatique, membres coupés et artères à nu.
C’est comme ça depuis l’aube de l’humanité.
Alors pourquoi croirais-je en sa candeur ? Elle savait. Mieux, elle a anticipé et savouré les conséquences de mes actes. Pour mieux m’en faire payer le prix. Quitte à sacrifier l’essentiel. À accepter le pire.
Mais qui suis-je pour la juger ?
2.
Je me souviens…
Nous sommes en été, sur la plage. Quelque part, en Grèce. Le sable brûle tellement que je dois courir pour atteindre la lisière des vagues. L’eau et le ciel se confondent dans un même indigo violent. Je discerne la forme pâle de mes chevilles sous la transparence liquide. On dit que cette mer est polluée, comme toutes les autres. Mais partout autour de moi miroite un cristal tiède et trompeur. Comment ne pas y croire ? Cette limpidité, cette odeur de pastèque qui semble bizarrement flotter dans l’air, mêlée à des relents lointains d’algues et de maquis…
Chloé me rejoint. Elle m’éclabousse en riant. Son corps est bronzé, svelte, à peine compromis par un minuscule deux-pièces orange, la couleur à la mode cet été-là. Elle est faite pour vivre nue et cela se sent, à l’aisance de ses mouvements, au grain serré de sa peau, au poli de ses courbes. La masse de ses boucles lui dévale jusqu’aux reins. Ses yeux gris paraissent translucides sous la lumière, translucides et opaques à la fois. Je ne peux rien y lire. Ils ne s’accordent pas avec sa jubilation proclamée. Cette fille est indéchiffrable. Trop jeune. Trop belle. Et je ne sais fichtrement pas ce qu’elle peut me trouver depuis un an.
Nous n’avons pas d’enfant. Pas ensemble du moins. Mais j’ai une fille, Justine, le sel de ma vie, que j’ai abandonnée à sa mère – en attendant de trouver une solution que j’anticipe mal. Chloé a surgi dans ma vie comme la foudre et comme la foudre elle a tout calciné sur son passage. Moi y compris. Une histoire sans originalité et sans morale. Comme tant d’autres. Pourquoi se vouloir exceptionnel et briller comme un astre solitaire dans le marasme ambiant ? Pourquoi se sentir coupable ?
— Pourtant tu devrais, dit-elle.
Nous y voilà. Causes et conséquences. Une histoire banale, avec ses enchaînements logiques. Ce qu’elle voudrait me faire croire.
Mais je ne suis pas idiot. Détruit, certes. Lucide, plus que jamais.
3.
Plus tôt…
La ville poudroyait sous une canicule précoce. Réchauffement climatique oblige. On venait de repaver le piétonnier et du sable jaune, encore frais, crissait sous mes semelles. La tour de la cathédrale, repeinte en jaune elle aussi, mais d’un ton plus ocre, couleur du calcaire originel d’après les spécialistes, s’imposait à l’angle de la rue et donnait de l’ombre.
J’étais en retard. Le Vieux habituel mendiait sous le porche du marchand de chaussures. Dans l’agitation du matin, il semblait curieusement immobile, petit bloc de résignation minéralisée dans l’effervescence du monde… Il m’intimidait un peu. Il ne levait jamais les yeux, ne disait jamais un mot quand on lui tendait une pièce qu’il escamotait, avec une sorte de dédain, entre ses longs doigts élégants et prodigieusement sales. Dans la broussaille de la barbe, on ne distinguait pas bien son visage, mais le Vieux, à bien y réfléchir, avait peut-être mon âge.
Je vis à Liège, ville de Simenon – sa seule gloire jusqu’à présent. La Belgique, la Wallonie… ce n’est plus très porteur à présent, à notre époque qui a éradiqué la sidérurgie, mais il y a pire.
Je suis agent immobilier.
Enfant je voulais être violoniste, ou explorateur, ou romancier… mais j’avais dû bâcler une école de commerce parce que ma mère, veuve précoce, n’avait pas les moyens de m’offrir le conservatoire ou un long cursus universitaire. Finalement, les affaires avaient mieux marché que prévu. À l’époque, la profession n’était pas encore strictement réglementée ; je m’étais révélé débrouillard, avec un flair de chien de chasse, et bientôt j’avais pu ouvrir ma propre agence, modeste, embaucher un employé, Charles Matagne, loger ma mère dans un pavillon confortable au bord de l’Ourthe, pour enfin m’offrir (j’étais à la source) un duplex au centre-ville.
Tout allait bien dans le meilleur des mondes… Sauf que ce métier m’emmerdait, au fond. Soyons honnête. Mais jouer du Bach à Pleyel ou partager un hamac avec une belle Yanomani ne semblait plus faire partie de la panoplie des rêves de base. J’avais grandi. Vieilli. Je repensais au visage broussailleux de mon mendiant et je m’imaginais à sa place. Il avait sans doute rêvé lui aussi. Imaginé. Décollé. Et s’était écrasé sur un trottoir, comme un oiseau mazouté dans les flots. La faute à pas de chance. Mais en ce jour de juin, dans la ville palpitante de chaleur, je n’étais plus sûr de rien. Même pas de ma chance à moi.
J’avais laissé endormie dans le lit conjugal Noémie, mon épouse depuis quinze ans. Une vraie blonde, poils pubiens compris. Ce gène viking, assez rare dans nos contrées, m’avait séduit au sortir de mes études. Mes divagations d’aventurier me faisaient alors dériver en pensée vers l’Arctique, ou la Baltique. En tout cas vers le grand Nord, ses icebergs, ses ours polaires pas encore menacés, ses saumons sauvages et ses banquises bleutées. Je n’avais pas assez d’argent pour me payer le voyage. Par la suite, j’ai vu Oslo et j’ai eu froid. Je n’étais pas de l’étoffe des grands voyageurs. Je ne connus donc ni la mélancolie des paquebots, ni les froids réveils sous la tente, n’en déplaise à Flaubert, que j’avais pratiqué avec plaisir durant mon adolescence solitaire et atypique.
Je me suis aisément pardonné de ne pas être à la hauteur de mes rêves. J’ai une grande propension à l’auto-indulgence. C’est dire si la blondeur scandinave de Noémie, nom de famille Pelletier – ni Ericsson, ni Rapoport – avait suffi à me faire appareiller vers d’autres rives. Brunehilde plutôt que Salammbô ou Marie Arnoux : on a les goûts exotiques que l’on mérite.
On s’était aimés, je crois. Noémie avait une fraîcheur de source, une spontanéité d’enfant, son rire fusait comme un geyser d’Islande, elle me ravissait : j’étais fier de l’exhiber à mes côtés. Mon trophée blond. On s’était mariés rapidement. Ce n’était déjà plus à la mode, mais mon métier me déformait. Je me voulais propriétaire. Foin du féminisme, Noémie me semblait du genre accommodant. Et je me pensais amoureux. Le corps de ma jeune épouse se déployait dans notre lit comme un grisant terrain de jeux.
Ça n’avait eu qu’un temps. Nous avons procréé assez vite.
Je ne l’ai pas aimée enceinte. Noémie. Ma femme. Encore aujourd’hui j’ai du mal à formuler cette ignominie. Mais la vérité, à présent, doit me tenir lieu de vertu.
Non, je n’ai pas aimé ses nausées, l’amplitude soudaine de son corps (amplitude qu’elle ne parvint jamais à perdre tout à fait), ses geignements et ses enthousiasmes à propos de poussette à roues pneumatiques ou de grenouillères en éponge. Je n’ai pas aimé ses roucoulades téléphoniques à rallonge avec sa mère – qui Dieu merci habitait à l’autre bout du pays – ou avec ses amies que je jugeais ineptes. Je n’ai pas aimé subir son accouchement en direct – on m’aurait traité de monstre si j’avais refusé d’y assister – mais la voir écartelée dans le sang et les humeurs, ouverte comme une caverne, a définitivement éradiqué mon désir. Je n’ai pas aimé ce qu’elle est devenue après, ce qu’elle était sans doute avant, une femme naïve, lourdaude, sans humour ni culture, une anti Mathilde de la Mole, ah Stendhal… Je payais cher ma passion de la blondeur, une blondeur qui grisonnerait vite, qui se travestirait sous la teinture ; je résiliais à vie ma fascination pour les walkyries de pacotille et les walhallas de supermarchés. J’avais trop lu, dans le désordre et l’incompréhension. Mon romantisme à deux balles se retournait contre moi. Je n’éprouvais plus rien. Sauf pour Justine.
Au début, ce n’était pas gagné. J’ai failli étendre ma déshérence à ce petit paquet gluant, glissant comme une otarie, que l’infirmière me présenta avec un sourire de complicité, jugé mal venu sur le moment. Puis la main minuscule de l’enfant, dans un geste réflexe j’imagine, se crispa autour de mon pouce et le miracle opéra. J’eus un choc paternel comme on peut ressentir un choc tellurique. Chloé seule a eu le pouvoir de réitérer ce prodige. Et presque de l’annuler.
Justine est donc devenue la seule blonde de ma vie. Elle seule m’a préservé de la platitude du quotidien, de l’absence de désir, de la mort des illusions. J’étais un peu jeune pour arborer le masque du désenchantement. Disons que ma fille m’a évité l’ennui de vivre en rase-mottes. Il y avait toujours chez elle quelque chose qui me ravissait, réveillait mes neurones, titillait ma curiosité ou ma passion. Elle se révéla précoce, intelligente (elle savait lire à trois ans ce qui me comblait d’une fierté un peu imbécile car ce n’était certes pas, me disais-je, des gènes de sa mère dont elle avait hérité) et jolie, ce qui me flattait. Je n’y étais sans doute pas pour grand-chose même si je jouissais d’un physique plus que passable. Ma mère m’avait toujours conforté dans l’opinion qu’un homme dépassant le mètre quatre-vingt-cinq et possédant des prunelles vertes avait toutes les chances de réussir dans la vie. Ma mère dont la mémoire à présent prenait l’eau de toutes parts et dont l’Alzheimer précoce m’inquiétait par bouffées. Combien de temps tiendrait-elle encore, sans surveillance, dans sa petite maison du bord de l’Ourthe ?
Ce sont toutes ces pensées, informes, plutôt désagréables, que je remuais dans ma tête en un magma confus tandis que je marchais vers mon lieu de rendez-vous. Justine passait la semaine chez une amie d’école qui vivait à la campagne, dans une agréable villa avec piscine que j’avais consentie à prix d’amis à ses parents. Les deux gamines préparaient leurs examens de fin d’année, et Justine servait plus ou moins de coach à sa copine moins douée. Des jours sans Justine signifiaient donc des jours avec Noémie, et le vide de nos conversations conjugales me revenait en boomerang. Discussions sur l’achat d’un pain ou le choix d’une série télévisée dont je me foutais.
Avec le recul, il est étonnant que je n’aie jamais trompé plus souvent ma femme. Remarque dont le cynisme ne m’échappe pas mais je suis par-delà le bien et le mal, comme écrivait un certain Friedrich… Il y avait bien eu une cliente éméchée, une voisine éphémère et jolie, la compagne d’un collègue que je ne piffais pas (je parle du collègue). Écume que tout cela…
Mon désamour de Noémie me poussait à l’indifférence, pas à la rancune ou au coït débridé. Je respectais notre passé, nos souvenirs vaporeux, notre enfant si réussie, je lui devais bien cela.
De plus, l’appel de la chair ne me tenaillait pas. Mes désirs restaient en bride, mes rêves érotiques mesurés, je n’attendais plus grand chose de la vie, mais en toute honnêteté, je ne trouvais rien de désespérant à la situation. Parfois on se sent brisé sans cassure. Il n’y a pas d’explication à fournir. J’avais cessé simplement de croire en la magie de l’imprévu. J’avais entendu Noémie chuchoter au téléphone, à l’une de ses amies, que Simon traversait encore une période de petite déprime, mais que ça allait s’arranger comme toujours, trop de boulot sans doute…
Oui je travaillais, beaucoup, je parlais cadastre et pourcentage, je mesurais des murs porteurs, j’évaluais des parquets en points de Hongrie et réhabilitais des salles de bains pourries ; je n’imaginais rien faire d’autre, il y avait parfois un peu de challenge, d’excitation, un gros coup en vue, je me battais contre des rivaux. Et puis le soufflé retombait. Période de creux. De jachère. L’ennui familier. Noémie, qui s’occupait de livres pour enfants dans une librairie spécialisée de la ville, me rapportait des anecdotes amusantes pour me changer les idées. Mais hormis celui de Justine, l’univers des mioches ne m’intéressait guère. Je ne me souvenais même plus avoir été l’un d’entre eux. Ma femme avait raison. Je traversais encore une période de déprime. Et oui, cette déprime était « petite », sans panache ; j’abandonnais volontiers aux authentiques capitulards les sauts dans le vide et les seaux de Xanax. N’empêche, les jours et les nuits me pesaient, sans raison. Une vieille habitude.
J’arrivai enfin au lieu de rendez-vous. La maison se situait dans une impasse et cela m’a quand même fait sourire. La cliente attendait. Elle ne consultait pas son portable, comme la majorité des humains de cette ville, mais une montre à gros cadran, qui semblait peser trop lourd pour son poignet. Elle devait s’impatienter. C’était Chloé.
4.
Chloé fut la première cliente dont je tombai amoureux. Pas la première avec qui je couchai, je l’ai déjà précisé, et cela a son importance même si les choses ne mirent pas longtemps à se mettre en place.
La première cliente et la première brune. Châtain plutôt, des boucles longues et libres, un visage mat alors que le regard, perçant, bagué de noir, était d’une clarté étonnante, plus gris que bleu, un peu vert aussi, des yeux pers, comme on ne disait plus mais j’avais de lointains souvenirs mythologiques : Athéna, la déesse aux yeux pers. J’imaginais sans peine un casque d’airain sur ses boucles, elle avait d’ailleurs le corps nerveux et le profil altier qui soutenaient cette comparaison.
Chloé Vernier vendait sa maison de famille. Elle venait de perdre son père, sa mère s’étant défenestrée alors qu’elle était encore enfant. Une mauvaise entrée dans la vie. Mais à vingt-quatre ans, la jeune orpheline devenait maîtresse de son destin et de ses biens. Et semblait pressée de se débarrasser, même à vil prix, de la petite maison de l’impasse en Hors-Château, si ancienne, si pittoresque, avec son mur dévoré de glycine.
Ancienne mais pas pratique, plutôt délabrée, regardez la salle de bains et la cuisine, vous voyez que je ne vous cache rien…
Elle avait raison, ça « craignait » un peu, et même beaucoup, mais de toute façon on ne dissimule rien à un agent immobilier, et je me sentais de taille à surévaluer la marchandise. Le goût des vieilles pierres, le charme de l’impasse, le carrelage usé, tout cela pouvait jouer en notre faveur. J’étais un pro.
Mon but était bien sûr d’impressionner ma cliente. Et accessoirement de nous faire gagner de l’argent. L’immobilier nous liait déjà par un pacte. Cette idée me boostait. Je reprenais goût au métier. Pas seulement.
J’ai parlé d’amour. De tomber amoureux. Une chute, donc, mais grisante. Immédiate. Tellement inattendue. J’ai fait durer la visite de la maison, j’ai pris des tas de notes sur un carnet, avec un stylo, à l’ancienne, j’ai entraîné la déesse à ma suite, de la cave au grenier, je voulais tout explorer, tout exploiter. Le salon, meublé sommairement (Chloé, pratique, avait déjà fait venir un brocanteur et un spécialiste en vide-greniers), n’encourageait pas aux étreintes bestiales générées dans l’urgence. Le plancher était pourri et le soleil se heurtait aux lattes des volets sans souci d’esthétisme. Ici, pas de contre-jour doré et cinématographique, mais une pénombre un peu boueuse de crypte. Une odeur de moisissure. Cette baraque était négligée depuis sa fondation. Chloé n’y avait jamais vécu. Son père, toujours en vadrouille, délaissait visiblement sa maison et sa fille. Ça tombait bien… Je me voyais assez en sauveteur de ce paquebot à la dérive… Paquebot semblait d’ailleurs un terme trop pompeux, mais la seule chose qui m’importait depuis mon arrivée, c’était ce grand remue-ménage qui s’opérait au fond de mes entrailles, ce coup de chaud qui ne devait rien à la température anormalement élevée. Je n’avais jamais ressenti quoi que ce soit de semblable depuis des décennies, j’exagère à peine. La blondeur de Noémie, certes, mais il y avait prescription ; quant aux autres, des corps sans importance, qui n’avaient pas laissé plus de trace qu’un effleurement de pollen.
Je ne sais si cet émoi fut partagé dès le début. La suite me fait penser que non, mais un reste de fierté m’oblige à sacrifier ma clairvoyance.
Chloé était trop jeune : à peine dix ans de plus que ma fille. Elle devait traîner tous les cœurs après elle. Sa séduction éclatait comme une évidence. Pourtant je n’ai pas douté.
— Tu aurais dû, dit-elle.
Étant donné l’état du monde, dont on nous prédisait – de l’adulte politique à l’enfant suédoise à nattes – qu’il n’en n’avait plus pour très longtemps ; étant donné les guerres, les naufrages, la montée des extrêmes, et la puissance cyclopéenne d’Internet, avait-on encore le droit de rêver à l’amour ? De nourrir des songes d’adolescent attardé ?
Ma « petite » déprime, finalement, ne paraissait-elle pas plus appropriée à la déliquescence de la planète que cette flambée soudaine de phéromones ? Toutes les histoires d’amour finissent mal, dit la chanson. La preuve : ma chronique conjugale s’effilochait dans l’indifférence mutuelle, mes aventures n’avaient eu ni lendemains, ni drames ; dans mon cas il ne s’agissait pas de fins tragiques, mais d’anesthésie générale. Et c’était peut-être très bien comme ça. À quoi sert de s’agiter dans un monde qui prend l’eau, dans tous les sens du terme ?
Certes, je pouvais encore me la jouer aventurier, récupérer mes idéaux de jeunesse au clou rouillé où ils moisissaient depuis des lustres, mais je ne me suis jamais laissé bercer d’illusions. Sauf celle de me faire aimer par Chloé.
5.
Je lui ai bien vendu sa maison. Les impasses de la rue Hors-Château connaissaient un regain d’intérêt de la part de jeunes couples branchés sur l’authenticité et la biodiversité : on sentait que la fête des voisins ne serait plus boudée dans le quartier…
Chloé paraissait pourtant indifférente à la grâce des ruelles inégalement pavées, à l’ombre mauve des glycines, au poids vénérable des ans. Elle ne vivait pas à Liège mais à Paris – son héritage était une corvée dont elle se débarrassait avec désinvolture. Je ne parvenais pas à saisir la source de ses revenus car elle ne me faisait aucune allusion à un métier ou à des études en cours. Ses rapports avec son défunt père frôlaient l’inexistence, en apparence du moins. En tout cas, le chagrin ne semblait guère l’accabler. Libre, sans entraves, belle à se damner, elle m’en imposait alors que je devais lui apparaître comme un pauvre plouc de province. Cela me motivait davantage. Je tenais le levier qui ferait bouger ma vie.
Convoiter une jeune et belle femme quand on végète dans la monotonie de jours sans relief ne relève pas, je l’avoue, d’une originalité folle. Mais je ne recherche pas la singularité, je n’ai jamais eu le goût du flamboyant – voir plus haut – jusque-là je suis resté modeste dans mes aspirations, et j’ai admis sans trop d’amertume que mon horizon n’offre qu’une perspective limitée. Je m’étiolais donc avec fatalisme jusqu’à cet instant unique où Chloé a croisé ses longues jambes gainées de jeans dans mon bureau de la rue Saint-Paul.
Bon Dieu, cette fille m’a fait l’effet d’un shoot d’héroïne, alors que je ne me drogue pas ! Héroïne d’ailleurs dans tous les sens du terme. Elle a surgi dans mon existence comme un personnage de roman. Salammbô s’incarnait. Et toutes les autres. Je pouvais désormais inventer ma vie. La magie existait ! Et ça, c’était le plus beau cadeau que me réservait l’avenir…
— Pauvre naïf ! dit-elle.
Est-ce que la naïveté est répréhensible dans un monde dominé par les cyniques ? Jusqu’alors je me situais plutôt du côté de ces derniers. Je n’avais rien d’un prédateur mais quand même, à défaut de vivre d’émouvants tumultes ou de côtoyer des abîmes, je ne m’encombrais guère d’une quelconque sentimentalité, percevais clairement mes intérêts et ne m’accablais pas de culpabilité lorsque je renvoyais sèchement Noémie à ses magazines people ou à ses illustrés de Babar pour passer une soirée arrosée entre copains.
Car oui, en ce temps-là, j’avais quelques copains, et des femmes, je l’avoue, que je faisais plus que frôler par inadvertance. Cela me permettait d’entretenir des illusions sur ma capacité à séduire et à mener ma vie à grands claquements de rênes. J’ai peut-être minimisé mes errances extra-conjugales (même si beaucoup d’inconnues n’ont pas dépassé le stade de l’investigation de base) et exagéré mon sérieux professionnel. Tout de même, aux yeux du cercle, certes assez restreint, des notables de notre ville, je passais pour un homme « qui réussissait ». Certains envisagèrent même de m’associer à leurs projets politiques, à vrai dire fumeux ou fumistes, les deux adjectifs s’associant volontiers. Accordez-moi au moins cette clairvoyance : j’ai toujours refusé. Le cynisme, toujours : ne préférais-je pas la bonne marche de mes affaires à celles de la Cité, et avais-je la moindre empathie pour mes contemporains ?
Si je ne me faisais d’illusions ni sur moi-même ni sur mes semblables, je gardais au moins une poche d’oxygène. Justine, ma fille, concentrait à elle seule le peu d’intérêt que je portais à mon entourage. Blonde, comme sa mère, elle avait des yeux perçants et calmes, un menton nettement dessiné et des pommettes exquises. Ses réflexions m’enchantaient. Sa précocité m’effrayait un peu. Elle lisait beaucoup – je ne lui interdisais rien en ce domaine – brillait en mathématique et comme tous les enfants biberonnés à Internet, surfait avec un peu trop d’aisance sur la toile, mais après tout, à son âge, le contraire eût paru étonnant. Justine était, en vérité, l’unique preuve que ma vie jusqu’ici n’avait pas été trop nulle.
Si je répète mon ode à Justine, c’est sans doute pour me dédouaner d’avoir accepté de la perdre.