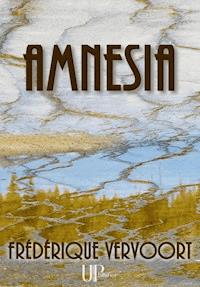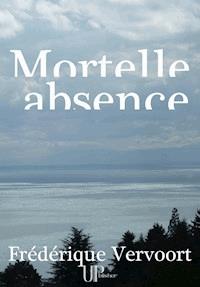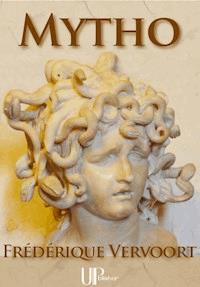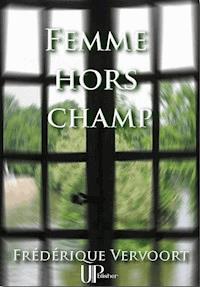Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La vie d'Isabelle semblait toute tracée, mais la jolie histoire s'est peu à peu transformée en cauchemar.
Isabelle raconte. Vingt-quatre mois de la vie d’une femme. Un homme aimant, une enfant adorable, un foyer. La paix. Enfin. Une jolie histoire qui glisse imperceptiblement vers un cauchemar sans nom.
Mater Dolorosa est un roman à la trame tendue, bouleversant, magistral ! Une plongée dans les zones parmi les plus sombres de l’âme humaine. Pas de pitié pour les naïfs ! La haine comme la lave refroidit avec le temps, elle devient socle. Isabelle survit. Elle témoigne. En détails. Lucide. Distanciée. Elle s’interroge, nous interpelle. Entre demi-vérités et omissions, le voile léger du mensonge l’effleure ; puis sans trop savoir pourquoi, ni comment, le malaise s’installe… va crescendo jusqu’à l’ignominie.
Au service d’une intrigue parfaitement menée, le style de Frédérique Vervoort fait mouche. Récit et dialogues s’enchaînent avec fluidité ; ce que vit, ressent Isabelle, nous le vivons, le ressentons aussi.
Au travers de ce roman au style fluide et léger, découvrez le récit d'une femme qui a connu l'enfer et qui se sert de sa colère pour survivre et témoigner.
EXTRAIT
Ensuite, comment dire… Pas de mariage, non. Mais un emménagement rapide dans sa grande maison, dans un village, Gilmont, à trente kilomètres de Liège. Village sans charme particulier : un réaménagement absurde l’avait transformé en parking, supprimant l’ancienne placette et son kiosque. Quelques commerces subsistaient, ainsi que l’église en pierre du pays : les carrières de grès avaient fait jadis la fortune de la région mais elles étaient aujourd’hui à l’abandon. Gilmont se nichait pourtant au cœur d’une vallée verdoyante, comme la vantaient les guides touristiques, et l’Ourthe attirait dès le printemps pêcheurs et kayakistes.
La maison de Bruno se trouvait un peu à l’écart, et un jardin vaste et assez sauvage la séparait de la rivière, qui coulait en contrebas et dont l’odeur fade entrait par les fenêtres les soirs de pluie. En principe, avec mes habitudes de citadine, j’aurais dû détester cette bâtisse carrée, aux murs épais, coiffée d’ardoises grises comme le ciel. Mais tout m’avait plu d’emblée, et surtout le jardin, mal peigné, avec ses haies de noisetiers, les aulnes qui se penchaient sur l’eau comme des guetteurs échevelés, l’allée de sable à demi-effacée, que la pluie transformait souvent en mare boueuse. Bruno n’avait pas l’âme d’un jardinier. Il était partisan de rendre à la nature sa sauvagerie initiale. Il faut dire que c’était facile.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Frédérique Vervoort s’aventure avec audace sur les terres calcinées d’une passion incandescente, sans limite, égoïste et cruelle car insensible à autrui. Que reste-t-il sous la cendre ? Un espoir ? Peut-être…
Mater Dolorosa, un roman choc au-delà de la souffrance.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mater dolorosa
Frédérique Vervoort
UPblisher.com
« Le plus grand empêchement à la vie, c’est l’attente que tient en suspens le lendemain » Sénèque
PROLOGUE
Je ne me suis jamais doutée de rien.
Bien sûr, après, c’est facile de retrouver des signes, des indices, comme ils disent…
Mais non, rien. J’ai beau faire un effort de mémoire.
En fait, je mens. On ment tous. D’abord à soi-même.
On ment pour des tas de raisons.
La première : s’épargner la souffrance. C’est humain après tout. La lâcheté est dans nos gènes. Le bonheur, une tromperie. Un attrape-gogos de foire. Une charlatanerie.
Disons que je suis tombée dans le piège.
Ce n’est en aucun cas une excuse.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE 1
Je venais de fêter mes trente ans. Sans tambour ni flonflons. J’avais déjà un divorce au compteur et d’imperceptibles griffures au coin des yeux.
Mais j’étais libre. Légère comme une bulle de champagne. Je m’étais débarrassée, sans état d’âme excessif, de mes dernières entraves. Damien, mon ex-mari, avait regagné son étude de notaire et son penthouse orienté plein sud en maudissant les épouses mal embouchées.
Cette inaptitude à la vie conjugale, je la tenais, pensai-je, de mon père. Homme d’affaires foireux, il multipliait les aventures et ne s’en cachait pas. Il avait l’air de s’amuser dans la vie. Tout le contraire de ma mère qui traînait en permanence une face de carême, tellement maussade que presque personne ne s’apercevait qu’elle était encore jolie.
Lorsque mon père avait engrossé une jeunesse et manifesté l’intention d’une « séparation à l’amiable » – ma mère s’avérant encore trop catholique pour envisager un vrai divorce – l’atmosphère, à la maison, était devenue intenable. En fin de compte papa avait pris le large, muni d’une amante toute fraîche et d’un couffin. Mon demi-frère s’appelait Edmond et le Dieu vengeur de ma mère le punirait en l’affligeant d’un asthme chronique qui l’obligerait plus tard à ne jamais ôter de la poche arrière de son pantalon sa bombe de corticoïdes.
À la suite de cet événement, survenu l’année de mes seize ans, ma mère avait sombré dans une dépression aussi prévisible qu’interminable. Dieu n’autorisait pas le suicide. Il tolérait les longues agonies. Celle de maman, entre psychotropes et vodka, n’en finissait pas de m’empoisonner la vie, niquait mes relations sociales et me forçait à n’imaginer l’avenir que drapé de crêpe et de sombres nuées.
Parfois, mon père surgissait, imprévisible et charmant, jetait un coup d’œil dégoûté sur ses amours défuntes, qui palpitaient encore vaguement sur le canapé du salon, et m’embarquait dans sa nouvelle Audi pour un petit « week-end » de récup’, comme il disait. Le week-end en question m’autorisait surtout à baby-sitter le fragile Edmond, qui refusait de prendre du poids, et surtout à supporter le caquetage de ma fausse belle-mère, Pam, un surnom qui claquait comme une tape sur ses fesses rebondies. Pam, Paméla, ou comme l’indiquait sa carte d’identité que j’avais reluquée en douce – Marie-Laurette Morisot – n’avait que 10 ans de plus que moi. Ce qui l’autorisait, croyait-elle, à de douteuses confidences sur la virilité toujours triomphante de mon père et l’état lamentable de ses finances. Marie-Laurette, dite Pam, avait la fraîcheur d’un gardénia et l’accablante bêtise d’une visionneuse de télé-réalités, émissions qui venaient tout juste de prendre forme sur l’écran des modes à fuir. Je m’ennuyais donc à périr. Au moins ma mère avait le bon goût de se taire la plupart du temps, assommée par les médicaments.
Il semblait évident que ce mode de vie alternatif ne pouvait déboucher que sur deux conséquences : une envie compulsive de fuir et un besoin réel de protection. Toutes choses que j’avais cru trouver chez Damien, qui finissait son notariat dans une étude de Liège. Étude qui appartenait d’ailleurs, comme il se doit, à son père. La succession paraissait assurée.
J’avais rencontré Damien De Haene à la cafétéria de l’université où je bâclais une licence de lettres, vite reconvertie en un graduat de bibliothécaire. Moins cher et plus rapide. Mon environnement familial me mettait les nerfs à fleur de peau. Un rien m’irritait. Damien, calme, pesant et réfléchi, s’était affirmé avec toute sa force tranquille, une formule politiquement à la mode à l’époque. Le mariage m’avait semblé la plus raisonnable des options. J’avais besoin à la fois de balises et d’évasion. Ce n’était pas forcément incompatible. L’officialisation de nos ébats – avec capeline et bénédiction recommandées – s’était imposée à nous. Cela soulageait ma parentèle. Consternait plutôt la sienne, bourgeoise et bien-pensante. Ma mère sous camisole chimique, mon père avec sa jeunette et son mouflet, ça les horrifiait bien sûr. Consolation : j’étais une vraie blonde, d’allure racée. Je pouvais faire illusion dans les rallyes mondains que Damien détestait autant que moi. C’était peu mais suffisant. On nous avait foutu la paix.
Le mariage m’avait délestée de ma famille, trop contente de se défaire de moi, et réciproquement, mais…
Je m’ennuyais. Le mal était littéraire depuis Flaubert mais bovaryser à longueur de journée n’avait rien de drôle. J’aimais notre immeuble sur les quais : rez-de-chaussée consacré à l’étude, étages voués aux reflets de la Meuse et à la dérive des nuages le long de nos baies vitrées… L’amour que je portais à mon époux, malheureusement, était moins inconditionnel. Damien restait calme, pesant, réfléchi. J’aurais dû m’en contenter.
Mon mi-temps de bibliothécaire, que j’avais réussi à conserver, m’autorisait d’intéressantes rêveries. L’informatisation n’avait pas tout à fait pris les commandes et je pouvais donc laisser planer un regard bleu glacier sur les têtes studieuses qui m’entouraient. Certaines étaient charmantes. Je distribuais des conseils littéraires, je dispersais des références, je me levais, dans une jupe entravée, pour aller quérir tel ou tel volume qui sentait bon son siècle passé. Des yeux caressants me suivaient.
J’ai fini par tromper Damien. Comme cela. Sans élan véritable. Comme on boit un verre de vin pétillant pour se changer de l’eau plate.
Il faut croire que je n’étais pas bien forte à ce jeu. Ou que j’étais trop paresseuse ou insouciante pour me cacher. Damien a fini par savoir. Il est sorti de ses gonds, pour une fois. C’était amusant à voir. Je lui ai répondu avec désinvolture que je m’en foutais, que j’aspirais de nouveau à me retrouver seule. Que je n’avais plus besoin de remparts ni de tendresse. J’avais fini ma mue.
J’ai divorcé. Ma mère s’est lamentée puis est retombée dans ses brumes. Mon père n’a pas osé moufter. Pas lui. Du moment que je ne lui demandais pas de fric, mon sort l’indifférait. La famille De Haene exultait. Le fils prodigue revenait à la raison. Il y avait encore des héritières à caser.
J’ai emménagé dans un petit studio en attendant que ça se tasse. Des chemins nouveaux se déployaient devant moi. Mon destin m’appartenait.
Je savourais ma disponibilité nouvelle.
Comme on dit des prisonniers : j’étais en relaxe.
CHAPITRE 2
Bruno et moi, nous nous sommes rencontrés un soir de printemps, à une terrasse. Banale introduction pour un chapitre destiné à se clore rapidement. C’est vrai que j’en avais connu de ces prémices qui ne débouchaient sur rien, et aucune n’avait levé en moi le moindre regret. On était d’ailleurs un bouquet de filles dans ce cas.
Nous avions toutes un métier, l’indépendance financière, l’indépendance tout court. Nous n’étions plus une génération de victimes.
Personne ne régentait ma vie, qui s’égrenait en une série de jours désinvoltes. Cette soirée de juin me rappelait le poème de Rimbaud, même si je n’avais plus dix-sept ans. Air tiède, parfum des tilleuls au-dessus de nos têtes et ciel transparent comme un saphir. On ne parlait pas encore d’attentats ni de badauds massacrés autour d’un verre, coupables d’insouciance et de joie de vivre… On vivait au jour le jour sans trop se poser de questions, malgré les journaux qui plombaient l’ambiance, la crise du pétrole et le Moyen-Orient en ébullition. Les téléphones portables ne régentaient pas encore nos existences de lucioles. Ils étaient rares et chers.
J’aimais les crépuscules. Et la nuit. Que je ne passais pas qu’à dormir. J’étais blonde mais pas idiote, plutôt gironde si j’en croyais les garçons. Depuis mon divorce, je me sentais comme une pouliche au pré. Fière de cavaler. Les horaires pépères de la bibliothèque m’arrangeaient bien. Il m’arrivait d’arrondir mes fins de mois en aidant quelques adolescents friqués à bachoter sur Madame de Staël ou les Confessions… Mon quatorzième étage, vue sur fleuve me convenait. La campagne me rendait mélancolique à l’époque, et je préférais voir de ma fenêtre l’écheveau vaporeux des nuages et des flots plutôt que le friselis des feuilles sur un mur d’enceinte.
Mais ça c’était avant. Avant Bruno.
Je le revois se pencher vers ma table où je sirotais, très écologiquement, un jus d’abricot.
— Vous ne préféreriez pas une boisson plus roborative? Un peu douceâtre le jus d’orange, non?
— C’est de l’abricot.
— À plus forte raison, alors…
— Vous me proposez quoi?
— Un petit blanc frais? Un rhum vingt ans d’âge? Un whisky malté?
— Vous voulez me rendre alcoolique?
— Vous n’avez pas l’air d’une fille raisonnable sinon je ne me serais pas permis de vous aborder…
— Dites tout de suite que j’ai l’air d’une gourgandine !
— “Gourgandine”… J’adore ce mot. Personne ne l’emploie plus, il sent son siècle dernier. Décidément, vous m’intéressez…
Et sans attendre ma réponse, l’homme s’était installé en face de moi. Il devait avoir dans les trente-cinq ans, châtain bouclé, des yeux tirant sur le vert, aux cils longs, la peau mate. En recevant de plein fouet son sourire, je me suis demandé une fois de plus ce qui m’avait pris d’épouser Damien, qui avait la robustesse paisible d’un percheron de labour. Réflexion qui manquait de charité si on considérait que l’individu me faisant face avait l’allure d’un héros de roman de gare. Faut-il se méfier des clichés ?
Je n’en n’étais plus à me repaître de magazines pour midinettes ; j’avais quelques heures de vol, et je n’étais pas douée pour la candeur. Pourtant Bruno m’a fait fondre dans l’instant. Il semblait n’avoir aucun surmoi et quand il a hélé le garçon pour nous commander d’emblée un cognac et s’est ensuite mis à me caresser les cheveux, je n’ai esquissé aucun geste de défense.
— J’aime tes cheveux, c’est un miracle d’être si blonde, tu t’appelles comment ? Moi, c’est Bruno. Je suis ton contraire…
En y repensant, cette phrase bizarre : « Je suis ton contraire » aurait dû sonner comme une prémonition. J’y ai vu une allusion à nos différences capillaires. Et c’était sans doute le cas. J’ai murmuré mon prénom, d’une voix timide, comme une pucelle de l’année :
— Isabelle.
— Un prénom de fille sage, de fille belle… Ton père doit être médecin. Ta mère, femme au foyer.
J’ai réagi au quart de tour, vexée. Il me tournait en dérision.
— Pas vraiment. Tu n’as aucun instinct.
Il a souri :
— Ça, il y a longtemps que je le sais. J’ai des méthodes de drague désastreuses.
— Parce que tu me dragues ?
— À ton avis ?
Il a plongé alors dans mes yeux son regard dont j’ai réalisé soudain l’étrangeté. L’œil gauche était vert alors que le droit tirait sur le brun, un brun presque noir mais néanmoins limpide, ocellé de paillettes. Je ne connaissais personne qui ait les yeux vairons. Je trouvais cette particularité à la fois dérangeante et belle. Il devait s’en servir pour déstabiliser ses interlocuteurs. J’ai attendu sa réponse avec une fausse assurance.
— Peut-être. Dans quel but ?
— Tu veux que je sois franc ?
Je m’attendais au pire mais je me sentais de taille à répondre. Le cognac m’échauffait et me rendait téméraire.
— Bien sûr. Je n’aime pas les menteurs.
Les yeux vairons ont rapidement cligné, voile de cils, un éclair alternatif, vert et or…
— Je pense que je pourrais vivre avec toi.
Là, j’ai été estomaquée.
— Un peu rapide, non, comme approche ? Je sors d’un mariage !
— Je n’ai pas dit que je voulais t’épouser. Rien de pire que les contrats ! Simplement, je voudrais t’emmener chez moi, dans ma maison. Il y a un jardin, au bord d’une rivière… Ça te plairait.
— Tu ne me connais pas ! Je déteste la campagne.
— Je t’apprendrai à l’aimer.
— Tu ne doutes de rien !
— Non.
Il a pris ma main, l’a portée contre sa joue, chaude et un peu râpeuse. Le contact m’a bouleversée.
— Je m’appelle Bruno Gandolphi. Je suis un homme très patient. J’attendrai que tu changes d’avis.
— Isabelle Delage. Il te faudra des arguments.
— J’en trouverai.
— Je ne baisse pas ma garde si facilement.
Il a ri.
— Pourquoi ce vocabulaire guerrier? Je ne te veux que du bien…
— Déjà ? En ignorant tout de moi ? J’ai un caractère impossible, une mère névrosée, un demi-frère asthmatique et un ex-mari notaire. Tu as toujours envie de m’emmener dans ta petite maison dans la prairie ?
— Plus que jamais.
— Alors, parle-moi de toi. Convaincs-moi…
Il ne m’a presque rien dit, car à ce stade on n’avait plus très envie de parler.
Et il m’a convaincue.
CHAPITRE 3
Ensuite, comment dire… Pas de mariage, non. Mais un emménagement rapide dans sa grande maison, dans un village, Gilmont, à trente kilomètres de Liège. Village sans charme particulier : un réaménagement absurde l’avait transformé en parking, supprimant l’ancienne placette et son kiosque. Quelques commerces subsistaient, ainsi que l’église en pierre du pays : les carrières de grès avaient fait jadis la fortune de la région mais elles étaient aujourd’hui à l’abandon. Gilmont se nichait pourtant au cœur d’une vallée verdoyante, comme la vantaient les guides touristiques, et l’Ourthe attirait dès le printemps pêcheurs et kayakistes.
La maison de Bruno se trouvait un peu à l’écart, et un jardin vaste et assez sauvage la séparait de la rivière, qui coulait en contrebas et dont l’odeur fade entrait par les fenêtres les soirs de pluie. En principe, avec mes habitudes de citadine, j’aurais dû détester cette bâtisse carrée, aux murs épais, coiffée d’ardoises grises comme le ciel. Mais tout m’avait plu d’emblée, et surtout le jardin, mal peigné, avec ses haies de noisetiers, les aulnes qui se penchaient sur l’eau comme des guetteurs échevelés, l’allée de sable à demi-effacée, que la pluie transformait souvent en mare boueuse. Bruno n’avait pas l’âme d’un jardinier. Il était partisan de rendre à la nature sa sauvagerie initiale. Il faut dire que c’était facile.
Au début, je m’étais amusée à planter des rosiers, à remplir de terre des vasques trouvées dans l’ancienne grange attenante, et à y semer géraniums et autres dahlias. Sans grand succès. Les fleurs poussaient certes, ainsi que les mauvaises herbes, dans la même joyeuse anarchie. Bruno n’avait pas tort. La nature aimait l’impulsivité.
La vraie raison pour laquelle j’avais tout de suite aimé cette maison, c’est qu’elle avait offert un décor, certes un peu frustre, à nos premières étreintes. Car j’étais tombée dans les bras de Bruno comme on tombe dans un puits, un puits sombre, peuplé d’ombres tremblantes, car tout était en pierre, le sol, les murs, les falaises calcaires qui nous surplombaient. Pierre et eau… Un silence liquide nous entourait et le corps de Bruno, brun et dur, semblait, lui aussi, jailli d’un rocher. Durant nos accalmies, ses yeux dissemblables me fixaient, comme pour me clouer à tout jamais sur ce lit en désordre dont les draps de lin m’écorchaient le dos.
Il me chuchotait tout aimer de moi, même ce qui me déplaisait : ma peau trop blanche, ma bouche épaisse, mes yeux dont le bleu me semblait fade et égal. Son contraire, son opposée, alors que j’aurais voulu lui ressembler, me fondre en lui.
Jamais je n’avais éprouvé pour un homme une telle avidité et comme un besoin primitif de fusion. Je n’avais envie de rien d’autre que sa présence. Et cette présence, il me l’offrait en permanence car, fait rare et scandaleux dans cette décennie besogneuse, Bruno vivait de ses rentes. Il me l’avait avoué avec un peu de réticence : ses parents, apparemment de riches restaurateurs du nord de la France, étaient morts dans un accident de voiture alors qu’il avait vingt ans à peine. Le premier choc passé, il avait poursuivi ses études de sciences politiques à Lille avant d’émigrer à Bruxelles pour un stage de droit européen, puis s’était décidé à revendre les commerces de ses parents au gérant actuel. Il avait fonctionné quelques années dans diverses entreprises avant de se rendre compte que ce boulot l’ennuyait au-delà de tout, et que sa fortune personnelle lui permettait de vivre comme il l’entendait, c’est-à-dire modestement, mais en évitant les circuits du travail traditionnel.
Autrement dit, tu ne fous rien !
La première fois que j’avais émis cette constatation, elle avait sonné, à mes oreilles du moins, comme une incongruité. Comment, à notre époque et dans nos contrées, face aux populations laborieuses, hantées par la peur du chômage, pouvait-on se permettre de vivre de l’air du temps ?
— On peut, c’est tout. Moi en tout cas je le peux, et je n’en n’ai pas honte. Plus envie de perdre ma vie à la gagner, comme on dit. Et puisque c’est un luxe que je suis capable maintenant de m’offrir, je le saisis, sans remords. Je n’aspire pas à jouer les Robinson sur une île à la mode mais je suis maître de mon temps, enfin, et ça, ma petite, c’est un cadeau inappréciable.
— Un cadeau? L’accident de tes parents ? L’héritage ?
J’avoue, j’étais choquée par son cynisme. Ma remarque l’a secoué et j’ai presque eu peur quand le vert de son œil gauche a foncé, viré à l’orage, un océan de tempête, tandis que l’autre lançait des éclairs sombres. Puis, à ma grande honte, il a baissé la tête et j’ai vu des larmes dévaler sur ses joues, le long des petites rides un peu amères que son sourire creusait parfois.
— Arrête de dire n’importe quoi. Tu ignores tout de l’histoire.
Honteuse, j’ai murmuré :
— Alors, explique-moi? Je ne voulais pas t’attrister, je te jure…
J’ai tenté un geste maladroit, une main sur sa nuque, là où les premières boucles prenaient racine. Il a bronché comme un cheval offensé.
— Arrête. J’ai fait une dépression, profonde, les psy m’ont parlé d’un syndrome de feedback, je ne sais plus, peu importe, j’ai encaissé avec retard, c’est tout. C’est pour ça que j’ai tout interrompu, le boulot, la vie, et même les amours qui allaient avec, je ne voulais qu’une chose. Tout stopper, arrêter la course, me terrer dans un endroit désert, ou du moins un patelin tranquille, où personne ne m’emmerderait. Le hasard m’a fait dénicher cette maison. Pas terrible peut-être, mais ça m’a plu. Voilà.
— Ça me plaît aussi. Tout me plaît avec toi. Excuse-moi.
Bruno a tenté un sourire. D’un revers de main il a essuyé ses larmes. Il paraissait confus de s’être ainsi abandonné. J’étais, bien sûr, ivre de repentance. Je l’ai serré dans mes bras. Il m’a repoussée avec douceur :
— Tu ne pouvais pas savoir. C’est de ma faute. Mais tout ça c’est du passé. Je vais bien à présent. N’en parlons plus.
On n’en a plus reparlé.
Et le scandale de notre bonheur oisif s’est prolongé. Des mois. Toute une année. Jusqu’à ce que mon ventre s’arrondisse.