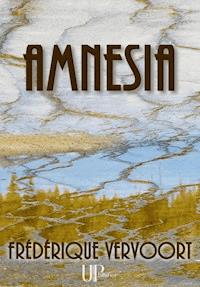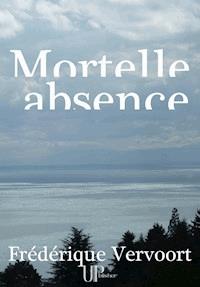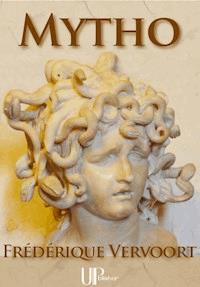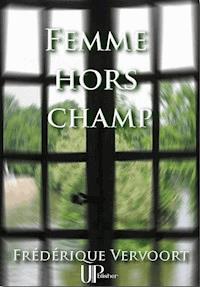
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Une héroïne vulnérable et au bord de la rupture qui se confronte à la complexe réalité de notre siècle...
Laura aimerait bien… une carrière qui la mettrait en lumière, rencontrer l’homme idéal, échapper au sort d’une mère provinciale et fade et suivre l’exemple d’une grand-mère urbaine et originale. Insatisfaite, elle abuse de stratagèmes qui, pour pimenter sa vie, la compliquent ainsi que celle de ses proches, sans jamais satisfaire sa quête de sens.
En ce début du XXIe siècle, secoué par un regain de violence, les choix hasardeux d’un « Machiavel aux petits pieds » ne sont pas sans conséquences. De petites compromissions elle dérive peu à peu vers son souhait ultime, se trouver au cœur de l’action…
Femme hors champ est une formidable étude de caractères. Laura la fille, mais aussi sa mère et sa grand-mère composent un trio de femmes dont chacune reflète son époque. Dernière de la lignée, Laura hérite des espoirs et frustrations des générations précédentes. À quel point est-elle maître de son destin ?
Avec subtilité, Frédérique Vervoort dessine un être ambivalent : mue par une volonté farouche, Laura partage avec nous cette aspiration universelle à « trouver sa place ». Nombriliste, elle ne s’embarrasse pas de procédés pour atteindre son but. À la fois touchante et détestable, elle est comme un élastique, toujours en tension, toujours au bord de la rupture. Faut-il y voir le symbole d’une génération désenchantée ?
La plume fluide et élégante de Frédérique Vervoort et son attention particulière pour ces fêlures qui en disent long sur la psychologie des personnages font de ce roman un régal.
EXTRAIT
Je n'ai rien contre ma mère. Disons que je n'ai rien pour non plus. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, et puis elle est morte,à quatre-vingts ans, d'une rupture d'anévrisme bien nette.
Mamilou (elle détestait qu'on l'appelle Mémé, ce dont je ne me privais pas, pour rire) était le contraire de sa fille. Elle avait été une Louise flamboyante, enceinte sans remords d'un G.I. rouquin, natif de Virginie, qu'une balle perdue avait rayé de son cœur juste à la fin de la guerre, manque de bol… Mais elle avait surmonté avec panache la dèche et les préjugés pour mettre au monde cette petite chose molle et sans éclat : ma mère. Un enfant d'après-guerre, qui payait pour les années de privations et d'infortune. La gamine avait une santé fragile, un caractère faible, une âme mal trempée, et il me semble qu' elle a tout de suite accepté le rôle de boulet que le destin lui avait assigné. Bringuebalée de pension en appartement précaire, elle n'a cependant jamais été reniée par sa mère. Pas vraiment. Mais Louise s'est sentie flouée. Elle aurait voulu accoucher d'une lionne. Elle s'est retrouvée avec un chaton malingre. Aussi s'est-elle enchantée du choix de Victoire, sa fille si mal nommée, d'épouser tout à trac un épicier de village bien trop âgé pour elle. Enfin, un autre reprenait le fardeau.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maître-assistante à la Haute École Charlemagne en Belgique,
Frédérique Vervoort réside à Liège. Franco-belge, elle demeure attachée à l'héritage culturel de ses deux pays d'origine.
L'écriture la passionne depuis toujours, mais c'est seulement maintenant qu'elle prend le temps de s'y consacrer et de partager avec les lecteurs ce qui n'était, jusqu'alors, qu'un plaisir personnel.
Ses romans et nouvelles nous plongent dans une atmosphère intimiste et mystérieuse. Suspense garanti pour ce remarquable auteur qui marche sur les traces de Simenon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Femme hors champ Frédérique Vervoort
UPblisher.com
CHAPITRE 1LAURA
J'ai toujours aimé la vision des champs de blé au soleil. Une plénitude dorée, ondoyante, sous un ciel limpide, voilà ma conception du bonheur. Pas de pensée superflue. Un air tiède qui infuse en douceur une lumière au parfum de céréales. Blé – pain. Un binôme satisfaisant. De la blondeur qui se mâche. Un océan d'épis. On a envie de s'y coucher. D'y dormir pour de bon. Il paraît que ça pique. Je n'ai jamais essayé.
Je vis en ville. La campagne, j'y vais par à-coups, quand j'y suis obligée. Là est le paradoxe. Et les champs de blé, je les longe en voiture, trop vite, en pestant contre les tracteurs chargés de foin qui retardent ma course. Parce que je sais qu'au bout de la route, après les vagues bucoliques des graminées oscillant dans la clarté de juillet, il y aura le village, la maison – et ma mère.
Je n'ai rien contre ma mère. Disons que je n'ai rien pour non plus. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, et puis elle est morte,à quatre-vingts ans, d'une rupture d'anévrisme bien nette.
Mamilou (elle détestait qu'on l'appelle Mémé, ce dont je ne me privais pas, pour rire) était le contraire de sa fille. Elle avait été une Louise flamboyante, enceinte sans remords d'un G.I. rouquin, natif de Virginie, qu'une balle perdue avait rayé de son cœur juste à la fin de la guerre, manque de bol… Mais elle avait surmonté avec panache la dèche et les préjugés pour mettre au monde cette petite chose molle et sans éclat : ma mère. Un enfant d'après-guerre, qui payait pour les années de privations et d'infortune. La gamine avait une santé fragile, un caractère faible, une âme mal trempée, et il me semble qu' elle a tout de suite accepté le rôle de boulet que le destin lui avait assigné. Bringuebalée de pension en appartement précaire, elle n'a cependant jamais été reniée par sa mère. Pas vraiment. Mais Louise s'est sentie flouée. Elle aurait voulu accoucher d'une lionne. Elle s'est retrouvée avec un chaton malingre. Aussi s'est-elle enchantée du choix de Victoire, sa fille si mal nommée, d'épouser tout à trac un épicier de village bien trop âgé pour elle. Enfin, un autre reprenait le fardeau. L'âge semblait garantie de stabilité. Néanmoins quand celui-ci est mort prématurément - arrêt cardiaque, boum, le nez dans les conserves de cassoulet – elle a accepté de m'élever pour moitié. Parce que – mystère de la génétique – j'avais sauté une génération et que mes traits, ma rousseur d'écureuil, lui rappelait Mark, le G.I. perdu. J'avais aussi hérité d'un tempérament volcanique et têtu, le contraire de celui de ma mère. Mon père, je l'avais trop peu connu pour porter un jugement. J'étais, bizarrement, la fille de mes grands-parents, et ma mère avait très vite accepté cet état de fait. J'étais donc partie vivre en ville, avec Mamilou, qui travaillait comme secrétaire dans une officine médicale mais s'arrangeait pour ses fins de mois avec un amant discret, son patron – un chirurgien cardiaque renommé et malheureusement grevé d'une épouse chrétienne et de nombreux enfants envahissants.
Veuve, ma mère avait repris l'épicerie de Gercourt et n'avait pas eu d'amant. Du moins à ma connaissance. Elle vivait recluse dans son village et je lui concédais une visite par mois. Puis par trimestre. Je la trouvais ennuyeuse comme la pluie. Une petite pluie de novembre, froide et serrée. On n'avait rien à se dire. Elle s'intéressait médiocrement à mes études de lettres et craignait toujours, comme une petite fille, les jugements ironiques de Louise qui, en mère responsable, se pointait régulièrement à l'épicerie pour juger de l'état des comptes et houspiller la malheureuse dont la vie semblait plate comme une autoroute hollandaise. Jamais de folies, jamais de vacances, ou si peu - alors que Louise s'envolait régulièrement pour des destinations exotiques dès que son amant lui offrait un congrès. Il faut dire que, du haut de son grand âge, Louise continuait à en jeter, avec ses yeux bleus rectangulaires à la Lauren Bacall et son sourire de louve… Elle était de ces femmes qui se « débrouillent dans la vie » comme disait ma mère avec un mépris mêlé d'envie et d'admiration. Elles n'avaient rien en commun, et pourtant, ces deux-là s'aimaient, je pouvais en jurer, à leur manière bancale, certes, et c'était mieux que rien. Louise continuait à protéger sa fille, même de loin, même si sa préférence allait nettement à moi, Laura, la dernière bouture, celle qu'elle avait taillée et embellie à sa mesure…
Moi, je le dis sans honte, à cette époque, seule ma grand-mère comptait. Et, prévisiblement, c'était la tendresse un peu affligée et sans concession que mon aïeule vouait à Victoire, sa progéniture, qui motivait, par osmose, mon manque d'empathie. Je n'aurais pas voulu de cet amour au ventre mou. Alors je préférais une indifférence froide que l'adolescence avait renforcée. Je n'avais pas besoin, dans mes bagages sentimentaux, de ce pauvre baluchon sans couleur. Une grand-mère originale et sexy suffisait à mon bonheur. Et puis j'adorais la vie citadine : les rues animées des quartiers commerçants, les promenades le long du fleuve, l'odeur de bitume et d'essence, l'université et les fêtes. Les mecs. L'attendrissement devant les champs de blé ne m'avait pas encore empoignée. Le parfum des bois en automne, la campagne pleine de glaise et de feuilles tombées, franchement, je laissais cela aux marcheuses de cinquante ans et aux scouts. J'avais le temps. Croyais-je.
Et puis Mamilou est morte. C'était incroyable. La veille, elle gambadait encore sur ses hauts talons et téléphonait à son chirurgien, rangé des voitures, certes, qui la gâtait encore comme une cocotte du siècle passé. Lui envoyait des orchidées fraîches dont elle émaillait notre appartement des bords de Meuse. J'entends encore son rire un peu rauque de grande fumeuse. Il adorait lui faire des blagues de carabin au téléphone. Elle raccrochait en disant : « Quel cochon, ce type, si sa bergère savait ! » Elle n'appelait jamais autrement l'épouse potiche.
La police m'a appelée en fin de soirée. Elle était tombée dans la rue, à deux pas de chez nous, même pas la faute à ses hauts talons. Son cœur avait simplement décidé de ne plus battre. J'étais abasourdie. La suite s'est déroulée dans une sorte de brume. Merci les pompes funèbres qui prennent tout en charge, et la prévoyance de ma grand-mère et de son bon docteur, qui ne me laissaient pas sans rien car j'avais encore mon diplôme à décrocher. J'héritais ainsi de l'appartement, passant une fois encore au-dessus de la tête de ma mère qui n'avait sans doute besoin de rien, avec son épicerie. Mamilou s'était débrouillée avec un notaire pour me faire une donation de son vivant, je n'y comprenais rien mais là, posthumement, ça me sortait la tête hors de l'eau.
L'incinération m'avait, comme de juste, laissé un souvenir de cendres… Le chirurgien pleurait, seul, vieilli, blanchi, toujours debout. Je l'aimais bien, même si je l'avais peu rencontré – Mamilou détestant mélanger l'intime et le familial – et puis, je savais ce que je lui devais. Je lui ai pris la main, très fort, et il m'a serrée contre lui, devant la petite foule d'amis, tous au courant de notre situation un peu particulière.
« Elle t'adorait, tu sais…
— Je sais, oui… »
L'odeur fade des fleurs me donnait mal à la tête. Il y en avait plein. Louise était aimée.
Pas de curé bien entendu, ni de sermon, ni de panégyrique. Elle aurait eu horreur de ça.
Ma mère. Au premier rang. Cela faisait bizarre. Si peu de monde la connaissait. Elle avait mis une tenue de deuil à l'ancienne, genre veuve de guerre. Un chapeau, une voilette noire, des gants. Une petite corneille muette. Sans larmes, cela m'a surprise. Je l'aurais pensée plus consensuelle.
Elle m'a quand même chuchoté, en me touchant l'épaule – elle n'osait pas aller jusqu'à l'embrassade – « J'espère que je te verrai plus souvent, maintenant… »
« Maintenant quoi ? » En ce moment solennel, Victoire avait réussi à me mettre encore en rage. Voulait-elle insinuer, à sa manière torve et peureuse, que Louise m'empêchait de la voir ? J'étais assez grande pour décider toute seule. D'une bourrade, je me suis dégagée. Elle a soupiré. Et puis a simplement relevé sa voilette. Et là, j'ai eu un choc. Jamais je ne m'étais avisée que Victoire ressemblât à ce point à sa mère. Même menton pointu, nez aux ailes retroussées, et yeux bleus en amande. Mais le tout comme effacé, dilué. Un lavis. Même le pervenche des prunelles paraissait insipide. Une sorte de Louise passée à l'éponge. Le résumé d'une vie en somme. Et brusquement j'ai eu pitié. C'était peut-être le message transmis par ma grand-mère. Que je n'abandonne pas tout à fait la filiation…
Et c'est comme cela que j'ai repris, peu à peu, le chemin du village. Et que j'ai redécouvert la blondeur des champs d'été…
Au début, c'était plutôt pénible. Je me forçais et ça se voyait. La campagne m'emmerdait. Le village où j'avais passé mes premières années ressemblait à tous les villages. Des maisons en pierres grises du pays regroupées autour d'une église sans style. Une rue principale où s'alignaient quelques commerces. Dont l'épicerie de mes parents. Derrière la vitrine au lettrage à demi-effacé, on avait remplacé les tablettes de bois à l'ancienne par un comptoir réfrigéré assez hideux mais « pratique ». Il faut bien vivre avec son temps. Ma mère avait conservé les grands bocaux de bonbons acidulés qui faisaient de moi une copine très convoitée à l'école primaire. Pour le reste, c'était un pêle-mêle de charcuteries préemballées, pâtisseries industrielles et conserves diverses. Mais les vieux du village, qui n'avaient pas de voiture pour les conduire à l'Intermarché à six kilomètres de là, s'en contentaient et pouvaient survivre. De là à faire la fortune de ma mère, il y avait de la marge, cependant elle n'avait jamais voulu quitter Gercourt, ni osé changer de métier. Elle redoutait par-dessus tout affronter l'inconnu. Elle était pourtant titulaire d'un diplôme d'institutrice et aurait pu prétendre à mieux. J'avais parfois l'impression qu'elle était d'un autre siècle – ce qui était en partie vrai – et que les bouleversements de l'ère qui s'annonçait n'allaient pas au-delà de son nouveau comptoir-frigo. À son âge, qui était loin d'être avancé, elle me semblait plus périmée qu'un courrier papier par rapport à un e-mail. D'ailleurs, elle prétendait être incapable de se servir d'un ordinateur – alors que Mamilou surfait allègrement sur le net et envoyait des courriels cryptés à son amoureux.
Le veuvage faisait partie de ma mère, à tel point que j'ignorais jusqu'à la notion de père. Edmond Dargent, mon géniteur, aussi mal nommé que son épouse, Victoire, avait été rayé du monde alors que j'avais à peine quatre ans. Mes souvenirs étaient flous. En cela Victoire et Louise se ressemblaient. Elles avaient été trop tôt des mères sans mari. De mon père je me souvenais vaguement d'une odeur de tabac, de joues qui piquaient, d'un grand front un peu dégarni et de prunelles obscures, dont j'avais hérité. Les quelques photos de famille confinées dans deux boîtes à chaussures – personne n'était du genre à confectionner des albums – confirmaient cette réminiscence. Mon père était à moitié chauve à quarante ans et ne ressemblait à rien. Sur une des photos, il posait devant la boutique, ensaché dans son tablier d'épicier, fixant l'objectif d'un œil noir et vide. Une mauvaise honte me montait au front. J'avais envie de fermer les yeux pour faire disparaître cette image, à la manière des enfants qui se croient invisibles lorsqu'ils se cachent le visage… Je n'arrêtais pas au contraire de reluquer l'unique photo de mon grand-père, l'Américain, que Victoire conservait dans un cadre, sur sa table de nuit, pour ne pas oublier d'où elle venait. Avec son uniforme kaki, son calot crânement posé de côté et sa mâchoire énergique de héros, j'en étais amoureuse. J'aurais voulu le connaître et je n'arrêtais pas de poser, enfant, des questions à son sujet. Oui, il était rouquin, comme moi, et beau gars, un peu hâbleur - il s'appelait Mark Weinstein, habitait à Richmond, où Louise aurait dû le suivre. Fin de l'histoire. Ma grand-mère n'en connaissait pas beaucoup plus à son sujet. Leur union avait été du style « brève rencontre » et cela ajoutait au romanesque de l'aventure. J'enrageais d'être la fille de mon père et pas celle de mon grand-père. Il y avait là une injustice flagrante. Ma mère était une erreur de transmission.
Pourtant, après la mort de Louise, j'éprouvai le besoin de renouer avec mes racines atrophiées, et je vins voir ma génitrice. Je recouchais même dans ma chambre d'enfant du premier étage. Je retrouvais sans émotion particulière les murs couverts d'une toile de Jouy fanée et mon lit de fillette. Victoire n'avait pas osé jeter mes poupées, mais leur petite face ripolinée me filait les jetons, la nuit… Même le couvre-lit en chenille rose n'avait pas changé.
« Tu aurais pu virer la déco, maman, je ne suis pas morte, pas besoin de garder toutes ces vieilleries !
— Mais tu n'es pas contente de tout retrouver intact ?
— Franchement, non ! Tu vois pas comme c'est moche ? »
Elle baissait la tête, sans relever mon insolence. Mais les poupées s'incrustaient. C'était sa façon à elle de me résister.
L'été de la mort de Mamilou, tout mon corps me parut comme aspiré par une sensation de vide presque insupportable. J'errai sans but, vacante et dépressive. Sans cesse, résonnait à mes oreilles le rire voilé de Louise. J'avais fui aussi pour cesser de guetter par la fenêtre sa silhouette virevoltante de jeune fille et son chignon haut laqué. Elle aimait tant flâner le long des quais… Même l'odeur de ses cigarettes me manquait. Je sursautais à chaque sonnerie de téléphone : et si elle m'appelait ?
Décidément, j'avais besoin de m'aérer la tête si je voulais boucler dans les temps mon travail de fin d'études : « Mensonges et idéalisation dans la Vie de mon père » On pouvait dire que j'avais de la suite dans les idées même si Restif de la Bretonne ne parvenait plus à me passionner.
Pragmatiquement, ma mère me redevenait utile pour l'intendance – les repas chauds, les jus d'oranges fraîchement pressées et la lessive repassée. Pour tout cela, Gercourt me semblait pratique. Transplanter ma mère à Liège était infaisable. Il y avait la boutique à tenir. Et j'aurais eu horreur de la voir dans nos meubles, à Mamilou et à moi. Je voulais garder le sanctuaire intact pour la rentrée.
Il y avait aussi une autre raison, moins avouable : je devais disparaître de la vie de Julien, mon petit ami du moment que j'avais décidé d'évacuer de mes pensées et de mes draps. Julien terminait brillamment une école de commerce et réunissait des qualités qui plaisent aux parents en général : il était sérieux, ambitieux, travailleur et possédait un pedigree de bête de concours. Il avait surtout de beaux yeux couleur d'amiante et des mains savantes pour toutes sortes de choses. Mais il ne me surprenait plus, donc il m'ennuyait. Il lui manquait le grain de folie et de révolte indispensable à toute jeunesse digne de ce nom. Tout ce qu'il faisait et disait me semblait prévisible. J'aurais pu terminer chacune de ses phrases et ce n'était pas par empathie. Il pensait comme la moyenne des gens, il croyait aux statistiques. Bien sûr, on nous le répétait à longueur de journaux, l'époque n'était pas à la fantaisie, nous vivions une jeunesse molle et désenchantée, la crise plombait nos envolées, etc. etc… Tout cela n'empêchait pas ce constat bientôt irrévocable : Julien serait toujours de l'étoffe des emmerdeurs bien élevés. Dont acte et rupture avec effet immédiat. Et repli chez ma mère.
Mais cela n'avait rien de drôle. Je m'ennuyais autant avec ma mère qu'avec Julien.
Après le travail, j'allais traîner dans les chemins qui s'écartaient du village pour s'enrouler dans les campagnes proches. C'est ainsi que je redécouvris l'ampleur sérénisante des blés ondulant au soleil. Les champs s'étendaient aussi loin que notre horizon – limité par des collines et des roches abruptes et lisses opportunément nommées « Tartines » – le permettait. Les pentes de calcaire dégringolaient directement dans l'Ourthe, qui serpentait en contrebas. Au-dessus, c'était les terres cultivables : les blés, le maïs, et les prairies où paissaient des vaches blanches et noires à gros cul, notre spécialité bovine. À part quelques tracteurs, il n'y avait jamais grand monde. Cela m'arrangeait. J'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de calme et de réflexion. Mon avenir m'angoissait un peu. Je ne me voyais ni dans une école en train de maîtriser des adolescents boutonneux, encore moins dans l'épicerie maternelle, ou occupée à faire la plonge dans un resto. Restif de la Bretonne intéressait moyennement les foules modernes, je le sentais bien. Il n'y avait ni libertinage ni révolution en vue dans le cercle étriqué où j'évoluais. Il aurait fallu casser d'invisibles frontières, sauter des barrages ; je ne voyais pas comment m'y prendre.
Il fut un temps où j'aurais voulu exercer un métier rock'n'roll : reporter de guerre ou découvreuse de pyramides. Les deux pouvant d'ailleurs se combiner dans les mêmes régions. Mais malgré cet aspect pratique, mon enthousiasme était vite retombé. Je n'aimais ni l'armée, ni les bombes, et ça compliquait tout.
« Alors, quoi ? demandait ma mère. Son bon sens paysan m'insupportait.
— Alors, rien. »
Pendant ce temps, le monde allait plutôt mal. À Gercourt, ce n'était guère perceptible.
CHAPITRE 2
La cuisine de ma mère avait récemment été agrémentée d'un lave-vaisselle dernier cri et d'un four à micro-ondes qu'elle avait acheté pour ne pas déplaire au vendeur, et dont elle se méfiait comme d'une bombe à fragmentation. Elle avait eu le culot de me dire qu'elle s'était procuré cet ustensile en vue des biberons à réchauffer de ma future progéniture. Je lui avais rétorqué que je n'avais pas l'intention d'accoucher dans les mois qui viendraient, que les exemples maternels que j'avais eus sous le nez, merci bien, d'ailleurs je n'aimais que les viandes rôties. La chose trônait donc, étincelante de blancheur inutile sur le plan de travail en stratifié imitation chêne. Et, en guise de séance de rattrapage, ma mère s'acharnait à faire rissoler des volailles sur le tournebroche de notre antique cuisinière à gaz.
« Mange, il faut que tu prennes des forces pour ton examen…
— Depuis quand te préoccupes-tu de mes examens ? »
Victoire prenait cet air coupable que je détestais. Ses yeux pâles, contrairement à ceux de ma grand-mère qui fulguraient façon laser, se délayaient, prenaient l'eau. Elle se détournait pour se moucher.
« Tu es injuste. Je t'ai toujours suivie !
— De loin. De très très loin… Ne t'en fais pas, tu n'y aurais rien compris, va !…
— Dis tout de suite que je suis une idiote ! »
J'avais décidé d'être insolente jusqu'au bout; je voulais tester les limites de la résistance maternelle :
« Non, mais avoue que c'est bien imité ! »
C'était tout vu ; elle capitulait sans combattre, se contentant de quitter la pièce en claquant la porte, juste un peu fort. C'était une maigre victoire… pour Victoire.
Après, je ricanais, alors que tout cela avait un goût de cendres. C'était facile de jeter ma mère dans les cordes, même si elle le méritait, selon moi. Aucune mère digne de ce nom n'aurait dû déléguer ses prérogatives à une aïeule, fût-elle chérie. Et le fait que ce soit moi qui avais réclamé cette passation de pouvoirs, que ce soit Louise qui s'était imposée, tel un chef d'armée, n'y changeait rien. Ma mère était coupable. De faiblesse. D'inertie. De vie fade et gâchée. D'être un contre-modèle évident. Je ne voulais pas finir comme elle, derrière une vitrine remplie de marshmallows et de surgelés, à compter mes sous et à regarder Drucker le dimanche.
Victoire avait quelques amies, aussi insignifiantes qu'elle, je ne me privais pas de le lui faire remarquer.
Il y avait Bernadette, qui était caissière en chef à l'Intermarché – on ne quittait pas les rayons ; Nathalie, l'instit du village, une ancienne copine de classe. Et c'était à peu près tout. Bernadette élevait une tripotée d'enfants et se débattait avec un mari porté sur la bouteille. Nathalie, divorcée, élevait seule un caniche abricot. Elles se prenaient des soirées parfois pour aller au cinéma, en ville. Le cinéma était la grande passion de ma mère. Celle qui, je suppose, la faisait vivre par procuration.
La troisième amie de ma mère, plus intime, était son médecin. Liliane Dupré. Une femme robuste, célibataire, qui teignait ses cheveux d'un henné sanglant et portait un discret piercing au sourcil gauche. Je la trouvais plus originale que les autres, la soupçonnais d'aimer les femmes ou les marins – d'accord, c'était plus difficile à trouver – et elle avait le mérite de rudoyer ma mère autant que moi :
« Allez, secoue-toi, tu n'as rien ! Un rhume ça prend 15 jours bien soigné et deux semaines si tu ne m'appelles pas ! » Elle se marrait, enchantée de sa plaisanterie, en buvant une goutte de genièvre sur un coin de toile cirée, parce que « ton déca, ma jolie, c'est de la flotte ! »
Ma mère l'avait connue à l'école primaire, et je supposais qu'elle lui avait souvent servi de rempart, par pure chevalerie, contre les méchants des cours de récréation. Elles s'appelaient entre elles Vic et Lili, ça faisait feuilleton américain. Seul rappel de ma lointaine filiation.
Quant aux hommes, point de traces. Bien sûr, je voyais traîner au magasin quelques fermiers du coin, en salopette ou bleu de travail, et je ne manquais pas de brocarder l'épicière :
« Dis-donc maman, tu ne m'avais pas dit que tes amoureux étaient aussi excitants ! Tu dois t'éclater, dis-donc ! Le gros à moustache surtout, une vraie bête de sexe, non ? »
« Arrête de dire des sottises ! C'est Fernand Matagne, le fils des laiteries, il était à l'école avec moi et tu as même connu sa fille, Kelly, tu te rappelles pas ? Elle travaille à la poste, à présent…
— Nan… Ah oui, la grosse molle qui me tannait toujours pour avoir des carembars… Eh ben tel père…
— Décidément, personne ne trouve grâce à tes yeux! Et pour une fois, ma mère avait eu un petit rire, presque ironique.
— Rassure-toi, je n'ai aucune vue sur Fernand Matagne, et réciproquement.
— Pas sûr, il traîne toujours dans tes parages. »
Avec un aplomb inattendu, Vic avait rétorqué :
« Eh bien, il peut se brosser, lui et les autres. J'ai un certain sens de l'esthétique, figure-toi! »
J'avais été soufflée :
« Et les autres ?? Tu traînes donc tous les cœurs après toi… Tu es une killeuse !… Tu vois,ça marche la jupe à godets et le tablier bleu marine !
— Je ne m'habille comme ça que pour travailler…
— C'est-à-dire six jours sur sept.
— Que veux-tu, je dois gagner ma vie, moi, tu ne vas pas me le reprocher ? »
C'était peut-être une allusion perfide aux donations de ma grand-mère. En avait-elle pris ombrage ?
Je m'empressais de répliquer :
« De toute façon, tu n'as jamais eu à m'entretenir. Tu ne vas pas me jouer les pauvres veuves méritantes. »
Ça lui avait cloué le bec. Un point partout. Elle s'était de nouveau éclipsée, la larme à l'œil.
Toutes ces échauffourées mettaient un peu de piment dans mon été mélancolique, mais il faut avouer que cela restait maigrichon.
En fait, je m'en apercevais seulement maintenant, j'étais plutôt solitaire, comme fille. J'avais moins d'amies que ma mère, et j'évacuais les hommes comme des colis encombrants dès qu'ils avaient cessé de servir. Pour entretenir des rapports humains aussi compliqués, je ne savais trop si je me situais sur une estrade ou dans la cave. C'est vrai – ma mère sur ce point avait raison – peu de monde trouvait grâce à mes yeux. Je jugeais vite les gens-même et surtout ceux de mon âge – inaptes ou ennuyeux. Je n'avais aucun modèle. Aucune idole – même de la chanson. D'ailleurs j'écoutais peu de musique, ou alors de vieilles chansons de Ferré ou de Barbara – ce qui épastrouillait les copains, aux écouteurs en permanence vissés aux oreilles. Je me souviens de Julien dodelinant de la tête en voiture, dans le lit, sur le trottoir où nous marchions, la main dans la main – et cela m'exaspérait, alors que c'était la norme.
Il fallait donc en conclure que j'avais toujours été un peu inadaptée. La faute à qui ?
Pas à Louise quand même, qui m'avait tenue à bout de bras.
La conclusion s'imposait d'elle-même. Ma mère, toujours elle. C'était ma mère la responsable. Victoire Aulnay, veuve Dargent.
Il ne me serait jamais venu à l'esprit de m'en prendre à moi-même.
L'été était fichu : la mort de ma grand-mère me plombait le cœur, la nouvelle cohabitation avec ma mère m'ennuyait, et aucune envie d'expédition sac au dos avec un copain-amant quelconque, comme j'en avais pris l'habitude depuis mes dix-sept ans, ne venait éclaircir l'horizon. Je me retrouvais seule, avec pour toute perspective, les examens à venir et une carrière sans gloire à entamer. Rien de tout cela ne m'enthousiasmait.
N'ayant rien de mieux à faire, j'avais étudié pour ces fichus examens et peaufiné mon mémoire sur Restif. Je fus reçue.
J'allai boire quelques verres avec le reste de ma section dans un des cafés du Carré, au centre-ville. Il fallait bien fêter ça. À ma mère, qui avait timidement proposé de m'emmener au resto pour « marquer le coup », j'avais ri au nez. Je n'étais pas désespérée à ce point et j'avais des copains, à défaut d'amis. En apparence j'étais rieuse, sociable, un peu barjo, et j'avais une jolie peau de rousse qui plaisait aux garçons. Je trouvais facilement des compagnons de guindaille. Là n'était pas le problème.
En cette période de l'année, septembre finissant, il y avait beaucoup d'étudiants qui traînaient, comme moi, dans les petites rues pavées de la ville, fêtant victoire ou défaite avec la même apparente insouciance. Je buvais, mais pas trop, ayant une maladive horreur de perdre le contrôle sur moi-même. Aussi, au milieu de la joyeuse petite troupe avinée, je ne tardais pas à m'ennuyer. Comme d'habitude. Je pensais à ma grand-mère qui aurait été fière de mes succès et l'idée de regagner notre appartement vide faillit me tirer quelques larmes. Heureusement j'étais de tempérament sec. Je serrai les mâchoires et regardais autour de moi. La nuit tombait mais il faisait encore tiède. Je portais l'uniforme habituel de ma génération : jeans et t-shirt. Le mien était turquoise, échancré sur les épaules, et j'avais relevé mes cheveux en chignon, ce que Julien adorait. Seulement Julien n'avait pas été invité et d'ailleurs il boudait.
L'avenir m'apparut sombre. Je n'avais envie de rien. Dans un roman, un inconnu aux yeux fauves m'aurait guettée au coin de la rue et je serais tombée par inadvertance entre ses bras. Il m'aurait emportée dans un pays lointain où nous aurions vécu des amours épicées. Il aurait peint, j'aurais écrit. Ou l'inverse. On aurait fait l'amour sous des cieux lourds et chauds et il aurait léché la pluie d'orage sur ma peau. Il y aurait eu des notes de cithare ou des tintements de gamelan. Des révolutions de palais. Des courses en moto. Des trains à vapeur… La belle vie…
Au lieu de quoi, je regagnais mon appartement, vaguement nauséeuse. De ma fenêtre, je regardais la Meuse plate et tranquille en rêvant d'océan couleur d'absinthe…
J'attribuais mes migraines et mes écœurements du lendemain à la gueule de bois. Je savais qu'il m'en fallait peu.
Mais les jours suivants, c'était pire. Je vomissais tous les matins et me sentais sans force. Le miroir me renvoyait un visage pâle aux yeux cernés.
La vérité mit un certain temps à remonter à la surface obscurcie de ma conscience.
Avec une appréhension folle, je me rendis à une pharmacie où je n'étais pas connue pour demander un test de grossesse. Lorsque la tigette devint bleue, je crus m'évanouir. J'étais bel et bien enceinte.
Le responsable – à part moi – était Julien, je n'avais aucun doute là-dessus. Les derniers temps, je m'étais montrée distraite avec ma pilule. Ce n'était pas un acte manqué, plutôt la croyance magique qu'une étreinte aussi piètre ne pouvait qu'être stérile.
Comment, à l'aube du vingt-et-unième siècle pouvait-on se montrer aussi naïve ?
Il ne me restait plus qu'à téléphoner vite fait à un planning familial et à me débarrasser de l'intrus. Ce bébé dans mon ventre, je le considérais comme un alien. J'en voulais âprement à Julien, ce maladroit. Ma colère augmentait mes nausées.
C'est dans cet état que je me présentai, comme pigiste free-lance, au bureau de recrutement d'un journal de la région.
« Le Quotidien » traitait surtout des chiens écrasés et aussi, accessoirement, des problèmes du monde. L'univers des bibliothèques et des écoles me semblait trop confiné. Je n'avais pas tout à fait oublié mes rêves de couvrir un conflit bien chaud aux frontières d'un pays au bord de l'implosion. Je savais que Le Quotidien s'occupait surtout de querelles de voisinage et comptait plus sur l'orthographe que sur le reportage à chaud. Qu'il payait sûrement mal, à la ligne. Mais bien des journalistes célèbres avaient commencé par là, du moins le croyais-je.
Alors que je me préparais, assise sur la chaise ergonomique d'un bureau vitré, à affronter mon premier entretien d'embauche, je ne me doutais pas de la foudre qui allait m'éparpiller, cœur et corps en chamade, dès l'entrée du DRH, qui s'avéra par la suite être le rédacteur en chef du journal.
Il avait le double de mon âge, des cheveux grisonnants aux tempes et des yeux verts aux pupilles cerclées de noir, d'une intensité insupportable. Et aussi, bien visible à l'annulaire, une alliance en or blanc.
Avec le recul, je me rends compte de l'étrangeté de cette folie, qui m'empoigna alors comme une vague déferlante. Cet homme était un cliché ambulant, il n'était pas libre, c'était mon patron, (ou il allait le devenir) et j'étais enceinte. Toutes ces raisons, y compris mon peu d'aptitude pour l'amour, et la sentimentalité qui allait avec, auraient dû m'alerter, me faire fuir à toutes jambes ce bureau étriqué.
Au lieu de cela, je joignis les mains, dans l'attitude d'une suppliante, et je répondis à ses questions – toutes convenues – avec la ferveur d'une condamnée qui joue son dernier va-tout. Je voulais ce poste. Je voulais cet homme. Et il le comprit, flatté au fond. À peine étonné. Cela aurait dû m'alarmer.
Une semaine après, j'entrai au Quotidien.
Et Brice Astier devint mon amant.