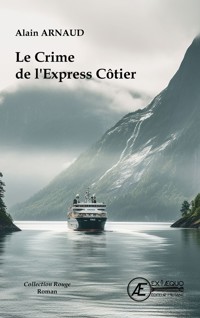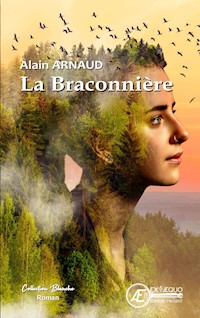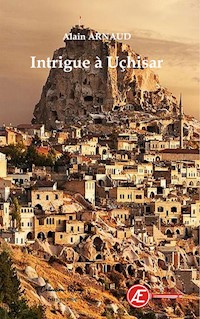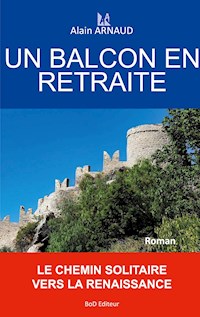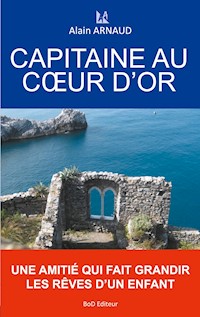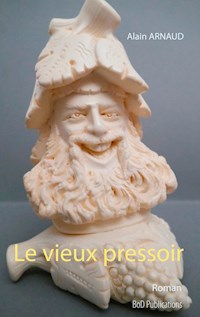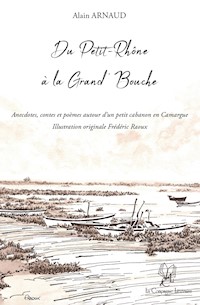
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Compagnie Littéraire
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Du Petit-Rhône à la Grand' Bouche est un recueil d'anecdotes autour de la Camargue. Le dernier eigadié du Garrouyas, un chasseur de Camargue, la sauvageonne de Tourvieille sont tant de textes immersifs, empreints d'un grand humour qui font découvrir ou redécouvrir la région. " Des souvenirs d'enfance, des rencontres insolites, des anecdotes délicieuses où la rigidité de la langue laisse un peu de place à la poésie, le tout, enveloppé d'expressions pittoresques et de quelques perles du vocabulaire local. C'est drôle, c'est tendre, c'est parfois émouvant ". Avec Du Petit-Rhône à la Grand' Bouche, à travers nouvelles contes et poèmes, Alain Arnaud parvient à immortaliser avec fidélité la vie rurale et l'art de vivre des habitants de la Camargue, autour d'un petit cabanon situé quelque part sur le littoral du delta du Rhône. Un ouvrage qui séduira sans aucun doute les habitants de cette région, qui parviendront sans difficulté à s'identifier au récit, mais aussi les autres, qui se trouveront, dans ces histoires du Pays de Cocagne, projetés hors du temps et dans la dimension du conte.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Arnaud est un fier habitant de Port-Saint-Louis-du-Rhône et voue une profonde admiration pour les cabanons, témoins de la richesse d'un terroir, mais pas seulement sur le plan architectural.
Du Petit-Rhône à la Grand’Bouche est son premier recueil de nouvelles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Arnaud
Du Petit-Rhône à la Grand’Bouche
N.B. La version numérique ne contient pas d’illustrations
La Compagnie Littéraire
Catégorie : Littérature du terroir
www.compagnie-litteraire.com
Aux gens d’ici et à ceux qui se reconnaîtront…
Remerciements
Je remercie chaleureusement Monsieur Frédéric Raoux, lauréat du festival de la bande dessinée d’Angoulême, pour sa gracieuse participation à l’illustration de ces textes.
Madame Nadia Lefort pour son aide.
La photo de la tour Saint-Louis appartient à la collection de Monsieur Jean-Pierre Connan.
Avertissement
Ces histoires flânent au sud du pays d’Arles, entre Fos-sur-Mer et Les Saintes-Maries-de-la-Mer, dans un périmètre que les anciens nomment encore boufo-mistràu tant la présence des vents y est coutumière.
Évidemment, elles souhaitent s’inscrire davantage dans la tradition orale que dans le droit-fil de l’écriture; il convient mieux de les lire du coin de l’œil.
Dans la conversation camarguaise, on rencontre çà et là des expressions que le simple passant aura du mal à comprendre. Ce sont les réminiscences de la langue maternelle qui, peu à peu francisées, se sont installées dans l’usage quotidien. J’ai voulu, moi aussi, profiter de l’aubaine et jouer avec ces provençalismes : roubine, rousiguer, rouste, bouléguer… Car issus du terroir, ils sont entrés naturellement dans le langage bien qu’ils n’appartiennent pas encore au Français académique.
Quant aux personnages, les uns auraient pu exister, les autres sont réels, tous vrais : je les ai connus.
L’arapède : la paternité du texte ne m’appartient pas et je n’ai pu à ce jour découvrir qui pouvait en être l’auteur.
Ce texte était dit ou chanté par mon grand-père dans les années cinquante, comme on le faisait souvent en Provence lors des fêtes de famille et les banquets. Enfant, j’en avais retenu la trame et me suis amusé à la reconstruire aussi fidèlement que possible.
Si je l’ai incluse dans ces pages, c’est surtout pour éviter que ce délicieux mélange d’euphonie franco-provençale ne sombre dans l’oubli.
Avant-propos
« Si les Français connaissent de leur langue ce qu’on peut en apprendre dans les livres, il en est une non moins belle que, malheureusement ils ignorent, ou que, plutôt, ils ont désapprise. C’est la langue terrienne et cadastrale, celle des champs et des aïeux, laquelle, d’un mot spécial, note tous les accidents de terrain, tous les détails du sol, tous les aspects de la patrie et qui, une fois bien connue, dispenserait d’inutiles descriptions les auteurs de récits rustiques ».
Paul Arène Sisteron 1843
Antibes 1896
La sauvageonne de TourvieilleDépart en Fanfare
À force de grandir à Faraman, entre les ruines du Mas Paulet et celles de Tourvieille1, mon ami Manolo, dit Spagna, finalement avait choisi son métier.
Non, au grand désarroi de ses cousines, toutes de bonne race sang et or, Manolo ne serait pas torero, car bien que les taureaux de monsieur Yonnet ne lui fissent point peur, le sang qui coulait dans ses veines le poussait vers une autre passion.
Spagna –sobriquet, certes, révélateur –pensait sans doute que toutes gloires acquises au mépris de la vie, arrachées à des êtres gisants sur le sable vermeil, demeuraient futiles et sans honneur. C’était pour cela, peut-être par souci philosophique, qu’en fier Espagnol de bonne souche, comme son père et son grand-père, Manolo se ferait maçon.
Comme je vous le disais à l’instant, ayant des souvenances espagnoles il se voulait maçon de la plus noble espèce. Or, antithèse déroutante, plâtre et ciment ne l’avaient jamais tenté. Cependant, les métiers de la pierre depuis peu le fascinaient; rénover, prolonger la vie des chefs-d’œuvre, quel prestige! Là était sa véritable voie… Marteaux et burins, il œuvrerait désormais pour l’éternité de la pierre.
Coquin de sort! Comment cette idée avait-elle pu germer dans sa tête, éclore et grandir? Avait-il vu l’abbaye d’Hulmet ou de Franquevaux? Peut-être Sylveréal2? Et ces messagères millénaires croulant d’indifférence sous la pierre de Beaucaire, ces décombres, qui jalonnent néanmoins notre histoire comme d’authentiques et rares témoins, l’avaient forcément convaincu. Outre cela, Spagna nourrissait un projet des plus audacieux. Ce rebelle voulait arracher Tourvieille aux mains destructrices de l’oubli.
Figurez-vous que je ne m’étais pas trompé. Un jour, sa mère nous envoya au grenier pour mettre un peu d’ordre dans nos pagailles. En fouinant dans une vieille malle délabrée, je tombai sur un grand livre tout poussiéreux qui devait nous attendre depuis des lustres. C’était l’histoire des bâtisseurs de cathédrales, lesquels semblaient s’activer hors du récit, à mesure que nous tournions les pages. Soudain, je vis dans les yeux de Manolo, luisant d’ébène, l’expression d’une imminente décision.
—Puisque les grandes personnes s’en foutent, s’énerva mon fougueux compagnon, il faudra bien que nous fassions quelque chose!
Quel enragé c’était! Voilà comment, sur un coup de colère, le grand projet pour sauver Tourvieille prit corps, ainsi que cette inénarrable mésaventure.
Cette année-là, les grandes vacances avaient aligné de délicieuses journées pleines d’insouciance. Manolo était épris de ces pierres, c’était une véritable passion. Le projet qui lentement avait mûri dans sa tête touchait au but et nous nous apprêtions à la découverte de cette ancienne place forte camarguaise, construite en 1614, pour, semble-t-il, clore définitivement la porte du Rhône à ces mécréants de Barbaresques.
Jamais autant je n’avais attendu les grandes vacances. De bon matin, avec les fauvettes qui saluaient le jour nouveau, je disputais déjà aux grenouilles le droit de papoter un peu. Je rayonnais d’impatience et Manolo fin prêt s’étirait devant sa porte :
—Ho! Tu lambines! Grouille-toi un peu! lui dis-je d’une voix étouffée pour ne pas tirer de leur sommeil les locataires de l’étage.
À pas feutrés il était entré dans la remise puis « grincinancouinant » il en sortit perché sur un attelage auquel je ne m’attendais pas :
— Amoulaïré, amoulaïré3! s’égosillait cet intrépide farceur.
Ce qui déclencha aussitôt une réaction en chaîne et toutes les persiennes du logis s’illuminèrent, comme si, en avance sur le jour, le coq avait chanté. Dissimulés sous le porche, nous recevions le courroux des travailleurs agricoles ainsi que les vives réprimandes de son père, qui, sans nous voir, se doutait bien que c’était nous :
—« Cogno ! Qué passa Manolo, ma quéqué tou fé, hombré, tou é fou! »
À son vélo, il avait attelé la jardinière; une petite carriole fabriquée maison que sa mère utilisait pour ses journées de potager. Cet équipage saugrenu rappelait celui du père Sainfoin, un gitan des Saintes-Maries, rémouleur de son état, lequel par tous les temps sillonnait la Camargue, poussant sa meule à brancards en entonnant, pour illustrer sa présence, des chansonnettes de sa composition, qui toutes commençaient par : amoulaïré! Et le père Sainfoin, dit Caruso, dans sa carriole de légende, à califourchon sur sa meule, nous offrait sur des airs d’opéra l’écho de ses sentiments anciens que nous devinions au fil de son répertoire. Tandis que les uns applaudissaient bruyamment, d’autres se pressaient autour de la carriole, qui des ciseaux de tondeur, qui une pelle toscane… Et Caruso, pédaleur immobile, faisait à présent chanter sa meule, donnant au fil des outils émoussés la brillance et l’éclat de son savoir-faire.
Manolo lui ne chantait pas, mais sa carriole chargée comme un tombereau rappelait celle de Caruso. Alors, cette canaille, spontanément dans un sursaut d’humour, n’ayant retenu que le début des chansonnettes et trouvant la comparaison évidente, à la pointe du jour s’était égosillée à se rompre les cordes vocales : amoulaïré, amoulaïré! Au risque, éveillant à l’aurore toute la maisonnée, de se voir gratifié en guise de salaire, des effets surprenants d’un superbe seau d’eau. Heureusement, lorsque tout redevint sombre, la caravane s’ébranla enfin et la draille de Beauduc s’ouvrant à l’aventure nous engloutit dans le secret de ses mille splendeurs.
Ainsi, tintinnabulant de trou en ornière, à l’heure où le marais exhale ses généreuses senteurs de menthe, de mûre, de figuier sauvage et de pâquerettes, nous arrivions aux baisses de la Bélugue où les citoyens doucement s’éveillaient : « frrt! frrt! » dans les roseaux, « ploc! ploc! » dans la roubine, le serpatié4 chassait le têtard, tandis qu’un couple de Tadornes, sympathiquement étonné, s’ébattait dans les premières vapeurs du jour qui pointait sur les lônes5.
Savez-vous, permettez-moi cette parenthèse, que ce marais qui serpente gentiment entre les manades, les deux Badons, l’Espéradou, les baisses du Pèbre, qui s’étire et s’allonge jusqu’à la mer, était autrefois le bras principal du Grand-Rhône? Puissant et redouté, il agonise aujourd’hui sur son lit de massettes, où ne ruisselle plus désormais qu’un filet d’eau paisible suffisant aux aigrettes; c’était pourtant le bras de fer. Jadis, la tumultueuse embouchure du fleuve était là; on y avait bâti une tour.
Au détour du chemin se dresse la muraille. Perchée sur sa dune, elle semble chercher vainement les flots tapageurs du Grand-Rhône, comme si malgré le temps, elle se voulait encore indispensable aux Arlésiens. Pour la première fois, je voyais Tourvieille, on aurait dit la muraille de Chine tant nous étions petits. Ce qui me frappa tout d’abord, ayant levé les yeux, ce fut le ciel; ses couleurs purpurines qui se meuvent, se mélangent et ajoutent à chaque instant de nouvelles teintes aux nuages; n’avez-vous jamais observé cela? Ensuite, devant un parterre de chardon et sous une pluie de gazouillements philharmoniques, j’ai vu la tour qui patiente au milieu de la dune. Quelle tristesse! Abandonnée à tous les vents je l’ai trouvée fort délabrée. Décidément je ne m’habituerai jamais à cette sorte de résignation qui laisse dans l’oubli les jolies choses du passé…
La sauvageonne de TourvieilleL’architecte-maçon
Manolo sortit son attirail.
—« Hombre », tiens-moi le vélo! me dit-il.
Les tendeurs relâchés et les ficelles dénouées, le gros du matériel tomba à terre. Il faut dire que nous étions fort organisés et que, pour avoir soigneusement préparé l’expédition, rien ne fut laissé au hasard. Manolo, inventeur de l’idée, s’était déclaré architecte-maçon et moi aide de camp. Obéissant et discipliné, pour satisfaire aux exigences de nos parents, j’avais installé le bureau démontable à l’ombre de la tour; en Camargue, les mois de juillet sont traîtres et si l’on n’y prend garde ils vous sèchent le cerveau. Alors comme il vaut mieux découvrir la forteresse que faire passer le soleil dans le verre d’eau froide chez la mémé du Salin, restons bien à l’ombre et gardons le chapeau.
—Homme, tu as pensé aux punaises!
—Évidemment, sinon à quoi serviraient les aides de camp?
Mon ami, ravi de cette initiative, s’empressa d’épingler sur sa planche la grande feuille blanche sur laquelle il porterait les cotes, les courbes et les angles, ainsi que toutes les mesures nécessaires à la conduite d’un tel projet.
—Ho! Spagna! Et pour la hauteur?
J’étais confus, car si j’avais pensé aux punaises, j’avais surtout omis d’emprunter l’échelle escamotable du père Caton qui, du reste, invoquant une quelconque malveillance de garnement, ne me l’aurait pas prêtée. Manolo empressé, pointant, traçant et dessinant des angles droits ne semblait pas vraiment atterré par cette affaire. Tandis qu’il déroulait le décamètre, m’enjoignant d’en tenir l’extrémité, il me démontra, hypothèse et conclusion, les bases du calcul des ombres portées, tel monsieur Laurent dans sa classe de fin d’études. Évidemment, je n’avais rien compris. Cigale beaucoup plus que fourmi, préférant porter la plume que le boulier, je l’ai laissé à ses savantes formules tout en me contentant de mesurer les choses simples. Ainsi, penché sur son bureau champêtre, Manolo aux écritures attendait mes données :
—Homme, combien?
Et moi, attentif et appliqué je répondais en admiration :
—Largeur douze mètres quarante; longueur quatorze mètres vingt!
Quel enthousiasme! assurément, Manolo serait un beau jour le plus exceptionnel architecte-maçon de Camargue, il trônerait aux plus belles places d’Arles ou de Nîmes et il aurait pignon sur rue.
La journée s’annonçait besogneuse, pourtant à l’heure du déjeuner, nous avions dépassé nos objectifs. Sur son plan, Manolo avait dessiné les différentes façades et noté les dimensions réelles. Comme je vous le dis, le bonheur se lisait sur nos visages. Mon ami était joyeux comme un pinson et moi, je recevais en privilège son sourire interminable par lequel s’échappait la blancheur de ses grandes dents.
Pour bien profiter de la pause, il s’étendit à l’ombre d’un tamaris et finissait de croquer une pomme. Tout en rousigant6une part de poulet froid et un quignon de pain de la veille, je m’avançais jusqu’à la muraille. N’étant plus affairé à mes mesures, je pris le temps d’observer les subtilités de la construction et je me demandais comment cela pouvait encore tenir debout : les crénelures, les voûtes, les linteaux si durement éprouvés n’allaient-ils pas s’écrouler sur ma tête; vraiment, quelque chose d’ancestral presque de familial périssait avec Tourvieille.
La sauvageonne de TourvieilleL’épouvantable apparition
Furtivement, comme pour nous surprendre, la largade7s’était levée. Par chez nous, il n’est pas rare que sous le ciel de juillet, ce mauvais vent vienne l’après-midi taquiner les habitants du marais. J’étais inquiet comme si un indéfinissable pressentiment était venu solliciter mon esprit. Nous allions reprendre nos travaux. Manolo penché sur son plan allait m’indiquer ses intentions, lorsque tout à coup, à quelques brasses de notre installation, fuyant la roubine8, je vis une volée de cols-verts cancanant à tue-tête, sans doute dérangés par autre chose que la largade. Je me tins sur mes gardes et malgré cette vague impression d’être épié par des yeux invisibles, je réussis à détailler et décrire la pierre héraldique qui se détache en relief au centre de la façade sud. Je me tournai vers Manolo pour mieux partager mes observations :
—Homme! Les mesures? me lance-t-il diligemment.
Je venais de faire un pas en arrière et ne pouvant aller plus loin je restais là, adossé à la muraille, la paume des mains touchant la froideur de la pierre, transi, paralysé par la peur :
—Alors homme! Les mesures?
Appliqué à sa tâche il n’avait pas levé la tête.
—Vingt… Vingt… Vingt-deux! avais-je balbutié.
Pour avoir déjà vu le blason désargenté, Spagna comprit très vite que dans cette information-là, il ne pouvait s’agir ni de mètres ni de centimètres, mais bel et bien d’une mise en garde. Ayant levé les yeux et me voyant ainsi figé, il n’osa pas se retourner. Derrière lui, farouche, se tenait la plus jolie sauvageonne de Camargue. Je ne distinguais pas ses sabots, mais je les supposais aussi noirs que le noir silence qu’elle venait de laisser sur la dune par sa soudaine et stupéfiante apparition. Ah! Seigneur! Si vous aviez vu le tableau : sa robe neuve de velours noir, ses pattes trapues et, fièrement campée au-dessus d’un large poitrail, les yeux écarquillés, il y avait une jolie petite frimousse noiraude sur laquelle, dressée vers le ciel, saint Georges avait planté comme une lyre, la plus pointue paire de cornes qu’on ait vues de mémoire de Salinier. Un bref mouvement de tête, un rapide coup d’œil tantôt sur l’un tantôt sur l’autre; elle aussi évaluait notre triangulaire position. Convaincu de sa présence par le souffle chaud qui sortait de ses naseaux et qui soulevait les pans de sa chemise débraillée, Manolo se tenait raide comme un pieu, il venait de saisir toute l’infortune de cette menace. En transe, Manolo suait beaucoup. Plus près de la sauvageonne que du barbelé, il décida, fort à propos, de miser sur l’immobilité, tel son cousin Garcia, dit l’agasse9 qui à Port-Saint-Louis-du-Rhône, pour les traditionnelles festivités taurines, au centre de l’arène, jouait l’homme de bronze. Manolo retenait son souffle. J’avais très peur. Mettez-vous à ma place! Mais aussitôt qu’il ferma les yeux pour se jeter au sol, je me souviens d’avoir bondi vers la barrière de barbelé vociférant des : « vévévévévé » et des « anda la vaca » afin de dérouter la mortelle trajectoire de ses banes10. J’imitais nos aînés lors des courses cocardières. Hélas! J’eus beau agiter les restes de ma culotte accrochée sur le fil de fer barbelé, la vaca ne vint pas. Elle avait choisi Manolo qu’elle jeta au sol d’un coup de tête terrible. Cette furie le tenait entre ses pattes comme un chat tient une souris. J’ai fondu sur le sol, sans doute guidé par ce sentiment d’impuissance qui peu à peu m’avait envahi et mêlait à mes pleurs quelques inutiles conseils : « fais le mort! fais le mort! » sanglotais-je à demi dévêtu. Mais la sauvageonne de coup de tête en coup de museau le bouscula jusqu’à la muraille. Les mains sur la tête et le nez dans la dune, Manolo demeurait inerte. Par malice, elle l’observa un instant. Je ne fis aucun geste, conscient de la fragilité de la clôture, et me souvenant qu’au printemps, pour la féria d’Arles, une friponne de cet acabit, d’un bond, s’était envolée par-dessus de gaillardes barricades construites pour l’occasion sur la place de la croisière.
Tapi sur le bord du chemin, j’étais absent. Manolo ne respirait plus et la sauvageonne cherchait à déjouer quelques subterfuges. Tête baissée, des yeux immenses, elle soufflait le sol, grattait, ratissait le sable de la dune que ses puissants sabots semblaient semer à la volée. De droite et de gauche, elle creusait de plus belle, avançait, reculait, baissait la tête à nouveau, mugissait, soufflait plus fort, grattait, creusait inlassablement et recommençait encore. C’était l’enfer. Combien de temps cette diablesse se fâcha-t-elle? Je ne m’en souviens plus mais ce dont je me souviens, c’est qu’elle s’en prit à tout ce qui bougeait et même à ce qui ne bougeait pas. Elle avait tout passé en revue, la table, l’assèti11 et les vélos; l’ambassadrice de la bouvine12 venait de nous déclarer la guerre.
Sa crise de nerfs se calma avec le vent d’ouest qui peu à peu avait faibli. Pour clore une bonne journée, elle lança vers le ciel un dernier « Bouahhou