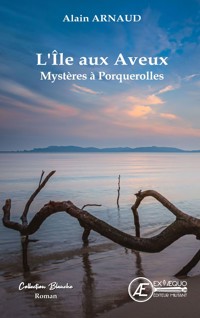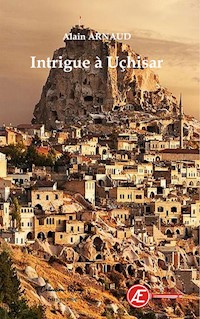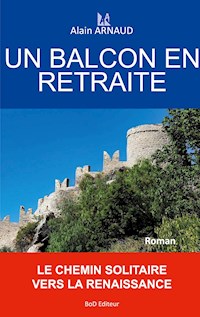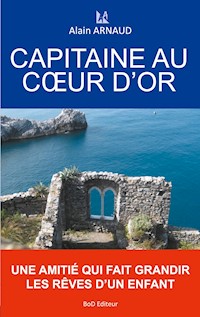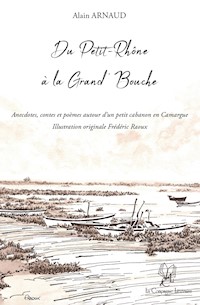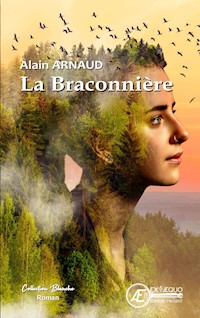
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Orpheline à onze ans, Diane est recueillie par sa tante, institutrice. Toutes deux vivent dans le hameau de Pierre Blanche niché dans les collines provençales. Pour l’adolescente qui abandonne trop tôt sa scolarité, la campagne environnante est un jardin où elle se réfugie dans la solitude, en compagnie des arbres et des bêtes.
Bien qu’encouragée par sa tutrice et un jeune homme de bonne famille à songer à son avenir, la jeune fille s’entête à vivre du braconnage, de la cueillette sauvage et de chapardages, ou encore de menues tâches rémunérées. Mais ses rencontres et mésaventures vont peu à peu bousculer ses convictions. Malgré son irrésistible attrait pour les collines alentour, Diane prend conscience que son isolement mène à une impasse. Ainsi s’impose à elle une volonté d’apprendre et un désir de revanche sur les malheurs qui ont marqué sa vie.
Réputée pour son agilité à franchir les obstacles dans les bois en présence d’un danger, de nouvelles épreuves l’attendent pour s’extraire de sa condition de sauvageonne et faire le grand saut dans l’inconnu.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Arnaud vit à Hyères-Les-Palmiers dans le Var. Après diverses activités professionnelles, notamment ingénieur en aéronautique, diplomate en ambassades de France et enseignant, il se consacre depuis 2018 à sa passion pour la littérature.
« La braconnière » est son sixième roman. https://www.calameo.com/read/0000842661304cb8f46b0
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain ARNAUD
La braconnière
Roman
ISBN : 979-10-388-0426-5
Collection Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : septembre 2022
© couverture Ex Æquo
©2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction intégrale ou partielle,
réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Il y a dans chaque cœur
un coin de solitude
que personne ne peut atteindre.
Albert Camus
Qui prend le passé pour racine
a pour feuillage l’avenir.
Victor Hugo
1
Victor n’aime pas les livres. L’homme ne lit que dans le ciel et la terre, puis dans les yeux et le cœur des gens. Les livres lui font peur. Il s’en tient à distance, les regarde comme des mines dont il ignore le mécanisme et qui pourraient lui sauter à la figure. Pourtant, Raphaël l’appelle « papivore », son papy de cœur à l’attention dévorante. Un mot entendu très jeune et qui sonnait bien, avant même d’en connaître le sens. Tout au long de son enfance, il reçoit de Victor des leçons de vie et de tolérance. C’est lui qui a ressorti un jour les vieux pièges à oiseaux enfouis dans une cave et en partie rouillés. Il les a nettoyés et lui a tout expliqué.
Les pièges claquent encore dans l’air avec la même violence, attisant la curiosité de l’enfant. Ils sont allés chercher des aludes, de grosses fourmis ailées qui servent d’appât. Par jeu, le gamin arme un piège et passe du temps, la tête dans les mains, à regarder briller les ailes suspendues dans le vide, à rêver lui aussi de liberté. Victor devra venir à son secours, alerté par les pleurs de Raphaël, le poignet rougi par les arcs métalliques refermés sur ses chairs tendres. L’enfant comprend mieux désormais le collier de douleur qui va serrer l’oiseau jusqu’à son dernier souffle. À la fin, il détache l’alude de son corset d’acier et la regarde s’envoler.
Cependant, dès ses dix ans, les jours de répit scolaire en hiver, Raphaël tend son regard au loin, par la fenêtre. La brume roule dans l’herbe encore barbouillée de rosée. Le soleil matinal fouille les frondaisons des pins dans la colline. Leurs rouleaux d’un vert profond viennent s’échouer sur la margelle des vignes. Le bruissement des feuillages dans les grands arbres alentour résonne dans ses veines comme un appel silencieux. Alors, l’estomac lesté d’un petit déjeuner, il s’en va seul par les chemins, avec dans sa musette les pièges et un canon d’aludes.
Sa mère le regarde partir, les yeux pleins d’inquiétude. Depuis le potager, Victor se redresse. En appui sur sa bêche, il l’accompagne de loin avec des signes d’encouragement. À son retour, peu importe le butin, celle qui a trouvé son équilibre et règne sur le domaine est encore là, le regard humide, à l’attendre, fière de sa progéniture et de son accomplissement.
Mais pour la mère de Raphaël, cette histoire a commencé treize ans plus tôt, par une épopée douloureuse que les vertus magiques de la Provence tarderont à apaiser et que l’on va découvrir.
***
2
On croit savoir comment le cœur humain choisit son berceau pour toujours. On imagine aussi que l’œil porte bien au-delà de ses limites naturelles. Ainsi, dès les premières lueurs de l’aube, même un rapace peu attentif distinguerait la large croûte d’argile perdue dans les collines d’un recoin de Provence, la lumière matinale rusant sur les toits. C’est Pierre Blanche, un hameau d’une quarantaine d’âmes. Les maisons y sont tassées les unes contre les autres. Remises et hangars s’y agrippent et déforment leurs joues. Depuis toujours, le hameau fait bloc contre les saisons, le mauvais temps et les événements.
En décembre 1972, à cette heure matinale, on peut voir les logis respirer par leurs cheminées. Une mince haleine de fumée se dissipe dans l’air comme les tentacules évanescents d’une méduse. En s’attardant un peu, l’oiseau de proie verrait aussi la jeune fille se détacher d’une ombrelle de tuiles, s’aventurer dans le chemin de terre puis disparaître dans le sous-bois.
Sa musette en vieux cuir portée en bandoulière, Diane s’enfonce avec grâce dans l’immense étendue de collines. Depuis longtemps elle s’y sent à l’aise, libérant son attraction naturelle, son goût pour la solitude et son instinct de chasseuse. C’est sa deuxième demeure, sans murs ni portes. Elle tire sur la lanière de sa besace pour mieux sentir son précieux contenu : un encas de biscuits secs pour une faim passagère mais surtout les pièges métalliques et un tube rempli d’aludes dont les oiseaux raffolent.
Les hommes ont dit que les grives sont arrivées en nombre à l’approche de Noël. Un cadeau inespéré pour les chasseurs comme pour les braconniers dont elle fait partie depuis son plus jeune âge, une sorte de tradition pour alimenter la table familiale à la campagne. D’un pas allègre et discret, Diane s’enfonce dans l’ombre épaisse des arbres, non sans un pincement au cœur et l’œil aux aguets car elle connaît la menace du flagrant délit par le garde-chasse, associée à la perte de ses pièges transmis entre générations : de robustes tiges d’acier en demi-cercles et leur ressort meurtrier lorsqu’un oiseau le déclenche. Une fois ouvert et tendu, l’alude vivante fixée au milieu, le piège est dissimulé sous une mince couche de terre fraîche, dans un endroit abrité où le gibier viendra gratter le sol pour chercher pitance.
Ce matin-là, dans l’air vif qui lèche ses joues, la jeune fille va relever les pièges posés la veille et profiter de l’aubaine pour en rajouter d’autres. En parcourant la chênaie, elle écoute le craquement des branches qui se déploient après la nuit, les premiers froissements d’ailes dans les frondaisons. À l’approche de la Drailleuse, les odeurs d’herbe humide gonflent ses narines et elle perçoit le chuintement de l’eau entre les rochers. Un fil d’eau claire recoud la peau encore ridée au sortir de la nuit. La respiration de la nature fait écho dans tout son corps. Diane s’assure une dernière fois que personne ne la suit. Elle prend son élan et saute le cours d’eau puis disparaît dans la végétation, dans un fouillis de bruyères et de pins.
Sa tante Lorette qui l’héberge lui répète souvent : « Surtout, sois prudente. Tu es dans l’illégalité et, de plus, tu es une fille. » Elle a mis du temps à comprendre la portée de sa dernière remarque, imaginant au début le qualificatif de fille comme synonyme de faiblesse, par comparaison avec les garçons. À dix-sept ans, elle a déjà tous les attributs d’une femme qu’elle abrite sous une vieille veste de cuir et un pantalon ample, usé jusqu’à la trame. Le visage fin, des cheveux bruns et courts sous sa casquette de velours, ses yeux marron clair toujours en mouvement la font ressembler à un animal aux aguets, prêt à bondir, à fuir le danger. C’est du moins comme cela qu’elle voit son reflet dans la rivière. Une attitude défensive qui la fait sourire. Sa tenue vestimentaire sombre et sa peau brune se confondent avec le paysage. Elle est capable de se cacher en grimpant dans un arbre ou de se plaquer au sol, parmi les feuilles sèches sous les broussailles, et de rester longtemps immobile, sa respiration en veille.
Après une bonne marche, elle arrive en vue de l’étroit vallon où rampe un maigre ruisseau. Sur ses flancs pavés de mousse et d’herbes folles, entre les genévriers et les bruyères arborescentes, elle inspecte ses pièges de la veille, anxieuse de découvrir leur prise, et toujours sur ses gardes, en braconnière méfiante. Elle avance sans bruit. Hélas ! Il n’y a rien sur les quatre premiers. Pire encore, le cinquième s’est refermé sans aucune prise et l’alude a disparu. Lui a-t-on volé son butin ou l’oiseau a-t-il déjoué le piège ? Sa frimousse prend une mine déçue. Elle a laissé les précédents pièges en place, sauf ce dernier qu’elle range dans sa musette. Enfin, sur les cinq suivants, elle relève deux grives et un petit oiseau. Son visage tendu se relâche.
Alors que le soleil arrose peu à peu le versant, elle continue de grimper hors de tout sentier, entre rochers et obstacles que la végétation tricote. Elle relève la présence de baies dont grives et merles sont friands, un nouvel emplacement favorable à la pose de ses pièges. Un bon braconnier procède à l’inspiration, fruit de son expérience. Il est capable de saisir le pouls de l’environnement et la teneur nutritive de l’endroit par son humidité et ses odeurs, la qualité du sol, la circulation du vent et du silence, de se projeter dans la peau et la tête de ses proies.
C’est toujours avec émotion qu’elle ouvre de nouveau sa musette. Elle en retire cinq arcs métalliques bien nettoyés, ôte le bouchon de liège du « canon » taillé dans un roseau épais où elle a stocké ses aludes et percé de petits trous pour leur respiration. L’appât positionné sur chacun, elle place ses pièges légèrement enterrés, de sorte que les ailes des grosses fourmis retenues vivantes vibrent bien en vue et scintillent dans la lumière rasante du matin.
Au moment où elle dispose le dernier piège, un froissement dans les buissons en contrebas la fait frissonner. Alors qu’elle est encore penchée sur le sol, elle suspend sa respiration et ses gestes. Les poils se dressent sur ses bras et son regard se brouille. À genoux, l’échine courbée, elle se sait à l’abri. Mais la crainte s’est installée. Elle entend son cœur tambouriner lorsque les craquements de branches se rapprochent. Est-ce un animal ou un homme ? Un garde-chasse qui l’aurait suivie ? Elle a désormais signé son forfait avec une quinzaine de pièges qui lui ressemblent, même si son nom n’est pas gravé dessus.
Diane décide soudain de réagir. Elle se relève et court vers les hauteurs comme une bête en fuite. Elle traverse un rideau de ronces au risque de s’écorcher, avance encore de quelques mètres dans le maquis et se tapit, le nez planté dans l’humus. Elle ne sait pourquoi, à ce moment précis, elle pense aux bras protecteurs de sa mère, au lointain souvenir de sa douceur. Mais une voix s’élève, une voix grave d’homme : « Je t’ai vu. Je suis armé. Je sais où tu te caches. Viens par ici où je tire. » La fille n’ose plus respirer. Ses idées à l’envers, incapable de raisonner, elle est paralysée, prise à son propre piège. C’est la première fois qu’elle affronte pareille situation. Elle pense à sa tante qui ne se remettrait pas si elle tombait sous les balles ou les plombs. La brave femme ne mérite pas de souffrir davantage et se repentir de n’avoir pas su la protéger. Il est encore temps de courir le plus loin possible, d’échapper à l’inconnu qui la menace, quitte à abandonner définitivement ses pièges. Diane est réputée pour son agilité, pour être insaisissable, véritable gazelle des bois capable de se faufiler en zigzag.
L’homme s’est rapproché. Avec le canon du fusil, il repousse les ronces et répète son ordre avec fermeté : « Sors de là où je tire. » L’ultimatum résonne dans sa tête comme une explosion. La voix est proche, l’arme sans doute braquée sur elle. Cette fois, elle est perdue. D’un mouvement d’automate dicté par sa conscience, elle se relève lentement et se dirige vers la voix en levant les bras, le visage crispé. Elle repousse lentement les ronces, décidée à se rendre. Malgré les épines déjà plantées dans ses mains, elle retient sa souffrance.
Un homme plutôt jeune portant une tenue complète de chasseur, des chaussures neuves et une casquette baissée sur le front l’attend, les yeux écarquillés. Pendant qu’elle s’approche, il abaisse le canon du fusil reluisant et fronce les sourcils, la bouche en cul de poule.
— Ça alors ! Si je m’y attendais. Vous… Vous êtes une… Mademoiselle ! Je vous ai vu poser des pièges.
— Oui, je le reconnais, répond Diane d’une voix coupable.
Elle baisse la tête. Il va me dénoncer, songe-t-elle, et je serai la risée de tout le hameau. Les jeunes se moqueront de moi et les anciens riront sous cape. Adieu les bonnes brochettes et les sorties libres dans les bois, la chasse à ma façon buissonnière ! Une amende à payer, peut-être la prison ! Un sombre tableau voile sa face.
L’inconnu est lui aussi embarrassé.
— Vous faites ça souvent ?
— Oui, depuis toujours, dit-elle en levant le regard pour montrer sa sincérité.
— Vous savez que le braconnage est interdit. Je suppose que vous faites ça pour vous nourrir et pas pour le commerce du gibier.
— C’est pour moi et ma tante. Je vis avec elle. Il n’y a pas de chasseur à la maison.
— C’est bon, je ne dirai rien, ajoute-t-il décontenancé. Comment vous appelez-vous ?
— Diane.
— Comme la déesse de la chasse ?
Tous deux sourient. Le chasseur invite Diane à s’asseoir sur un rocher, tandis qu’installé sur un autre, il ouvre sa musette neuve et en sort un sandwich au jambon cru, beurre et cornichons, le coupe en deux et lui en tend la moitié. Elle accepte volontiers, ne voulant pas le contrarier et soulagée d’être pardonnée.
— Je m’appelle Martial. Mes parents sont propriétaires du château et du vignoble dans la plaine du Gastinet.
Diane acquiesce. Elle connaît ce château, le seul de la région. Sa tante lui avait parlé des propriétaires, la famille de Noblecourt. Ses grands-parents avaient travaillé comme saisonniers dans les vignes des châtelains qui résident la plupart du temps en région parisienne. Dans sa tête, il s’agit de gens riches, cultivés et inabordables. Elle s’étonne de partager un sandwich au milieu des bois avec quelqu’un de cette famille qu’elle ne connaît pas et n’aurait jamais osé aborder.
Martial lui parle de sa passion pour les collines provençales, nichées à une trentaine de kilomètres de la côte d’Azur. Il les préfère à son escorte de villes balnéaires qui brillent l’été de toutes leurs paillettes. Un monde inconnu de Diane et qui ne lui inspire aucune envie. Le jeune homme de vingt ans évoque aussi son attrait pour la chasse depuis l’enfance. C’est la première année qu’il peut vraiment s’y adonner. Son équipement professionnel fait sourire la jeune fille. Ne va-t-il pas effrayer le gibier avec sa tenue neuve dont le cuir raide craque encore, et avec son fusil aux éclats visibles à cent mètres. Il lui semble déjà entendre les geais et les merles se moquer de lui dans les arbres.
Sans s’en rendre compte, Martial se confie à elle comme à une vieille connaissance. Il évoque sa vie dans leur grande maison familiale à Meudon et ses études de droit à Paris. Certes, la vie intellectuelle et culturelle y est riche et abondante, mais le naturel et la beauté des collines lui manquent. En résumé, il se sent beaucoup mieux seul dans l’immensité des paysages avenants de Provence que dans la cohue parisienne où l’on peut ressentir la solitude.
Tout en l’écoutant, Diane a retrouvé une respiration normale, sans tremblement. Elle est ébahie par la simplicité et les aveux de l’inconnu assis tout près d’elle. S’il était du même monde, elle pourrait peut-être en faire un ami, songe-t-elle un instant. Elle lui apprendrait à poser les pièges, à choisir les meilleurs emplacements, à reconnaître les oiseaux rien qu’à leur chant ou à leur battement d’ailes.
Tout à coup, il regarde sa montre et décrète qu’il est temps de rentrer au château. Martial n’a rien tué mais il a passé un bon moment de détente. Il lui serre fortement la main, se demande quel âge elle peut avoir, ainsi accoutrée en garçon mais il emporte le souvenir d’un doux visage empreint d’une intelligence spontanée et d’une capacité d’écoute presque naïve.
— Soyez prudente, dit-il en agitant l’index droit dans sa direction.
Diane regarde s’éloigner le garçon aux épaules robustes et au front haut, à la voix ferme et sûre. Il lui inspire confiance mais son déguisement neuf de chasseur d’opérette ne lui semble pas adapté au personnage. Elle reste figée un moment, ne sachant que faire et que penser de sa rencontre. Une étrange apparition qui l’a bouleversée et lui fait réaliser combien son aventure hors la loi et solitaire est périlleuse. Sa tante lui répète si souvent d’être prudente qu’elle ne l’entend plus.
Sa frayeur matinale complètement disparue, elle garde encore longtemps la chaleur d’une poigne d’homme au creux de la main et poursuit sa maraude.
***
3
Le hameau est accroché comme une verrue au flanc de Peyresourde, la colline dominante qui règne sur la meute des autres tout autour. C’est sur leurs pentes et dans leurs replis que Diane s’aventure et s’acharne avec l’obstination d’un pou.
À Pierre Blanche, les maisons sont agglutinées le long de la rue centrale en terre battue et de quelques courtes ruelles transversales pareilles à des moignons. Depuis le sommet de Peyresourde, le hameau ressemble à un squelette de poisson que l’on aurait coloré de rouge argileux, ou parfois à un arbre dépouillé qui respire encore, à cause du souffle obstiné des cheminées. Aucun commerce n’anime le lieu. Pas d’école ni de médecin. Peu d’enfants. Une poignée de familles autour d’un noyau dur de veufs et de veuves y vivote de la terre et de menus emplois, tandis que l’énorme rocher de granite posé au sommet telle une borne céleste fait miroiter fièrement son torse au soleil, en signe de supériorité. Une prétention démesurée à laquelle les gens d’ici ne font plus attention.
Tout au long du déjeuner, Diane parle peu, encore remuée de s’être laissé surprendre à braconner. Le regard de biais, elle observe sa tante Lorette. La petite femme douce et futée, à la retraite depuis deux ans, n’a rien deviné de sa mésaventure matinale. Sa nièce l’a connue dans son rôle d’institutrice à l’école primaire du village, dévouée aux enfants et fine psychologue. Une personne attirante dont la beauté, avec le temps, s’est retranchée à l’intérieur pour céder peu à peu sa place à une sagesse résignée. Elle n’a jamais été mère ni épouse, déçue par ses amours de jeunesse. Finalement, les enfants des écoles ont comblé en partie un manque, lui laissant l’espace des vacances pour refaire une santé à sa nature peu vaillante.
Bien lui en a pris car elle a dû s’occuper longtemps de ses parents malades, décédés il y a huit ans pour son père et sept pour sa mère. Elle a conservé la modeste maison familiale dans le hameau : un rez-de-chaussée tout en longueur faisant office de salle de séjour et de cuisine, borné par un local à vocation de buanderie et de cellier. À l’étage, trois petites chambres, une salle de bains sommaire, un WC à part. Le terrain sur l’arrière lui sert de potager où elle s’évertue à cultiver des légumes pour leur quotidien et les conserves traditionnelles. Un garde-manger à ciel ouvert où elle bêche, plante, arrose et récolte tout en se vidant la tête encore pleine de regrets et de déconvenues.
On dirait que le malheur s’acharne à planer au-dessus d’elle comme un nuage de mauvais augure. Voilà qu’un an après la perte de ses parents, un éboulement de terrain dans les Alpes où vivaient sa sœur Annette, de dix ans sa cadette, et son beau-frère, a englouti leur maison dans la nuit. La montagne s’est brutalement refermée sur le silence et sur ses proies humaines. Elle n’a rien rejeté. Seul hasard heureux, leur fille Diane dormait chez une amie d’école dans le village voisin.
Lorette a spontanément hébergé sa nièce, une enfant de onze ans, tombée de la montagne et réfugiée dans l’incompréhension, assommée par un chagrin insoutenable. Pendant plusieurs mois, l’adolescente n’a plus prononcé un seul mot comme si sa bouche avait été ensevelie en même temps que ses géniteurs, ses paroles taries et le corps desséché. Son esprit juvénile était resté dans les Alpes, tournant comme un fantôme en détresse au-dessus de l’ombre du nid familial détruit. Il a fallu à Lorette beaucoup de patience et d’amour pour la ramener à la vie.
Depuis ces temps, les cernes ont creusé leur lit sous les yeux de l’institutrice. Une mosaïque de tristesse tapisse le fond de son regard. Elle tient souvent sa tête inclinée sur le côté, alourdie par un excès de souffrance et de malchance qui l’empêche de regarder l’avenir comme un espoir encore à sa portée. Son sourire légèrement forcé s’illumine pourtant quand elle regarde Diane. Si elle était croyante, elle prierait chaque jour pour lui promettre un destin auréolé de bonheur. Elle aimerait tant que l’éducation de sa nièce soit une réussite. Mais l’orpheline est têtue. Elle arrête ses études à seize ans. Solitaire de nature et par le choix du sort, elle préfère à l’ambiance bruyante et conflictuelle du lycée l’infinie cour d’école des collines, prête à survivre de petits boulots occasionnels, de tâches saisonnières au fil des jours. Elle se débrouillera par elle-même comme elle aime à le clamer, le menton en avant et la mâchoire tendue.
Certes, sa tante n’a pas les moyens de lui payer des études supérieures à l’université, mais quelques années de lycée en plus auraient agrémenté son bagage et peut-être suscité une vocation. Non, la jeune fille a préféré remplir sa besace en cuir au gré des saisons, optant pour le braconnage et le chapardage, misant sur son intelligence animale et son agilité, sa rapidité à la course et sa facilité à sauter les obstacles naturels.
Son apprentissage de femme se fait à la maison, le gîte et le couvert assurés, par l’enseignement verbal et l’observation de sa tante, par son goût pour la lecture et la rêverie, et dans la forêt, les vallons et les plaines où il lui semble s’enrichir en se frottant chaque jour à la grandeur des éléments et aux animaux dont elle envie la liberté. Diane s’en remet à la nature sauvage, cette grande sœur qui s’occupe d’elle, la protège et lui enseigne la vie pratique et ses chausse-trappes. La volière infinie des oiseaux est sa nouvelle aire de jeu et son unique perspective.
Les émotions du jour lui ont ouvert l’appétit. Diane reprend de l’omelette de pommes de terre au persil et fixe de nouveau sa tante. Elle a besoin de parler.
— Ce matin, dit-elle, j’ai rencontré le fils du château. Il allait à la chasse dans une tenue impeccable. Il est très poli et gentil.
— Martial !
— Tu le connais ?
— Je ne crois pas l’avoir revu depuis sa plus tendre enfance.
Elle reste pensive un moment avant d’ajouter : « Un gamin mignon et vif, si je me souviens bien. »
— Il a bien changé. Il est beau garçon, je dois le reconnaître.
— Il a une sœur, Clarisse, de deux ans son ainée. Une fillette blonde et espiègle que j’ai bien connue lorsqu’elle avait trois ans. Elle tardait à parler. Sa mère, Madame de Noblecourt, m’avait demandé de m’occuper d’elle pendant l’été. Martial avait alors un an. Un bébé adorable. Je me suis laissé dire qu’il fait de belles études à Paris. Mais j’ai perdu de vue ces enfants et ils ne me reconnaîtraient même pas alors que je les ai tenus dans mes bras. Clarisse doit avoir au moins vingt-deux ans. Peut-être est-elle mariée, qui sait ?
Diane ne s’attendait pas à une telle réponse. Sa tante a été intime avec les enfants du château !
— Et alors ? dit Lorette.
— Et alors quoi ?
— Eh bien, qu’est-ce qu’il t’a dit Martial ?
La jeune fille rougit. Elle réfléchit à l’impression qu’elle garde du garçon aimable à la carrure puissante, sans nul doute intelligent. Elle ne peut avouer sa faute, au risque d’être privée de son activité de braconnage à laquelle elle tient tant.
— On a un peu parlé… Il m’a demandé mon nom, d’où je venais et où il pouvait trouver du gibier ?
Sa tante la regarde avec suspicion. Elle connaît par cœur son caractère réservé et ses réactions. Elle a le sentiment que sa nièce lui cache quelque chose. Aurait-elle un faible pour le fils du château devenu un homme ?
Diane se penche sur son assiette et mange en silence. Elle revoit Martial assis sur un rocher, lui parlant comme à une amie de longue date, au milieu des hêtres et des hautes bruyères, tous deux bercés par les senteurs du sous-bois et le chant des oiseaux. Elle réalise alors que ce moment de joie s’est inscrit dans sa mémoire comme un événement d’importance dans sa vie ordinaire, gommant déjà sa faute de braconnière prise en flagrant délit.
***
4
En dehors de ses escapades solitaires dans la campagne, Diane garde un pied dans la civilisation par le biais d’emplois précaires et de services rendus qu’elle grappille de-ci de-là. Depuis l’été dernier et à l’occasion des vacances, un couple d’Anglais propriétaires d’un mas isolé font appel à elle de temps à autres pour garder leurs enfants, lorsqu’ils s’absentent pour les courses ou un rendez-vous et, de rares fois, pour une sortie nocturne.
John Smith, banquier à Londres, a besoin de l’air pur des collines de Provence pour restaurer sa santé d’asthmatique. Chaque opportunité est bonne pour rejoindre leur résidence secondaire, y séjourner quelques jours ou semaines. Son épouse Jennifer, une grande brune à l’allure bourgeoise, sollicite Diane pour surveiller leur progéniture : Joanna, deux ans, des joues bien remplies sous une épaisse chevelure blonde, la démarche encore instable malgré ses jambes dodues, et son frère Ryan, quatre ans, un rouquin avec de grands yeux curieux, une nature effrontée.
Le rôle de Diane est bien cerné : assurer leur sécurité en l’absence des parents, leur faire découvrir l’environnement naturel, les plantes, les arbres et les animaux, et leur apprendre quelques bribes de français. Et résister autant que possible aux gros mots de Ryan glanés à l’école auprès d’un enfant plus âgé, une mauvaise fréquentation.
Lorsqu’une explication l’ennuie, le garçonnet arrose la jeune fille de ses expressions favorites : « Fuck you » (va te faire foutre) ou encore « I don’t care » (je m’en fous). Diane lui oppose un sourire crispé, refreinant son envie de lui donner une baffe, mais les remarques acerbes font trébucher sa bonne humeur. Elle tient à conserver cet emploi à proximité. Joanna semble percevoir son désarroi et serre encore plus fort sa main. Au retour de promenade ce jour-là, Diane marque un arrêt sous un noisetier au bord du ruisseau où elle casse à coups de pierre les dernières noisettes. Elle déguste la chair du fruit avec la pensée agréable de mordre dans le bras de Ryan, dans sa chair rebelle.
Peu à peu, elle absorbe elle-même des mots d’anglais, feuillette des magazines dans leur salon, regarde les affiches décoratives, écoute les parents bavarder entre eux. Une atmosphère d’Outre-manche tourbillonne dans sa tête et pénètre ses pores. Elle se surprend à rêver que les oiseaux de Pierre Blanche chantent en anglais autour du mas des touristes londoniens et que leur rengaine se déverse jusqu’au hameau. Ses oreilles bourdonnent alors d’une musique nouvelle qui la berce, avec le ravissement d’une découverte.
C’est décidé, elle va apprendre la langue de Shakespeare et, un jour, elle ira jusqu’en Angleterre, se prouver à elle-même et au monde entier qu’elle n’est pas une sauvage. Des plans secrets débordent parfois de ses rêves tel une obsession.
Soucieuse de l’éducation de sa nièce, Lorette n’est pas avare de conseils sur le comportement à tenir avec les enfants. Elle lui achète la méthode Assimil complète : livres, cassettes et lecteur audio, de quoi apprendre sérieusement la langue étrangère. Diane lui saute au cou. Le cadeau répond à une attente qu’elle n’osait même pas formuler.
Deux jours avant Noël, Monsieur et Madame Smith sont de retour et la réclament. Elle se presse de bonne heure pour la tournée de ses pièges, récupère à la hâte quatre grives et un merle qu’elle remet à sa tante. Elle se change en vitesse, enfile une robe claire qui la transforme en jeune fille présentable, avant de rejoindre le mas des Anglais avec le curieux sentiment qu’elle va retrouver une famille proche, grisée aussi par la note d’exotisme que ces gens lui apportent ou par l’ouverture au monde extérieur sans commune mesure avec les collines où ses pas la ramènent sans cesse. Même lorsqu’elle découvre un nouveau vallon, un endroit différent pour caler ses pièges ou le gonflement d’un ruisseau resté jusqu’alors inactif, l’effet de surprise et l’étonnement restent mesurés. Elle ressent parfois un besoin incontrôlé de changement, de défi nouveau, comme pour se convaincre qu’elle peut s’affranchir, s’il le fallait, du confort des collines qui l’entourent !
Jennifer l’accueille de nouveau les bras ouverts. Diane se surprend à lui parler en anglais, usant de quelques phrases simples puisées dans sa méthode Assimil et d’un accent déplorable. Peu importe, la dame vêtue comme pour une cérémonie à la ville lui sourit poliment et la complimente.
— Excellent. You are gorgeous ! (vous êtes merveilleuse).
La fierté inonde son jeune visage lisse et lui picote les yeux.
— N’oubliez pas qu’il faut parler en français aux enfants, ajoute-t-elle. En revanche, vous pouvez parler anglais avec nous si cela vous convient. Je suis très ravie de vos progrès.
Des pas se précipitent dans le couloir. Joanna apparaît la première et se jette dans les bras de la jeune fille, suivie de près par Ryan. La voilà enlacée par deux enfants qui lui témoignent un élan d’amour, en souvenir d’un moment d’été. Elle se met à tourner avec eux dans une danse dont elle ne se savait pas capable. Les enfants rient aux éclats.
Jennifer revient de la cuisine avec une théière et une tranche de pudding. Diane se sent adoptée et se demande si elle n’aurait pas dû offrir quelques grives à ses nouveaux amis puis se ravise. Ils ne connaissent pas les coutumes du pays et ne sauraient que faire d’oiseaux avec leurs plumes, le gosier encore garni de graines.
Alerté par la joie ambiante, John rejoint la fête, le sourire déployé. Il salue la jeune fille avec un mélange de mots anglais et français, comme si ses paroles s’emportaient, heureux de retrouver ce lieu favorable à sa santé, les odeurs de la région, l’accent local. Pour lui, Diane est un condensé de tout ce qui l’enchante avec son mélange de beauté, de pudeur et d’inconnu, le tout agrémenté d’une voix chantante qui berce ses oreilles. Le visage franc et mystérieux de leur nounou reflète la profondeur de la Provence, celle qu’il apprécie dans ses dimensions insondables. L’air si particulier y caresse ses poumons dans le bon sens du poil et lui redonne du souffle en même temps qu’un élan d’optimisme.
Autour de la table, John et Jennifer regardent avec curiosité et tendresse la jeune fille qui tient Joanna sur ses genoux et croque le pudding à pleines dents. Diane est surprise par la blancheur aux reflets cadavériques de leurs visages et de leurs mains. Peut-être est-ce le mauvais effet de la lumière nordique qui les rend si ternes, à moins que ce ne soit la grande ville grise, avec son air acide et pollué, qui ronge leur peau sans qu’ils ne s’en aperçoivent.
L’homme s’enquiert des nouvelles des gens de Pierre-Blanche, de Lorette dont il a eu écho des talents d’institutrice, d’Augustin, militaire à la retraite. Avec son fils Martin, ils ont fait des travaux dans leur maison.
— Ils sont des bricoleurs habiles, dit John, avec une expression de respect.
— Vous avez beaucoup de la chance, dit Jennifer, d’habiter Pierre Blanche, un endroit de rêve pour nous.
Diane les remercie de leur excès d’attention qui accrédite son choix de se vouer à ses terres d’aventure et d’épanouissement. Elle explore chaque jour l’étendue d’un jardin naturel en perpétuelle transformation, grimé par les saisons, qu’on leur envie pour sa beauté et sa douceur de vivre, que l’on vient de loin pour admirer.
— Quels sont vos projets pour plus tard ? demande John. Que comptez-vous faire ?
Alors qu’il la fixe avec de grands yeux rieurs, elle est prise au dépourvu, déstabilisée. Elle réfléchit puis hausse les épaules. Le silence lui pèse.
— Je ne sais pas encore, répond-elle timidement, sauvée par Joanna qui la tire par le bras et l’entraîne dans sa chambre.
***
5
La veille de Noël, après la gelée matinale, un soleil froid roule sur les collines. Diane contemple le ciel. Elle résiste à l’appel de la forêt et accorde deux jours de répit aux passereaux comme aux oiseaux sédentaires. Dans le hameau, personne n’en parle mais chacun est au courant de ses activités de braconnage et de sa connaissance des endroits à grives et à merles. Elle sait d’emblée si la terre se prête à leurs coups de becs, si l’humus recèle des insectes, des lombrics et des larves, si les herbes retiennent les araignées et les limaces. Elle sait où poussent les aubépines, le houx, le lierre et le gui, une végétation dont les oiseaux sont friands des baies et des fruits. Oui, Diane est reconnue pour ses talents de chasseresse qui agit dans l’ombre. On la respecte en silence. La discrétion et la solidarité sont de mise dans le hameau sur les activités illégales des uns et des autres.
Pour autant, Lorette ne cache pas aux voisines qu’elle prépare, avec sa nièce, une brochette à cuire dans la cheminée pour fêter Noël de l’année 1972 dans le respect de la tradition. Elle a laissé suffisamment d’oiseaux faisander dans le cellier et il est grand temps de déguster la bonne viande sauvage, d’inonder le palais des senteurs du terroir glanées par les oiseaux. Ils ont respiré le même air parfumé que les gens d’ici, la saveur cachée des collines et du maquis en plus, et ils en gardent le meilleur dans leurs chairs.
En prélude aux festivités, la journée est consacrée à plumer les oiseaux, à brûler au feu le duvet et les dernières traces de plumes avant d’entourer chaque bête d’une tranche de lard. On remet en marche le vieux tournebroche mécanique hérité des grands-parents et on embroche le gibier pour un dîner aux allures d’abondance. Les oiseaux avec tous leurs abats ronronneront longtemps dans l’âtre, devant la nichée de braises, tandis que le jus s’écoulera lentement sur les tranches de pains disposées au-dessous. Même le père Noël, bien que privé du passage, s’en lècherait les babines !
En fin d’après-midi, une nouvelle vient contrarier leurs préparatifs. On frappe à la porte. Lorette va ouvrir. L’odeur du gibier remplit déjà la pièce lorsqu’un homme de grande taille entre. À son allure, Diane reconnaît aussitôt Martin, son visage sobre taillé en biseau et sa mèche tombante sur le front. Son regard d’aigle a toujours impressionné la jeune fille et elle a depuis longtemps des sentiments particuliers pour ce garçon dont la seule présence dans le hameau la rassure. Il lui inspire confiance et la force naturelle de ses grands bras soulève plus que le respect. De l’aigle, il ne lui manque que les ailes.
La petite orpheline n’oubliera jamais qu’il lui a sauvé la vie lorsqu’elle est arrivée à Pierre Blanche, à onze ans. À cette époque, pour la distraire de son désarroi, Lorette l’avait confiée aux enfants du hameau habitués à se baigner l’été dans le trou d’eau que retient la rivière en contrebas des habitations. Diane avait maladroitement glissé sur un rocher et chuté dans la partie la plus profonde. Réalisant alors qu’elle ne savait pas nager, elle se débattait dans l’eau sans oser appeler au secours. Martin, de quatre ans son aîné, avait rapidement compris sa détresse et plongé sans hésitation. Il l’avait ramenée au bord. Elle tremblait dans sa serviette et ne pouvait rien exprimer d’autre que des halètements. Son sauveur avait froncé les sourcils puis, sans rien dire, il avait emporté dans ses bras le corps frêle et frémissant jusqu’à la maison de Lorette.
Diane n’a jamais oublié les bras rassurants qui la tenaient contre son torse chaud. Elle s’était accrochée à son cou comme à une bouée qui la ramenait à la vie. Depuis cet événement, un espoir indicible lui serrait le cœur chaque fois qu’elle le croisait. Elle le regardait s’éloigner avec un regard aimanté, une admiration qui se muait en une affection étrange, jusqu’à ce qu’il disparaisse au coin d’une rue ou dans une maison et que la déception inonde ses pensées. Martin ne se retournait jamais. À ses yeux, elle est restée une enfant et sa tenue de garçonne n’arrange pas son image.
L’homme est discret et ses visites rares. Souvent en déplacement pour son métier de couvreur, il revient le week-end chez son père Augustin. Diane l’imagine sautant de toiture en toiture sur ses grandes jambes souples, soulevant des bordées de tuiles pour les hisser jusqu’au toit du ciel. Une sorte de père Noël discret recouvrant les maisons d’un feuillage de tuiles pour protéger les familles du mauvais temps. C’est en imitant son courage qu’elle a appris à bondir d’une rive à l’autre de la rivière, à franchir les fossés d’un élan intrépide.
Lorette l’invite à s’asseoir. Il dépose un pot sur la table.
— C’est du broussin, dit-il. Celui de Néné le fromager, l’un des meilleurs de la région.
La jeune fille raffole de ce mélange de fromages fermentés que l’on élève dans une jarre en terre, à dominante de chèvre et de brebis, brassé avec un soupçon de marc de Provence, des herbes de la région et le poivre du moulin. On y rajoute régulièrement les restes de vieux fromages afin d’entretenir sa culture tout au long de l’hiver. Pâteux et fort au goût, on le déguste à toute heure sur une tranche de pain de campagne grillée devant la cheminée. Chez les anciens, le broussin était à point lorsque de petits verts blancs dansaient en surface dans la jarre. Les vers grillent au feu et l’enrichissent de protéines, jurent avec sérieux les connaisseurs.
Lorette lui sert un verre de vin rouge. Martin hoche la tête, pensif. Il n’a jamais été bavard. Il fait un effort pour expliquer sa visite.
— Voilà ! Je viens vous dire que je pars. Je… Je m’engage dans la Légion étrangère. Je dois être à Aubagne la semaine prochaine. Je vais voir du pays, ajoute-t-il gêné, comme pour s’excuser d’abandonner la grande famille de Pierre Blanche.
Bien que tous les habitants ne s’adorent pas, il existe une union tacite, une solidarité inavouée qui fait la force du hameau : chacun peut compter sur son voisin, prêt à aider ou porter secours si besoin.
Lorette reste debout à l’observer. Elle l’a connu enfant sur les bancs de l’école puis elle l’a vu grandir. Il est devenu un gaillard sensible et généreux malgré sa grande taille et sa force. Elle sait qu’il ne s’entend guère avec son père, un militaire de carrière acariâtre à l’aspect bougon. Le soldat boîte depuis son retour du Vietnam, la jambe gauche postillonnée d’éclats d’obus. Il n’a jamais accepté la sentence de la réforme. Marié sur le tard avec une Portugaise, femme de ménage. Elle n’a pas supporté son conjoint. Elle est repartie dans son pays. Martin souffre en silence de son abandon.
Assise en face de lui, Diane est paralysée par la nouvelle. Elle a peu d’échanges avec Martin, mais elle aime l’apercevoir le week-end dans le hameau. Elle ne saurait expliquer pourquoi sa présence la réconforte, l’encourage à se surpasser.
Le visiteur lève les yeux vers elle et l’interpelle.
— Mon père s’en sortira pas tout seul en vieillissant. Est-ce que tu veux bien lui faire un peu de ménage ? Deux fois par semaine, c’est assez.
Martin sait qu’elle est en quête de menus travaux. Elle sourit et accepte de lui rendre ce service. Il finit son verre et s’en va, le buste en avant comme s’il s’apprêtait à plonger dans l’inconnu, dans un autre monde, peut-être pour se sauver lui-même cette fois. Mais Diane le revoit toujours à quinze ans, portant dans ses bras son frêle butin détrempé vers le hameau, une gamine perdue condamnée à vivre sans ses parents, loin de ses repères montagnards.
Elle lui doit en partie la réussite de son insertion à Pierre Blanche. Chaque fois qu’elle grimpe au sommet de Peyresourde et appuie ses mains contre la roche de granite chauffée au soleil, elle se revoit dans ses bras secourables, accrochée au cou de son sauveteur qui s’éloigne désormais. Dans le silence des hauteurs, elle refait en secret un plein d’énergie pour mieux endosser son infortune et sa vie solitaire, sans amis. Le départ inattendu de Martin vient entacher le jour de fête.
Bien qu’elle n’en dise rien, Lorette aussi est perturbée. En soirée, tout en dégustant les oiseaux cuits à point, dans l’odeur agréable de viande et de pain grillé recouvert d’une épaisse sauce, elle est songeuse.
— Quel gâchis ! dit-elle.
— De quoi parles-tu ? demande Diane.
— Martin est un bon garçon, sérieux et travailleur. Il aurait pu rendre une femme heureuse et vivre au pays parmi nous.
Sa tante secoue la tête cependant que la jeune fille croque les os avec hargne, comme si elle voulait se venger du sort. Elle songe à ce qui disparaît autour d’elle. Ses parents en premier, puis Martin qu’elle voyait comme un pilier rassurant, peut-être bientôt la famille anglaise à laquelle elle s’est attachée. Et un jour sa tante partira vers le ciel ou sous terre, au choix des croyances de chacun. Les siennes sont encore incertaines. Sa seule certitude est qu’aucun Dieu n’est venu à son secours sur cette terre qui lui porte assistance en la nourrissant de ses légumes, de ses fruits sauvages ou chapardés, de son gibier qu’elle capture avec ruse.
— Et puis, ajoute Lorette, je ne vois pas d’un très bon œil que tu fasses le ménage chez Augustin.
— Pourquoi ? C’est toujours un peu d’argent en plus pour nous.
— Je… Je n’ai pas confiance. Il a un sale caractère. C’est une brute.
Elle baisse la tête pour cacher le fond de ses pensées. La jeune fille éclate de rire, emportant finalement l’enthousiasme de sa tante en cette veillée de Noël. Elle aurait souhaité lui en dire plus sur Augustin, mais se limite à un timide : « Méfie-toi quand même de lui. »
Bientôt rassasiées du gibier accompagné de vin rouge, elles préparent d’autres tranches de pain à griller pour le broussin, en l’honneur de Martin. Les bûches crépitent et la cheminée aspire dans son gosier les mauvaises pensées de Lorette aussitôt dissipées dans les boyaux de la nuit.
***