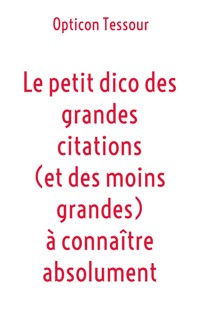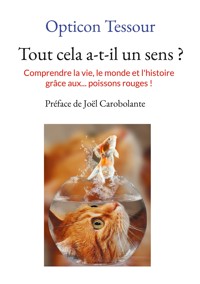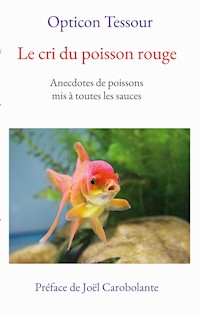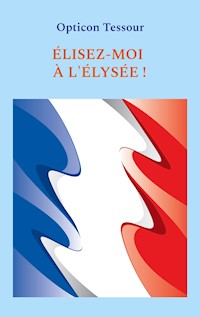
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Opticon Tessour vous demande de l'élire à la présidence de la République dans ce livre qui présente le candidat, ainsi que son programme, pour l'élection de... 2037 ! Ce n'est pas qu'Opticon Tessour s'y prenne en avance, c'est que l'action de ce livre se situe en 2033. Pourquoi 2033 ? L'auteur veut sans doute anticiper sur lui-même, être en avance sur son temps. Allez savoir... En tout cas, tenez-vous prêts, informez-vous, lisez donc le livre d'Opticon Tessour dès maintenant ! Ce livre est la transcription d'un entretien accordé par l'auteur à Pierre Pratlong, du journal « Le cri du poisson rouge ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un entretien avec Pierre Pratlong, du journal « Le cri du poisson rouge », sur ma vie, mon œuvre, mon programme pour la présidentielle de 2037
À toutes les Françaises et à tous les Français
Et à Élise
Sommaire
Opticon Tessour, un homme de la terre de France
Opticon Tessour et l'école : donner la priorité à l'éducation
Opticon Tessour et la laïcité : un homme de conviction
Opticon Tessour et l'armée : un homme engagé pour la paix
Opticon Tesssour et le monde de la finance : pour une juste redistribution des richesses
Opticon Tessour, un homme au grand cœur
Opticon Tessour et la politique : le combat d'une vie
Opticon Tessour d'un siècle à l'autre : un homme en avance sur son temps
De la campagne de 2032 à celle de 2037 : « Élisez-moi à l'Élysée ! »
Mon programme pour 2037
Lettre à Élise : Élisez-moi à l'Élysée !
I
Opticon Tessour, un homme de la terre de France
Pierre Pratlong : Bonjour, Opticon Tessour, comment allez-vous ?
Opticon Tessour : Bonjour à vous aussi. Je vais bien, merci, en tout cas jusqu'à présent. Ma santé évoluera peut-être tout au long de cet entretien. Mais j'ai bon espoir, je suis robuste, vous ne m'abattrez pas comme ça ! Enfin, si jamais telle était votre intention !
Rassurez-vous, Opticon Tessour, ma seule intention est d'informer nos lecteurs de la façon la plus objective possible. Justement, Opticon Tessour, l'an dernier, en 2032, vous avez créé la surprise en vous qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle, et vous avez été à deux doigts de battre le président sortant. Vous avez aussitôt annoncé que vous seriez à nouveau candidat en 2037, dans quatre ans maintenant. On a beaucoup parlé de vous, pourtant, finalement, vous connaît-on vraiment ? Qui êtes vous donc, Opticon Tessour ?
Je suis avant tout un homme de la terre de France, fier de ses racines. Comme beaucoup de Français, j'ai des racines rurales, j'ai l'amour de la terre et de son histoire. À 83 ans, j'en aurais des choses à raconter ! Non, pas sur les dix dernières années, ce serait trop facile ! Je vous raconterai cela plus tard. Je pourrais plutôt vous raconter maintenant ce que j'ai vécu avant, et ce que l'on m'a raconté sur les temps passés, depuis le début du XXe siècle. Un de mes oncles a d'ailleurs écrit des livres à ce sujet. Un gars du coin, qui porte le même nom que vous, mais pas le même prénom. Peut-être un lointain parent à vous, qui sait ?
Opticon Tessour, nous sommes donc peut-être tous deux de lointains cousins. Mais que cela n'influence en rien cet entretien ! Alors, allons-y, racontez-nous maintenant les temps passés !
D'accord ! Mais tout d'abord, je précise qu'il ne s'agit pas pour moi de dicter mes mémoires, mais de montrer d'où je viens, avant de dire où je veux aller. Nous sommes ici, à Hyelzas, un paisible hameau du causse Méjean, en Lozère, qui dépend du village de La Parade situé à cinq kilomètres. Sans y être né, je l'ai toujours connu. Dans ma plus tendre enfance, le chemin pour y accéder n'était pas encore goudronné et le raccordement au réseau d'eau n'avait pas encore été effectué, par contre il y avait quand même déjà l'électricité depuis les années 1950, et le téléphone. Enfin, le téléphone... Il n'y avait qu'un seul poste pour le hameau, et pour avoir une communication, il fallait passer par une opératrice. La Lozère, le département le moins peuplé de France, fut d'ailleurs un des derniers à passer à l'automatique. Mais c'était déjà le progrès ! Auparavant, il n'y avait eu le téléphone qu'à La Parade, et un seul : la sonnerie retentissait dans la rue, car la personne chargée de répondre habitait à deux cents mètres. Je n'ai pas connu ce temps-là mais, par contre, j'ai connu l'arrivée de l'eau. Pour avoir de l'eau, il fallait autrefois la puiser à la citerne. C'était l'eau de pluie ‒ il n'y a aucun ruisseau ou plan d'eau dans les parages. Quand il n'y avait plus assez d'eau pour remonter l'eau avec un seau, il fallait descendre dans la citerne pour remplir le seau avec des casseroles. Et quand il n'y avait vraiment plus rien du tout, il fallait faire deux kilomètres pour prendre de l'eau à la rivière la plus proche, la Jonte, ou à une source située à côté de celle-ci. Pour laver les draps, les dames se rendaient toujours à cette source, et elles remontaient la pente à pied, avec des draps qui, mouillés, avaient augmenté de poids. Il y avait bien eu jadis une mare à Hyelzas, mais elle avait été comblée, un enfant s'y étant noyé.
Horreur ! L'arrivée de l'eau a donc été un énorme progrès.
Oh ! que oui ! Et pareil pour l'arrivée de l'électricité ! Auparavant, la production d'énergie se faisait surtout par la force musculaire, soit celle des hommes et des femmes, soit celle des animaux : les bœufs et, pour les personnes les plus riches, les chevaux. Le travail manuel était vraiment manuel. Chaque commune avait son forgeron, son maréchal-ferrant, son tailleur, son maçon, ses commerçants. Des vendeurs ambulants passaient aussi pour vendre des cordes, des ficelles, du tissu, des lunettes aussi. Les autres habitants étaient agriculteurs et leur principal revenu venait de la production de lait pour la fabrication du Roquefort. Il fallait garder les brebis, les tondre, et les traire. L'agnelage avait lieu en février. Les normes d'hygiène n'étaient pas celles d'aujourd'hui : dans le lait, il pouvait y avoir plus que du lait, si les brebis en disposaient ainsi. Par exemple, si les brebis avaient un besoin pressant... Le fromage fait maison pouvait, lui, contenir des asticots : pour certains, cela lui donnait plus de goût.
Mais c'est dégoûtant, tout ça !
C'est la nature ! Sur le Causse, on pouvait aussi trouver des chèvres, dont on utilisait le lait, des vaches parfois, des cochons souvent. À l'automne, on cherchait le bois pour l'hiver et la mise à mort d'un cochon était tout un spectacle. La pauvre bête criait à en mourir, et elle en mourait effectivement, tandis qu'on recueillait son sang pour en faire du boudin. La basse-cour fournissait des œufs et des volailles que l'on pouvait vendre à la foire, et le potager les légumes pour les repas. Ceux-ci comportaient toujours de la soupe, avec du lard, des pommes de terre ou des haricots, ou d'autres légumes. Quand un patron fermait son couteau Laguiole, cela voulait dire qu'il fallait repartir au travail. Dans les familles catholiques, il y avait le bénédicité, ainsi que la prière le soir avant de se coucher, voire le matin. Les gens étaient debout, appuyés sur une chaise, à réciter le chapelet ou d'autres prières.
Êtes-vous croyant, Opticon Tessour ?
Nous verrons cela plus tard. Je continue ! Les hivers pouvaient être rudes. Certes, les maisons avaient des murs très épais, un mètre et plus, avec de petites fenêtres. Une grande cheminée, où l'on pouvait s'installer, apportait chaleur et lumière. Lors des veillées, chacun s'occupait en discutant de tout : on y triait les noix, on y tricotait, on y jouait aux cartes... Ailleurs, l'éclairage laissait à désirer : il y avait les lampes à pétrole, les lampes à acétylène, ou avec une bouteille de gaz, ou tout simplement les bougies. Les chambres étaient froides, il pouvait même y geler. Pour se chauffer au lit, il y avait le moine (un appareil contenant de la braise). Ce nom viendrait de l'usage ancien, dans les monastères, d'utiliser un jeune moine pour chauffer le lit des plus anciens ‒ d'où cette expression :« mettre le moine au lit. »
Pittoresque !
Certes ! Le matin, chacun faisait sa toilette dans la chambre, avec une carafe d'eau et une bassine. La douche était alors inimaginable. On naissait et on mourait dans une chambre, souvent au même endroit. La femme accoucheuse aidait dans le premier cas, et le curé apportait les derniers sacrements pour le second. Entre les deux, le médecin était bien loin. On le faisait venir pour les cas graves. À cause de la de cataracte, on pouvait devenir aveugle. Les hommes mouraient en général avant 75 ans, les femmes à cet âge ou peu après. La vie était rude, mais c'était ainsi, on ne se plaignait pas. Aujourd'hui, la vie est en général moins rude, et on se plaint tout le temps ! C'est ainsi ! Autre chose : le petit coin, bien sûr, c'était dehors, avec cependant le pot de chambre à l'intérieur.
Un objet alors bien familier !
Oui ! Peut-être trop ! Un jour, j'ai failli en revoir un sur la tête ! Le matin, ma mère le mettait sur le rebord de l'escalier. Ce jour-là, elle l'avait posé un peu vite, et comme j'étais en-dessous, j'en ai reçu une goutte !
Elle vous a baptisé !
Mouais, si l'on veut ! Autrefois, on faisait aussi boire aux jeunes mariés un liquide évocateur, plus ou moins marron, dans un pot de chambre, pour leur montrer que tout ne sera pas toujours rose dans leur vie... Autrefois aussi, il y a plus longtemps encore, dans les rues en ville, on proposait aux dames de quoi se cacher. « Chacun sait ce qu'il a à faire », disait celui qui proposait ce service. Mais je reviens à mon histoire. Tout ce monde se déplaçait à pied, voire à cheval, sur des distances et dans des conditions que l'on imagine mal aujourd'hui. Les jeunes comme les vieillards ! Avant d'avoir eu une voiture, le facteur pouvait faire ainsi quelque trente kilomètres à pied lors de sa tournée. Pour aller à la messe le dimanche, au catéchisme le jeudi, et à l'école les autres jours, les enfants faisaient aussi des kilomètres et des kilomètres à pied. Pour pouvoir prendre la communion, il fallait être à jeun : pour les habitants d'Hyelzas, cela faisait cinq kilomètres à pied, le ventre vide, et parfois dans la neige. Heureusement, la communion, ce n'était pas chaque dimanche. Ces longues marches à pied rappellent ce qui se fait encore dans de nombreux pays, où l'on peut voir des gens marcher, alors qu'ils sont loin de tout. Avant leur macadamisation dans les années 1960, les chemins étaient caillouteux, et des ornières se formaient régulièrement. Le passage de voitures à chevaux, avec des roues ferrées, les abîmait, et les habitants, voire un cantonnier, devaient les réparer en empierrant les trous. Dans ce monde rural, la mécanisation avait été un progrès, avec notamment l'arrivée des tracteurs pour remplacer les bœufs, après la dernière guerre. Jadis, la fenaison se faisait avec la faux, et il fallait battre le blé avec un fléau, et les bœufs ou le cheval tournaient sur l'aire pour égrener les épis. Enfin, aux temps vraiment anciens, car les machines existaient au début du XXe siècle. Il y eut d'abord des machines tirées par un cheval, puis des machines à moteur. La dernière guerre, ai-je dit : façon de parler, car il y en eu d'autres après. Ici sur le causse, comme ailleurs, celle de 1914 avait été horrible. Une famille compta jusqu'à quatre fils tués à la guerre, plus un dernier juste après, mort des suites de ses blessures. Ailleurs en France, sur dix enfants d'une même famille partis à la guerre, six y furent tués, et deux autres moururent peu après, toujours des suites de leurs blessures. À peine, vingt et un an après, la guerre recommençait déjà. Pendant l'Occupation, les Allemands ne vinrent jamais à Hyelzas, qui était trop à l'écart. Par contre, certains de leurs habitants furent pris en otage, au risque d'être fusillés, quand les Allemands vinrent à La Parade et se heurtèrent à des résistants, le dimanche de Pentecôte, 28 mai 1944. Pour le coup, ma mère faillit y passer, et il n'y aurait pas eu alors d'Opticon Tessour ! Avec sa propre mère, et deux de ses frères, elle s'était en effet rendue à La Parade pour porter le lait à la laiterie et assister à la messe. Après deux guerres mondiales, la guerre d'Indochine et celle d'Algérie (non reconnue comme une guerre à l'époque), la paix avait pu s'installer un peu plus durablement, en tout cas en France même. Les années ont passé, tout cela peut désormais sembler bien loin, le monde a bien changé, ainsi que les conditions de vie, la technologie a évolué, les mentalités aussi, mais le monde est-il devenu plus sage pour autant ?
Grande question !
Nous sommes aujourd'hui en 2033. Il y a un siècle, Hitler arrivait au pouvoir. En 1939, il envahissait la Pologne. En 2022, il y a à peine plus de dix ans, un certain Poutine envahissait l'Ukraine. On peut se demander s'il y a eu progrès. Certes, les pays vraiment démocratiques ne se font plus la guerre entre eux. Le trio, autrefois turbulent, composé de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la France est ainsi en paix. Les pays démocratiques peuvent guerroyer loin de chez eux, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes. Le pouvoir n'est pas chose facile à exercer. D'une façon générale, cependant, les statistiques montrent une baisse de la violence, y compris au niveau domestique. Si elle nous frappe, c'est qu'on en parle plus, et c'est tant mieux. La violence peut toujours resurgir avec des pics imprévus. Que faut-il en penser ? Et qui suis-je pour en penser quoi que ce soit ?
C'est justement ce que les lecteurs aimeraient savoir !
Il est vrai que je vous ai raconté le monde d'hier sans me présenter. Peut-être aurais-je dû commencer par là, ma modestie dût-elle en souffrir. Souffrez donc (à votre tour, vous et vos lecteurs) que je me présente : Opticon Tessour, 83 ans, retraité (malgré le recul de l'âge de la retraite, c'est possible !), retraité du Trésor public plus précisément, marié, père et grand-père, originaire de la Ville rose, Toulouse. Opticon Tessour ? Opticon ? Vous vous doutez bien que ce n'est pas mon nom à l'état civil. Tout le monde le sait, d'ailleurs. J'ai expliqué son origine dans mon livre « Tout cela a-t-il un sens ? », dont je ne peux que vous conseiller la lecture ‒ car c'est assurément une saine lecture. Ce livre explique tout sur tout : rien que ça ! Pour l'état civil, je suis François Bonicel, et je vous propose, lors de cet entretien, de vous raconter ma vie, ainsi que celle du monde que j'ai connu, depuis ma naissance, le 1er avril 1950.
C'était à Toulouse, si je suis bien renseigné ?
Oui, à Toulouse, la Ville rose.
Et un 1er avril ! C'est étonnant !
Amusant peut-être, mais pas si étonnant que ça ! Après tout, on peut dire que tout le monde a une chance sur 365 de naître ce jour-là : rien d'extraordinaire, donc ! En tout cas, mon intérêt pour les poissons vient de là, mais nous en reparlerons.
« Le cri du poisson rouge », mon journal, ne peut qu'apprécier ! Toulouse, ce n'est pas le monde rural. Vous êtes donc plutôt un enfant de la ville, n'est-ce pas ?