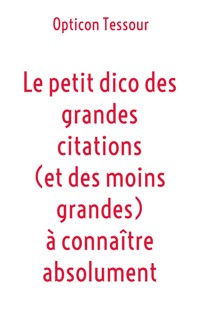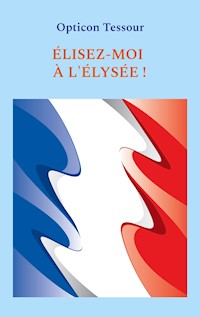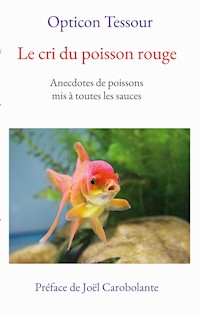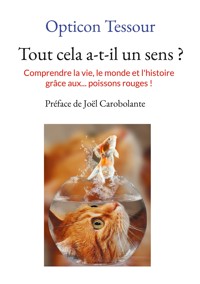
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Comment expliquer le monde qui nous entoure, ce tourbillon de vie qui entraîne tout ce qui existe ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Tout cela a-t-il un sens ? Opticon Tessour, le chercheur français mondialement inconnu, formé dans les plus grandes universités comme Cambridge et Harvard, dérange les mythologies, les religions et la théologie, la philosophie, l'histoire, la science et la littérature pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Dans un style limpide comme l'eau de pluie que traverse l'arc-en-ciel un jour d'été, il dévoile enfin le pourquoi du comment du sens de l'histoire. Et cela, grâce à ses poissons rouges ! Ceux-ci, pourtant muets comme des carpes, nous donnent ensuite leur point de vue, ou du moins celui d'Opticon Tessour lui-même qui, s'étant assoupi dans son spa après un repas bien arrosé, s'est vu en poisson rouge. Opticon Tessour a alors tout compris : le Big Bang, la naissance des atomes, puis celle des poissons rouges, leur vie mouvementée, leur destin singulier, et partant celui de l'Univers entier. Cela peut avoir du sens, et puis l'histoire ne devrait pas finir en queue de poisson ! Afin de tirer le meilleur parti de ce livre, il ne vous sera pas nécessaire de vous mettre dans la tête d'un poisson rouge, ni de demander à votre poisson rouge préféré des explications si vous ne comprenez pas tout, mais peut-être qui sait si entre lui et vous, les similitudes ne sont pas plus grandes qu'escompté ? Dans ce cas, les réponses données à vos poissons rouges ou par les poissons rouges seraient aussi les vôtres, et vous pourriez alors nager dans le bonheur, heureux comme un poisson dans l'eau pure et claire d'un aquarium. Ou du moins, n'exagérons pas, nager dans leur apaisante sérénité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 857
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes poissons rouges,
(dédicace logique, quasi automatique)
À mes autres poissons, sans distinction ni discrimination,
(ne soyez pas jaloux, ça n'en vaut pas le coup)
Et à tous les bipèdes pensants
(ne pensez pas trop, quand même, ce n'est pas la peine)
À tous donc, sans lesquels ce qui n'est pas
ne serait toujours pas
et ce qui est, serait quand même
(ou le contraire, peut-être, ou sans doute)
Enfin, laste beute note liste, pour parler anglais,
puisqu'il est de bon ton de spea-quer désormais ainsi,
À Brigitte, David et Florian,
qui se reconnaîtront
avec ou sans poil au menton
Sommaire
« Fais comme l'oiseau », chantait Michel Fugain.
Picore donc comme l'oiseau ce qui t'intéresse, un peu ici un peu là.
Il n'y a pas de sens de lecture obligé. Certes, il faut bien lire de gauche à droite. Mais tel ou tel chapitre peut être lu avant un autre qui est avant lui, au choix de chacun ‒ même si le chapitre sur la littérature marque un changement de paradigme orthographique (comme c'est bien dit !). Ce qui ne veut pas dire que tout soit sens dessus dessous, comme eût pu le dire à son tour Raymond Devos (à propos de cet auteur et de tous les autres, le regretté Opticon Tessour avait d'ailleurs tenu à les remercier chaleureusement, avant de s'effacer mystérieusement ).
Attention danger
Préface du préfacier
Des poissons en hors d'œuvre
Le sens de la vie et les mythologies
Le sens de la vie et les religions
Le sens de la vie et la philosophie
Le sens de la vie, l'humanisme et l'esprit du temps
Le sens de la vie et l'histoire, la grande et la petite
Le sens de la vie, la science et les pseudo-sciences
Le sens de la vie et la littérature
Pour ne pas finir en queue de poisson : un tourbillon de vie !
Postface du préfacier
Appendice
Quand j'étais un poisson rouge
ou quand un poisson rouge fait valoir son droit de réponse
Introduction du préfacier
Le petit poisson rouge, l'académicien et le petit âne gris
Au commencement
Autobiographie d'un poisson rouge
Retour à la vie d'avant
Les leçons de vie du poisson rouge
La religion du poisson rouge
La philosophie du poisson rouge
Heureux comme un poisson dans l'eau
Épilogue du préfacier
Opticon Tessour disparut donc, mais son souvenir demeure.
Si vous voulez témoigner de votre sympathie envers les personnes qui l'ont connu et aimé, merci de laisser un message, soit sur les sites de vente comme ceux d'Amazon et de la Fnac, soit sur les sites de bibliophiles et sur les réseaux sociaux.
Attention danger !
Si l'humanité est dangereuse, seule l'humanité peut essayer de trouver des réponses à ses problèmes. Ce livre peut sembler parfois pécher par optimisme. Quand on voit l'état du monde, les guerres, les violences, comme celles de 2023 en France, on pourrait se dire que tout va forcément de pis en pis, que tout est à désespérer. L'actualité semble impitoyable : une catastrophe succède à une autre. On verra cependant que, selon les statistiques, tout n'est pas si sombre. Certes, des années sont moins bonnes que d'autres, ou franchement mauvaises. C'est le principe des dents de scie : cela monte et cela baisse. Mais sur le long terme, la situation s'améliore dans la plupart des domaines. L'humanité vit mieux et plus longtemps qu'autrefois. Bien sûr, il se trouvera toujours des personnes pour commettre des actes insensés, mais cela n'invalide pas les tendances à long terme. Bien sûr aussi, il reste le problème du dérèglement climatique. Là, par contre, il est déjà trop tard pour éviter le pire. L'humanité doit maintenant trouver comment s'y adapter. Ce sera dur, elle souffrira, mais elle s'y adaptera – sauf ceux qui ne pourront pas. L'avenir ne sera jamais tout rose, ce qui ne devrait pas empêcher de tout faire pour voir la vie en rose. Certes, sur le long terme l'humanité est condamnée. Tout être qui naît est d'ailleurs condamné à mort dès sa naissance. C'est la vie ! Notre planète aussi : rien n'est éternel dans l'Univers. Sans même rappeler le réchauffement climatique, le Soleil rendra un jour la vie impossible sur Terre, car il fera vraiment trop chaud (dans à peu près un milliard d'années, c'est vrai...). Mais d'ici là il appartient à chacun de contribuer à son échelle à rendre l'humanité plus « chaleureuse » (!). À cet égard, ne vous méprenez pas sur la préface de ce livre : son ton léger ne vise qu'à introduire des sujets plus complexes. Tellement complexes que de courtes histoires moins sérieuses ont été ajoutées pour en alléger également le propos. Si, après avoir lu ce livre, le monde des poissons vous intéresse toujours, lisez aussi un autre livre de l'auteur, Le cri du poisson rouge. C'est un peu la suite logique de Tout cela a-t-il un sens ?, et c'est un petit livre avec de grandes ambitions. Vous en apprendrez sûrement beaucoup sur les poissons, rouges ou non, mais aussi sur le monde des humains, et sur les relations de ceux-ci avec les animaux. Pardonnez à l'auteur d'avoir pris ensuite la grosse tête. Ayant examiné l'état du monde dans Tout cela a-t-il un sens ?, il n'a rien trouvé de mieux que de se porter candidat à l'élection présidentielle française de... 2037 ! Son livre de candidature, Élisez-moi à l'Élysée, mérite d'être lu, car il présente assurément quelques idées intéressantes. Et puis, 2037 va arriver si vite ! Autant s'y préparer dès maintenant !
Retour au préfacier : lui, il s'est plu à rendre hommage à l'auteur, Opticon Tessour, devenu président de la République, qui est décédé en... 2049. Dans son livre Opticon Tessour 1949-2050, il relate les faits marquants de la présidence d'Opticon Tessour (deux mandats pour le plus vieux président que la France ait jamais eu !) et, de plus, il explique toute sa philosophie. Un livre à lire, même par ceux qui n'ont pas forcément l'intention de voter pour Opticon Tessour... en 2037 ! Dans son autre livre, L'entonnoir de la vie, le préfacier présente l'histoire de plusieurs vies, des vies de migrants qui ont fait la France d'aujourd'hui : ce livre mélange histoire et philosophie pour expliquer le monde contemporain. Enfin, dans son dernier livre, La conspiration des chats, le préfacier narre l'histoire d'un complot... Ne vous fiez cependant pas trop au titre... Mais lisez plutôt le livre ! Et si vous aimez les chats, n'ayez crainte, tout finira bien ! Ne manquez pas d'ailleurs de consulter la présentation des écrits de l'auteur et du préfacier à la fin de ce livre. Alors, tout cela a-t-il un sens ? Mais « tout cela », c'est quoi ? Vaste sujet ! Lisez donc Tout cela a-t-il un sens ? pour le savoir, et pour savoir quel sens donner à « tout cela » !
Préface de Joël Carobolante
Trésorier honoraire de l'Association ataraxique des aquariophiles et amis des animaux aquatiques
« Le sens de la vie expliqué à mes poissons rouges » : quel titre bizarre pour un livre ! C'était le titre de la première version de ce livre. L'auteur a préféré le changer, mais son livre n'en continue pas moins de traiter du sens de la vie – de la vie vue comme un mystérieux tourbillon.
Qui oserait pouvoir prétendre expliquer le sens de la vie ? Faut-il être quelque peu prétentieux pour prétendre – justement ! – expliquer cela ! Nous sommes tous en vie, sans avoir jamais rien demandé à personne, alors pourquoi se poser la question d'un quelconque sens de la vie ? La vie est. Point ! On n'a pas le choix : puisque nous sommes en vie, vivons ! Est-il besoin de chercher un sens à cette vie que la vie nous inflige ? (à cette vie que la vie nous inflige : un peu étonnante, cette formulation.) Que serait notre société si chacun s'interrogeait sans cesse sur ses raisons de vivre ? Et pourquoi l'expliquer à des poissons rouges ? Pourquoi pas à d'autres poissons ? Et pourquoi à des poissons ? Opticon Tessour répond vaguement à ces interrogations dans ce livre, d'un intérêt limité selon moi, dont j'ai accepté de rédiger la préface pour le présenter, Opticon Tessour ayant malheureusement disparu entre-temps, et ne pouvant donc plus s'expliquer lui-même sur son ouvrage.
J'ai peu connu Opticon Tessour. En fait, je ne l'ai vu que deux fois, dont la première dans un magasin d'optique, évidemment, si je puis dire, vu son nom. Comme il était déjà à moitié sourd, et comme moi peu loquace, nous avons eu une conversation assez laborieuse, en attendant qu'un employé du magasin daignât s'occuper de nous. Tous les deux, nous parlâmes ce jour-là de tout et de rien, et nous en restâmes là ‒ même si Opticon Tessour me parut un brin mystérieux. Je soupçonnai alors qu'il y eût anguille sous roche. L'avenir devait révéler le pot aux roses. Allez savoir pourquoi, nous nous donnâmes nos adresses informatiques, et c'est ainsi que pendant plusieurs mois nous eûmes de longs échanges électroniques. Opticon Tessour finit par m'inviter à venir manger chez lui, parce qu'il avait quelque chose à me dire de vive voix.
Le jour convenu, je me rendis donc chez lui, seul, mon épouse n'ayant pu m'accompagner. Il fut heureux de me voir, ayant cru, je ne sais pourquoi, que j'allais lui poser un lapin.
— Excusez ma conjointe, me dit-il d'un air chagrin. J'ai dû appeler tout à l'heure le médecin pour lui dire : Docteur, ma femme est clouée au lit, j'aurais voulu que vous la vissiez. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu, ce malotru ? Qu'il n'était pas menuisier ! Enfin, il est quand même venu avec sa trousse à outils, et il a fait le nécessaire.
De l'Opticon Tessour tout craché ! Mais était-il sérieux, ou se moquait-il ? Pince-sans-rire ? Tout cela avait-il un sens ? Avec lui, comment savoir ?
Nous mangeâmes ensuite en silence, dans une ambiance monacale, car étant tous deux de tempérament toujours aussi mutique. Je lui fis quand même un compliment de pure forme sur le repas, dont le plat principal était composé d'une viande que je ne reconnus pas. Entre la poire et le fromage, il me dit alors, mi-figue, mi-raisin, ne sachant pas si ce que je venais de lui dire, c'était du lard ou du cochon :
— Je pars demain à Srinagar, en Inde, à la recherche du tombeau du Christ.
Devant ma mine étonnée, il me dit que selon une tradition locale, Jésus-Christ aurait survécu à sa crucifixion, et serait enterré là-bas.
— Ah ! fis-je, figé telle la femme de Lot transformée, selon la Bible, en une statue de sel.
Puis, plus rien pendant un long moment. Le silence finit par devenir assourdissant. On entendait une mouche voler, ce qui me mit la puce à l'oreille : Opticon Tessour allait me demander quelque chose. Mais je n'osai l'interroger, de peur qu'il ne prît la mouche.
— J'ai un service à vous demander, mon ami, murmura-t-il. Si je ne revenais pas, pour une raison ou une autre, pourriez-vous vous occuper de faire publier le livre que je vais vous donner ?
Pourtant fier comme un pou, Opticon Tessour me demandait un service ! J'acquiesçai donc sans discuter, ce qui l'étonna et lui cloua illico le bec. Puis, passant du coq à l'âne tout en me regardant et, comme pour ménager la chèvre et le choux, Opticon Tessour me déclara que, somme toute, son repas eût pu être meilleur, mais la faute en était que lui-même n'avait pas été dans son assiette, et qu'il avait eu la tête ailleurs. Enfin, cessant de tourner autour du pot, il mit les pieds dans le plat, en déclarant, dans un grognement :
— Trop de sel tue le goût.
Il eût été malvenu que j'ajoutasse mon grain de sel, aussi me tus-je. Non que son repas fût bon, mais, de toute façon, je n'avais pas l'intention d'en faire tout un fromage. Satisfait de son aveu, je buvais du petit lait. Vint le moment du dessert. Opticon Tessour avait concocté un délicieux gâteau. Je ne pus résister, j'en pris et en repris, peut-être un peu trop. Mon commensal me fit alors remarquer :
— Faites attention, il serait dommage qu'à trop manger de ce gâteau, vous en pâtissiez.
De surprise, je renversai sur moi mon verre, et me précipitai pour jeter du sel sur ma chemise. Opticon Tessour leva les bras au ciel :
— Maladroit ! C'est inutile, ce vin fait des taches, il eût fallu que vous le sussiez !
Encore tout surpris, rouge comme une écrevisse, je ne répondis pas, peut-être aussi par peur de ne pas avoir tout compris d'un langage ironique ou par trop châtié. Voyant ma tête, Opticon Tessour se mit alors à rire comme une baleine. Après le dessert, cerise sur le gâteau, il me donna un joli paquet de feuilles imprimées, en me promettant de m'envoyer sans tarder le fichier informatique correspondant. Malheureusement, je ne l'ai jamais reçu, et j'ai dû me débrouiller avec les feuilles imprimées. J'avais du pain sur la planche ! Car comme elles n'étaient pas numérotées, et que je les avais malencontreusement mélangées chez moi, j'ai dû reconstituer le livre comme j'ai pu, en ayant la douloureuse impression d'avoir été le dindon de la farce. Enfin, le livre est là, et il est comme il est, tel un plat prêt à être servi, comestible ou non, je ne sais ! Je crois, en tout cas, que certains le trouveront indigeste, car un brin trop sérieux, difficile à lire. D'autres, à l'inverse, le trouveront trop simplificateur. Difficile de contenter tout un chacun ! Je redis aussi que son intérêt est limité, car Opticon Tessour ne fait que reprendre ce qu'il a lu dans d'autres livres : il n'y a rien d'original, rien de nouveau. Alors, pourquoi le lire ? Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais une promesse est une promesse, je l'ai tenue, et voilà ! Il va de soi que toutes les erreurs et fautes que vous trouverez certainement dans ce livre ne pourraient être que de son fait. Pour ma part, je ne me suis occupé que de sa publication, sans tirer d'aucune façon les marrons du feu. Et encore, vous n'avez pas entendu les poèmes d'Opticon Tessour !
— Venez voir, je fais des vers, avait-il murmuré avant que je partisse.
Sur le moment, comme il venait de me parler de sa santé, je pensai à des problèmes intestinaux, mais Opticon Tessour se mit aussitôt à réciter une de ses œuvres, après m'avoir dit qu'il ne savait comment l'appeler.
— Écoutez bien attentivement, me dit-il, je déclame :
Il eût fallu que je vous visse Pour que mon amour je vous disse, Que sans détour vous me plussiez Et qu'enfin vous me connussiez. Mais m'apercevoir vous ne pûtes, Et m'imaginer vous ne sûtes. Ô ma rage, ô mon désespoir ! Tout n'était plus que noir sur noir ! Puis un jour soudain vous mourûtes Au grand jamais à moi ne fûtes. Ma mie que je n'ai pas connue Vous serez toujours l'Inconnue.
— Quels mauvais vers ! maugréai-je innocemment à voix basse.
— Mauve et vert ! s'exclama-t-il, songeur. Comme titre, c'est bien trouvé ! Je n'y aurais pas pensé !
Assurément, il se bourrichonnait le bourrichon quant à ses talents poétiques. Heureusement, il ne me demanda pas de publier son œuvre. Certains poètes gagnent à être méconnus.
Vous vous demandez peut-être comment Opticon Tessour disparut. Je vais vous le dire, mais permettez-moi tout d'abord de vous préciser qu'il était né un 1er avril : étrange, n'est-ce point ? Du coup, cela pourrait expliquer son intérêt pour les poissons...
J'ai été informé de la disparition d'Opticon Tessour par une étrange lettre d'une de ses connaissances, qui me racontait comment cela s'était passé. Opticon Tessour s'apprêtait à entrer au Mac Donald's de Srinagar, au Cachemire indien ‒ car même là-bas il y en a un ! ‒ quand une jolie demoiselle voulut faire de même. Galamment, Opticon Tessour s'effaça pour la laisser passer. (On ne retrouva même pas la gomme...)
Il s'était effacé – intégralement, complètement, entièrement, totalement ! Effacé ! Effacé... Effac... Effa... Eff... Ef... E...
Des poissons en hors d'œuvre
Bonjour, je m'appelle Opticon Tessour et je vais vous parler du sens de la vie – du tourbillon de la vie. Un tourbillon à comprendre, et donc à expliquer.
Qui suis-je pour prétendre y connaître quoi que ce soit que vous ne connaissiez déjà, vous mes chers petits poissons rouges ? Vous me connaissez bien, puisque je vous nourris, et que je vous parle chaque jour. Mais bon ! Refaisons les présentations !
Quand j'étais petit, on m'a appelé Opticon. Roland Bacri, mon père littéraire a ainsi décrit comment c'est arrivé, dans son livre appelé justement « Opticon », qu'il m'a consacré et qui ne parle que de moi. Ma modestie dût-elle en souffrir, permettez que je vous en lise un extrait :
Après l'avoir toisé, palpé, ausculté, en long, en large, en travers, les médecins avaient diagnostiqué qu'il n'était ni myope, ni presbyte, ni astigmate, ni strabiste. Il n'appelait pas un chat un chat, pour la bonne raison qu'à ses yeux, il n'y avait pas un chat mais selon le cas une vessie, une lanterne, une chèvre ou un chou. En désespoir de cause, pour que la science ait quand même le dernier mot et parce qu'il s'agissait somme toute d'un phénomène optique aberrant, ils l'avaient baptisé : « Opticon ».
Opticon : déjà tout un nom !
J'ai eu une enfance heureuse, et même très rêveuse :
Opticon n'est pas de ces vicieux qui veulent s'enfoncer dans la Lune, de ces audacieux qui du haut des cieux veulent se faire lanlaire en l'air. Il sait bien que notre Terre n'est qu'un habitacle, que là-haut à l'aurore, le spectacle est stratosféerique mais il se méfie des sites de Mars, fait fi des trucs sans sas et du compte à rebours pour des globes ou des globinettes. Opticon, ce qui l'intéresse, c'est de s'envoyer sur Vénus dans le plus simple appareil.
Et puis je me suis cru inventeur :
Opticon travailla des mois après son robot femelle. Elle s'anima enfin, belle entre les belles, plus vraie que nature. Ils s'aimèrent. Neuf mois après, ils avaient la joie d'annoncer la naissance d'œufsautomates.
Puis, un beau matin, je suis tombé amoureux, cette fois c'était sérieux :
Opticon voulut dire avec des fleurs tout son amour... Pour mieux la griser, il glissa dans le bouquet, des lys de Capoue. Pour lui rappeler que la jeunesse n'a qu'un temps : des genêts de soleil. Pour traduire sa folle impatience : des chardons ardents. Il mit dans ses mains les fleurs les plus belles : odorants jasmins, frêles asphodèles, des lilas itou et de grands glaïeuls... Elle fit la gueule. Ce qu'elle voulait ? Des pensées, encore des pensées, toujours des pensées !
Et puis j'ai vieilli avec ma mie, j'ai gagné des rides et j'ai perdu l'ouïe. T'es sourd ? disait ma mie, alors à force de m'entendre appeler ainsi, tout le monde a fini par m'appeler Opticon Tessour.
Voilà ! Vous savez tout ! Ah non ! J'oubliais de vous donner mes références, pour vous montrer que je sais de quoi je parle ! Après des études à l'université des Sciences sociales de Toulouse, je suis allé à Cambridge, en Angleterre, et à Harvard, aux États-Unis. Certes, c'était en tant que touriste, mais ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse ? C'était donc une formation, tout comme à l'université. Tout pareil !
Ensuite, j'ai eu deux charmants enfants avec ma mie, ma muse, ma mie-muse, et j'ai travaillé puisqu'il fallait bien travailler, et au soir de ma vie je me suis interrogé sur le sens de la vie. J'eusse pu m'y prendre plus tôt, ne fût-ce que le matin, mais il n'est jamais trop tard, non ?
Je ne sais pas si j'ai tout compris, en tout cas je vais essayer ici de vous expliquer le peu que je pense avoir compris, c'est-à-dire pas grand-chose, mais peut-être assez pour vous qui, de toute façon, n'avez rien demandé. Accessoirement, ce livre pourrait d'ailleurs intéresser n'importe qui, car il parle un peu de tout et de n'importe quoi. Après tout, quelles questions pourraient-elles être plus importantes que de savoir si la vie a un sens, et si oui, de savoir lequel ?
Et d'abord, qu'entend-on par le sens de la vie ? Le sens de la vie pour les poissons rouges, le sens de la vie en général, ou le sens de la vie pour les humains ? Et pourquoi l'expliquer à vous, mes chers poissons rouges ?
Il est facile de répondre à cette question : parce que vous n'êtes pas contrariants. Je peux vous expliquer ce que je veux, vous n'allez pas me contredire. Donc autant m'adresser à vous, c'est plus facile et plus reposant que de m'adresser à des humains qui ne manqueraient pas de contester, d'argumenter, ou encore de m'envoyer promener. Et puis, ce n'est pas vous qui pourriez me sortir quelque chose comme Un récit qui s'adresse à des petits poissons rouges, ça ne devrait pas voler haut ! Piètre argument oisif, en vérité !
Dans le film des Monty Python « Le sens de la vie », on voit des poissons qui sont dans l'aquarium d'un restaurant et qui, philosophes, s'interrogent sur le sens de la vie, tout en regardant les convives manger d'autres poissons.
Vous autres, mes poissons rouges, vous êtes sans doute moins futés. Je ne pense pas que vous vous interrogiez beaucoup, sauf si je vous dérange pour nettoyer l'aquarium, sauf si je fais semblant de vous donner à manger, sauf si... Finalement, vous devez quand même vous poser des questions ! Alors, autant essayer de vous répondre.
Quel est donc le sens de la vie pour vous, pour nous les humains, pour la vie elle-même ? La réponse est claire, nette définitive : c'est tout droit, et au bout, c'est la mort. Fin du bouquin.
Sauf si l'on prend le mot sens pour signification, et non pour un simple panneau routier. Sauf si l'on remplace bout par but . Notre but dans la vie sera alors une cible à viser, en tirant dans le bon sens, le sens de la vie.
Mais, au fait, pourquoi la vie aurait-elle forcément un sens ? La question est pertinente, et mérite une réponse. Si l'on répond que la vie n'a aucun sens, ce qui est possible, comment ce livre pourrait-il continuer ? Nous allons donc partir – pour l'instant ! – du principe que la vie a un sens. Après tout, il faut bien partir de quelque part. En route donc pour le sens de la vie ! Pour cela, nous aborderons divers thèmes, comme les mythologies, les religions, la philosophie, l'humanisme et l'esprit du temps, l'histoire, la science et les pseudo-sciences, ainsi que la littérature, avant de conclure en disant que le sens de la vie, c'est... Mais commençons plutôt par le commencement...
Ce panneau, déjà vu ailleurs, n'interdit pas de continuer : ce n'est pas le panneau officiel du sens interdit
Le sens de la vie et les mythologies
Plutôt que le chant des sirènes, oyez l'histoire édifiante du prophète Jonas et de son grand poisson
Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Éternelles questions que les hommes se sont posées très tôt, peut-être autour du feu, en regardant le ciel étoilé, près de leurs cavernes climatisées. Bien plus que vous les poissons (désolé !), les hommes (des anciens poissons, pour ainsi dire), sont assurément des êtres exceptionnels qui ont bouleversé la vie sur terre. Leur intelligence et leur facilité d'adaptation leur ont permis de coloniser tous les milieux de notre planète, même les plus hostiles. Face aux éléments naturels, parfois terrifiants, face à tous les dangers de la vie quotidienne, ils avaient besoin de comprendre le monde, de trouver des explications et du réconfort. Animaux sociaux, la mort qui les frappait, souvent à l'improviste, les interrogeait. Dès qu'ils se sont mis à enterrer leurs morts, nos lointains ancêtres ont franchi une étape notable dans leur humanité. Leur vie spirituelle a émergé. Les esprits de la nature, puis les dieux et les déesses sont nés. Le monde mythique pouvait alors commencer.
Seul l'homme sait qu'il est né et qu'il va mourir. Lui seul sait ce qu'est la vie, ce qu'est le passé, le présent et l'avenir. Lui seul se sait fragile. Il sait qu'il a besoin de la solidarité des autres pour se défendre contre ceux qui veulent s'en prendre à lui, aux siens ou à son territoire. Nos ancêtres ne pouvaient pas se permettre d'être individualistes. La vie est dure et, en plus, elle ne dure pas : toute l'angoisse du monde est là. Selon le joli mot d'André Malraux, L'homme est né lorsque pour la première fois, devant un cadavre, il a chuchoté : Pourquoi ?
Comment comprendre le monde, donner du sens au réel ? Par la mythologie. Depuis toujours les hommes aiment se raconter des histoires. Les mythes viennent de là. Pour ceux qui y croient, il ne s'agit pas de mythes, mais d'histoires qui donnent du sens. Cependant, les mythes sont des récits imaginaires qui violent souvent la réalité physique ou biologique. Les mythes, c'est la vérité des autres à laquelle on ne croit pas. Pour que l'on appelle mythes ces histoires, il faut aussi qu'il y ait entre elles et nous de la distance, temporelle ou spatiale.
De nombreuses cultures ont leurs explications sur le début du monde. Pour certaines, le monde se forme tout seul, ou il était déjà là et est donc incréé. Ou encore un être primordial surgit du néant et introduit de l'ordre dans le chaos en séparant les ténèbres et la lumière, ou la terre des eaux ou du ciel. Cet être primordial peut se situer en dehors du monde, comme dans la Bible, mais souvent il s'agit en fait de deux êtres qui s'accouplent et ont une descendance, ou encore de deux êtres qui s'opposent, un être qui apporte la vie et tout ce qui est bien, un autre qui apporte la mort et tout ce qui est mal. Ou encore tout commence par un œuf primordial, ou avec un géant démembré dont les membres vont former les éléments du monde – tout est possible, y compris que le géant sorte de l'œuf primordial.
Le récit le plus connu, celui de la Bible, tranche en ce sens qu'il n'y a qu'une divinité et que les phénomènes et éléments naturels ne sont pas des dieux. Les anges y sont juste des sortes de fonctionnaires célestes. Les auteurs de la Bible ont voulu se séparer du polythéisme, mais ils n'ont pu rompre avec la mythologie, même dans des récits ultérieurs qui se voulaient plus historiques.
Il semble que les mythes les plus anciens racontent que les hommes vivaient autrefois sous terre et que les femmes dominaient le monde, puis que les hommes prirent le dessus. Le mythe du matriarcat primitif a pu servir à justifier la domination masculine. Il a certes pu cependant exister jadis des sociétés plus égalitaires entre les sexes que ce que l'on pense aujourd'hui, et certains mythes ont pu s'inspirer d'un passé réel, mais par définition un mythe n'est pas un récit historique.
Le mot mythe a plusieurs sens, mais nous nous en tiendrons ici surtout à celui que l'on donne aux récits légendaires des temps anciens. Nous nous en tiendrons aussi aux mythes qui ont marqué la civilisation européenne, le monde étant trop vaste et trop divers pour tout résumer en quelques lignes, au risque de trop généraliser et de tout fausser.
On trouve dans les mythes l'histoire des divinités ou des héros, des récits sur l'origine du monde et de tout ce qui vit sur terre, sur les causes des phénomènes naturels, le sens de la vie et de la mort, ou encore sur l'au-delà. Les mythes relient l'homme au cosmos et expliquent en les justifiant par leur origine divine les mystères de la vie, les faits et les coutumes humaines. C'est en fait tout l'imaginaire des Anciens sur des thèmes universels qui reflètent notre humanité, dans sa grandeur comme dans ses faiblesses.
Les mythologies sont essentiellement polythéistes. Les dieux s'y comportent comme les mortels, ils ont les mêmes passions ‒ amour, jalousie, colère, loyauté, courage ‒ mais ils sont immortels. Contrairement au Dieu de la Bible et du Coran, ces dieux ne sont pas hors du temps et de l'espace, leur pouvoir et leur volonté sont donc limités. Comme les hommes, ils mangent, dorment, copulent avec des mortelles ou des déesses. Ils n'ont pas toujours l'apparence humaine, mais ils en ont l'intellect. Ces dieux sont en fait avant tout des puissances. Leurs conflits et leurs combats se situent entre la passion et la raison, l'ordre et le désordre, et révèlent les grands phénomènes de la nature qui interrogent l'homme. La morale des mythes est que les hommes ne doivent pas se croire les égaux des dieux. Ce sont là les caractéristiques de nombreux mythes, mais les mythes évoluent et se contredisent, il ne faut pas y chercher la rigueur des religions fondées sur des dogmes.
Amis poissons, faisons un petit tour rapide des mythes qui ont influencé notre héritage culturel judéo-chrétien, comme il est de bon ton de dire.
Les mythes mésopotamiens (Iraq actuel et ses voisins) ont eu une grande prospérité, car certains d'entre eux ont inspiré plusieurs mythes bibliques, comme ceux de la création et du déluge. L'épopée de Gilgamesh, est ainsi passée des Sumériens aux Hébreux pour devenir l'histoire du déluge. Ce dernier, qui est répandu dans de nombreuses cultures, a pu être inspiré de faits réels, une série d'inondations locales, mais il reste un mythe, car jamais une inondation ne recouvrit la terre entière, notamment les plus hautes montagnes. À noter dans ces mythes de Mésopotamie la présence d'une chimère à corps de chèvre et queue de poisson qui est souvent associée au dieu Ea qui régit les eaux. Logique, après tout !
Amis poissons, notez aussi qu'en Égypte les divinités pouvaient avoir la tête d'un animal, d'un chat par exemple (la déesse Bastet), mais n'ayez crainte, ces divinités sont bel et bien mortes. La mort préoccupait beaucoup les Égyptiens ‒ c'est le pays de l'art funéraire ‒ ces sépulcres royaux que sont les pyramides en témoignent, ainsi que les momies d'hommes, de femmes, de chats... et de poissons, bien sûr !
Les Grecs anciens, eux, avaient également beaucoup de dieux, mais aussi des héros ou demi-dieux mêlant une ascendance humaine et une ascendance divine, le plus célèbre étant Hercule qui finit enlevé au ciel sur un nuage, comme ce que l'on devait appeler plus tard une assomption. Les Grecs demandaient aux dieux leur protection contre les malheurs de l'existence, mais peu à peu leur conception des dieux évolua. Les dieux devinrent les garants du bien et de la justice, punissant les méchants et récompensant ceux qui faisaient le bien. L'au-delà existait pour punir les uns et récompenser les autres.
Les Romains reprirent les dieux étrusques et grecs en les assimilant à leurs propres cultes. Pour connaître la volonté des dieux, ils examinaient aussi bien les phénomènes célestes que les entrailles d'animaux sacrifiés. Les prêtres chargés de révéler ce que signifiaient ces signes s'appelaient des augures ‒ d'où l'expression c'est de bon augure. Le culte de l'empereur se développa également. En outre, des religions venues d'Orient séduisirent ceux que la religion romaine ne satisfaisait pas. En particulier, le culte de Mithra, dieu de la lumière et de la vérité, se développa. Ce dieu rédempteur indo-iranien qui devait venir juger le monde attira de nombreux hommes. Le sang d'un taureau sacrifié permettait, dit-on, de sauver les fidèles. Cette religion fut un concurrent sérieux du christianisme naissant, avec lequel elle aurait eu quelques ressemblances. Selon Ernest Renan, on peut dire que, si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste.
Religion disons-nous, et non pas mythe ? C'est que tout se rejoint, même si, ici, nous préférons parler de mythes, puisque personne n'y croit plus. Du reste, les religions peuvent être considérées, par ceux qui n'y croient pas, comme des mythes anciens devenus dogmes.
Voyons, par exemple, comment les Grecs imaginaient l'origine du monde. Selon la généalogie qui nous vient du poète grec Hésiode, du Chaos sortent l'Amour et la Nuit, et de la Terre (Gaïa) sortent le Ciel (Ouranos) et l'Océan. De l'union de Gaïa et d'Ouranos (son fils, donc) naissent douze Titans, dont le cadet s'appelle Cronos. Celui-ci a du tempérament : il châtre son père à la demande de sa mère, et avale ses propres enfants qu'il a eus de sa sœur Rhéa, afin qu'ils ne puissent le détrôner, mais l'un d'eux, Zeus, l'oblige à recracher ses frères et sœurs. Sa grand-mère Gaïa donne ensuite naissance à Typhon, un colosse immortel aux cent têtes de dragons cracheurs de feu que Zeus réussit à terrasser. Zeus s'unit avec des déesses aussi bien qu'avec des mortelles, et sa descendance est prolifique. Il est le plus grand des dieux, c'est le maître de l'Olympe, le domaine des dieux en Grèce. Il est le maître de la lumière, de la foudre, de la pluie et du vent. Il s'impose aux autres dieux, mais il reste à l'image des hommes, sujet à ses passions. Sur le mont Olympe, les autres dieux forment quant à eux une cour indisciplinée où règnent rivalités et adultères, comme dans une bonne ou mauvaise série télé, selon les goûts de chacun.
Ailleurs dans le monde, d'autres mythologies racontent l'histoire d'autres dieux, héros ou sages. Ces histoires peuvent nous sembler farfelues, et l'on peut se demander si les Anciens y croyaient vraiment. Le contexte social et culturel était différent du nôtre, mais l'on peut faire un parallèle avec les religions actuelles. Certains, par exemple, croient littéralement à tout ce que raconte la Bible, comme la création du monde en six jours, le déluge universel, la tour de Babel, le fait que le prophète Jonas passe trois jours dans le ventre d'un grand poisson, l'âne de Balaam qui parle, le soleil qui s'arrête pour faire gagner une bataille à Josué, et ainsi de suite. D'autres, par contre, y croient sans y croire, ou n'y attachent pas grande importance. Ils essaient de voir quels enseignements ils peuvent tirer de ces récits. La pratique de leur foi, le réconfort des rites, leur importent plus que les écrits ou les dogmes. La vérité de la foi passe alors avant la vérité historique. Comme Paul Veyne le montre dans son ouvrage « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? », la question n'a, en fait, pas de sens. On peut, par exemple, ne pas croire aux fantômes et en avoir peur. Ou l'on peut ne pas croire aux revenants, et être mal à l'aise si l'on doit traverser un cimetière la nuit. La logique de l'esprit humain peut avoir des limites bien humaines. Par ailleurs, au delà de tout ce polythéisme, des penseurs ont pu aussi songer à un dieu unique, ou à l'inexistence d'êtres surnaturels.
Les philosophes, à partir de Platon, virent de plus en plus dans ces mythes singuliers ou archaïques l'histoire déguisée ( « codée » pourrions-nous dire) des pérégrinations de l'âme à la recherche de l'absolu, c'est-à-dire en général du paradis perdu ou du bonheur futur. Jacques Lacarrière, « Au cœur des mythologies »
Aujourd'hui encore, c'est le monde grec qui représente le mieux l'univers des mythologies. Les Jeux olympiques n'ont plus lieu à Olympie pour honorer Zeus, mais ils sont devenus la plus grande manifestation sportive mondiale. Plusieurs expressions nous viennent de Grèce : sortir de la cuisse de Jupiter, un travail de titan, tomber dans les bras de Morphée, ouvrir la boîte de Pandore... Chacune de ces expressions rappelle un mythe grec, et chaque mythe grec qui semble n'être qu'une histoire à dormir debout peut être riche d'enseignements.
Amis poissons, et si l'on parlait maintenant des mythes qui vous concernent directement ? Ne revenons pas sur le mythe du déluge universel, puisque, en tant que poissons, vous avez été épargnés d'office, sans avoir eu besoin de grimper dans l'arche de Noé. Sans pattes, cela vous eût été d'ailleurs difficile, même si, avec les mythes, tout est possible.
(Petite parenthèse, quand même, sans vouloir chercher la petite bête : vous, poissons d'eau douce, vous ne supportez pas l'eau salée, et les poissons d'eau de mer ne supportent pas l'eau douce. La Bible ne mentionne précisément comme entrant dans l'arche que le bétail, les oiseaux et les reptiles. Comment ce problème a-t-il été résolu ?)
Parlons plutôt du chant des sirènes. À l'origine, dans la mythologie grecque, des monstres marins à tête et buste de femme, mais avec des ailes, ces monstres ont ensuite évolué dans notre imaginaire comme on les connaît aujourd'hui, en de charmantes demoiselles avec une queue de poisson. Les appels des sirènes causaient des naufrages entre la Sicile et le sud de l'Italie, où sévissaient les monstres Charybde et Scylla. Dans « L'odyssée », Ulysse doit se faire enchaîner pour résister à leurs voix envoûtantes. Il y réussit, mais en devenant presque fou. Mais en fait, il faut bien séparer les sirènes de la mythologie grecque de celles du folklore médiéval nord-européen ‒ qui sont les sirènes telles que nous les imaginons, à queue de poisson. Ce sont ces sirènes qui ont été popularisées par l'écrivain danois Hans Christian Andersen, et par Walt Disney avec La Petite Sirène. L'origine de ces sirènes est peut-être dans les récits des navigateurs qui rencontraient des animaux marins tels que les lamentins ou les dugongs. La croyance aux sirènes a perduré moins longtemps que celle des licornes.
Loin de toute réalité : une sirène en bonne compagnie, et Jonas dans son grand poisson
Quant au prophète biblique Jonas, il prit la mer pour ne pas obéir à l'Éternel qui voulait l'envoyer à Ninive pour que la ville se repentît de ses péchés. Une tempête se leva. Les marins tirèrent au sort pour savoir qui attirait le malheur sur eux. Le sort tomba sur Jonas. Ne pouvant gagner la terre à cause de la mer déchaînée, ils jetèrent Jonas dans la mer, à sa propre demande, précisons-le. Voici la suite de l'histoire, racontée dans le livre biblique de Jonas, version Louis Segond :
L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. [Jonas pria l'Éternel, puis] l'Éternel parla et le poisson vomit Jonas sur la terre.
Jonas obéit ensuite à l'Éternel en allant demander aux habitants de Ninive de se repentir de leurs péchés, ce qu'ils firent bien volontiers.
Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.
Jonas en fut irrité et il voulut mourir. Il se retira hors de la ville.
L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha.
Jonas en fut encore irrité, et voulut encore mourir.
Et l'Éternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre !
Amis poissons, qu'en pensez-vous ?
Le mythe des sirènes ? Il montre l'attitude ambivalente de l'homme envers la femme, cet être à part, à la fois attirant mais mystérieux dont il faut se méfier. Tous les hommes ne pensent certes pas ainsi, mais ce mythe nous donne l'occasion de nous interroger sur l'histoire des rapports entre l'homme et la femme.
Contrairement à d'autres récits mythologiques où l'homme et la femme sont créés en même temps, dans l'un des deux récits bibliques de la création du livre de la Genèse, la femme est créée après coup, après même les animaux, comme à regret presque, et qui plus est à partir d'une côte de l'homme, pour bien montrer qu'elle lui est inférieure. Ou alors, on considère que l'homme a été tiré de la terre, de la boue, et la femme de l'homme, non de la boue, ce qui peut paraître plus propre, plus civilisé, moins terre à terre pour ainsi dire. On peut cependant douter de cette interprétation. Rappelons au passage que l'homme et la femme ont le même nombre de côtes, ce qui avait surpris les premières personnes à avoir regardé cela de plus près. (Ce n'est pas le moment ici de se demander si Adam et Ève, n'ayant pas grandi dans le ventre d'une mère, avaient un nombril. Si vous pensez que oui, vous croyez à l'omphalisme. Si vous pensez que non, vous croyez à l'anomphalisme.) Il paraît qu'Adam n'eut même pas mal quand Dieu lui retira une côte : son sommeil avait été un excellent anesthésiant. Ce fut le premier don d'organe de l'histoire...
Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l'appellera femme [« ischa »] parce qu'elle a été prise de l'homme [« isch »].
Adam était tout content ! Pensez : une femme créée rien que pour lui, pour son propre confort ! (qu'en aurait-il été si des femmes avaient écrit la Bible ?) Mais, toujours selon le récit biblique, c'est la femme qui entraîna l'homme à pécher en lui faisant croquer la pomme, d'après l'expression populaire. Pourquoi une pomme ? Pourquoi pas une figue, puisque l'histoire se poursuit ainsi : Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures ? Bien sûr, certains y ont vu des allusions sexuelles (pourquoi donc, puisque Dieu lui-même leur avait ordonné de faire des petits ?) ou symboliques, mais pomme ou figue, le récit garde son caractère quelque peu misogyne puisque Ève pèche la première et incite Adam à pécher. À contrario, on peut voir ce récit comme le refus par la femme de la simple soumission – le premier geste féministe de l'histoire ! ‒ la raison qui passe avant la foi, le début du combat entre la philosophie et la science contre la religion. Tandis que l'homme, lui, imbécile heureux, se contente de ce qu'il a, la femme fait la première expérience scientifique de l'histoire ‒ une autre première ! Bien sûr, l'auteur du récit voit les choses différemment, c'est le serpent qui tente Ève, et la femme, la tentatrice éternelle de l'homme, entraîne l'homme dans la chute : la misogynie est sauve, et avec la honte de la nudité commence le mépris du corps et de la vie charnelle, qui ne sont que déchéances par rapport à la vie spirituelle. Amen ! Dans la mystique catholique, Marie, la mère de Jésus, devait cependant, et pour ainsi dire, contrebalancer la faute d'Ève.
Comme dans tous les récits mythologiques de création, l'homme avait été créé immortel, pour être au service de Dieu, en travaillant pour lui, ici en entretenant le jardin d'Éden. Il devait croître et multiplier pour augmenter le nombre de travailleurs, et donc la productivité. Par la faute de la femme, selon la Bible, et plus encore du serpent qui avait séduit la femme (c'est pas moi, c'est lui ! avait dit Ève), l'homme est devenu mortel (lui, il avait dit : c'est pas moi, c'est elle !). Le serpent, le diable, est dans le récit pour expliquer l'origine ultime du mal, du malheur. Pour le coup, lui, n'avait pu se retourner contre personne, et il s'en mordit la queue en perdant définitivement l'usage de la parole. C'est depuis lors que l'on ne peut plus discuter avec les serpents, c'est pourquoi l'on préfère les éviter. Le serpent avait alors d'énormes pattes, comme celles des dinosaures. Pas les plus grands dinosaures, n'exagérons pas, non, le serpent n'était pas plus grand qu'un chameau, selon la tradition rabbinique.
Si la femme est ainsi malmenée dans la Bible, il ne faut pas oublier que pour les hommes, les premiers dieux furent d'abord une seule déesse, la grande Déesse, celle de l'amour et de la fécondité, celle de la terre qui fait pousser la vie, une Vénus aux formes plantureuses quelque peu disproportionnées. Le dieu mâle, par contre, lui, était pour la guerre. Mars attendait son heure pour triompher et dominer Vénus. Pour le moment, il était pour ainsi dire dans la lune.
Tout ce qui, sur cette terre, subit un rythme, un cycle, un devenir, fut, très tôt, associé à la lune : les eaux, en raison des marées – même si les peuples anciens n'ont perçu que tardivement le lien réel unissant la lune et les mers ; les plantes, car leur croissance correspond souvent à celle de la lune ; les femmes, puisqu'elles connaissent, dans leur propre chair, un cycle assimilé à celui de la lune ; la mort et l'immortalité, puisqu'elle meurt pour renaître. Jacques Lacarrère, « Au cœur des mythologies »
Pour les plantes, c'est une légende qui a la vie dure, mais c'est faux. En bon français, c'est du pipeau ! Inutile de jardiner avec la lune, on sait de nos jours que ce n'est pas scientifique, pas plus que l'astrologie. Mais reprenons avec les mythologies : la lune...
...est une lumière qui meurt pour renaître, créant au sein du ciel une alternance de deuil et de joie et ce cycle se retrouvera, sur la terre, dans les passions tourmentées des dieux et des héros qui meurent et renaissent : Osiris, Attis, Adonis, Zagreus, Penthée, Dionysos, Mithra, Jésus. Connaissant à la fois les angoisses de la mort ‒ pendant les trois jours de sa disparition ‒ et les joies de la renaissance, elle devient l'astre gouvernant les épreuves, les calvaires et les initiations des hommes ainsi, tout naturellement, que la sagesse et la révélation qui en résultent.
Et c'est ici que l'on retrouve le prophète Jonas qui fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jésus, aussi, fut mort pendant trois jours et trois nuits, comme pour imiter Jonas.
Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre...
… écrit l'évangéliste Matthieu. (Ce n'est pas le moment ici de discutailler si le compte est bon entre le Vendredi saint et le dimanche de Pâques, où l'on aurait pourtant du mal à mettre trois jours et trois nuits. Bon, passons, il paraît que c'est juste une expression.)
Trois jours et trois nuits : peut-être parce que la lune disparaît chaque mois pendant une telle durée ‒ en fait, disons qu'elle est très peu visible pendant cette période, et même un peu plus, soit à peu près la moitié d'une semaine. Ladite semaine qui dépend aussi de la lune, puisque c'est le quart d'un cycle lunaire. Cette division due aux Babyloniens fut reprise par les Hébreux. On doit aussi aux Babyloniens la division de l'année en douze mois (lunaires), nos jours de vingt-quatre heures (deux fois douze heures) divisées en soixante minutes qui se divisent en soixante secondes. À part notre année calendaire (qui est solaire et remonte aux Égyptiens via les Romains), nous comptons le temps comme les Babyloniens : rien de mythologique là-dedans. Comme quoi, si les mythes antiques ont vécu, le temps antique est toujours d'actualité.
Que penser donc de tout cela pour le sens de la vie selon les mythologies ?
Poursuivons avec ce qu'écrit Jacques Lacarrère :
Ainsi, les mythes décrivent-ils l'aventure de l'homme : façonné par un dieu mais rivé par sa faute à cette terre lourde et grossière, nanti d'une âme immortelle prisonnière d'un corps mortel, il lui faudra, pour retrouver la condition paradisiaque primitive, surmonter les épreuves dressées sur sa route, dont chacune le purifiera de ses éléments matériels : vaincre les dragons, savoir dominer ses passions et ne pas écouter les Sirènes, respecter les interdits, les secrets, et ne pas cueillir le fruit défendu ou enlever les troupeaux du Soleil. Ainsi seulement, en sachant se vaincre lui-même, l'homme pourra espérer vaincre également la mort et accéder à l'immortalité.
À l'origine, comme en Égypte, l'immortalité pouvait être réservée à une élite, c'est pourquoi il fallait se faire enterrer le plus près possible de la sépulture du pharaon pour profiter, comme par capillarité, de son immortalité. Par la suite, l'au-delà fut heureusement démocratisé. Chacun fut jugé selon ses mérites. La pesée du cœur donnait un sens moral à la mort et à la vie. Selon « Le livre des morts », l'après-vie, c'était soit le paradis, soit la dissolution dans le néant.
Pendant longtemps également, notamment chez les Akkadiens, les Sumériens et les Hébreux, les morts poursuivaient une vie latente, à la façon des ombres, au séjour des morts, le Shéol. Ni paradis, ni enfer, mais un lieu égalitaire d'un ennui mortel (!), aujourd'hui heureusement abandonné.
Pour en revenir encore à la mythologie grecque, les morts allaient dans l'Hadès où ils étaient dans le regret de leur vie sur terre. Par la suite, les poètes et les penseurs imaginèrent un autre au-delà où l'âme du mort va aux Enfers (et non en enfer). Le mort est jugé. Soit il va au gouffre du Tartare subir d'affreux supplices, avec démons et feu éternel, soit il va aux champs Élysées, vaste prairie remplie d'asphodèles.
Le paradis et l'enfer devaient par la suite faire florès, l'un pour réconforter les croyants, l'autre pour effrayer les incrédules, les deux pour répondre au scandale d'une vie où les justes souffrent et les méchants prospèrent. L'au-delà devait alors servir à rétablir la justice.
Moralité, quoi qu'il en soit : ne soyons pas mytho avec les mythologies. Pour le Tartare, n'en faisons pas tout un fromage, et qui a vu que les Champs-Élysées étaient remplis d'asphodèles, du moins à Paris ? Et, amis poissons, n'ayez pas peur du Léviathan, cet effroyable monstre marin mythologique mentionné dans la Bible et ailleurs : soyez rassurés, il n'existe pas !
Le sens de la vie ? On n'en sait guère plus, on a vu plus de mort que de vie, même des dieux qui maintenant sont morts, rien de concluant donc, alors ne concluons pas et continuons notre enquête avec les religions, telles que nous les connaissons. Les religions relèvent de la foi, même si la mythologie n'y est pas absente – ce que la plupart des croyants admettent.
Du reste, la mythologie est partout. Elle imprègne des romans, des films ou des jeux vidéo qui s'en inspirent : Superman et tous les super héros, la Guerre des étoiles, le Seigneur des anneaux, Game of Thrones, Harry Potter... Comme la fiction, la mythologie n'est pas la réalité. La vérité ultime a toujours semblé inaccessible à l'homme. Cela a pu lui donner l'idée d'une divinité, ou de plusieurs, la connaissant enfin.
À quoi croit-on ? Pourquoi croit-on ? Hier aux mythes, puis aux religions, aux idéologies, et maintenant aux théories du complot ? Nous verrons un peu de tout cela dans ce livre, mais que l'on soit croyant ou non, le doute n'est jamais à exclure. Raymond Devos nous le rappelle, avec une histoire tirée de son recueil « Matière à rire » :
Quand on demande aux gens d'observer le silence... au lieu de l'observer, [...] ils l'écoutent... et tête baissée, encore ! Ils ne risquent pas de le voir, le silence...! Parce que les gens redoutent le silence. Alors, dès que le silence se fait, les gens le meublent ! Quelqu'un dit :
— Tiens ? Un ange passe ! alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer ! [...] Lorsqu'un ange passe, je le vois ! Évidemment que je ne dis pas que je vois passer un ange parce qu'aussitôt, dans la salle, il y a un doute qui plane ! Je le vois planer, le doute !... [...]
— Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude ?
À son ombre ! L'ombre d'un doute, c'est bien connu...! Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe...! Il n'y a pas d'ombre sans doute ! Et l'on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres ! S'il y a cent ombres, il y a cent doutes. [...] Je ne sais pas comment vous convaincre ?! Je vous donnerais bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute ! Le doute... je vais le voir planer... Je vais dire :
— Je vois planer un doute.
Aussitôt, le silence va se faire... Quelqu'un va dire :
— Tiens ? Un ange passe !
Et il faudra tout recommencer !
Commençons plutôt à aborder le thème des religions ! Avec en guise d'introduction, une autre histoire, du même auteur et du même livre :
Je viens de lire sur un mur une chose étonnante. Quelqu'un avait écrit : « Jésus revient ». C'était écrit en toutes lettres : « Jésus revient ! » Vous vous rendez compte : Jésus ! C'est important ! Jésus ! C'est le ciel ! [...] Quand j'étais petit, on me parlait toujours du petit Jésus. Le petit Jésus ! Je vous voyais tout petit ! Et tout à coup, je découvre... un grand Seigneur !
Vous me voyez devant la porte de ma demeure, annonçant la nouvelle à travers le judas ?
— Devinez qui vient dîner ce soir ? Je vous le donne en mille : Jésus !
— Mais non !
— Mais si !
Vous voyez d'ici la scène (Cène). Il vaudrait peut-être mieux ne pas raviver la Passion !
Le sens de la vie et les religions
Si l'on mange du poisson le vendredi, on ira tous au paradis, là où les petits pois sont rouges
Amis poissons, il est temps maintenant d'abandonner les mythologies pour entrer pleinement dans le monde des religions actuelles. La frontière entre mythologies et religions est d'ailleurs assez floue. Pour simplifier, disons que les mythologies relèvent du passé auquel on ne croit plus, et que les religions relèvent du présent auquel certains croient. Mais c'est beaucoup simplifier, et ces définitions ont surtout pour but de nous permettre de traiter des religions actuelles à part. Quoi qu'il en soit, les religions font une suite logique aux mythologies. Ainsi, de nombreux dieux sont devenus des saints, et des églises ont été bâties là où s'élevaient des sites sacrés où l'on vénérait des dieux ou des esprits. La fête de Noël est nettement antérieure au christianisme, et le dimanche était le jour du Soleil avant d'être le jour du Seigneur. Des statues d'Apollon sont devenues celles de Jésus en bon Pasteur, portant un agneau sur les épaules. La liste serait longue si l'on y ajoutait les feux de la Saint-Jean, Pâques (Easter, en anglais, du nom d'une déesse célébrée au printemps), le 15-Août et d'autres dates déjà célébrées avant même que l'on commençât à parler du christianisme, et qui ont été recyclées pour les besoins de la cause.
Comme les mythologies, les religions sont multiples. Le mot même de religion recouvre des réalités différentes.
Si quelqu'un vous dit : « La religion est une doctrine qui affirme que nous sauverons notre âme en croyant à un sage et éternel Créateur de l'univers », c'est qu'il n'a pas assez lu ou voyagé. Dans de nombreuses cultures, on tient pour évident que les morts reviennent hanter les vivants, mais ce n'est pas universel. Dans bien des sociétés, on pense que certains individus peuvent communiquer avec les dieux ou les morts, mais cette idée n'est pas universelle. On estime souvent que les hommes ont une âme qui survit après la mort, mais cela non plus n'est pas universel. Avant de proposer une explication générale de la religion, il faut s'assurer qu'elle voit plus loin que le bout de son nez. Pascal Boyer, « Et l'homme créa les dieux »
Voilà qui est dit ! Gérald Messadié, l'auteur du célèbre roman controversé « L'homme qui devint dieu » a aussi écrit un livre tout aussi intéressant sur l'histoire de l'idée de Dieu, intitulé « Histoire générale de Dieu » :
Il n'y a jamais eu de civilisation sans dieux : le besoin de divinité est essentiel à l'être humain. Ce besoin a toutefois varié : il y a trentecinq mille ans, la divinité était exclusivement féminine. Les premiers dieux masculins sont apparus avec l'invention de l'agriculture, et ils ont longtemps partagé le pouvoir céleste avec les femmes. La première divinité a été la déesse de l'amour et de la fécondité, et le premier dieu masculin, celui de la guerre. C'est en Iran, il y a près de deux mille six cents ans, que le pouvoir divin a appartenu pour la première fois sans partage a un dieu masculin unique. Depuis, les monothéismes ont dominé la moitié du monde, rejetant unanimement la femme des grandes fonctions religieuses et sociales. [...] Ce besoin de divinité est fidèlement façonné par les civilisations : de Platon aux théologiens chrétiens, l'homme crée ses dieux selon son imaginaire, mais aussi selon son besoin de logique. [...] C'est la logique ellemême et son refus de l'absurde qui font que le besoin de Dieu est impérissable.
Qu'est donc la religion ? C'est, dit-on, ce qui relie l'homme au sacré. Outre ce sens de relier, une autre étymologie possible est recueillir, ou relire (l'enseignement de Dieu). La religion est une constante dans l'histoire de l'humanité qui révèle le besoin que peut ressentir l'homme d'une vie spirituelle, d'un lien avec l'au-delà qui le dépasse, d'une réponse à la question de savoir quelle est sa place dans le monde et pourquoi il vit. La religion, c'est aussi tout ce qui nous touche au cœur : la mort, le malheur, la morale, le sens de la vie. Contrairement aux mythes, la religion, cela fait plus sérieux, plus crédible. Des écrits et des dogmes sont en général d'ailleurs là pour la confirmer, et les croyants ne doivent pas se risquer à les contester. Il n'empêche que certains croyants des religions actuelles prêtent encore foi à des récits bibliques manifestement mythiques, comme, on l'a vu pour l'histoire de Jonas qui fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits.
D'où viennent donc les croyances ?
Une croyance, comme une superstition, peut naître d'une mauvaise interprétation d'un phénomène : si quelqu'un chante et qu'il pleut, il en conclut que le chant fait venir la pluie. Conclusion hâtive ! Le culte du cargo est ainsi né d'une telle conclusion : dans les îles du Pacifique, de la fin du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle, des aborigènes furent stupéfaits par tout ce qui venait par avion-cargo pour enrichir les Occidentaux installés sur place qui ne faisaient rien d'utile, comme travailler la terre par exemple. Si en plus les administrateurs coloniaux leur donnaient des vivres en cas de famine, cela encourageait leur foi dans le cargo. La Seconde Guerre mondiale développa le phénomène. Pour attirer sur eux la faveur divine, des aborigènes construisirent des pistes d'atterrissage, et des pseudocabines d'opérateur-radio pour demander des vivres au micro...
Une croyance, comme une superstition, peut naître de la peur face à ce que l'on ne comprend pas, dont la mort en premier lieu. À propos d'une croyance, on parle de l'esprit magique : c'est croire que le monde est habité par des volontés, que l'on peut au besoin infléchir par des sacrifices, alors que pour un esprit scientifique, le monde est régi par des lois qui sont immuables. À l'opposé de la peur, une croyance peut aussi être vue comme une espérance, notamment dans un au-delà, ou dans l'intervention d'un être surnaturel, ou de plusieurs. La croyance ‒ et donc la religion ‒ s'opposent alors à la vision matérialiste des athées selon laquelle il n'y a que la matière. Pour les croyants, il y a la matière, plus quelque chose d'autre ‒ ce peut être des esprits, un ou plusieurs dieux, une âme immortelle. Pour les incroyants, la peur de la mort, et le fait de prendre ses désirs pour des réalités sont donc à la base de la religion.
Croire s'oppose à savoir, comme la foi s'oppose à la connaissance, et la soumission à la raison. Foi et soumission constituent la religion. D'un point de vue scientifique, on peut dire que la religion est une création de notre cerveau, que des millénaires de processus évolutifs ont prédisposé à croire.
Ceux qui ne croient pas croient (quand même) que c'est simplement un manque d'esprit critique qu'il faudrait corriger.
Ceux qui croient croient (sans forcément coasser comme des grenouilles de bénitier) que la religion est la vérité qui explique, réconforte, fonde la morale et l'ordre social.