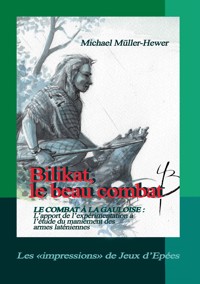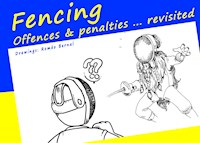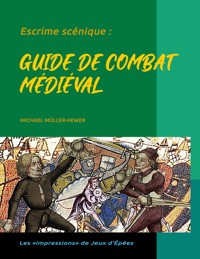
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Escrime scénique : Guide de combat médiéval" est un manuel conçu pour initier les pratiquants à l'utilisation du système liechtenauerien dans le cadre du combat scénique. Il propose une approche progressive, alliant des fondamentaux de la sécurité, les principes de la chorégraphie et les techniques de mise en scène, affin de recréer des affrontements dynamiques et crédibles tout en garantissant la protection des combattants et l'impact visuel recherché.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dédicace
Ce livre est dédié à la mémoire d'Alexandre Bourguignon, connu sous le nom de guerre de Ferrant III de Lanthenac, baron de Sept-Font.
Combattant féroce, fine lame, chorégraphe talentueux et metteur en scène hors pair, il nous a quittés à l'âge de 41 ans.
Précurseur dans la recherche sur les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE), reconstitueur chevronné et combattant médiéval d'une compétence inégalée, son souvenir demeure vivace.
Je tiens à remercier Céline et Christine pour l'effort considérable qu'elles ont fourni pour corriger et reformuler certaines idées qui n'étaient pas très claires ...
Sommaire
Avant tout
Préface
– Philippe Penguy
Acte 1 : L’histoire du combat
Art de combat au Moyen Age
Traités historiques
Le Jeux de la Hache
MS I.33 (manuscrit de Walpurgis)
Johannes Liechtenauer
Fiore Dei Liberi
Hans Talhoffer
Paul Hector Mair
Joachim Meyer
Escrime de taille ou d'estoc ?
Acte 2 : La Chorégraphie
L’espace scénique
Théâtre dit « à l’italienne »
Le théâtre grec
L’arène – le cirque – le Colisée
Le spectacle vivant (le spectacle de rue)
Combat chorégraphié ou combat scénarisé ?
Le combat scénarisé
Le combat chorégraphié
Création et répétition de la chorégraphie de combat
Mise en scènes des batailles
La chorégraphie d’un duel
La peur devant la non-action
Le rapport entre action et tension
Le point de suspension de l'action
La réalité martiale
Réalisme scénarisé et improvisation
Soldats et civils : deux réalités
Réalité martiale vs réalisme du combat
Que cherchent les spectateurs ?
Ce que le spectateur ne peut pas voir, ce qu'il peut voir et ce qu'il est prêt à voir.
Ce que le spectateur peut ou ne peut pas voir
Ce que le spectateur ne peut pas voir : l'exemple des lames
Ce que le spectateur peut voir et ce qui passe mal
La sécurité dans l’escrime scénique
Sécurité active et passive
Les distances
Comment définir la distance entre deux combattants ?
Comment arrêter un coup de taille ?
L’importance de l’angle naturel
L’objectif de l’attaque et l’utilité de l’allongement du bras à la fin d’un coup
Le coup d’estoc
Les esquives
Menacer son partenaire
Les désarmements
Les chutes
Des armes dites « sécurisées »
La construction d'un combat
Les cibles d’attaque
Les postures de garde
Les coups
La tactique du combat et son utilisation pour la chorégraphie
Comment s’approcher d’un adversaire ?
Le combat rapproché
La lutte
Exemples d’enchainements
Acte 3 : Quel arme pour le spectacle ?
L’épée dite médiévale
Caractéristiques générales de l’épée
Historique et évolution
Types d’épées médiévales
Comment tenir l’épée ?
Les épées en aluminium
Le maniement de l’épée
Les coups de taille de base
Le tranchant et le contre-tranchant, le plat et le faux plat
Résumé historique
Le grand bâton
Le bâton français
Le bâton à deux bouts
Le bouclier, quelques généralités de son utilisation
Formes et usages des boucliers
Comment tenir le bouclier
La position de combat avec un bouclier
Les sept positions élémentaires et les positions spéciales
Comment se battre avec un bouclier
Comment utiliser le bouclier en spectacle
Le bouclier de duel
Caractéristiques du bouclier de duel
Techniques et utilisation
Un usage réservé aux duels
Dans la chorégraphie
La hache noble (hache de guerre)
Quelques exemples du maniement de la hache par
Peter
Falkner
Les armes d hast
La lutte
Préparation
Position de base
Exemples d'actions adaptées à la chorégraphie
Intégration dans une chorégraphie
Le combat en armure
L'armure : une seconde peau
Les armes du chevalier en armure
Le déroulement des duels en armure
Le combat en armure dans les tournois
Acte 4 :
Annexes
Glossaire des termes allemands d’escrime médiévale
Sources et bibliographie
Liste des images
Avant tout
Lorsque, dans les années 1980, j'ai commencé à apprendre l'escrime de spectacle ou l'escrime ancienne à la Cité Universitaire de Paris avec Maître Heddle-Robot, que tout le monde appelait « Bob », notre connaissance du combat médiéval était encore rudimentaire. Les paroles de nos maîtres d'armes faisaient autorité, notre confiance en leurs connaissances était encore intacte.
L’image classique du chevalier, à l’époque, était celle d’une « grosse brute frappant tout ce qui bouge sans technique, avec des armes démesurément lourdes ». Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé à quel point les connaissances historiques de nos maîtres étaient souvent peu développées. Et ceux qui avaient accès aux quelques copies qui circulaient les gardaient jalousement. Mon vieux maître Bob ne faisait pas exception. Un jour, j'ai découvert dans sa bibliothèque personnelle la copie d'un manuscrit de Fiore dei Liberi datant de 1410.
En réalité, la plupart de nos professeurs de l’époque ne juraient que par un seul traité, qu’ils n’avaient souvent lu que superficiellement : « Schools and Masters of Fencing » d’Egerton Castle1, traduit par Albert Fierlants2 en 1888. Le livre commençait ainsi son premier chapitre : « Quelque paradoxal que cela paraisse, c'est l'invention des armes à feu qui fut la première cause du développement de l'art de l'escrime. L'histoire de l'escrime ne commence donc pas avant le XVe siècle. »
Cette hypothèse a été reprise par le maître d'armes Pierre Lacaze, ancien président de l'AAF, dans son livre Histoire de l'escrime3 (1971) et dans son livret populaire En garde4 (1991) : « Etant donné le poids des armes, la technique était fondée sur la puissance musculaire. Il n’y avait ni école, ni méthode. »
Aujourd’hui, nous savons que ce ne sont pas les armes à feu qui ont sonné le glas des armures et de la chevalerie, et qu’il existait bel et bien un art du combat avant le XVe siècle.
Telle était la situation à la fin des années 1980. Ces deux citations résument à elles seules les connaissances de l’époque sur le Moyen Âge, à quelques exceptions près. Pour nos scènes de combat, nous nous sommes donc naturellement tournés vers l’escrime moderne.
Un autre défi était l'acquisition des armes. Au début des années 1990, il y avait peu de fabricants d’épées médiévales adaptées au combat en Europe. J'avais entendu parler d'un fabricant anglais onéreux, de « Del Tin » en Italie, également cher, et notre salle d'armes entretenait de bonnes relations avec « France Lame », qui n'existe plus aujourd'hui. Une troupe de saltimbanques du Jura français, « Les Chevaliers du Franche-Comté », a commencé à se fabriquer des épées à partir de lames de ressort de camion.
Pour nos premières représentations médiévales, nous avons pu acquérir deux de leurs épées longues, pesant chacune 8 kg.
En 1991, j'étais acteur et cascadeur dans « La Chanson de Roland » à Avignon. Sans entrer dans les détails du déroulement catastrophique de cette pièce de théâtre, quelqu'un avait eu l’idée de faire fabriquer des épées et des boucliers en tôle d'acier dans des écoles professionnelles. Les épées étaient magnifiques, parfois bien équilibrées, pesaient environ 1,5 kilogrammes et étaient étonnamment résistantes. C'étaient jusqu'alors les meilleures épées médiévales que j'utilisais lors de mes représentations.
La situation n'a changé qu'à la fin des années 1990, lorsque des forgerons, principalement tchèques, ont commencé à produire des épées adaptées aux combats de spectacle à des prix abordables. Les lames étaient découpées dans des plaques d'acier, ce qui réduisait considérablement les coûts de production. C'est ainsi que j'ai payé l'équivalent de 350 € pour deux épées à une main et deux épées bâtardes chez Jiri Krondak. Ces armes ont survécu à des centaines d'heures d'entraînement dans les mains d'innombrables élèves. La technique de fabrication n’a guère évolué depuis.
Quelques tentatives sérieuses ont été faites pour mettre de l'ordre dans cette confusion. En 1996, Joël Geslan, directeur de la troupe Seigneur de Guerre, a fait circuler un manuel d'escrime, Le combat médiéval5. Bien qu'il s’appuyât sur l'escrime moderne, l'auteur y introduisait quelques expressions médiévales et expliquait le principe du coup de taille. Il offrait également un bon aperçu du combat asymétrique, c'est-à-dire du combat avec différentes armes.
À peu près à la même époque, le maître Jean-Luc Pommerolle rédigeait son Cours d'escrime médiévale6 qu’il distribuait lors de ses stages. Son approche était intéressante : pour lui, la notion de distance était fondamentale. Il classait les différentes techniques en quatre groupes de distance de combat distincts. Il expliquait également le principe de l'escrime de taille et plaçait l'escrime de parade-riposte à côté d'exemples tirés des premiers traités germaniques (Talhofer dans la traduction du capitaine Hergsell) et italiens (Fiore dei Liberi), une interprétation que je ne partage pas.
En 1998, l'Américain John Clements a publié Medieval Swordsmanship, Illustrated Methods and Techniques7. La revue française Histoire Médiévale et d'autres revues spécialisées en Europe ont publié plusieurs articles sur cet ouvrage, lançant pratiquement le mouvement des Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE). C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à travailler avec le maître Jan Fantys et que j'ai intégré l'École lémanique des armes anciennes (ELAA) à Lausanne en tant que maître d'armes. Jan s'était beaucoup investi pour développer une escrime médiévale à partir du traité de Talhoffer de 1459.
En 2002, grâce à une meilleure accessibilité d’Internet, j'ai trouvé une copie du traité de Joachim Meyer8, maître d’armes à Strasbourg, datant de 1600. De langue maternelle allemande, j’ai été surpris de pouvoir comprendre une grande partie du texte médiéval. J’y ai découvert un art de l’escrime simple, clair et efficace.
La même année, et pendant douze ans ensuite, j'ai donné des stages d'escrime scénique sur des bases historiques avec mon compagnon de longue date, le maître Philippe Penguy, à Paris. Nous nous sommes plongés dans les textes germaniques. Dès 2002, lors d’un premier week-end de stage médiéval, nous avons présenté des éléments de notre interprétation du traité.
Après un quart de siècle, notre connaissance de l'escrime médiévale s'est considérablement améliorée, notamment grâce à Internet. Les AMHE ont également évolué dans les domaines du sport et de la recherche historique. Ces avancées ont influencé ce qu’on appelle aujourd’hui « l’escrime artistique ». Cela ne signifie pas pour autant que les représentations de combats médiévaux sont aujourd'hui plus précises et plus proches de la réalité historique qu'il y a 20 ou 30 ans. Même si le chevalier « Grosse Brute » et son épée de 5 kg ont disparu de notre vision générale du Moyen Âge, nous n’avons pas encore réussi à nous affranchir des règles et des coutumes de l’escrime olympique dans nos chorégraphies. Mais est-ce grave ? Après tout, notre objectif n'est pas de créer des reconstitutions historiques.
Pour moi, témoin de ces découvertes et de ces changements, ce fut une période passionnante et pleine de surprises.
Un mot sur ce livre : il s'agit d'une tentative de partager mes quarante années d'expérience dans le domaine des combats scéniques et historiques. Je suis conscient que d'autres ont suivi des chemins différents, et que certaines de mes idées peuvent ne pas correspondre aux leurs. Cela ne me dérange pas, tant que nous pouvons échanger de manière constructive. L'échange et la coopération ont toujours été des valeurs fondamentales pour moi. Notre milieu n'est pas destiné aux solitaires ; pour créer un bon duel, il faut être deux.
Je ne peux conclure ces quelques pages sans rendre hommage au maître qui m'a marqué par son épée, Bob Heddle-Roboth, que j’ai suivi pendant 15 ans. Escrimeur hors pair, génie artistique, chorégraphe de combat intuitif et pédagogue innovant, c’était un tempérament bien trempé, toujours entouré de son harem d’admiratrices, les « Bobettes ». À la fois bienveillant et condescendant, il m’en a fait voir de toutes les couleurs, comme on dit. J’espère avoir pu perpétuer son oeuvre.
Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les autres maîtres d’armes avec qui j’ai eu le privilège de travailler et qui, chacun à leur manière, ont enrichi mon répertoire. Tout d’abord, Patrice Camboni, mon premier maître d’armes en France, et son coéquipier François Rostain, qui retrouvera dans ce livre certains concepts découverts grâce à lui. J’ai aussi eu la chance d’étudier avec Jean Promard, adepte de Tai Chi et grand connaisseur de la canne et du bâton, ainsi qu’avec Claude Carliez, qui m’a initié à l’escrime et aux cascades devant la caméra. En Allemagne, Eberhard Gäble, directeur de combat au studio Babelsberg à Berlin, m’a aidé à obtenir mon diplôme de maître d’armes.
Hommage aussi à mes amis et compagnons de route, avec qui j’ai partagé tant de moments inoubliables et construit une multitude de souvenirs : Philippe Penguy, Philippe Hélies, Nadine Gibouin, Évelyne Bonnevie, Florence Leguy, Catherine Robert, André Obadia, Jean-Pierre Maurin, Bernard Chabin, Rafael Beauville, Jan Fantys.
Et tant d’autres encore que j’ai croisés pendant ces quarante ans : coéquipiers de scène, partenaires de combat, et avant tout mes étudiants …
Chaque rencontre, chaque collaboration a laissé une empreinte indélébile sur mon parcours.
Michael Müller-Hewer
1 Schools and Masters of Fencing, Egerton Castle, London 1885
2 Escrime et les escrimeurs, Egerton Castle, Traduction A. Fierlants, Paris, 1888
3 L’Histoire de l’escrime, Pierre Lacaze, Editions Estienne 1971
4 En garde, Du duel à l’escrime, Pierre Lacaze, Découvertes Gallimard, 1991
5 Le Combat Médiéval, Joël Geslan, Autoédition 1996
6 Cours d’Escrime Médiévale, Jean-Luc Pommerolle, Autoédition 1996
7 Medieval Swordsmanship, Illustrated Methods and Techniques, John Clements, Paladin Press 1998
8 Gründliche Beschreibung der freien und ritterlichen Kunst des Fechtens, Joachim Meyer, Augsburg 1600
Préface
Il y a dans l’approche de Michal Muller-Hewer quelque chose de fondamental, et qui se démarque, il me semble, de tous les ouvrages sur le même sujet écrits jusqu’à présent. Certes, je n’ai peut-être pas tout lu à ce propos, aussi l’auteur que j’aurais oublié voudra bien me pardonner.
Ce quelque chose, c’est à la fois la connaissance de l’escrime de spectacle, de l’escrime ancienne, des traités historiques, de l’escrime moderne, et enfin du monde du spectacle vivant sous toutes ses formes. Ce n’est pas faire injure à ceux qui nous ont précédés que de dire qu’ils connaissaient seulement une partie de ces différents mondes. Et si par hasard certains maîtres connaissaient toutes ces composantes, ils n’ont tout simplement rien écrit sur le sujet.
En cela je trouve que le travail effectué par M. Muller-Hewer est novateur, et précieux. Il est en effet Maître d’Armes en escrime moderne, artistique, et en AMHE (Arts Martiaux Historiques Européens), comédien et chorégraphe de combats. Pour avoir partagé la scène en sa compagnie, organisé et coanimé des stages avec lui, je peux affirmer qu’il sait de quoi il parle. Dans son ouvrage, il compile ainsi son expérience, ses connaissances et ses réflexions, qui sont le fruit de plusieurs années d’analyse et de recherche sur l’escrime scénique.
Il nous a habitués à ses articles parfois sans concession, mais aussi à ses doutes et aux incertitudes sur « la vérité » d’un combat, graal toujours recherché, et à ma connaissance toujours pas trouvé. Tant mieux, la quête est le plus beau chemin, et le voyage souvent plus passionnant que le paysage que l’on découvre lorsque l’on arrive enfin au port.
Nous avons eu et nous avons peut-être encore des points d’accord et des controverses, et c’est le lot du sujet qui nous occupe et que je vous laisse découvrir sous sa plume. Ce que je sais, c’est que l’échange, la controverse, la discussion, les engueulades, la mise en pratique et l’expérimentation, épée en main, les divergences et les remises en question ont depuis plus de 40 ans fait énormément avancer la façon de considérer le combat scénique et l’escrime de spectacle, quelles que soient les armes utilisées et les époques représentées.
Philippe Penguy
Acte 1 L’histoire du combat
L’art de Combat au Moyen Âge
« Jeune chevalier, apprends
à aimer Dieu et tiens les femmes en estime,
ainsi croîtra ton honneur.
Pratique la chevalerie et apprends
l’art qui te dignifie
et te mènera à l’honneur dans la guerre.
Sois bon à la lutte,
manie la lance, l’épée et le couteau de manière virile
et détrompes-les dans les mains de ton ennemi … »
Johannes Liechtenauer9
Depuis quelques années, nous assistons à la renaissance des arts martiaux historiques européens (AMHE). Le grand public découvre avec surprise une richesse d’armes et de techniques de combats. Nous pouvons dire avec fierté que notre passé de combattant n’a rien à envier à celui des samouraïs japonais et des moines Shaolins.
En 1995 encore, le chercheur en arts martiaux était obligé de passer des heures dans les diverses bibliothèques afin de dénicher des traités historiques, souvent très usés et donc fragiles, rédigés dans des langues anciennes, connues des seuls spécialistes. Cette recherche était réservée aux professionnels. L’amateur avait seulement accès à quelques rares dessins, gravures ou reproductions qui, jalousement gardés, circulaient entre maîtres d’armes et spécialistes.
Un grand pas vers la vulgarisation a été franchi en 1998 avec la reproduction de Talhoffers Fechtbuch10de 1467 en paperback. Ce livre a permis de découvrir, par des dessins très détaillés, les actions du combat au XVe siècle. Faute d’explications précises, chacun a interprété ces dessins et le résultat fut l’apparition d’une multitude de systèmes d’escrime dits médiévaux, souvent fondés sur l’escrime moderne. Ces derniers ont fait la joie des groupes d’animations des fêtes médiévales et de leurs spectateurs mais heureusement cette période est révolue.
En effet, c’est paradoxalement la généralisation d'un bon accès à Internet au début du XXIe siècle qui permet aujourd’hui à tous d’effectuer des recherches sur l’art du combat des siècles derniers. Sur le Net, tout amateur intéressé par les recherches sur les techniques européennes du combat peut maintenant trouver les traités historiques majeurs, en version originale ou en transcription. De plus, ces ouvrages sont généralement traduits dans une langue d’usage courant. La quantité d’informations accessibles à tous est écrasante. Divers groupes de discussion débattent de l’interprétation, de l’entraînement, des armes et échangent de multiples informations, tout en les mettant à l’épreuve.
Nous sommes dans un domaine en permanente évolution. Certaines « vérités » d’aujourd’hui seront remises en question par des informations provenant d’études approfondies ou l’apparition de nouveaux traités historiques. Les maîtres d’armes et entraîneurs sont obligés de remettre régulièrement leurs connaissances à niveau afin d’intégrer les nouvelles données, ce qui peut être douloureux, car ils sont parfois contraints d’abandonner des idées qui leur sont chères.
Le combat médiéval n'est pas seulement un sujet de recherches pour les clubs AMHE, mais également pour beaucoup de compagnies et troupes de spectacle. Les grands combats entre chevaliers et brigands sont l’une des attractions des marchés médiévaux et des fêtes historiques. Malgré l’évolution importante des connaissances sur les arts martiaux historiques européens durant ces 20 dernières années, le niveau de ces combats évolue peu et cela ne semble pas changer. En règle générale, il s’agit d'escrime moderne adaptée à des épées à une ou deux mains, les armes d’hast étant souvent utilisées comme un bâton français, ce qui n’est pas gênant en soi quand le spectacle est de qualité.
L’évolution de l’escrime scénique11 des 25 dernières années nous a habitué à croire que le combat était le moment le plus important d’un spectacle, or c’est une erreur. Historiquement, les affrontements et les combats ont toujours été au service de quelque chose de plus grand, comme dans notre cas, le personnage joué, le scénario, le script ou l’histoire racontée. Un combat qui ne sert pas une histoire n’est qu’un combat vide de sens, réduit à des prouesses techniques, de vitesse ou de dextérité. En revanche, quel régal pour le spectateur quand les personnages, sous le stress du combat, dévoilent leurs vrais visages et que le plus rusé terrasse le géant ou lorsque l’issue du combat surprend le spectateur, donnant du sens à une histoire ou déclenchant, comme chez Shakespeare, des intrigues.
Dans ce contexte, peu n’importe que l’on utilise de l’escrime moderne ou les dernières découvertes des AMHE, il faut soigner la scène de combat. Lors d’un combat, peu importe si ce dernier est réel ou scénique, l’improvisation n’a pas sa place. Duels singuliers ou bataille, devant un public ils doivent tous deux être chorégraphiés.
Une grande question se pose : L’escrime médiévale est-elle utilisable pour le spectacle ? La gestuelle et quelques principes faciles à reproduire, me font répondre oui, mais personne ne nous y oblige et c’est là la liberté du spectacle.
Aujourd’hui encore, le grand public ne différencie pas escrime moderne et combat médiéval. La seule chose qui compte, c’est l’histoire que nous racontons.
Dans ce livre, j'ai voulu donner quelques indications aux amateurs et professionnels de spectacle qui voudraient utiliser les techniques de combat médiéval pour enrichir leurs chorégraphies. Je vais essayer de faire l’état de la recherche pour clarifier cette jungle d’informations. Vous trouverez notamment une liste des traités principaux, à mon avis utilisable pour l’escrime scénique, des descriptions des armes, mon explication du système de combat de l’époque ainsi qu’un glossaire des principaux termes utilisés dans les traités.
9 Daniel Jaquet, Combattre su Moyen Âge, New York 2017
10 Talhoffers Fechtbuch, VS-Books 1998
11