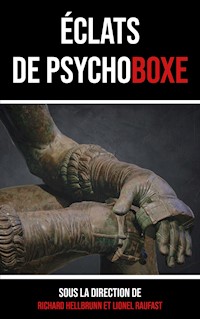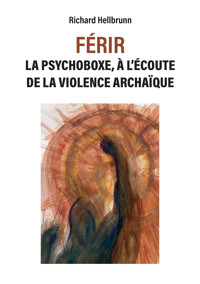
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Richard Hellbrunn a fondé la psychoboxe, qu'il a pratiquée depuis quarante-cinq ans, à l'écoute de celles et ceux qui ont accepté de mettre en travail leur rapport à la violence. La psychoboxe a pour but de permettre à un sujet, à travers ses gestes, ses affects et ses représentations de remettre en jeu l'universalité des processus et la singularité des positions qui émergent de sa confrontation à ce qui lui est violence dans son corps, sa parole et ses actes.
Ce livre s’adresse essentiellement à celles et ceux qui ont accepté de s’engager dans une réelle pratique concernant les questions que la violence ne cesse de poser aux humains.
Il témoigne de la nécessité, toujours insuffisante, de penser la pratique, et ceci malgré la complexité de l’entreprise, afin de réduire un peu le risque de développer une violence seconde, née de la simplification qui accompagne toujours l’illusion de son éradication.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
Publishroom Factory
www.publishroom.com
ISBN : 978-2-38713-014-3
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Richard Hellbrunn
FÉRIR
La psychoboxe à l’écoute de la violence archaïque
L’illustration de la couverture a été réalisée par Sylvain MARNOT-HOUDAYER
« Qu’est-ce qu’un geste ? Un geste de menace, par exemple, n’est pas un coup qui s’interrompt. C’est bel et bien quelque chose qui est fait pour s’arrêter et se suspendre.
Je le pousserai peut-être jusqu’au bout après, mais en tant que geste de menace, il s’inscrit en arrière.
Cette temporalité très particulière, que j’ai définie par le terme d’arrêt, et qui crée derrière elle sa signification, c’est elle qui fait la distinction du geste et de l’acte. »
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XI, Seuil, 1973, p. 106.
Sommaire
Avant-propos
Après quarante cinq années de pratique soutenue de psychoboxe, mais aussi d’interventions diverses et variées généralement centrées sur la problématique de la violence, il m’a semblé nécessaire de m’adresser à ceux qui ont bien voulu m’accompagner sur cette voie étrange et semée d’embûches, avec le projet complexe de tenter de transmettre : les quelques avancées que l’expérience a fini par autoriser sur la question, mais peut-être aussi une part de l’incontournable malaise qui accompagne ceux qui essaient tant bien que mal de maintenir ouverte la question que la violence pose à ceux qui la vivent. Le praticien trouvera sans doute ici quelques réflexions pour orienter son parcours, mais peut-être aussi, plus largement, le lecteur intéressé par l’insistance en l’humain de la problématique d’une violence impossible à éradiquer. Comment faire, avec la violence ?
Toute cette pratique n’a pas été sans s’appuyer sur un certain nombre de concepts puisés dans le champ de la psychanalyse, pour l’essentiel, et parfois de la polémologie. Ils ont été revisités par mon approche particulière ; j’aborderai aussi quelques notions nouvelles amenées par la pratique : le débordement, l’image du corps d’action, l’appareil d’emprise, la plasticité de l’image du corps, qui viennent éclairer une clinique gestuelle du sujet en situations.
La psychoboxe, par son propre mouvement, oblige à repenser en permanence le rapport entre violence et subjectivité, afin de ne pas se figer en une technique dont l’efficacité même viendrait sceller la fin en la noyant dans son objet. La question qui nous revient, et qui distingue ici le psychanalyste du chamane, est bien de tenter de savoir d’où cette pratique tire son efficience, empiriquement constatée, comme s’il était culturellement impossible de nous satisfaire d’un résultat sans l’interroger, sans l’inscrire dans un champ de savoir préétabli, d’où, seulement, il pourrait tirer quelque droit à l’existence. Mais nous savons aussi que l’élaboration ainsi produite ne saurait métaboliser son objet sans produire de reste : tout ne peut pas être dit, quant au rapport complexe que nous nouons avec la violence ! Cette part obscure qui résiste à l’élaboration, immanquablement présente dans l’humain, nous oblige à spéculer par la pensée, avec les moyens du bord, pour tenter de comprendre comment ce qui nous semble tellement inhumain, et donc de ce fait extérieur à nous, peut soudain nous habiter à ce point, comme si une brusque condensation d’objets violents non identifiés formait une sorte de corps étranger, nimbé d’un halo d’étrange familiarité, qui permet enfin à un malaise diffus de se représenter. Pour tenter d’y voir plus clair j’essaierai, à la fin du livre, d’aborder les rapports complexes entre ce que j’appelle la « violence archaïque » et la pulsion de mort. Pour introduire notre cheminement, il me paraît essentiel de montrer que les approches simplement réactionnelles à la violence, qui nous offrent généreusement de grandes économies de pensée, ne font généralement que la prolonger par d’autres moyens. Le seul moyen d’aborder cette question avec un certain succès serait donc de ne pas céder sur sa complexité en suscitant, dès que possible, un espace de pensée au cœur de notre psychisme, et en tentant de le maintenir transversalement au travail sur et autour de la violence. Je vais donc commencer par dire ce que j’entends par « violence », en donnant également une définition la plus claire possible du « sujet » qu’elle habite. Mais il sera également question du corps, jamais absent de la violence, qu’il en soit le support, le vecteur ou la cible, dans une expression réelle ou fantasmée. Ce corps est-il ici celui du guerrier, du sportif, celui de la médecine ? Ou celui de la psychanalyse, qui aurait fini par se lever, pour mieux faire face à la violence ?
Je ne saurais donner à toutes ces questions le développement qu’elles méritent dans le cadre de cet ouvrage, de portée beaucoup plus modeste, mais il me semble indispensable au moins de les esquisser par respect pour tous ceux qui pensent un travail dynamique de la violence dans une autre perspective culturelle, anthropologique, technique, que la nôtre, à laquelle je vais maintenant donner toute sa place.
1. AUX SUJETS DE LA VIOLENCE
Définir la violence ne saurait aller de soi, et nous confronte d’emblée à une difficulté et à un malaise, que les débats actuels sur la question nous présentent dans une intrication qui constitue un véritable défi à notre capacité de discernement.
La difficulté tient, pour l’essentiel, à l’impossibilité de traiter de la violence sans y mêler notre opinion sur la violence. Dès lors, aucune définition de la violence ne saurait échapper à la contamination par son objet.
Le malaise, quant à lui, procède du pouvoir spécifique à la violence – qu’il s’agisse d’un discours ou d’une manifestation – de convoquer le sujet en tant que tel sur la scène qui met en jeu son rapport à la parole.
Pas de violence, donc, hors sujet !
Nous ne saurions alors penser la violence sans un positionnement précis sur la théorie du sujet.
Commençons par le détour de cette traduction d’un poème de Hölderlin, suivie d’un commentaire de Martin Heidegger :
« Puisqu’il faut que sous la Mesure
De la violence même
Le Pur sache l’usage
Pour avoir de soi connaissance. »1
« La violence ne s’ajoute pas à ce qui est pur comme quelque chose de plus. Ce qui est pur n’a pas besoin de la violence. Mais, en revanche, que ce qui est pur se manifeste à soi-même comme le pur, et partant, comme l’Autre de la violence, qu’à ce moment seulement il soit en tant que lui-même, cela exige bien de la violence. (…) » Plus loin :
« Le pur même ne peut être en tant que pur que dans la mesure où il fait entrer la violence jusqu’à lui, dans la proximité de son être, et qu’il la garde là. »2
Cette opposition entre la violence et ce qui a besoin d’elle pour se prétendre son autre, au prix quelquefois d’un inquiétant clivage ou d’une effrayante forclusion, est familier à ceux que cette question met en travail. Tous les discours courants actuels se repaissent de l’inhumanité prêtée aux sujets dits violents, qu’ils soient considérés comme définitivement habités ou seulement occasionnellement traversés par cette violence que les autres tentent d’éradiquer pour le plus grand bien d’une humanité dont ils seraient à la fois les porte-parole exclusifs et les garants autoproclamés de son évolution. Cette violence seconde, qui avance sous les oripeaux d’une morale plus ou moins laïcisée par la science, ne peut prospérer comme elle le fait qu’en parasitant une violence archaïque tout en se nourrissant de la promesse illusoire de pouvoir un jour s’en séparer sans reste. A écouter fermement le sujet de la violence, nous savons que cette promesse est mensongère.
Il nous revient alors d’interroger sans relâche le fragment d’inhumanité dans l’humanité comme étant paradoxalement constitutif, en propre, de l’humain.
Ceci nous ramène à notre étonnement premier devant cette traduction d’Aloys Becker et de Gérard Grauel du poème de Hölderlin cité plus haut, dont voici la version originale :
“Denn unter dem Masse
des Rohen brauchet es auch
Damit das Reine sich kenne.”3
Roh veut dire : cru, brut, fruste, non travaillé, brutal, rude, grossier, inculte. Il n’est donc pas question ici, à proprement parler, de violence : Gewalt. Il arrive cependant que les deux termes soient associés : mit roher Gewalt : brutalement. Le « Rein », quant à lui, s’oppose bien au « Roh » : pur, sans mélange, net, parfait, sans défaut, innocent, propre. L’opération de passage de l’un à l’autre pourrait donc être un nettoyage, une purification par filtrage, décantation, distillation, ou un polissage de bois brut, une écriture « au propre ». Le rapport entre ces deux termes est donc celui d’une continuité sans rupture, d’une transformation, comme celle qui va du gros œuvre à une maison achevée, ce qui modifie notre première lecture qui pouvait tendre à cliver radicalement « la violence » du « pur ». Nous aurions pu traduire :
Car sous la Mesure
Le Brut est utile
Afin que le Pur se connaisse.
Si les traducteurs ont opté pour la violence, c’est peut-être pour rendre au brut son étymologie sanglante, référée au cru. Et le cru, en l’humain, c’est la cruauté : au commencement était le sang. La violence ici mentionnée est donc celle d’un Brut, posé comme violence originaire, archaïque, mal dégrossie, mais irrémédiablement co-constitutive du Pur, qui ne doit son existence qu’à son étayage sur elle.
Mais reprenons ici notre quête d’une définition, à partir du constat d’un malaise qu’il convient peut-être, pour le rendre pensable, de supporter, comme le dit Heidegger, de « le faire entrer jusqu’à nous, dans la proximité de notre être, et de le garder là. »
Celui-ci procède pour partie d’une confrontation permanente à des traits d’indignation morale, chargés d’une intention magique visant à dissoudre l’objet qui se trouve dès son émergence frappé d’un interdit de pensée. Des doses massives d’affects sont généralement employées comme autant de dissolvants. Force nous est alors de répondre par cette simple assertion :
« Et pourtant, il y en a ! » S’ouvre alors une opposition stérile, répétitive, parfaite illustration de la pulsion de mort pour ceux qui souffrent à cette place d’un manque d’étayage clinique :
Le débat, lourdement chargé, entre les « pour » et les « contre », qui montre combien il est toujours encore question du mal, à travers ce que nous appelons violence.
Clément Rosset nous livre à ce propos une pensée sans ambiguïté :
« La disqualification pour raisons d’ordre moral permet ainsi d’éviter tout effort d’intelligence de l’objet disqualifié, en sorte qu’un jugement moral traduit toujours un refus d’analyser et je dirais même un refus de penser, ce qui fait du moralisme en général moins l’effet d’un sentiment exalté du bien et du mal que celui d’une simple paresse intellectuelle. »4
Il est donc difficile de penser la violence, si l’on confie à la morale le soin d’établir une Mesure, dont le franchissement serait synonyme de violence.
La morale est elle-même violence, excès, démesure. Il est nécessaire de nous en distancier, si nous voulons préserver notre intelligence, déjà mise à mal par la confrontation à la violence brute. Les attaques contre la pensée en matière de violence se font généralement en deux temps difficiles à démêler tant pour les « auteurs » que pour les « victimes » : un premier effet de sidération lié à la scène réelle, un deuxième effet lié à l’intervention humaine de ceux qui, n’ayant pas vécu la scène, font tout pour qu’elle s’efface au plus vite, quitte à sacrifier le témoignage de ceux qui ne pourraient pourtant traverser cette épreuve qu’en passant par la parole.
Ces derniers se confrontent alors à une triple problématique :
- eux-mêmes ont du mal à mettre en mots ce qui, à partir de la scène violente, maltraite les limites du sujet et celles de son extériorité.
- les autres résistent à les écouter, voire leur imposent le silence.
- notre espace culturel semble étrangement fermé à cette question, ce qui n’apparaît au sujet qu’à partir du moment où le réel de la confrontation lui impose la charge d’un questionnement dont il n’a pas choisi le moment, et dont, surtout, il était loin de soupçonner l’abîme.
Violence ! Et pourtant le mot existe. Nous pourrions même dire qu’il fait partie des mots qui insistent dans leur lointain appel à être enfin entendus et pensés. Il remonte à la « vis » romaine, à cette force en action, qui n’est sans doute pas étrangère à la « virilité », et qui se manifeste tout d’abord dans l’espace politique sous le double aspect d’une armée disciplinée et de celui d’une échappée tumultueuse. Dès l’origine, se pose donc la question de l’usage et du contrôle de cette force, la violence apparaissant du côté de son excès, puisque le latin « violentus » désigne un caractère emporté concernant une personne, et une notion d’impétuosité concernant les éléments, comme ceux qui se déchaînent dans une tempête. La violence est donc ici un débordement de la force, soit parce qu’elle est trop chargée de puissance, soit parce que manquent les contenants culturels, institutionnels, ou individuels pour en assurer le contrôle. Avant de mener plus avant un questionnement sur ce que serait une bonne définition, il conviendrait de s’arrêter à celles qui, courantes et implicites, participent confusément et complaisamment aux processus qu’elles prétendent mettre en ordre par la mise en branle de tout un système de représentations auxquelles nul ne peut prétendre échapper.
Les représentations les plus courantes en matière de violence se réfèrent ainsi à la loi, dans un Etat de droit, ne désignant sous le nom de violence que les effets d’une force qui serait d’emblée illégitime ou dont l’excès seul serait de nature à outrepasser les limites posées par le cadre de la loi. Ainsi pourront se côtoyer sous le même vocable les violences subversives produites par des émeutiers, et celles liées à l’enthousiasme de sa répression, pour peu que cette dernière ne rechignât pas à se laisser aller à quelques débordements. Une autre représentation voisine est celle qui fleurit sur le couple d’opposition : ordre – subversion, la question centrale étant ici le pouvoir. Nous pouvons ainsi rencontrer diverses figures qui emblématisent la violence :
Un coup d’état militaire supprime une légitimité antérieure en conjuguant la soif du pouvoir et la passion de l’ordre dont ses auteurs se posent comme étant le dernier recours.
Une subversion légitime se lève, désignée comme étant terroriste par ceux qui la combattent. Chaque protagoniste fixe l’origine de la violence chez son ennemi. Le vainqueur écrira l’histoire à son avantage.
Un terroriste dépose une bombe dans la paix d’une démocratie parée de toutes les vertus. La situation est mûre pour une manifestation « contre » la violence, pendant que le terroriste monopolise la faveur des médias.
Dans tous ces cas de figures, le pouvoir est tenu de se manifester, de se taire ou de communiquer, d’agir ou d’attendre des jours meilleurs. Qu’il soit ou non présent dans le projet de ceux qui agissent ou du moins dans leurs représentations, il ne peut pas se permettre de s’en désintéresser. En matière de violence, il est responsable au sens où il est tenu de répondre, même – et surtout – lorsqu’il n’a rien à dire, et qu’il ne sait pas quoi faire.
Les logiques du pouvoir sont aussi à l’œuvre dans toutes les pratiques de soins qui prétendent traiter de la violence à partir d’une pathologie de l’agressivité. Il s’agit alors de pouvoir s’appuyer sur un champ repérable de savoir pour légitimer ses pratiques institutionnelles et techniques, les tenants de ce savoir acceptant notamment de générer des normes de comportement. Cette position « scientifique » n’est pas très éloignée de la morale dont nous parlions plus haut : la même économie de pensée est ici réalisée.
La localisation du siège de l’agressivité dans telle ou telle zone du système limbique peut induire maint passage à l’acte thérapeutique justifié par l’évidence d’une adéquation entre l’adaptation à une norme culturellement admise et la supposée bonne santé psychique du sujet désigné avec succès comme étant agressif à l’excès. Les pires pratiques comportementales trouvent ainsi à se vendre sous couvert d’efficacité, à partir d’un mode de raisonnement propre à séduire plus d’un gestionnaire de l’humain.
Le pouvoir, je l’ai dit, est convoqué par la violence, et ne peut éviter de la traiter.
D’une certaine manière elle l’interroge quant à son origine sanglante : images crues du pouvoir brut, souvent oubliées dans les livres d’histoire.
Mais faut-il pour autant réduire la dimension de la violence à son instrumentalisation par le pouvoir, quitte à promouvoir ensuite un modèle de société qui échapperait, idéalement, à toute violence, définitivement bannie ?
Ou faut-il, au contraire, poser la violence comme une donnée incontournable de l’humain, toujours présente sous une forme ou une autre, définitivement transversale aux sujets, aux groupes, aux institutions et ceci quelle que soit la culture considérée ? Il nous resterait alors à supporter, dans les différents registres énoncés, la charge de travail à la fois permanente et occasionnelle liée à cette question.
Ce n’est qu’en réalisant le deuil de son éradication qu’il devient possible d’entendre quelque chose à la violence, de là où elle nous met en travail, bien plus que nous ne sommes capables de la contrôler. Il nous appartient de cultiver en nous une aptitude à « la faire entrer en nous, dans la proximité de notre être », dans un mouvement d’accueil, assumé comme tel, d’un dehors vers un dedans, où nous aurons alors la force de reconnaître qu’elle se tenait déjà, avant de songer à humaniser ce que nous fantasmons comme nous demeurant extérieur.
Cette attitude suppose un retour à la dimension du sujet, qui apparaît dans sa singularité par la rupture qu’il produit avec la culture qui le fonde ce qui, du coup, l’installe dans ce que Lacan appelle une « structure de méconnaissance » par rapport à ses propres conditions de possibilité.
Partons de cette définition de B. Ogilvie5 :
« La constitution du psychisme individuel se produit dans une méconnaissance radicale du processus objectif qui sous-tend le développement de son espèce, lequel est lui-même dans un rapport négatif avec son substrat biologique : la carence instinctuelle laisse libre cours à la relation sociale et culturelle qui vient jouer un rôle auquel suffisent chez toutes les autres espèces les déterminations biologiques et qui est appréhendé par le sujet comme une contrainte extérieure. Nature, culture, subjectivité : c’est en pensant la négativité qui les relie sous la forme de leur séparation que l’on confère au psychisme une dimension propre. »
La première rupture subjective à laquelle nous sommes inévitablement confrontés en matière de violence est celle qui arrache le sujet aux régulations du vivant ordonnées par la nature.
En stigmatisant tel criminel du côté de la monstruosité, nous l’utilisons comme un écran projectif contre-nature, qui se veut révélateur de notre position idéalement conforme à l’ordre naturel, mais nous le désignons, simultanément et sans aucun égard pour la logique formelle, comme le « chaînon manquant » d’une nature perdue, qu’il aurait manifesté par un trait de violence brutale, étrangement, paradoxalement, et néanmoins constamment référée au monde animal. C’est que la violence nous sépare, par son excès, de la nature, laquelle ne peut être fantasmée, au-delà de ses représentations qui doivent tout à la culture, que parce que précisément elle nous échappe. Et c’est seulement parce que la violence, par son effraction, déchire le voile de la culture, que nous imaginons pouvoir célébrer de plus vieilles retrouvailles : l’illusion de tenir par un bout le lien perdu. L’homme peut enfin se soulager du poids de son psychisme qui ne peut que le rendre foncièrement psychopathe en le poussant à devenir un loup pour l’homme, oubliant que seul l’homme est un « loup-pour », les loups réels demeurant des « loups-contre » : sauvages, ils résistent à la projection anthropomorphe et continuent à vivre, sans rien nous demander. C’est ce manque de réciprocité qui a causé leur extermination. Ils ont été doublement victimes de notre férocité : par la destruction réelle dont ils ont fait l’objet, et par la projection préalable qui en est la cause. L’homme a fait preuve à leur égard, en les traitant à la fois comme ses « autres » et comme ses semblables, d’une méta-sauvagerie dont la folle économie consiste à déposer dans une nature mythifiée un refus de penser la rupture entre nature et sujet dans l’humain. La violence ainsi produite est déposée dans son objet, qui en devient l’origine et la cause. C’est en tant que « loups » que nous serions féroces à l’égard de nos semblables, ce qui permet de fantasmer une humanité purifiée de toute violence, et c’est au nom de cette purification que nous nous autorisons à exterminer les loups.
Folie des hommes de ne pouvoir assumer leur identité qu’en passant par l’autre : « Je suis semblable à celui qu’en le reconnaissant comme homme, je fonde à me reconnaître comme tel. »6
« Quoi qu’il en soit, l’idée chez l’homme d’un monde uni à lui par un rapport harmonieux laisse deviner sa base dans l’anthropomorphisme du mythe de la nature ; à mesure que s’accomplit l’effort qu’anime cette idée, la réalité de cette base se révèle dans cette toujours plus vaste subversion de la nature qu’est l’hominisation de la planète : la « nature » de l’homme, c’est sa relation à l’homme » , nous dit Lacan.7
C’est la culture, portée par le langage, qui prend le relai des contenants naturels, mais elle le fait en toute méconnaissance de cause de la part du sujet, qui n’émerge que par la négativité.
Le sujet est « contre-tenu » par la culture.
Les discours qui traitent de la violence ne cessent, sans le savoir, de graviter autour d’une définition du sujet, pour autant qu’ils en stigmatisent les effets de rupture :
- du côté de l’ensauvagement, en ce qui concerne la nature et la culture.
- du coté du crime et de la subversion, de la répression et de la passion de l’ordre, de la fondation et de la maintenance quant à ce qui manifeste la rupture entre le sujet et la culture dont il n’émerge qu’au prix d’une étrangeté assumée.
Ce n’est qu’après avoir intégré cette contribution essentielle de la psychanalyse à une pensée de la modernité qu’il devient envisageable de poursuivre notre recherche d’une définition de la violence, en acceptant d’en décliner un peu plus les formes et les effets.
De mon point de vue, les discours qui posent la violence comme étant uniquement déterminée par le franchissement des limites définies par le droit, courent le risque de s’enfermer dans une boucle tautologique : le droit interdit la violence, donc la violence est ce qui est interdit par le droit, donc n’est violence que ce qui est prévu par le droit. Il y a là de quoi plonger plus d’un pervers dans une jouissance sans bornes tellement il peut épuiser ses victimes en les soumettant à un débat incessant entre un fond jamais atteint, qui se dérobe pour laisser le sujet au désespoir d’un abîme innommable, et des formalités harcelantes qui se jouent du droit, retourné contre la victime qui tente encore d’y croire. Le droit est une nécessité dans un Etat de droit, mais il est loin d’être suffisant à saisir la violence dans toutes ses dynamiques. Il ne fait que fixer pour un temps les modalités de son exercice.
Les discours qui traitent la violence comme d’un excès d’agressivité ne la définissent pas davantage, et ne font que réglementer une production de normes sociales, attendues par le pouvoir, depuis la séparation entre l’Eglise et l’Etat. La laïcité a besoin de la science comme d’un nouvel appareil de croyance. La violence est transversale à toutes ces définitions qui dessinent les contours des dispositifs appelés, non sans violence déniée, à la traiter chez ceux qui d’être auteurs désignés, sont supposés en être la seule origine.
Je préfère pour ma part me référer à un trait de destruction, spécifique à l’humanité, et à peu près constant dans son histoire, qui ne parvient à s’épuiser ni dans les attaques bouclées dans sa propre espèce, ni dans les atteintes portées par la technique à la nature qui encore la contient.
Cette destruction se manifeste réellement par les prolongements corporels ouverts par la technique, dont la guerre moderne apporte des possibilités nouvelles dont nous sommes loin de mesurer toute la portée : nous pouvons désormais détruire sans engagement corporel, donc étymologiquement sans agressivité, puisqu’il n’est plus nécessaire de marcher pour répandre le sang, et nous ne sommes plus éclaboussés par la proximité de nos victimes ; notre bras ne risque plus de retomber de fatigue après un massacre, enfin frappé de déni au moment même où il se réalise.
La destruction, loin d’être contenue par un retrait du geste, donnant ainsi à entendre qu’elle ne trouverait son origine que dans les débordements de notre enveloppe corporelle, traverse aussi les effets de parole. Elle est présente dans ces mots qui traversent des enfants promis au sacrifice par des parents qui trouvent ainsi de quoi survivre psychiquement ; elle est particulièrement élaborée dans les pratiques de sorcellerie, expertes en déplacements et en économie de la violence interstitielle de la paix sociale ; dans la propagande de haine que le docteur Goebbels a su porter à des sommets jusque là inégalés, en parfaite synergie avec les plus récentes avancées de la technique : micro, caméra, puis chambres à gaz comme ultime étape d’un management sans faille.
La destruction symbolique insiste dans la production de ces déferlements d’agressions verbales qui débordent la capacité de gestion des institutions du droit, et qui sont libérées par l’Etat des régulations claniques et familiales de l’honneur : les injures répètent le manque de contenants culturels, et crient la perte du respect, comme incapacité à poser le regard sur l’autre. Elle s’étaye également sur les nouvelles contraintes économiques qui fleurissent sur la faillite du politique, en développant des manipulations diverses, du harcèlement dit moral, des conduites poussant à la dépression, voire au suicide, par un véritable travail de sape dont l’objet est de siphonner le narcissisme de l’autre, et qui n’ignore aucune ficelle pour le plonger dans une mort suffisamment différée pour ne pas laisser de traces.
Les attaques réelles, de la gifle au missile, s’intriquent et se désintriquent aux atteintes symboliques, dans des rapports alternés d’articulation, de préparation, d’accompagnement, de prolongement, ou de déliaison, quelquefois de substitution.
Pour conclure, je définirai la violence comme étant la projection d’une force sauvage, qui occasionne des effets de destruction variables selon le choix de ses objets couplé aux modalités de son exécution.
La violence n’est jamais hors sujet, pour autant que son jaillissement ne fait jamais qu’en révéler la structure, et que sa définition même ne saurait être que subjective, à savoir le produit d’une interprétation qui correspond dans la dimension intrapsychique à une trace indélébile de débordement.
1 Martin HEIDEGGER, Qu’appelle-t-on penser ?, PUF, 1959, p. 182.
2Op. cit., p. 182.
3 HOLDERLIN, Die Titanen in Gedichte. Reclam, p. 187.
4 Clément ROSSET, Le Démon de la Tautologie, Editions de Minuit, 1997, p. 68.
5 Bertrand OGILVIE, Lacan. Le Sujet, PUF, p. 92.
6 Jacques LACAN, Ecrits, Seuil, p. 118.
7Idem, p. 88.
2. POSITION DE LA PSYCHOBOXE
Définition
La psychoboxe existe depuis quarante cinq ans, si je prends pour repère le premier article publié sur ce sujet en 1979, sous l’appellation de « dynamique oppositionnelle », écrit après quatre années de tâtonnements et d’expérimentations.
« Cette forme de travail permet de dégager les représentations angoissantes de chacun. On évoque des atteintes corporelles diverses, des accidents passés, des agressions réelles vécues ou fantasmées, des cauchemars, dont la thématique est intimement liée à ce qui se représente par les gestes. Ce qui est redouté se trouve souvent projeté sur le corps de l’autre. (…)
Il arrive aussi qu’un participant ferme les yeux, détourne la tête, étende les bras dans un geste de refus et de protection symbolique. Nous retrouvons là le geste des nourrissons qui refusent le sein, première ébauche du « non ». Dans notre pratique, l’angoisse est alors à un point culminant. Nous recherchons cette rupture que nous nommons « débordement ». Celui-ci est souvent lié à une incapacité de voir tout le corps de l’adversaire. Les coups arrivent de partout, de l’espace, de façon apparemment immaîtrisable, ce qui renvoie au morcellement du corps. L’angoisse est là dès que l’image du corps de l’autre se perd comme totalité et que les coups arrivent là où on ne peut plus les attendre. »8
1982 : « Cette alternance d’attitudes, de situations et de rôles amène le sujet à effectuer ses projections violentes sur une figure qui ne se limite pas à un support occasionnel et anonyme servant d’exutoire à la haine. C’est notre image qu’il frappe, mais nous retrouvons d’autres modalités d’échange entre les coups, dans une relation jamais réduite à l’opposition. Cette situation induit une ambivalence de la part de la personne violente à notre égard. Elle évoque, de façon privilégiée, la fantasmatique agressive que l’on rencontre dans une situation oedipienne : une articulation polymorphe de projections mortifères, d’interdits et d’identifications. (…)
La verbalisation entretient, avec le travail corporel, un rapport permanent de reprise des actes par les mots, et de retour, de réinjection des mots dans la pratique corporelle.
Nous avons montré la richesse des représentations qui sont, quelquefois, masquées et représentées par des gestes et qui, par la voie du corps, arrivent à se mettre en mots. Il s’agit peut-être là d’un maillon important, voire nécessaire, pour rétablir la chaîne associative pour certaines représentations clivées et isolées des autres aspects de la vie psychique. »9
Elle a lentement mûri, depuis cette date, son cadre et ses processus ayant fini par se stabiliser. Elle a également pu se transmettre, là encore lentement, à partir de quelques écrits, et des formations distillées çà et là en fonction des demandes.
Elle se définit aujourd’hui de la manière suivante :
La psychoboxe a pour but de permettre à un sujet, à travers ses gestes, ses affects et ses représentations, de remettre en jeu l’universalité des processus et la singularité des positions qui émergent de sa confrontation à ce qui lui est violence dans son corps, sa parole et ses actes.
Des combats libres à frappe atténuée effectués dans un cadre formellement défini quant aux mouvements qu’il autorise, contient, transforme et porte à l’intelligibilité, font apparaître le travail d’une image inconsciente du corps, dont la dynamique est secondairement reprise par une parole visant à la reconnaître, à l’élaborer et à lui permettre de s’engager dans une évolution propre.
La psychoboxe ne se soutient que de l’ouverture d’une scène qui appelle un sujet à interpréter sa violence en la précipitant dans des formes perceptibles.
Mais que dire aujourd’hui de cette voie étrange, de cette chimère, au sens, non pas d’un projet irréalisable, mais pour en souligner le caractère composite, la boxe et la psychanalyse étant aussi peu faites pour fusionner harmonieusement qu’une créature qui aurait le devant d’un lion, le milieu d’une chèvre et l’arrière-train d’un serpent ? Il s’agirait donc ici de faire vivre ensemble, comme c’était sans doute le cas au départ, des pensées de psychanalyste dans un corps et des gestes de boxeur, pour finir à l’économie, le temps faisant son œuvre, par des pensées de boxeur dans un corps de psychanalyste !
Mais qu’en est-il alors de ce corps de psychanalyste qui se met debout, face à son psychoboxant, pour échanger avec lui des coups certes atténués, mais néanmoins portés, y compris au visage ? C’est un corps qui s’engage dans l’ écoute de cette part de violence archaïque susceptible de resurgir en chaque sujet, selon des modalités portées à la fois par l’histoire longue de l’humanité et par l’absolue singularité de celui qui supporte en lui la question que lui pose la violence qui l’habite. Les mouvements trouvent, par cette écoute, une fluidité qui rompt avec les sports de combat, une fluidité qui doit tout à l’attention flottante de Freud, dansée par le corps.
La pensée issue de la boxe est celle de la reconnaissance de l’efficience d’un espace à l’intérieur duquel le sujet soutient de répondre à la fois de ses actes, mais aussi de tout ce qui lui arrive, espace de confrontation, matrice de tensions à la fois intra psychiques et ouvertes à une dynamique intersubjective qui ne peut pas faire l’économie de l’altérité.
Origine
La genèse de la psychoboxe a été abondamment développée dans « A poings nommés », mais il me faut ici la résumer pour les lecteurs du présent ouvrage. J’ai fondé la psychoboxe à Strasbourg, dans un contexte globalement peu propice aux innovations. Il s’agissait surtout pour moi de tenter de trouver une médiation pour répondre aux difficultés de symbolisation auxquelles je me heurtais dans ma pratique de psychologue clinicien et de psychanalyste travaillant dans un service de prévention auprès de jeunes fréquemment sujets à des passages à l’acte violents. Une expérience parallèle d’enseignement de la boxe française et de la canne d’arme dans un autre quartier difficile de la banlieue de Strasbourg m’avait permis de découvrir la richesse des associations d’idée de ceux qui venaient se confronter à des phases de combat et qui n’hésitaient pas – alors même que le cadre ne s’y prêtait pas – à évoquer des souvenirs liés à leurs expériences antérieures. J’avais rapidement compris la nécessité – en raison du public particulier qui fréquentait ma salle – de commencer d’emblée par le combat afin de sculpter le geste technique dans le mouvement tout en restant nécessairement attentif à la singularité de chaque construction de l’image du corps en relation avec des éléments de tactique. Il me fallait donc être à l’écoute des mouvements du corps de l’autre, en adaptant mes gestes aux siens pour souligner, montrer, interroger ce qu’il mettait en jeu, dans la seule perspective de l’ enseignement d’un sport de combat, par ailleurs soumis aux exigences normales de ce type de pratique en termes de passages de grades, de diplômes et de compétitions.
Devant la richesse et la diversité de ce qui pouvait se déployer comme n’étant à l’époque qu’un mode singulier d’entrée dans une confrontation sportive, souvent associé à des paroles fortes et tout à fait inattendues dans un tel cadre, l’idée m’était alors venue de reprendre cette pratique dans le cadre de la prévention à l’adresse de ceux qui souhaitaient interroger leur rapport singulier aux situations violentes en passant par un combat libre à frappe atténuée dans le seul but, cette fois clairement énoncé au départ, de rendre intelligibles les processus qui pouvaient se déployer dans ce cadre, afin de les reprendre par la parole. Cette pratique ne pouvait bien sûr s’adresser qu’à des sujets qui en faisaient la demande, généralement pour mieux comprendre leurs débordements violents. C’est à partir de ces rencontres que s’est alors constitué un mode d’écoute qui a muté, à partir de certaines demandes, vers une démarche à visée thérapeutique.
Il s’agit là d’une application psychanalytique limite en ce qu’elle fait violence au cadre instauré par Freud, qui avait pris soin de restreindre la motricité par une position allongée, pour ne même plus offrir le support de son visage et de son regard au patient, afin de conduire la relation psychanalytique vers la seule médiation encore possible : la parole. Il s’agit ici, tout au contraire, de retrouver une parole à partir d’une saturation de gestes, d’affects et de représentations, dans une alternance de mouvements du corps et de temps de parole. Si j’ai pris la responsabilité de travailler ainsi, de face, avec des coups certes atténués, ce n’est pas par caprice ni par souci d’originalité, mais pour limiter la violence du cadre psychanalytique pour des sujets trop angoissés pour supporter ne serait-ce qu’un entretien en face à face, et dont la parole ne pouvait – à ce stade – pas rendre compte de leurs débordements pulsionnels en actes.
Différenciation
La psychoboxe est aujourd’hui stable dans son cadre, dans l’accompagnement, suivi d’une élaboration, des processus qui s’y déploient, et dans ses principales applications. La psychoboxe assume sa rupture totale avec la dimension sportive : pas d’entrainement ni de compétition, aucun enseignement de techniques, mais seulement un questionnement du sujet sur les processus qui apparaissent au cours du travail, en association avec des souvenirs, des situations vécues, des affects…
Ce positionnement ne pouvait pas être sans effets sur la technique gestuelle elle-même qui s’est bien détachée de la boxe : la frappe est tellement atténuée qu’une multitude de coups légers est nécessaire pour produire un effet de débordement, là où une frappe unique et décisive aurait été effectuée dans un cadre pugilistique.
Le psychoboxeur doit donc être capable de ne pas combattre pour lui, comme il l’aurait fait dans une confrontation sportive, mais de mettre ses gestes au service d’un questionnement sur le regard, la distance, l’angoisse, la peur, la colère, l’évitement du regard, les états de transe ou de sidération …
La psychoboxe est à la boxe ce que le psychodrame est au théâtre, elle est donc proche du psychodrame analytique dont elle se sépare à son tour par la réduction de son champ d’expression au combat libre, et aussi par l’absence de scénario préétabli par des échanges verbaux, l’archaïsme des processus engagés, la mise en évidence, puis le débordement des défenses, l’autorisation du toucher, avec des gants…
Elle se rapproche aussi de la danse dans la mesure où elle conduit un sujet à s’écouter dans ses mouvements corporels, dans son exploration spatiale, dans ses rythmes, et elle s’en détache par la permanence de sa rencontre avec une pression extérieure, intersubjective, qui réduit son expression en la finalisant dans un « tenir-debout », un « tenir-contre », un combat, une garde.
Effets
Les effets de la psychoboxe sont généralement assez rapides, deux à trois séances permettent d’articuler un travail précis qui mobilise une image dynamique du corps dans ce qu’elle nous dévoile de stable et de récurrent dans la distance à l’objet et dans son rapport à l’angoisse, et des affects qui trouvent à se nommer dans un cadre qui croise trois regards : celui du pratiquant, celui du psychoboxeur et celui du tiers qui soutient le cadre, qui observe, et qui peut, comme les deux protagonistes engagés dans le combat, arrêter la confrontation à n’importe quel moment. Si l’engagement ne fait l’objet d’aucune interruption, il sera stoppé au bout d’une minute et demie.
Ce travail fait rapidement apparaître l’extrême labilité de certaines postures qui avaient pourtant fini par faire corps avec le sujet. Dès les premières séances, les attitudes d’attaque et de fuite cessent d’être systématiques pour alterner avec beaucoup de fluidité. Les moments de sidération et les phases de débordement sont surmontés immédiatement après une interruption d’une vingtaine de secondes, sans qu’aucun échange verbal ne vienne orienter le pratiquant vers quelque solution que ce soit.
Il s’agit ici de donner du jeu à ce qui était figé dans des attitudes quelquefois très anciennes et répétitives, quelquefois reliées à un traumatisme, et qui avaient fini par se sédimenter dans l’image du corps du sujet. Tel pratiquant qui s’était défendu lors d’une bagarre à l’école, et qui avait expédié son adversaire à l’hôpital après une mauvaise chute, était persuadé qu’il ne pouvait rien contrôler de sa force, et évitait depuis l’enfance le moindre conflit. Il a été surpris de découvrir qu’il pouvait attaquer et se défendre dans un cadre sécurisé, sans être immédiatement propulsé dans une dangerosité extrême. Tel autre qui se jugeait lâche pour avoir été un jour dans un état de sidération dans une situation dangereuse qui s’était malgré tout bien terminée, a découvert combien il lui était facile d’explorer d’autres moyens de défense sans plus chercher à s’identifier à ce seul moment pris comme un effet de vérité.
Il faudrait faire ici une parenthèse anthropologique pour souligner combien le sujet de la démocratie « immunitaire » occidentale, selon l’expression du philosophe Alain Brossat10, qui cherche avant tout à ne plus être touché, est encore pris, paradoxalement, dans des représentations anciennes du courage, qui enfermaient les pratiques corporelles des guerriers dans un tissu serré d’obligations dont le non-respect les faisait irrémédiablement déchoir.
Ce premier travail de rencontre qui s’ouvre à la dimension corporelle se poursuit, dans un second temps, par des échanges de parole à partir de ce que chaque protagoniste peut dire, de sa place, à propos de ce qui s’est ainsi mis en scène. Nous rejoignons ici une dimension bien connue des psychodramatistes.
Efficience
Le premier niveau d’efficience de cette pratique ne tient pas d’emblée à la dynamique des processus spécifiques qui sont appelés à s’y déployer, mais procède de l’effet de l’émergence de son cadre, en ce qu’il constitue une adresse d’un travail possible sur les problématiques de violence.
Nous rejoignons ici une dimension institutionnelle qu’il faut au moins mentionner faute de pouvoir la développer. Elle s’illustre de cet exemple : un jeune homme, fréquemment exclu des différents foyers où il avait été placé, m’avait été adressé par la directrice du dernier en date, vécu par elle et par lui comme étant celui de la « dernière chance ». Comme il ne pouvait toujours pas y contrôler la violence de ses actes malgré une inlassable répétition de « rappels de la loi » conjuratoires, la directrice me demanda si j’assurais aussi un hébergement. Je lui ai répondu que j’acceptais de le rencontrer pour discuter d’une éventuelle indication à la pratique de la psychoboxe en réponse à une éventuelle demande de sa part, qui serait nécessairement à différencier de la question pressante pour elle de trouver un nouveau lieu où le placer. Elle trouve alors une nouvelle solution et l’accompagne pour un premier entretien dans un long voyage en train. Ce qu’il a pu lui dire pendant le voyage suffisait à articuler la question des coups d’abord reçus, puis donnés, qui venaient orchestrer ses déplacements en fonction de l’angoisse qu’il vivait. Le combat de psychoboxe en tant que tel était devenu inutile, mais la seule représentation qui anticipe un cadre rendant possible un travail à partir de la violence, permet aux professionnels comme aux jeunes concernés de parler de ces questions sans les réduire à l’urgence d’une impossible éradication.
Le deuxième niveau d’efficience de la psychoboxe est à repérer dans la dimension corporelle, qui permet de déplacer le questionnement d’un « pourquoi ? » en quête de causes ou de justifications, vers un « comment ? » qui ouvre à une parole plus riche et plus vraie. Le fait de passer d’abord par le combat dégage un espace d’écoute qui va bien en-deçà et au-delà de ce que le sujet est capable de formuler verbalement. Il n’est donc plus confronté d’emblée aux échecs répétés d’une parole trop souvent piégée d’avance par des attentes qui s’énoncent en termes de normes de comportement. La rencontre précède ici la nécessité de définir son rapport à la violence par la parole. Elle s’ouvre sur des processus et non sur les effets stigmatisants d’un diagnostic. Le sujet n’est pas seul en cause, puisque chaque protagoniste s’engage dans la parole à partir de ce qu’il a vécu ou observé.
Nous pouvons alors explorer des mouvements archaïques d’excorporation, ou des phases d’envahissement et de débordement accompagnant des affects difficiles à supporter, qui sont repris et reliés par la parole, mais après avoir été préalablement contenus dans un cadre sécurisant ouvert à une intersubjectivité des échanges corporels, et déjà transformés par la dynamique d’une gestuelle qui échappe à la conscience sans être pour autant être livrée aux dangers pulsionnels.
Nous retrouvons enfin, à ce stade, un troisième niveau d’élaboration verbal proche du psychodrame analytique qu’il est inutile de développer ici.
Applications
Les principales indications de cette pratique restent du côté de ceux qui ont fréquemment recours à des actes violents, à des accidents, à des parcours tumultueux qui les confrontent à des alternances d’exclusions et d’enfermements. Plusieurs meurtriers ont ainsi pu retrouver des séquences entières de leurs actes passés dont ils n’avaient plus aucun souvenir au moment du procès. J’ai ainsi travaillé pendant plus de vingt ans en milieu carcéral essentiellement avec des meurtriers. J’ai engagé ce travail à la demande de Madame Maryse Fabacher, assistante sociale, qui a pris sa retraite au moment où j’écris ces lignes, et qui m’a accompagné dans la mise en place de ce travail, en amont, pendant les séances, et en aval, avec une constance et une détermination sans faille. Elle est membre d’honneur de l’Institut de Psychoboxe. De nombreuses précautions étaient nécessaires, au plan institutionnel, avant de pouvoir travailler dans des conditions correctes en milieu carcéral. Certains grands psychanalystes continuent à soutenir, du dehors, que le travail y est impossible. J’ai pu vérifier, de l’intérieur, qu’il était seulement presque impossible. Une grande vigilance est ici de mise, et il faut être prêt à arrêter le travail à tout moment.
Nous avons longuement travaillé avec des adolescents, dans des Centres Fermés, avec Lionel Raufast et Régis Guede, à Narbonne, avec l’engagement et le soutien de leur directeur Christophe Warnault, mais aussi en milieu ouvert, comme en Avignon avec Jean Haour et Bernard Richaud dans le cadre d’une action portée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, mais ouverte au Conseil Général et à l’Administration Pénitentiaire. La psychoboxe se développe aussi dans des Maisons d’Enfants à Caractère Social, comme à Nîmes, avec Ghislain Pateux, sous la direction initiale de David Payan. Nous intervenons aussi auprès des adultes dans le cadre de violences intrafamiliales. Un petit livre : « Au vif de la violence », retrace six années d’une telle pratique avec ma collègue Karima Merah. Nous avons alterné un travail individuel et groupal en psychoboxe, et un accompagnement sous forme d’écoute téléphonique.
Quelques psychoboxeurs travaillent en direction des enfants, en institution ou en cabinet. Sonia Weber, à Strasbourg est la plus expérimentée d’entre nous.