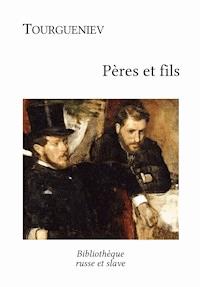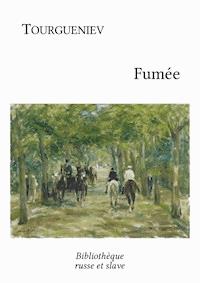
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Grigori Litvinof attend que sa fiancée Tatiana vienne le rejoindre à Baden-Baden et côtoie ses nombreux compatriotes russes en villégiature. Parmi eux, il croise Irène, qu'il a passionnément aimée quelques années auparavant mais qui l'avait quitté pour faire un meilleur mariage.
Roman de l'amour inoubliable et de ses illusions, galerie de portrait des Russes à l'étranger,
Fumée est un des grands derniers romans de Tourgueniev.
Traduction intégrale et préface de Génia Pavloutzky, 1937.
EXTRAIT
Il y avait foule ce 10 août 1862 à quatre heures de l’après-midi devant la célèbre « Potinière » de Baden-Baden. Il faisait un temps splendide ; tout aux alentours, les arbres verts, les claires maisons de la coquette station, les montagnes ondoyantes, tout s’étalait avec un air de fête sous les rayons d’un soleil clément ; tout souriait aveuglément, avec une confiance charmante, et c’était ce même sourire indéfini qui flânait sur les figures jeunes et vieilles, belles et laides. Même les visages peints des cocottes parisiennes ne rompaient pas l’atmosphère générale de jubilation, et les rubans multicolores, les plumes, les reflets d’or et d’acier sur les chapeaux et les violettes rappelaient involontairement au regard l’animation brillante et les jeux frivoles des fleurs printanières et des ailes irisées : seule la sèche et gutturale crécelle du jargon français qui traînait partout, n’arrivait ni à remplacer ni à égaler le babil des oiseaux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ivan Sergueïevitch Tourgueniev est un écrivain, romancier, nouvelliste et dramaturge russe né le 28 octobre 1818 à Orel et mort le 22 août 1883 à Bougival. Son nom était autrefois orthographié à tort Tourguénieff ou Tourguéneff.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Ivan Tourgueniev
Тургенев Иван Сергеевич
1818 – 1883
FUMÉE
Дым
1867
Traduction et introduction de Génia Pavloutzky, 1937.
© La Bibliothèque russe et slave, 2017
© Génia Pavloutzky, 1937, 2017
Couverture : Otto DILL, Lichtenthaler Allee in Baden-Baden (1925)
INTRODUCTION
IVAN TOURGUENIEF est né en 1818 et mort en 1883. Il appartient à cette admirable pléiade d’écrivains qui s’épanouissent en Russie au cours du XIXe siècle, malgré l’oppression politique, sociale et intellectuelle. La fameuse intelliguentzia portera au tsarisme les coups les plus efficaces et les plus profonds ; parmi ces précurseurs Tourguenief tient une place de premier plan.
Un peu plus jeune que Pouchkine, il est de la génération de Dostoïevsky et de Tolstoï, le prédécesseur de Maxime Gorki. Il était issu d’une famille de gros propriétaires provinciaux, peu faite pour le comprendre et avec laquelle il ne s’entendit jamais. Attiré vers l’étranger, il profita de la liberté relative dont il jouissait pour aller, à l’âge de 28 ans, passer trois ans à l’université de Berlin. En 1852 il publie les célèbres Récits d’un chasseur, violent réquisitoire contre le servage qui sévissait alors dans toute la Russie. On sait que la condition des moujiks russes était cent fois pire que celle des paysans français avant 1789. Attachés au sol qu’ils n’avaient pas le droit de quitter, astreints à la corvée, aux redevances, soumis au bon plaisir de leur maître, ils menaient une vie misérable et famélique, à peine reconnus comme des hommes.
On pouvait trouver dans les journaux des annonces du genre de celle-ci : « À vendre, un perruquier et une vache de bonne race ». Le retentissement des Récits d’un chasseur fut énorme ; le Tsar Alexandre II devait reconnaître par la suite que le livre de Tourguenief « avait été pour beaucoup dans la résolution qu’il avait prise d’abolir le servage ». Mais sur le moment le résultat le plus immédiat fut d’envoyer l’auteur en prison. C’était un avertissement. Désormais Tourguenief préférant l’exil à l’atmosphère étouffante de son pays, s’installe à l’étranger, ne faisant plus que de brefs séjours en Russie. Il vit d’abord en Allemagne et se fait construire une villa à Baden-Baden, la ville d’eau dont il a décrit la vie mondaine et artificielle dans Fumée ; puis en France après 1870 où il devait jouir jusqu’à sa mort d’une grande notoriété dans les milieux littéraires.
L’intelliguentzia russe était alors partagée en deux tendances ; les Slavophiles et les Occidentaux. Les premiers pensaient que tout ce qui venait de l’Europe risquait de corrompre et les institutions et les mœurs originales de la Russie ; ils déclaraient que la Russie pouvait suivre un développement propre sans rien emprunter à l’étranger. Les autres au contraire estimaient que la Russie n’avait d’autres moyens de rattraper son retard que de se mettre, sans arrière-pensée, à l’école des civilisations occidentales ; qu’il fallait leur emprunter leurs techniques, leurs mœurs, leurs institutions politiques. Par instinct libéral, autant que par suite de son exil, Tourguenief se range délibérément du côté des occidentaux ; il n’a que sarcasmes, dans Fumée en particulier, pour cette ignorance naïve qui prétend exalter le génie inventif d’un peuple qui en plein XIXe siècle conserve encore le servage, la famine et l’autocratie absolue et dont la civilisation présente un retard de deux siècles. À cet égard Potoughine est dans Fumée son porte-parole le plus fidèle.
Cette absence de génie inventif, Tourguenief se la serait volontiers attribuée à lui-même — sans doute avec quelque injustice. Mais il a toujours considéré le rôle de l’écrivain comme analogue à celui du peintre ; il a décrit scrupuleusement tous les milieux qu’il a traversés excluant l’imagination de son œuvre pour ne conserver que l’observation minutieuse. Fumée ne fait pas exception à la règle, c’est une peinture minutieuse et il faut bien le dire, peu flatteuse des Russes à l’étranger : aristocrates et militaires ignorants, grossiers et jouisseurs ; intellectuels naïfs, bavards, coupeurs de cheveux en quatre et incapables de toute action positive. Pourtant derrière ce tableau assez sombre, il est facile de sentir vibrer un amour sincère de l’humanité ; l’ironie volontairement froide de Tourguenief n’arrive pas à masquer sa sentimentalité profonde. Il peint ses compatriotes tels qu’il les voit, et vraisemblablement tels qu’ils étaient à cette époque ; mais avec quel intense regret il les voudrait autres, plus virils, plus doux, plus humains. Et le pessimisme de Fumée ne saurait nous faire oublier que Tourguenief est capable de sympathie, voire d’enthousiasme, lorsqu’il décrit par exemple dans Terres vierges le mouvement vers le peuple des fils de familles aristocratiques, à l’appel de Bakounine.
Toutefois — et par là il est bien spécifiquement russe — le fatalisme demeure le fond de son caractère. En cela il se distingue de ses contemporains Tolstoï et Dostoïevsky ; il n’a ni la foi du premier, ni l’âpreté du second. La révolution qu’il appelle il ne la croit pas possible ; les hommes sont trop médiocres. L’énergie qu’il sent nécessaire, il ne l’éprouve ni en lui ni autour de lui. Le trait essentiel de l’humanité selon lui, c’est l’indécision ; le geste familier de ses héros, c’est de se plonger la tête dans les mains, leur état constant le découragement ; et s’ils parlent tant c’est pour ne pas se regarder en face, pour s’étourdir devant les tâches qui les attendraient et dont ils se sentent incapables.
Ce sentiment de désespérance domine l’œuvre que nous publions aujourd’hui. Fumée, le titre est significatif, fumée c’est tout ce qui restera de ces vaines agitations, fumée les interminables palabres de l’intelleguentzia, fumée les espoirs de la jeunesse, fumée l’amour lui-même, ses désenchantements, ses caprices. Rien ne reste de rien ; rien ne vaut la peine de l’effort ; tout s’en va en fumée sur le plan individuel comme sur le plan social.
Que dire maintenant de l’intrigue qui sert de trame au roman ? À vrai dire elle n’en forme pas le sujet réel. C’est une simple et banale histoire d’amour ; tout l’intérêt est dans l’atmosphère où elle se déroule.
Irène, Litvinof, Tatiana sont-ils autre chose que des pantins animés et joués par des forces qui les dépassent ? Irène est-elle responsable de ses caprices, de sa coquetterie ? Litvinof de sa veulerie et de sa faiblesse ? La passion qui les rapproche et les fait se heurter n’est elle-même que le reflet de l’inquiétude sociale ; les vicissitudes de leur amour traduisent l’instabilité du monde où ils vivent et les obstacles contre lesquels ils viennent buter sont ceux que leur oppose une société mal faite et artificielle.
L’amour n’est donc pas le vrai thème du roman de Tourguenief ; même lorsqu’elle semble plonger aux profondeurs de la psychologie individuelle, la littérature russe ne peut jamais s’affranchir des préoccupations sociales. Derrière l’histoire de Litvinof et d’Irène Ratmirof il y a le » drame d’une société croulante et perdue ; et derrière le tableau des mœurs russes il y a l’homme, dans ce qu’il a d’éternel et d’immuable, de grand et de pitoyable ; et si ce livre de Tourguenief est une grande œuvre c’est précisément parce qu’il a su donner une forme personnelle et originale à ce problème unique et constant qu’est l’homme pour lui-même. — G. P.
FUMÉE
I
IL y avait foule ce 10 août 1862 à quatre heures de l’après-midi devant la célèbre « Potinière » de Baden-Baden. Il faisait un temps splendide ; tout aux alentours, les arbres verts, les claires maisons de la coquette station, les montagnes ondoyantes, tout s’étalait avec un air de fête sous les rayons d’un soleil clément ; tout souriait aveuglément, avec une confiance charmante, et c’était ce même sourire indéfini qui flânait sur les figures jeunes et vieilles, belles et laides. Même les visages peints des cocottes parisiennes ne rompaient pas l’atmosphère générale de jubilation, et les rubans multicolores, les plumes, les reflets d’or et d’acier sur les chapeaux et les violettes rappelaient involontairement au regard l’animation brillante et les jeux frivoles des fleurs printanières et des ailes irisées : seule la sèche et gutturale crécelle du jargon français qui traînait partout, n’arrivait ni à remplacer ni à égaler le babil des oiseaux.
Tout suivait son cours habituel. L’orchestre du Pavillon faisait entendre tantôt le potpourri de La Traviata, tantôt une valse de Strauss ou bien Dites-lui, romance russe, exécutée par un chef d’orchestre obligeant. Dans les salles de jeux se pressaient, autour du tapis vert, les mêmes figures avec la même expression bornée et avide, irritée, consternée et rapace qu’imprime aux traits les plus aristocratiques la fièvre du jeu. Le même gros propriétaire du Tambof, obèse et vêtu avec recherche, les yeux exorbités, la poitrine étalée sur la table, négligeant les sourires railleurs des croupiers, éparpillait d’une main moite aux quatre coins du tapis, avec la même inconcevable et fébrile rapidité au moment précis du traditionnel « rien ne va plus », les disques jaunes des louis d’or, se coupant par là même son droit au gain, quelle que fût sa chance. Ce qui ne l’empêchait nullement le soir même d’appuyer avec une sympathique indignation les propos du prince Coco, lequel à Paris dans le salon de la princesse Mathilde avait si bien dit en présence de l’empereur lui-même : « Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie ». C’est à l’Arbre russe que se réunissaient d’habitude tous nos aimables compatriotes ; ils s’approchaient avec de grands airs, nonchalants, et se saluaient avec aisance, grâce et majesté, comme il sied à des représentants de l’élite intellectuelle ; mais une fois assis ils n’avaient plus rien à se dire et se trouvaient réduits à rabâcher de vains ragots ou bien à répéter les saillies usées d’un ex-littérateur parisien, petit homme planté sur des jambes malingres, avec une misérable barbiche sur une vilaine tête de bouffon bavard. Il en imposait à tous ces princes russes en leur racontant les plates fadaises des vieux almanachs du Charivari ou du Tintamarre, et les princes russes s’esclaffaient d’un rire reconnaissant comme pour avouer involontairement et l’écrasante supériorité de ce « bel-esprit » étranger et leur propre et définitive incapacité à trouver quelque chose de spirituel. Et pourtant il y avait ici presque toute la fine fleur de notre société, les types les plus représentatifs du beau monde. Il y avait le comte X... notre incomparable dilettante, musicien profond, divin « diseur » de romances, qui en réalité savait à peine distinguer une note de l’autre et qui chantait comme un mauvais bohémien ou comme un coiffeur parisien. Il y avait aussi le délicieux baron Z..., ce maître universel, homme de lettres et d’affaires, orateur et tricheur. Il y avait aussi le prince Y..., ami du peuple et de la religion qui jadis, à l’époque bienheureuse de l’affermage, avait réalisé une fortune immense en vendant de l’eau-de-vie mélangée de stupéfiants. Et le brillant général O..., qui ayant vaincu je ne sais plus quoi et soumis je ne sais plus qui, ne savait plus que faire de lui-même, ni par quoi se manifester ; et R..., gros et jovial qui se croyait très malade et très intelligent et qui était en réalité fort comme un bœuf et bête comme un âne.... Il était à peu près seul à garder encore la tradition de l’époque du Héros de notre temps1 et de la comtesse de Vorotinsky. Il lui en restait le « culte de la pose », une démarche balancée, une lenteur affectée de mouvements et une expression de somnolente majesté sur des traits immobiles et comme offensés. Il coupait la parole à ses interlocuteurs en baillant, examinait soigneusement ses mains et ses ongles, riait du nez, et ramenait constamment d’un mouvement brusque, son chapeau de la nuque aux sourcils.... Il y avait même des hommes d’État, des diplomates, de grands noms européens, sagaces conseillers d’État prenant la Bulle d’or pour une proclamation du Pape et la taxe des pauvres pour un impôt sur les pauvres ; il y avait enfin de fervents mais timides admirateurs des « dames aux camélias », jeunes lions mondains dont une raie superbe départageait les cheveux jusqu’à la nuque, avec de magnifiques favoris pendants et des costumes venus de Londres, jeunes lions qui pouvaient rivaliser avantageusement en platitude avec le fameux bavard parisien. Mais non ! nul n’est prophète en son pays, et la comtesse Ch..., célèbre arbitre des élégances et du bon ton surnommée par les mauvaise langues « La reine des guêpes » ou la « Méduse en bonnet », préférait à défaut du bavard parisien se tourner vers les Italiens, les Moldaves, les spirites américains, les brillants secrétaires d’ambassades étrangères, les Allemands à figure poupine et prudente. Suivant son exemple, la princesse Babette, celle-là même dans les bras de laquelle Chopin a rendu le dernier soupir, (on compte en Europe un millier de dames à revendiquer cette gloire) ; la princesse Annette qui en imposerait à tous si de temps à autre, de manière subite, ainsi que l’odeur du chou au milieu de celle de l’ambre, ne se révélait en elle une blanchisseuse villageoise ; l’infortunée princesse Pachette dont le mari haut fonctionnaire calotta, Dieu sait pourquoi, le maire de la ville et vola 20.000 roubles au Trésor ; enfin la folle petite comtesse Zizi et la larmoyante princesse Zozo, — toutes elles abandonnaient leurs compatriotes. Abandonnons donc, nous aussi, ces dames charmantes et éloignons-nous de l’arbre célèbre autour duquel elles sont toutes assises dans leurs robes coûteuses et de mauvais goût et que Dieu allège l’ennui qui les grignote.
1. Roman de Lermontof.
II
À quelques pas de l’« Arbre russe », attablé au café Weber, était assis un bel homme d’une trentaine d’années, de taille moyenne, plutôt maigre, le teint halé ; il avait un visage viril et agréable. Penché en avant, il s’appuyait sur sa canne avec la simplicité d’un homme qui ne pense même pas à se faire remarquer. Ses grands yeux bruns expressifs, à reflets jaunes, regardaient lentement autour d’eux, tantôt clignant au soleil, tantôt suivant attentivement un passant excentrique, et un sourire ironique effleurait alors ses fines moustaches.
Il était habillé d’un ample manteau de coupe allemande, et un feutre gris recouvrait à moitié son large front, On aurait dit, au premier abord, un homme comme il y en a tant de par le monde, un homme sérieux, honnête et sûr de lui-même. Il semblait se reposer après de longs travaux, et le tableau qui s’offrait à lui l’amusait d’autant plus que ses pensées étaient loin et qu’elles appartenaient à immonde bien différent de celui qui l’entourait pour l’heure. C’était un Russe, il s’appelait Grigori Michaïlovitch Litvinof.
Nous devons faire connaissance, et c’est pourquoi il nous faut conter en quelques mots son passé simple et sans aventure.
Fils d’un fonctionnaire en retraite, d’origine bourgeoise, il fut élevé non à la ville, comme on aurait pu s’y attendre, mais à la campagne. Sa mère, de petite noblesse, malgré un caractère assez ferme, était une nature bonne et enthousiaste. Plus jeune de vingt ans que son mari, elle le rééduqua autant qu’elle le put. Elle le fit passer des ornières du fonctionnaire dans celles du propriétaire terrien, elle modéra et adoucit son caractère bourru et rude. Elle lui apprit à s’habiller proprement et à bien se tenir. Il cessa même de jurer et se mit à admirer les savants et la science, quoique évidemment n’ayant jamais lu, et devint très soucieux de sa dignité ; sa démarche même s’apaisa, et il parlait d’une voix dolente de sujets de plus en plus élevés, ce qui, d’ailleurs, lui coûtait pas mal de peine. S’il lui arrivait de penser : « Quelle bonne fessée mériterait celui-là », sa voix disait seulement : « Oui, oui... bien sûr... C’est une question qui se pose... » La mère Litvinof avait mis sa maison sur un pied européen, on disait « vous » aux domestiques et personne, à table, n’avait le droit de manger gloutonnement. Quant à ses terres, ni elle ni son mari n’avaient su en tirer quelque chose. C’étaient des espaces abandonnés depuis longtemps, avec toute sorte de dépendances, de forêts, de lacs. Il y avait aussi une grande usine construite par un seigneur plein de zèle, mais peu expérimenté ; elle prospéra un moment entre les mains d’un habile filou, mais fut ruinée définitivement par un honnête gérant allemand. Madame Litvinof avait au moins la satisfaction de ne pas s’être ruinée et de ne pas avoir contracté de dettes.
Malheureusement, sa santé n’était pas bonne, et elle mourut tuberculeuse l’année même où son fils fut inscrit à la faculté de Moscou. Des circonstances que le lecteur apprendra par la suite l’empêchèrent de terminer ses études, et il se retrouva en province, où il traîna quelque temps, sans occupation, sans amis, presque sans relations. La petite noblesse du canton lui portait peu de sympathie, moins à cause des idées occidentales sur le caractère pernicieux de l’« absentisme » que par application d’un vieux proverbe selon lequel « rien n’est plus près de son corps que sa propre chemise ». Ainsi entra-t-il, en 1855, dans l’armée. Une fois, en Crimée, il faillit mourir du typhus sans avoir, pendant les six mois qu’il resta dans une cabane au bord de la Mer Putride2, aperçu un seul « allié ».
Rentré au village, il se passionna pour l’agriculture.
Il comprenait que la propriété de sa mère, mal dirigée par un père vieillissant, ne rendait pas la dixième partie de ce qu’elle aurait pu donner, et que, placée dans des mains expertes, elle pouvait devenir en une affaire d’or. Mais il comprenait aussi qu’il manquait de connaissances techniques et il partit pour l’étranger afin de s’initier à l’agronomie et à la technologie, résolu à apprendre son métier en commençant par l’A. B. C. Il passa plus de quatre ans à Mecklembourg, en Silésie, puis à Carlsruhe ; de là il s’en fut en Angleterre et en Belgique, travailla consciencieusement, acquit de l’expérience et des connaissances ; elles ne lui venaient pas facilement, mais il tint bon jusqu’au bout, et maintenant, sûr de lui-même, sûr de son avenir, sûr d’être utile à sa terre et peut-être à son pays, il se prépare à retourner dans sa patrie d’où son père, complètement débordé par les événements, le réclame par des lettres déchirantes, pleines d’implorations et de suppliques.
Que fait-il alors à Baden ?
Il attend d’un moment à l’autre l’arrivée de sa cousine et fiancée : Tatiana Petrovna Chestovaïa.
Il la connaît depuis son enfance, et il a passé avec elle le printemps et l’été, à Dresde, où elle habite avec sa tante. Il éprouve un amour sincère et une estime profonde pour sa jeune parente, et sur la fin de son obscur travail de préparation, au moment d’entrer dans une vie nouvelle, de commencer le vrai labeur, il lui a offert d’être à la fois la femme aimée, la camarade, l’amie ; d’unir leurs deux vies pour les joies et l’adversité, pour le travail et le repos, « for better for worse » comme disent les Anglais. Elle a accepté et il est parti à Carlsruhe chercher ses livres, ses papiers et ses affaires... Mais que fait-il alors à Baden, demanderez-vous encore ?
Il est à Baden parce que la tante de Tatiana, Capitolina Markovna Chestovaïa, qui l’a élevée, vieille fille de 55 ans, la meilleure et la plus honnête des originales, âme libérale, brûlant du désir de sacrifice et de renoncement, esprit fort (elle a lu Strauss, il est vrai en cachette de sa nièce) et démocrate, ennemie jurée du grand monde et de l’aristocratie, n’a pas pu résister à la tentation de jeter un coup d’œil, ne serait-ce qu’une fois sur ce même grand monde dans un lieu aussi chic que Baden... Capitolina Markovna ne portait pas de crinoline et taillait court ses cheveux blancs, mais elle se sentait secrètement émue par le luxe et l’apparat et elle prenait un doux plaisir à le mépriser, à en médire.
Pourquoi ne pas donner cette satisfaction à la bonne vieille dame ?
2. XXXXX
III
— TIENS, tiens ! voilà où l’on se trouve ! résonna tout d’un coup à son oreille une voix glapissante, tandis qu’une main secouait lourdement son épaule.
Il leva la tête et vit une des rares personnes qu’il avait connues à Moscou, un certain Bambaef, brave homme insignifiant ; plus très jeune, il avait un nez et des joues comme ramollis par la cuisson, des cheveux gras et ébouriffés, un corps obèse et flétri. Toujours sans le sou, mais dans un ravissement perpétuel, Rostislav Bambaef traînait avec bruit, mais sans but sur la face de la terre.
— Voilà ce qui s’appelle une rencontre ! répétait-il en ouvrant tout grands des yeux noyés de graisse et en avançant des lèvres bouffies au-dessus desquelles pointaient d’une façon étrange et déplacée des moustaches teintes.
— Ah ! ce Baden ! Tout le monde finit par s’y rencontrer. Comment es-tu ici ?
Bambaef avait le tutoiement universel.
— Je viens d’arriver il y a quatre jours.
— D’où ?
— Qu’est-ce que cela peut te faire ?
— Comment ! Mais attends, attends ! sais-tu qui est ici encore ? Goubaref ! lui-même. Il est arrivé d’Heidelberg hier seulement. Tu le connais certainement ?
— J’en ai entendu parler.
— Seulement ? De grâce ! tu vas venir chez lui à l’instant. Ne pas connaître un tel homme ! Tiens ! voilà Vorochilof... Mais tu ne le connais peut-être pas non plus ? J’ai l’honneur de vous présenter : deux savants ! C’est même un « phénix » ! Embrassez-vous !
Et en disant ces mots, Bambaef se tourna vers un beau jeune homme à la figure fraîche et rose, mais sérieuse. Litvinof se souleva et naturellement ne l’embrassa point. Il se borna à échanger un salut bref avec le « phénix » lequel, à en juger par la sévérité de son maintien, ne goûtait pas outre mesure une présentation inattendue.
— J’ai dit « phénix », et je ne me récuse point, continuait Bambaef ; va voir à Pétersbourg, au régiment et regarde le tableau d’honneur : quel est le nom qui y est inscrit en premier ? C’est Vorochilof Simon Iakovlevitch ! Mais Goubaref, Goubaref, mes enfants ! Voilà chez qui il faut courir ! Je suis en vénération devant cet homme ! Et je ne suis pas le seul : tous le vénèrent. Il est en train d’écrire une œuvre, oh !... oh !...
— Une œuvre sur quoi ? demanda Litvinof.
— Sur tout, mon ami, dans le genre de Buckle, mais plus profond, bien plus profond... Tout y sera résolu et éclairci.
— Tu l’as lue ?
— Non, je ne l’ai pas lue. C’est un secret qu’il ne faut pas divulguer. Mais on peut s’attendre à tout de la part de Goubaref... à tout ! Oui, oui !
Bambaef soupira et se croisa les bras.
— S’il y avait encore deux ou trois cerveaux comme celui-là en Russie, que verrions-nous, mon Dieu, que verrions-nous ? Je vais te dire une chose, Grigori Michaïlovitch : quelles que soient tes préoccupations en ce moment, et je ne sais pas du tout ce qu’elles sont ; quelles que soient tes opinions, et je ne les connais pas non plus, tu trouveras toujours quelque chose à apprendre chez Goubaref. Malheureusement, il n’est pas ici pour longtemps. Il faut en profiter, il faut y aller. Chez lui... Chez lui !...
Un gandin avec des bouclettes rousses, un ruban bleu sur un chapeau bas, se retourna en passant avec un sourire sarcastique, et dévisagea Bambaef à travers son monocle. Litvinof lui dit, agacé :
— Pourquoi cries-tu comme si tu avais le diable à tes trousses ? Je n’ai pas encore dîné.
— Qu’est-ce que ça fait ? On n’a qu’à dîner tout de suite chez Weber... tous les trois... C’est parfait ! Peux-tu payer pour moi ? ajouta-t-il à mi-voix.
— Je peux, mais je ne sais vraiment pas si...
— Laisse donc ! Tu m’en seras reconnaissant et lui en sera certainement très content. Mon Dieu ! s’interrompit-il soudain, — mais c’est la finale d’Hernani qu’on joue. Que c’est beau !... A som... mo Carlo... Comme je suis tout de même ! me voilà en larmes ! Eh bien ! Simon Iakovlevitch Vorochilof, allons-y !
Vorochilof, qui restait immobile et digne, baissa les yeux, fronça les sourcils, marmonna quelque chose entre ses dents, mais ne refusa point ; Litvinof pensa : « Tant pis, allons-y puisque nous n’avons rien à faire. » Bambaef lui prit le bras, mais, avant d’entrer au restaurant, il fit signe à Isabelle, célèbre fleuriste du Jockey-Club, pour s’offrir la fantaisie d’un bouquet. Mais l’aristocratique fleuriste ne bougea pas ; qu’avait-elle à faire d’un monsieur qui portait des chaussures éculées, un veston taché et une cravate bigarrée. Il n’avait même pas de gants, et elle ne l’avait certainement jamais vu à Paris auparavant. Vorochilof lui fit signe à son tour. Cette fois, elle s’approcha. Il choisit dans son panier un minuscule bouquet de violettes et lui jeta un florin. Il pensa l’étonner par sa générosité ; mais elle ne sourcilla même pas et quand il fut passé, une grimace méprisante joua sur ses lèvres. Vorochilof était vêtu avec élégance, voire avec recherche, mais l’œil expérimenté de la Parisienne reconnut sans peine dans sa toilette, dans son maintien, dans sa démarche même, où l’on sentait la raideur militaire, l’absence du véritable chic.
Après avoir choisi leur table dans la grande salle du restaurant Weber et commandé leur dîner, ils engagèrent la conversation. Bambaef se remit à célébrer avec flamme la haute valeur de Goubaref, mais il se tut bientôt, et avec force soupirs, se mit à manger bruyamment, avalant verre sur verre. Vorochilof, lui, mangeait et buvait peu, comme malgré lui, et après avoir questionné Litvinof sur le caractère de ses occupations, il commença à exposer ses opinions personnelles... moins sur les occupations de Litvinof que sur les sujets les plus divers. Il s’anima soudain et se lança à bride abattue comme un cheval de race, en appuyant sur chaque syllabe, sur chaque lettre, comme un fort en thème à l’examen. Ses mains faisaient de grands gestes, souvent mal à propos. Personne ne l’interrompant, il devenait de plus en plus éloquent, de plus en plus hardi : on aurait dit qu’il faisait un cours. Les noms des savants modernes, avec la date de leur naissance ou de leur mort, les titres des plus récentes brochures, des noms, des noms, des noms tombaient de ses lèvres, lui procurant visiblement une jouissance dont les reflets tremblaient dans ses yeux allumés. Il était évident que Vorochilof méprisait tout ce qui était ancien, qu’il ne tenait qu’à la crème de la culture, aux toutes nouvelles découvertes de la science. Rappeler, même mal à propos, le livre d’un quelconque docteur Zauerbengel sur les prisons pensylvaniennes, ou un article paru hier dans l’ « Asiatic Djournal » (il prononçait Djernal, sans évidemment connaître un mot d’anglais), sur les Védas et pouranas, était pour lui une volupté sans limite. Litvinof l’écoutait ; il l’écoutait en essayant vainement de comprendre quelle était sa véritable spécialité. Il parlait tantôt du rôle de la race celtique dans l’histoire ; tantôt du monde ancien ; il discourait alors sur les marbres d’Égine, sur Onatas, prédécesseur de Phidias, dont il faisait d’ailleurs Jonathas, ce qui donnait par moment à son discours une couleur mi-américaine, mi-biblique ; tantôt il s’élançait dans l’économie politique, il traitait Bastiat d’imbécile, de tête de bois, « ne valant pas plus qu’Adam Smith et tous les physiocrates... »
— « Physiocrates ! murmurait Bambaef après lui, « aristocrates ?... »
Il étonna beaucoup Bambaef par une remarque négligente sur Macaulay qu’il qualifia d’écrivain démodé, dépassé par la science ; quant à Neist et Riehl, il déclara qu’ils méritaient tout juste une mention, et haussa les épaules. Bambaef, à son tour, haussa les épaules. « Et tout cet étalage devant des étrangers, sans raison, au restaurant !... » pensa Litvinof en regardant les cheveux blonds, les yeux clairs, les dents blanches de sa nouvelle connaissance. Il était gêné par ces grandes dents blanches comme du sucre et par le mouvement désordonné de ces mains ; « et sans se dérider une seule fois : malgré tout ce doit être un brave garçon assez naïf... »
Vorochilof se calma enfin ; sa voix sonore et enrouée comme celle d’un jeune coq fléchit un peu...
À ce moment, Bambaef commença à réciter des vers, et faillit de nouveau fondre en larmes, ce qui fit scandale à la table voisine, occupée par une famille anglaise, et déchaîna l’hilarité de deux cocotes dînant à côté, en compagnie d’un vieux monsieur à perruque lilas. Le garçon apporta l’addition et nos amis payèrent.
— Maintenant, une tasse de café et en route ! s’écria Bambaef en quittant péniblement sa chaise. « Ce que c’est tout de même que notre Russie ! » ajouta-t-il avec ravissement en s’arrêtant à la porte et en désignant de sa main rouge et molle ses deux convives...
« Oui, la voilà la Russie » songea Litvinof ; Vorochilof, lui, avait déjà repris son air pénétré ; il sourit avec condescendance et claqua légèrement les talons.
Quelques instants plus tard, ils montaient tous trois l’escalier de l’hôtel qu’habitait Stepan Nikolaevitch Goubaref... Au même moment, une grande femme élégante en descendait rapidement. Une épaisse voilette noire tombait de son chapeau. En apercevant Litvinof, elle s’arrêta comme foudroyée, rougit, pâlit sous la trame épaisse de la dentelle. Litvinof ne s’aperçut de rien et la dame disparut rapidement.
IV
— JE vous présente Grigori Litvinof, un vrai Russe et un chic type, s’écria Bambaef en conduisant Litvinof vers un homme de petite taille, à l’allure de propriétaire terrien, et qui se tenait au milieu d’une pièce chic et bien meublée. Il était chaussé de pantoufles et portait un pantalon gris-clair et une courte vareuse sur une chemise à col ouvert. « Et celui-là, continua Bambaef, c’est Goubaref lui-même, en propre personne ! »
Litvinof dévisagea ce « lui-même en propre personne » avec curiosité, et ne lui trouva au premier abord rien d’extraordinaire. C’était un monsieur d’aspect respectable et légèrement hébété, avec un grand front, de grands yeux, de grosses lèvres, une longue barbe, un cou large et un regard fuyant.. Le monsieur sourit et dit : « Hum !... oui... très bien... je suis ravi... », porta la main à son visage et, tournant le dos à Litvinof, fit quelques pas sur le tapis. Il avait une démarche bizarre qui rappelait le lent balancement des fauves. Goubaref avait l’habitude de marcher de long en large, en tortillant sa barbe du bout de ses ongles longs et durs. Une dame d’une cinquantaine d’années se trouvait dans la même pièce. Elle portait une robe de soie usée, sa figure, jaune comme un citron, était d’une mobilité extraordinaire, un léger duvet noir ornait sa lèvre et ses yeux vifs semblaient vouloir s’échapper de leurs orbites. Un homme corpulent était assis dans un coin, recourbé sur lui-même.
— Eh bien ! honorable Matrena Simonovna, — dit Goubaref en se tournant vers elle, — qu’est-ce donc que vous racontiez ?
Il trouvait probablement superflu de lui présenter Litvinof.
La dame (elle s’appelait Matrena Simonovna Soukhantchikof, était une veuve sans fortune et sans enfants, qui depuis deux ans, traînait de pays en pays), se laissa aussitôt aller à une volubilité passionnée :
— Eh bien ! il va trouver le prince et lui dit : « Votre Grandeur, il vous est facile de m’aider dans votre situation et avec votre nom ; vous ne pouvez pas ne pas respecter la pureté de mes convictions ; est-il possible, à notre époque, de poursuivre quelqu’un pour ses opinions ? » Et savez-vous ce qu’il a fait, ce grand seigneur, cultivé et haut placé ?
— Qu’a-t-il fait ? demanda Goubaref en allumant distraitement une cigarette.
La dame se redressa et, pointant l’index de sa main osseuse :
— Il fit venir son valet et lui dit : « Ôte la redingote de cet homme et prends-là, je te la donne ! »
— Et le valet obéit ? demanda Bambaef en levant les bras au ciel.
— Il obéit et la prit. Et c’est le prince Barnaoulof qui a fait cela, lui, ce gentilhomme, ce gros richard, nanti de pouvoirs extraordinaires, représentant du Gouvernement ! Que nous reste-t-il à espérer, après cela ?
Le corps malingre de Madame Soukhantchikof tremblait d’indignation, son visage se tordait, sa poitrine plate se soulevait par saccades sous le corset étroit ; quant à ses yeux, n’en parlons pas : ils semblaient vouloir sortir de leurs orbites. N’importe quelle conversation, d’ailleurs, les mettait dans cet état.
— Affaire scandaleuse, scandaleuse ! s’écria Bambaef ; et qui mérite un châtiment exemplaire !
— Hum !... hum !... Tout est pourri du haut en bas, remarqua Goubaref sans élever la voix. Ce n’est pas un châtiment qui est nécessaire ici... c’est une autre mesure.
— Mais, voyons, est-ce vrai seulement ? prononça Litvinof.
— Si c’est vrai ! s’exclama Madame Soukhantchikof ; mais il est impossible d’en douter, impossible... Elle prononça ces mots avec une telle force qu’elle en fut toute contractée. « Je tiens ça d’un homme archi-sûr. Mais vous le connaissez d’ailleurs, Stepan Nikolaïtch : c’est Elistratof Capitou. Il le tient de témoins oculaires de cette ignoble scène.
— Quel Elistratof ? demanda Goubaref. Celui de Kazan ?
— Celui-là même. Je sais qu’on l’accusait de toucher de l’argent de certains entrepreneurs et vignerons. Mais qui l’accuse ? Pelikanof. Mais il est indigne de foi ; car tout le monde sait que c’est un espion !
— Permettez, Matrena Simonovna, intervint Bambaef : c’est un ami à moi, comment pourrait-il être un espion ?
— Si, si, c’en est un, pourtant !
— Mais, de grâce, écoutez...
— C’est un espion, un espion, criait Soukhantchikof.
— Mais non, mais non, attendez ; écoutez-moi ! vociférait Bambaef.
— Un espion, un espion ! s’obstinait-elle.
— Non, non ! si vous me parliez de Teutcleef, ça c’est une autre affaire ! hurla Bambaef hors de lui.
Soukhantchikof se tut instantanément.
— Je sais de source sûre, continua-t-il d’une voix calmée, que quand ce monsieur fut appelé par le Deuxième Bureau, il se jeta aux pieds de la Comtesse Blazenkrampf, en la suppliant de le sauver. Jamais Pelikanof n’aurait fait pareille bassesse.
— Hum... Teutcleef..., marmonna Goubaref : il faut s’en souvenir.
Soukhantchikof haussa dédaigneusement les épaules.
— Ils se valent tous, proféra-t-elle ; mais j’en connais une meilleure encore sur Teutcleef. Il était affreusement tyrannique avec ses gens, malgré ses prétentions d’émancipateur. Un jour, à Paris, il rencontra chez des amis Madame Beecher-Stowe, vous savez bien : « La Case de l’Oncle Tom ». Très vaniteux, il demanda à lui être présenté ; mais quand Madame Beecher-Stowe entendit son nom : « Comment ! dit-elle, vous avez osé vous présenter à l’auteur de L’Oncle Tom ? Hors d’ici immédiatement ! » et vlan ! elle lui donne une gifle. Savez-vous ce que fit Teutcleef ? Il prit son chapeau et s’esquiva l’oreille basse.
— Ceci me paraît exagéré, intervint Bambaef. Il est de fait qu’elle lui dit : « Hors d’ici ! », mais elle ne l’a pas giflé.
— Elle l’a giflé, elle l’a giflé ! répéta convulsivement Soukhantchikof ; je n’invente rien. Et voilà vos amis !!!
— Permettez, permettez, Matrena Simonovna, je n’ai jamais prétendu être l’ami de Teutcleef ; je parlais de Pelikanof.
— Si ce n’est pas Teutcleef, c’est un autre : Mitheef, par exemple.
— Et celui-là, qu’a-t-il fait ? demanda avec anxiété Bambaef.
— Ce qu’il a fait ? Comme si vous n’étiez pas au courant ! Il criait dans la rue, à tous les vents, qu’il fallait mettre tous les libéraux en prison. Et ce n’est pas tout ! Un jour, il reçoit la visite d’un vieux camarade pauvre, qui lui demande : « Puis-je dîner chez toi ?... » Et l’autre lui répond : « Non, tu ne peux pas ; j’ai aujourd’hui deux comtes à dîner, fiche le camp !... »
— Mais c’est de la calomnie, voyons ! hurla Bambaef.
— Calomnie ? Calomnie ? C’est le prince Vakhrouchkine qui dînait ce soir-là chez votre Mitheef...