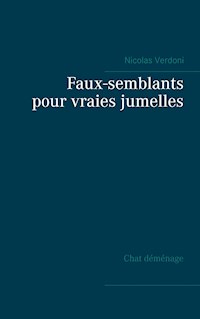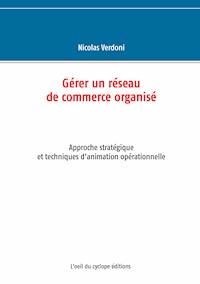
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
On ne crée pas un réseau par hasard. On n'adhère pas non plus par hasard. Ce livre aide les gestionnaires à comprendre les enjeux spécifiques au réseau, à donner du sens à cette entité complexe dans laquelle le facteur humain occupe une place spéciale, à poser un diagnostic adapté au tout et aux individualités, et à déterminer une stratégie pertinente. - une analyse originale de ce qu'est la réalité d'un réseau - une méthode de diagnostic - des techniques d'animation opérationnelle - des exemples concrets
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Jean-Michel C. et Guy H. pour leurs relectures, leurs encouragements et leurs conseils.
« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux »
Montesquieu
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
ère
PARTIE : UN RÉSEAU, POUR QUOI FAIRE ?
La Finalité
La Fonction
La Stratégie
2
ème
PARTIE : LE DIAGNOSTIC DU RÉSEAU
Méthode de diagnostic
L’état de lieux
3
ème
PARTIE : LA GESTION OPÉRATIONNELLE DU RÉSEAU
Le rôle de la tête de réseau
Les leviers d’action de la tête de réseau
La cohésion de réseau
POUR CONCLURE
INTRODUCTION
Le réseau est l’ensemble des intermédiaires de la distribution permettant la commercialisation d’un bien ou d’un service, et parfois même sa promotion.
Être organisé en réseau signifie que plusieurs entités, le plus souvent des personnes morales, décident d’interagir pour créer de la valeur ajoutée, et de lier leurs destins pour tout ou partie de leur activité.
Un réseau est donc un ensemble, un Tout, avec ses règles, son histoire, ses buts, ses moyens, sa culture, sa Direction, ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs, ses arrivées et ses départs, ses méthodes…
Dès lors que l’on examine un Tout, on se doit de considérer non seulement ses individualités, mais aussi, voire surtout, leurs interactions. Nous verrons dans les pages qui suivent que la gestion d’un réseau se conçoit et se fait à plusieurs niveaux. Nier ou sous-estimer les interdépendances est l’une des erreurs les plus courantes commises dans la gestion d’un réseau. Cette idée devra pousser les Directions (tête de réseau) à segmenter leur approche.
Le réseau revêt plusieurs réalités :
→ Une réalité identitaire :
Un réseau a une identité, des valeurs qui sont le socle, et parfois l’argument commercial d’adhésion, des composantes. Des hommes et des femmes ont prennent la décision de créer ou rejoindre un réseau parce qu’ils y voient un intérêt dans la marche en avant de leur entreprise.
→ Une réalité humaine :
L’ADN d’un réseau, aussi techniquement perfectionné soit-il, réside dans les hommes et les femmes qui le composent. Dans leurs expériences, leurs certitudes, leurs craintes, leur grandeurs et leurs petitesses, leur diversité, leurs aspirations, leur courage, leur travail, leurs émotions, leurs rapports à eux-mêmes et aux autres.
C’est ce qui rend l’aventure parfois dure ou ingrate, mais souvent enrichissante et passionnante.
→ Une réalité juridique :
Le contrat qui lie les composantes du réseau diffère selon divers critères. Selon le mode de réseau choisi, les liens entre les composantes sont plus ou moins obligeants, ou agonistes (selon une définition Maussienne). Le degré d’interdépendance entre les parties induit par le choix d’organisation du commerce, implique des obligations réciproques plus ou moins importantes.
Le tableau ci-après synthétise rapidement les principaux types de commerces organisés :
→ Une réalité économique :
Le réseau propose (ou impose) un modèle économique le plus précis possible. Ce modèle décrit la chaine de création de valeur ajoutée de manière plus ou moins exhaustive. Ce principe concerne entre autre les niveaux de prix (et donc de marges), la gamme de produits et services commercialisée, les méthodes, les savoir-faire, les secteurs concédés.
On peut ajouter à ces aspects la notion de notoriété et d’image de marque qui sont des indicateurs plus difficilement quantifiables, mais qui ont un impact réel et déterminant sur la qualité et la performance du réseau.
Affirmer l’identité du réseau, c’est affirmer ce qui le différencie des autres.
En quoi tel ou tel réseau est-il différent d’un autre qui commercialise les mêmes produits ? Est-ce la qualité de ses produits, le dynamisme de sa communication, son maillage territorial et sa proximité avec les consommateurs, son offre de formation ?
Tout réseau doit être appréhendé dans la diversité de ses réalités. Pour tout réseau, il est important d’identifier, analyser et faire vivre ces aspects.
Cela impacte la pérennité du réseau :
- au niveau du développement : donner du sens à l’adhésion, et muscler l’effort de développement en proposant des arguments qui font la différence
- au niveau des adhérents : consolider le sentiment d’appartenance, faire vivre la dynamique, concrétiser les attentes mutuelles formalisées lors de l’adhésion.
En temps que tel, un réseau vit. De manière classique, il a un cycle de vie avec une phase de démarrage, une phase de croissance, une phase de maturité et une phase de déclin.
Le présent livre a pour objet d’aider les gestionnaires de réseau dans leurs analyses, leurs choix et leur actions.
Il n’a pas pour vocation d’apporter uniquement (loin s’en faut) des contenus théoriques, mais de présenter des méthodes, des outils, et des réponses concrètes.
Il décrit des expériences vécues et des méthodes validées, mais aussi des événements entendus ou des analyses benchmarkées.
Par soucis de discrétion, le nom des réseaux utilisés à titre d’exemples n’est pas cité.
Emprunt d’une grande sincérité, cet ouvrage tente par ailleurs de faire adhérer le lecteur à une certaine vision de la réalité humaine de la vie d’un réseau. Gérer les egos, arbitrer les conflits, détecter les mauvaises pratiques, sanctionner, motiver, former n’est pas toujours chose simple.
Nous verrons qu’à l’instar d’un manager, la tête de réseau, en cela qu’elle dirige le réseau, a forcément plus de responsabilités que les adhérents dans la réussite du projet porté par le réseau. Diriger, cela commence par donner la direction, fixer des objectifs, agréger des moyens et mettre en œuvre un plan d’action.
Diriger, manager, c’est placer les autres en situation de performer.
Diriger c’est donc avoir une vision pour le réseau et savoir évoluer et s’adapter. La vérité (ou le postula) du début n’est pas forcément celle du présent et encore moins celle de l’avenir.
Nous tenterons donc dans une première partie de répondre la question : Un réseau pour quoi faire ?
Dans une deuxième partie, nous décrirons une méthode de diagnostic de réseau.
Enfin, la troisième partie abordera la question de la gestion pratique d’un réseau au travers de l’analyse du rôle des différentes composantes du réseau d’une part, et du recensement des leviers d’action du réseau d’autre part.
PREMIERE PARTIE : UN RÉSEAU, POUR QUOI FAIRE ?
Et oui, commençons par répondre à cette question. À quoi sert notre réseau, pour quelles raisons les adhérents le rejoignent-ils ?
1) La Finalité
Répondre à cette question, c’est aborder le sujet de la finalité.
La finalité est la base de tout car elle donne du sens à toute démarche (même dans le champ personnel).
La finalité peut être définie comme étant ce qui constitue le but de quelque chose conformément à une intention humaine.
Posons la question simplement : pourquoi et pour quoi a ton un réseau ?
Le pourquoi (cause) peut être intéressant, mais il n’est selon moi pas fondateur.
Le pour quoi (en deux mots) est à mon sens bien plus puissant. Car une finalité clairement définie et posée permet de concevoir les choses plus facilement. Cette remarque renvoi à la maxime bien connue :
« Il en est des révolutions comme du reste : il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. »
Bien sûr, penser réseau n’a, a priori, rien à voir avec une révolution. Mais allons plus loin dans la formulation :
« Les révolutionnaires sont d’accord sur ce dont ils ne veulent plus. Mais une fois que se posera la question de l'alternative, ils risquent bien d’être perdants car ils ne sont pas d’accord sur ce qu’ils veulent. »
Je propose une formulation négative de cette idée :
À ne pas savoir ce que l’on veut, on est sûr de ne pas l’avoir.
Et une formulation positive en paraphrasant Sénèque :
« Il est des vents porteurs pour qui sait où il va. »
En effet, savoir où l’on veut aller aide à recenser et définir les objectifs (quantitatifs et qualitatifs), les moyens, les priorités et les méthodes.
Combien de diagnostics d’entreprise concluent que l’un des problèmes, si ce n’est le seul, réside dans le manque de vision du Dirigeant, son manque de conscientisation de la finalité de son projet d’entreprise ? Ils sont légions !
Dans mes travaux avec des Dirigeants de PME/TPE, j’aborde dès que cela se justifie, la question de la finalité : Pour quoi faites vous cela ?
Autant dire qu’une réponse vague, incomplète ou lascive, m’alerte. Aucun travail ne pourra produire d’effets concrets, bénéfiques et durables si cette question reste sans réponse précise.
Le premier travail consiste donc à impliquer le ou les Dirigeant sur cette question. J’ajoute qu’à la limite, le reste n’est qu’affaire de techniques, de connaissances disponibles auprès d’experts ou dans des ouvrages spécialisés.
Exemple concret : la finalité est claire.
L’accompagnement que j’ai eu l’occasion de faire auprès d’un jeune (39 ans) Dirigeant de PME a mis en lumière l’importance de l’identification de la finalité.
Je vous le décris.
Nous sommes dans le Lot et Garonne. Cet entrepreneur possède plusieurs sociétés dans le domaine du bâtiment et de l’amélioration de l’habitat. Ses sociétés sont regroupées sous la houlette d’une holding au bilan plutôt rassurant (niveau de fonds propres, niveau de liquidités, etc…). L’une des entreprises du groupe est adhérente à un réseau de vente BtoC, mais le patron n’est plus satisfait des prestations réalisées par la tête de réseau (problème de positionnement produit, de qualité de communication promotionnelle et de notoriété notamment). Lors d’une de nos séances de travail, ce patron me fait part de sa volonté de quitter le réseau auquel il est affilié et de créer son propre réseau régional.
Connaissant mon appétence pour les problématiques de réseau, la demande du Dirigeant tourne autour d’une prestation de conseil sur la stratégie de création et de lancement de son réseau. Demande que j’accepte volontiers.
Nous démarrons nos travaux avec quelques postulas que m’expose le Dirigeant : il veut maitriser son développement et demeurer le plus autonome possible, le financement se fera pour partie sur les fonds propres de la holding et pour partie en recourant à l’emprunt bancaire, le positionnement du réseau sera basé sur la vente de produits à forte marge (61% au compte de résultat) et induira un effort significatif de communication.
Avant de continuer dans le recensement et l’analyse des idées du Dirigeant, je lui pose une première question qui le surprend tout en éveillant une certaine curiosité. La question est : « Quelle est la finalité de ce projet ? Et je la reformule : « Où veux-tu aller avec ton réseau ? »
La réponse est rapide, claire et précise : « Je veux développer un réseau, le rentabiliser, le vendre dans 7 ans ainsi que le reste de mes actifs pour arrêter de travailler.» La finalité est claire : donner un dernier coup de rein pour hâter son départ vers une vie plus oisive.
Cette finalité ainsi exprimée nous a facilité le travail de conception et de lancement de son projet de réseau. Et pour cause ! Le fil rouge a été de déterminer les conditions, les moyens, les ressources et les étapes de la construction du réseau pour atteindre un périmètre de 12 magasins en n+7 et une rentabilité de 5% (résultat net) minimum. Sachant que le prix de vente du réseau (ou plutôt l’entreprise qui l’exploite) serait sans nul doute déterminé par un multiplicateur de l’EBE, nous avons conçu un business plan conciliant le besoin de rentabilité nette et le besoin d’obtenir un EBE conséquent.
Voilà donc pourquoi l’expression de la finalité de ce projet a été si importante. Non seulement elle a permis de recenser les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs, de donner du sens aux actions de court, moyen et long terme et de les séquencer logiquement. Mais aussi, elle nous a permis de déterminer des priorités précises et donc une stratégie adaptée et clairement exprimée.
Exemple concret : la finalité n’est pas consciente
Dans le cadre de mes fonctions d’animateur réseau dans la menuiserie, un Chef d’entreprise me faisait part de son « ras-le-bol » dans la gestion de sa force de vente. Ils répétait : « Ils sont tous nuls, ils ne bossent pas et se contentent de leur MG (Minimum Garanti du VRP). » C’était un discours récurrent. Le Dirigeant était dans un état de colère quasi permanent.
En l’amenant à s’exprimer sur la finalité de son business, il a formulé l’idée qu’en fait il était là pour gagner vite beaucoup d’argent en se versant des dividendes importants (du temps où ils n’étaient pas soumis à charges sociales). Autrement dit, peu importe la méthode (et les problèmes qu’elle engendre), je prends ce qu’il y a à prendre tant que ça marche, et après on verra.
Je lui ai répondu que le problème n’était donc pas les commerciaux, mais lui. Il était la cause de ses problèmes puisque c’était lui et lui seul qui recrutait les commerciaux selon ses critères personnels. Aussi, en replaçant le problème dans une dynamique de finalité, on ne l’a certes pas résolu, mais on l’a replacé dans un contexte général qui l’a relativisé.
Mais je sentais que tout n’avait pas été dit. Par un questionnement adapté, j’ai pu de surcroit faire émerger l’idée que la colère du Dirigeant ne venait pas spécifiquement du comportement de commerciaux et de la non atteinte des objectifs, mais du fait que cette colère découlait avant tout d’un besoin inassouvi du Dirigeant. Ce besoin était centré autour de l’idée qu’il voulait, en quelques sortes, rendre aux autres la chance qui lui avait été donnée lorsque, à 18 ans, jeune apprenti tourneur-fraiseur, un patron de PME lui avait proposé de devenir commercial dans son entreprise de menuiserie (une grande enseigne nationale). Chance qu’il avait su saisir et qui avait suscité chez lui un investissement total dans ses fonctions. Or, il ne retrouvait pas cette implication chez ses commerciaux (et c’était pas faute d’en avoir usé quelques uns…). Sa colère était là : la bêtise de ses commerciaux qui ne savaient pas saisir la chance qui leur était donnée. L’ingratitude de ces jeunes qui n’avaient même pas conscience de l’opportunité qui leur été offerte de se construire une vie meilleure.
Il y avait une finalité double : gagner de l’argent et protéger sa famille pour satisfaire le besoin d’un adulte ayant connu la faim, d’une part ; et rendre à ses collaborateurs la chance qui lui avait été donnée 12 ans plus tôt pour les placer en situation d’atteindre le même objectif d’autre part.
J’ai amené ce Dirigeant à conscientiser sur le fait que ses besoins, aussi respectables soient-ils, n’étaient pas universels et que d’autres (ses commerciaux) pouvaient naturellement avoir des besoins bien différents (bien qu’évoluant dans le même secteur et les mêmes fonctions que lui) d’une part ; et d’autre part sur le fait que la méthode de vente qu’il préconisait avait beaucoup d’avantages, mais avait l’inconvénient de réduire à presque zéro la jugeote des commerciaux. Tout était écrit, prémâché, à apprendre par cœur. Alors pas étonnant que les individus qui la mettaient en œuvre n’aient pas, dans leur immense majorité, le recul nécessaire, la finesse d’analyse, pour s’approprier les leviers psychologiques de leur patron.
Nous en avons conclu que 2 options se présentaient :
- option 1 : il ne change rien à sa méthode (commerciale) court-termiste, mais dans ce cas, il ne déplore plus que l’efficience et la mentalité de ses commerciaux ne soient pas celles qu’il espérait
- option 2 : il change de méthode (voire de culture) commerciale, il recrute de commerciaux plus impliqués, sachant mettre en œuvre une méthode de vente faisant appel à d’avantage d’autonomie, de recul et privilégiant une relation au temps et au client plus « mature » inscrite dans le moyen terme.
Cela s’est soldé par une tentative non réussie de changement de méthode (car le Dirigeant, assez mono culturé lui-même, ne voulait pas changer), et finalement une pérennisation de la méthode d’origine. Quitte pour le Dirigeant à prendre sur lui par rapport aux carences et déficiences de ses commerciaux. L’expression d’une finalité précise et consciente lui avait permis de ne rien changer… mais de savoir pourquoi. Et donc de faciliter l’acceptation des problèmes engendrés par cet immobilisme.
2) La Fonction du réseau
Certains définissent la fonction d’un réseau comme consistant () « à réduire l’incertitude dans les échanges entre ses membres. Dans un réseau l’information se multiplie par l’échange. Nous ne sommes donc pas dans une logique morale (je donne parce que c’est bien), mais dans une logique rentable (je donne pour recevoir plus en retour). Ainsi le réseau est le seul lieu où la rentabilité rejoint la morale. »
Le réseau crée du lien entre toutes ses composantes.
Pour l’adhérent, on peut retenir trois motivations à rejoindre un réseau :
- sécuriser son démarrage. Baliser le « grand saut » dans l’entreprenariat par l’accès à l’appui stratégique et méthodologique fourni par la tête de réseau
- accéder à une garantie de succès. Succès découlant de l’offre de la tête de réseau en matière de notoriété, de visibilité, de moyens, de méthodes, de supports, de produits, et de connaissance du marché,…
- accéder à des échanges intra réseau. Echanges avec la tête de réseau, mais aussi avec les autres membres. Lors de la visite de l’animateur, quel adhérent ne demande pas des nouvelles du réseau, des informations sur ce qui marche, sur les fameuses « bonnes pratiques », des raisons expliquant le succès de tel ou tel adhérent, l’ordre du jour de la prochaine réunion régionale ?
Exemple 1 : l’indépendant décide d’adhérer au réseau
Imaginons l’entreprise artisanale MARTINOT qui existe depuis 56 ans. Elle a été fondée par un passionné revendiquant le titre de MOF (Meilleur Ouvrier de France) dans son domaine qui est la fourniture et la pose de carrelage haut de gamme. Son fils puis son petit fils ont repris l’activité avec autant de passion que le fondateur. Ils ont toujours cultivé une certaine indépendance notamment dans leur approche commerciale basée sur le bouche à oreilles. La clientèle de l’entreprise est essentiellement composée de professionnels (prescripteurs, maitres d’œuvre et maitres d’ouvrage). L’entreprise est prospère, connue et reconnue, structurée, le turnover des personnels est inexistant grâce à un management humain et proche des collaborateurs.
C’est alors qu’il prend la décision d’accorder enfin un rendez-vous au développeur réseau qui le démarche depuis 1 an. « Ca ne mange pas de pain », se dit-il… Le développeur lui expose lors du R1 le concept du réseau en utilisant la méthode C.A.B.A. (nous l’examinerons plus loin dans ces pages). Convaincant, le développeur parvient à ouvrir le champ des possibles pour Christian. L’entreprise peut continuer d’exister mais doit pour cela revisiter son business model. Un marché s’ouvre à l’entreprise : le particulier en rénovation, ses avantages (marché plus stable que le professionnel en neuf, risque commercial dilué, marges plus importantes). Un réseau lui procure ses moyens (force de vente, communication, méthodes, formations, notoriété etc…). Christian poursuit le process et adhèrent au réseau 3 mois après.
Qu’est-il venu chercher ?