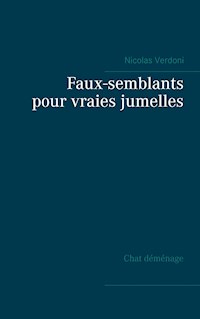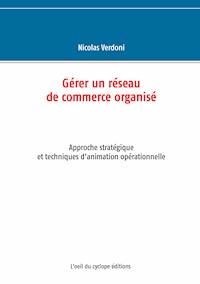Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Voici un livre témoignage. Loin d'être une vérité absolue ou une formule créée pour se différencier, l'idée que la vente est un sport de haut niveau est l'expression d'un regard laudatif qui revisite "l'art d'influencer pour convaincre". Ce livre procure aux praticiens de la vente ou à ceux qui s'intéressent à ce sujet, les clés d'une réussite personnelle qui conjugue performance et épanouissement. La vente n'est pas un métier banal. Pour réussir il faut mobiliser les mêmes compétences et le mêmes ressources que celles d'un sportif de haut niveau. La plus puissante et la plus pérenne de ces ressources n'est autre que le commercial lui-même. Découvrez au fil des pages comment le commercial devient maître de ses actions et garant de sa réussite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE :
AVANT PROPOS
1
ère
PARTIE : RÔLES ET ENJEUX DU COMMERCIAL
1.1 Les enjeux du commercial
1.2 Un commercial ça sert à quoi ?
1.3 Un commercial ça fait quoi ?
1.4 Un profil type du commercial
2
EME
PARTIE : LEVIERS D’ACTION DU COMMERCIAL
2.1 La posture
2.2 La confiance
2.3 L’influence
2.4 Le pouvoir
3
EME
PARTIE : LES 4 AXES DE DIFFÉRENTIATION
3.1 La Problématique
3.2 Les Personnes
3.3 Le Processus
3.4 La Proposition
POUR FINIR
AVANT-PROPOS
La vente est sport de haut niveau. Pourquoi donc proposer pareille assertion ?
Parce que je pense que c’est vrai, la vente est réellement un sport de haut niveau.
Dans son document « Référentiel de compétences du sportif de haut niveau ou professionnel », l’Agence Nationale du Sport, créée en 2019, identifie 10 savoir-être du sportif de haut niveau qui sont : adaptabilité, ambition, concentration, contrôle de soi, créativité, fiabilité, persévérance, réactivité, résilience et rigueur. Ils sont tous transposables à l’activité commerciale. Tous. Ce même document propose une définition de la compétence : « La compétence du sportif de haut niveau est entendue comme la combinaison et la mobilisation d’un ensemble approprié de ressources personnelles (connaissances, savoir-faire, savoir-être…) et de ressources externes (collègues, experts, autres métiers, bases de données, bibliographies…) pour gérer un ensemble de situations de référence dans un contexte donné, afin de produire des résultats satisfaisant à certains critères de performance. » On peut dans cette définition aisément remplacer sportif de haut niveau par commercial sans que cela ne gêne. D’ailleurs, ils sont légion les sportifs, anciens ou encore en activités, qui font des conférences en entreprise pour apporter leur vécu et le transposer aux défis de leurs auditoires.
La vente est un métier parce qu’elle désigne l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel, en vue d'une rémunération, ou encore, selon le Larousse, la vente est une « activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc… » Et en tant que métier elle exige des savoirs, des savoirfaire et des savoir-être spécifiques en lien avec son objet.
Ce qui différencie le métier de la vente de bien d’autres métiers, c’est selon moi l’incertitude. Pour imiter la maxime attribuée à Platon je dis : ce qui est sûr, c’est que rien n’est sûr. Car la vente intègre une dimension d’incertitude liée à sa nature même. Qui peut être sûr de vendre et de continuer à vendre ? Même les types de vente basés sur des process récurrents, comme par exemple les contrats renouvelables (assurance, maintenance, prestations diverses, etc…), les abonnements (téléphone, box TV, titres de transports en commun, etc…), les baux commerciaux, ou autres, incluent dès leur conception des modalités de fin de contrat ou de rupture anticipée.
Le mieux pour vendre c’est de savoir qui veut acheter quoi. Dans ce registre, on distingue souvent deux types de marketing : le marketing de l’offre, dont l’objet est d’identifier les cibles et segments de clientèles envisageables pour une offre existante, et le marketing de la demande qui analyse le marché pour tenter de comprendre ce qu’il veut en vue de le lui fournir.
La vente n’est pas troc ou échange car la vente consiste en une prestation ou une livraison moyennant contrepartie financière. L’argent est donc une donnée consubstantielle de la vente et avec l’argent s’ouvre le champ des possibles, des excès et des phantasmes, des filouteries et des escroqueries, des émotions comme de la froide raison.
Il est vrai aussi que la vente, pas sa nature, met en jeu des mécanismes relationnels dans lesquels un ou plusieurs de ses protagonistes peut se surimpliquer émotionnellement ou pécuniairement. Cette surimplication, quelle qu’en soit la manifestation, pourra, de fait, faire l’objet d’une exploitation orientée, pour ne pas dire inappropriée ou immorale.
Mais on ne saurait décemment résumer la vente à ce type de pratiques.
Il en va de la vente comme du reste, certains praticiens sont dans l’excellence, d’autres dans la performance et d’autres dans une espèce de somnolence, voire de défiance. Pour certains la vente est une fin, pour d’autres un moyen.
A l’heure où j’écris ces lignes, même si les algorithmes prennent une place croissante dans les transactions, la vente demeure un phénomène humain impliquant des humains entre eux. La place centrale de l’humain dans le processus de vente accrédite l’idée que l’ensemble des caractéristiques humaines entre en ligne de compte dans les rouages d’une opération de vente.
L’humain est capable du pire comme du meilleur (moralement s’entend), et la vente n’échappe pas à cette caractéristique. En cela qu’elle est d’essence profondément humaine la vente est elle aussi capable du pire comme du meilleur. Il existe donc logiquement un spectre qualitatif qui va d’une version restrictive, bas de gamme, moyennasse, de ce processus, à une version plus aboutie, plus complète, plus exigeante, ou encore, plus inspirante. Et ça n’est, toujours selon moi, pas une question de diplôme, d’intelligence, de statut, de hiérarchie ou de secteur d’activités. C’est une question d’engagement, de croyances, de motivation, de sens, de recherche, d’auto affirmation. Alors peut-être peut-on s’autoriser, aussi surprenant que cela puisse être, à lier vente et désir spinozien, vente et expression de l’effort humain pour déployer sa propre existence. La vente pourrait alors être perçue comme l’une des expressions du conatus.
Le sujet ici n’est pas de « philosopher » sur la vente, mais d’introduire l’idée que la vente ne se résume pas aux clichés, trop souvent péjoratifs, qu’elle véhicule. L’activité commerciale peut, et finalement doit, proposer la meilleure version d’ellemême. Une version moderne, enrichie des expériences et constats qu’une analyse, une pratique, ou les deux, permettent. Une version constructive, créative, épanouissante, solide, et éthique.
Alors, comment faire ?
En connaissant, en comprenant, et en faisant.
Chacune de ces 3 idées fera l’objet d’une partie de ce livre.
En première partie, connaitre consistera à analyser le rôle et les enjeux du commercial. En deuxième partie, comprendre s’attachera à montrer quels sont les leviers d’action du commercial au travers de la posture, de la confiance, de l’influence et du pouvoir. Et enfin en troisième partie, nous examinerons les 4 axes de différenciation au travers de la méthode des 4P.
Mais avant cela je souhaite partager quelques constats.
Je travaille au quotidien depuis presque 20 ans avec des forces de vente, et cette fonction de consultant en performance commerciale me permet d’observer ce qui se fait, d’entendre ce qui se dit, de constater ce qui est constatable, et de livrer ce qui est commandé.
La vente c’est sérieux, c’est même dans le Code Civil à l’alinéa premier de l’article 1582. C’est un processus dont l’objet est la recherche d’une décision entre un vendeur et un acheteur, décision par laquelle l’acheteur obtient le transfert à son profit de la propriété d’un bien ou d’un service, contre le versement au vendeur d’un prix en argent. En cela on l’a vu, elle n’est pas troc ou échange car la nature même de la convention entre le vendeur et l’acheteur est basée sur l’argent. Elle n’est pas non plus négociation puisque la négociation est la recherche d’un accord, notamment par un jeu de concessions et de contreparties, entre plusieurs parties qui ont des intérêts divergents. On peut donc vendre sans négocier, mais pas négocier sans vendre.
Il existe bon nombre de types de vente différents : vente aux particuliers/vente aux professionnels, vente directe/vente indirecte, vente transactionnelle/vente relationnelle, vente physique/vente en ligne, vente au détail/vente en gros, vente de service/vente de produit, vente provocatrice, vente collaborative, vente sociale, etc, etc...
Tous ces types de vente ont certes des différences (parfois uniquement dans l’esprit de leur inventeur, mais c’est une autre histoire) mais aussi et surtout des points communs. Quel que soit le contexte, le marché, la méthode, la cible, le produit, la technologie, le canal, la vente reste dans tous les cas l’art d’influencer pour convaincre.
Cela fait de la vente une activité parfaitement comparable à bien d’autres. Au même titre que d’autres, elle nécessite des compétences, des appétences, des savoirs, de la formation, du cadre, de la méthode, de la dynamique, de la volonté, de la technique, de l’écoute, de l’empathie, de la curiosité, du zèle, de l’entrainement, de la remise en question, etc... En un mot : du travail.
Et comme la vente est comme le reste, alors elle en a les mêmes caractéristiques : elle change, elle évolue, s’amende, se cabre, se défend, se perd, se retrouve, se cherche. Elle n’est plus entièrement ce qu’elle a longtemps été et n’est pas encore totalement ce qu’elle sera peut-être longtemps. Dans un monde où changement rime avec chamboulement, il y a un défi particulièrement prégnant qui réside dans la capacité des Hommes et des structures à imaginer le sens et le contenu de la fonction commerciale. Stress inhibant pour certains, stimulant pour d’autres, cette situation impose à ses acteurs d’accepter que les solutions d’hier ne sont pas celles de demain, ni même celles d’aujourd’hui, voire même celle de cet après-midi. Les solutions, quelles qu'elles soient, semblent toutes avoir en commun d’être court-termistes. Or cette difficulté à imaginer l’avenir, à se projeter vers une situation future améliorée, représente la première source de stress et d’égocentrisme.
En matière de changement ce qui est important c’est de se poser des questions et de se poser les bonnes : qu’est-ce qui change ? Comment se manifeste le changement ? Où se situe mon seuil de perception du changement ? À quel type de changement avons-nous affaire ? Quelles sont les conséquences du changement ?
Le changement est une dynamique naturelle et, on peut le penser, perpétuelle, à laquelle tout et tout le monde est confronté. L’idée n’est pas d’éviter le changement ou de faire comme s’il n’existait pas ; mais bien plus de le considérer pour ce qu’il est, tout en essayant d’en être l’acteur pour l’orienter, ou a minima un spectateur qui en retire un certain bénéfice.
Le changement n’est pas monolithique, il y en existe de différents types. Je vous propose donc une approche à 2 niveaux : changement de type 1 et changement de type 2.
• à quel type de changement avons-nous affaire ?
Cette question de la nature du changement est peu ou pas assez posée. Or, elle est fondamentale. La réponse à cette question permet de cibler et adapter notre conduite du changement. Je dis bien conduite, car le changement n’est pas un phénomène que l’on subit par essence. On peut (et parfois on doit) décider de changer, ou encore d’accompagner un changement dont nous ne sommes pas à l’origine. L’expression « conduite du changement » n’est pas un oxymore idéaliste, mais bien plus une décision proactive.
La théorie générale des systèmes (Ludwig von Bertalanffy) et la cybernétique (Norbert Wiener) ont mis en évidence dans les années 1950 une distinction dans les natures de changement des systèmes complexes. Grégory Bateson, dont les travaux ont donné naissance à l’approche de Palo Alto, s’est appuyé sur ces réflexions afin de mieux comprendre l’évolution des personnes ou des systèmes humains qu’elles composent. Il a parlé de deux types de changement : le changement de type 1 et le changement de type 2.
La recherche de solution face à un phénomène de changement ne doit pas faire l’économie de l’examen du type de changement.
Alors, 1 ou 2 ?
Le changement de type 1 est celui qui répond à la question : qu’est-ce que je dois changer pour que rien ne change ? Ce changement déploie des solutions pour revenir à une situation ou un équilibre antérieur au changement. Il est l’expression manifeste d’une résistance au changement dans la durée. Il n’y a pas à proprement parler de transformation des mentalités ou des modes de relations. Les efforts menés permettent de s’accommoder, de s’adapter aux évolutions de l’environnement ou d’une situation.
Exemple (très prosaïque) : je suis dans une pièce chauffée à 20 degrés et la température de mon corps est à 36 degrés. Je dois sortir et la température extérieure est de 5 degrés. La question est : que dois-je faire pour que, malgré le changement de 20 à 5 degrés, mon corps reste à 36 degrés ?
Réponse A : ne pas sortir.
Réponse B : sortir et résister le plus longtemps possible, quitte à faire des grands moulinets avec mes bras, courir, taper dans mes mains.
Réponse C : sortir en mettant un manteau.
Réponse C, évidemment.
Mettre un manteau constitue une réponse facile, logique et accessible et permettra de revenir à la situation antérieure une fois que l’on sera sorti dehors.
Dans ce cas la résistance au changement est faible ou inexistante. Le changement de type 1, se caractérise par un degré d’ouverture important au départ du projet. Degré qui décline au fur et à mesure du temps qui passe car, dans le fond, les pratiques restent les mêmes.
Le changement de type 2 répond quant à lui à la question : qu’est-ce que je dois changer pour le Tout change ? Ce type de modification remet en cause les acquis tant personnels qu’organisationnels. Il modifie les équilibres, et les façons de faire avec l’environnement, qui ont prévalus avant le changement.
On trouve de nombreuses organisations qui souhaitent voir leurs collaborateurs prendre des initiatives et faire preuve d’autonomie, mais moins qui parviennent à produire ce type d’évolution. Un changement de type 2, avec une telle demande, doit amener l’encadrement à repenser son rôle et sa manière d’être en relation avec ses collaborateurs. Un tel type de changement modifie la répartition habituelle du pouvoir, débloque les statuquo et fait apparaître des fonctionnements inconnus jusque-là.
Les changements de type 2 viennent transformer la culture des individus ou des organisations qui les développent. Contrairement au changement de type 1, ils entraînent un faible degré d’ouverture au changement à l’origine du processus. Cependant cette ouverture va croissant chemin faisant.
Pour faire le lien entre changement et commercial, je décris cette situation vécue il y a quelques années.
Je suis à cette époque consultant pour un réseau national de vente de menuiseries au particulier. Je me trouve dans l’un des magasins du réseau et je discute avec un commercial. Ce dernier me dit en substance qu’il est de plus en plus dur de vendre et que cela vient globalement du fait que les clients ont changé, les produits ont changé et les concurrents ont changé. Ce à quoi je réponds : « Et toi, as-tu changé ? ». Fin de la discussion, début du travail.
Ce court exposé a pour intention d’introduire l’idée majeure que le changement, important ou pas, est omniprésent et que ça risque de durer.
Racontons une histoire, celle de Jean-François. Jean-François né en août 1935, à Béziers dans l’Hérault. Dernier enfant d’une fratrie de 3, il grandit au soleil du midi entre ses deux soeurs, sa mère très présente et son père grand capitaine d’industrie. La vie est simple, la famille ne manque de rien. Jean-François est entouré de l’amour des siens. Il va à l’école, fait ses devoirs et aide dès qu’il le peut sa maman à préparer les repas. Il est heureux comme peut l’être un bambin dans une famille unie. Il n’a pas encore 4 ans lorsqu’il apprend un nouveau mot : guerre ; et par encore 5 quand il apprend défaite, humiliation, occupation. Juin 1940, la France est balayée par l’armée allemande. Le temps s’est figé, comme si quelqu’un avait mis un soldat de plomb dans un engrenage de l’horloge du premier étage. Béziers est en zone libre, mais Jean-François apprend encore un nouveau mot : privation. Puis, c’est en 1942, un 11 novembre il s’en souvient, que les boches passent pour la première fois devant la porte de la maison de la famille. Jean- François a 7 ans, il les trouve raides et pas rigolos du tout. Il apprend de nouveaux mots : couvre-feu, pénurie, rationnement, délation, collaboration, dénonciation, torture, « papire biteux », « chnel ». La nourriture manque, l’essence aussi. Les chaussures ne sont plus ressemelées on met du carton dur à la place, les vêtements difficilement reprisés. L’école est fermée parce que le professeur ne vient plus, on ne sait pas trop ce qu’il est devenu, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. On mange moins et moins bien, on ne voit plus trop les copains ni la famille. On se débrouille, on s’adapte, on invente des nouvelles recettes avec moins d’ingrédients, on imagine des choses nouvelles. Maman a planté un potager au fond du jardin. Parce qu’il fallait trouver de la place pour mettre les légumes de saison, elle a sacrifié les rosiers que sa propre grand-mère avait plantés, là près de la lavande et le romarin. C’est maman qui fait la classe à ses 3 enfants pendant que papa fabrique et vend des gros trucs très compliqués à des gens très très sérieux. Et puis vient ce jour de 1944, 3 jours avant son anniversaire, où Béziers se vide de ses allemands. Il fait beau, le vent souffle mais pas trop. Le temps se relance. On fête, on jubile, on chante, on s’embrasse, on s’aime. Jean-François comprend alors ce qu’il entendait quand les grands parlaient ou quand son père écoutait cette radio qui faisait un bruit bizarre : libération, vie nouvelle, espoir, de Gaulle, résistance. Petit à petit la vie reprend un cours normal. Jean-François retrouve ses camarades P’tit Louis et Gabin. Ses soeurs sont de nouveau coquettes, les garçons trouvent ça encourageant. Sur le fronton de la mairie il y a un drapeau tricolore, comme avant, quand les frilolins n’étaient là pour nous empêcher d’être heureux. Tout n’est pas rose, y’a qu’à demander à cette famille dont les 2 oncles et 3 cousins ne sont toujours pas revenus, mais Jean-François s’en moque un peu, il n’y peut rien et puis ce qu’il veut c’est vivre comme avant, vivre tout simplement. Il dit que plus tard il sera comme son père, un grand ingénieur et qu’il construira des avions qui iront très très haut dans le ciel et même peut-être l’espace. Il dit aussi qu’il est content que tout ça ait changé. Il en avait marre de pas trop rigoler. Il reçoit un colis de son cousin de Carcassonne. Dedans il y a des biscuits. Ils sont secs parce que le colis a été envoyé il y a 2 mois, mais qu’est-ce que c’est bon des biscuits. Ses premiers depuis 2 ans. Secs ou pas, il les dévore. Puis vient ce jour d’août 1949, c’est le départ pour la capitale. Pas celle de sa région, non ; celle de la France : Paris !
Nous sommes tous des Jean-François. Candide gamin ou adultes responsables, nous sommes tous confrontés au changement. Ce qui est arrivé à Jean-François, cette paix balayée par une guerre inéluctable et une défaite minable, puis le retour à la joie et l’espérance, nous le vivons tous. Jean-François n’a pas fait les mêmes choses avant la guerre et pendant la guerre. Lui, sa famille et des millions de personnes se sont adaptés au changement.
La concurrence économique croissante apparente le passé à un doux temps de paix. Combien de commerciaux est-ce que j’entends dire : « Quand j’ai commencé, il suffisait de… et maintenant c’est plus difficile. » On ne fait pas les mêmes choses en temps de paix qu’en temps de guerre. Le concept de guerre économique reflète le climat actuel (et pas nouveau) dans lequel agissent les forces de vente qui deviennent de ce fait des armes au service de l’atteinte d’objectifs.
Parce que c’était la guerre, Jean-François a changé, et les autres, ceux qui n’ont pas accepté de changer, l’ont payé cher. Dans le commerce comme ailleurs, ne pas changer représente un risque qu’il est bien trop aventureux d’assumer. Changer est un devoir, une réalité, une opportunité.
PREMIÈRE PARTIE : RÔLES ET ENJEUX DU COMMERCIAL
Faisons tout de suite une nuance : le vendeur vend, il réalise un acte de vente ; le commercial quant à lui vend, mais travaille aussi en amont de la vente (il prospecte), et en aval de la vente (il fidélise). Le rôle du commercial étant plus étendu, il requiert des profils plus complets que pour des vendeurs.
On peut cependant souligner que certaines forces de vente sont organisées en 2 populations plus ou moins distinctes : les éleveurs et les chasseurs. Les premiers exploitent un portefeuille de clients, les seconds sont centrés sur l’acquisition de clients.
On peut aussi identifier différents titres qui correspondent à des fonctions et des périmètres précis : commercial, chargé de clientèle, ingénieurs d’affaires, attaché commercial, technicocommercial, etc...
Le Commercial Grands-Comptes (Key Account Manager, ou KAM) est souvent perçu comme le commercial le plus prestigieux. Il requiert en effet des compétences particulières liées à la « vente complexe ».
1.1 Les enjeux du commercial
L’enjeu c’est que l’on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose.
Si l’on adhère à l’idée de l’importance capitale du rôle du commercial, alors on conclut facilement que les enjeux du commercial sont très importants.
L’enjeu pour le commercial est d’assurer une quantité et une qualité de travail dans la durée. Il est d’identifier ses priorités et adapter son effort commercial. Il est d’être efficient (rapport entre que l’on fait et ce l’on obtient) et d’optimiser son travail, c’est-à-dire obtenir le meilleur résultat possible de chacune de ses actions.
Pour y parvenir, le commercial doit conjuguer des contraintes d’un côté, avec des zones de (relative) liberté d’un autre côté.
1.2.1. Les contraintes
Ce sont les obligations créées par les règles en usage dans un milieu, ou par les lois propres à un domaine, ou encore par une nécessité.
Retenons que la contrainte représente tout élément restreignant ou orientant la liberté d’action du commercial.
On peut distinguer les contraintes personnelles, celles qui sont liées à l’individu et à sa sphère privée ; et les contraintes professionnelles, celles qui sont liées à l’entreprise et son environnement.
L’entreprise n’a pas de responsabilité directe concernant la première catégorie, mais elle peut cependant en tenir compte pour partie. La prise en compte des contraintes extra professionnelles est une décision importante puisqu’elle introduit des paramètres nouveaux, et moins maitrisables dans la gestion du collaborateur. La prise en compte d’éléments de la sphère privée représente un risque mais est parfois quasi incontournable dans les entreprises où l’emploi est en tension.
Il est à noter que l’évolution récente montre que les candidats ou les nouveaux entrants sur le marché du travail, prennent en compte, voire imposent, leurs contraintes (ou aspirations) personnelles dans le processus de recrutement, et plus généralement dans leur vision de la sphère professionnelle.
La prise en compte, ou le niveau de prise en compte, représente en soi un acte managérial fort.
1.2.2. Les zones de liberté
On peut affirmer que dans l’immense majorité des configurations ou organisations, le commercial bénéficie de zones de liberté assez importantes. Appelons-les : autonomie.
Cette remarque ne vaut pas pour la vente dite « one shot », c’est-à-dire dont le but est de vendre le plus cher possible dès le premier (et seul) rendez-vous. Ce type d’approche commerciale impose une mono pensée quasi totale : une seule façon de faire, une seule façon d’être, une seule façon de parler, de se présenter, de faire le pdm (passage de main), etc…
Dans ce cas il n’y a qu’un seul axe : prospecter au maximum en vue de créer du contact actif, créer l’urgence (pour qu’il n’y ait pas de concurrence et donc pas de possibilité de comparer), se mettre en scène, faire une grosse remise commerciale en utilisant le passage de main, vendre, et si on ne vend pas s’autoriser la « politique de la terre brûlée ». La méthode devient caricaturale, et, au fond, très enfermante. Le commercial n’a aucune autonomie, ou pour être plus précis, il est maintenu en phase de dépendance (voir plus bas).
Revenons aux autres, ceux qui ont des zones de liberté et leur corollaire l’autonomie : ça se mérite.
L’autonomie peut se décrire comme un cycle (Katherine Symor).
L’individu passe par 4 phases successives.
Si on les examine dans le milieu professionnel on peut distinguer :
1) LA DÉPENDANCE : La responsabilité incombe à l’autre. Ce premier stade procure sécurité, protection, cadre et règles de vie. Il présume aussi de la reconnaissance positive ou négative. C’est la période d’apprentissage. La jeune recrue est formée, prend connaissance des process, s’éveille à la singularité de l’entreprise. Elle s’approprie les méthodes internes de travail.
2) LA CONTRE DÉPENDANCE : le collaborateur se construit et affronte sa hiérarchie. Symbolisée par l’adolescence et ses révoltes typiques, la contre dépendance est aussi un état de besoin, mais un besoin d’agir de manière autonome. Pour autant, la personne n’a pas encore les moyens de sa dépendance. Elle s’informe et cherche, ellemême, de nouvelles ressources, aiguise son sens de la critique et engage son libre arbitre. Cette période se caractérise par des refus, des oppositions. Bref, la voix s’élève contre l’autorité. Le collaborateur se construit, il apprend à assumer ses responsabilités et ose sa solitude. Un jeune premier soucieux de balayer les vieilles pratiques commerciales désuètes se place clairement au stade de la contre dépendance.
3) L’INDÉPENDANCE : le professionnel s’affirme et s’épanouit. Phase de l’expérimentation, l’indépendance favorise la prise de risques et la validation des acquis. Le cordon de la tutelle est coupé. Le junior ne sollicite plus ses aînés, il teste ses limites, explore de nouveaux systèmes. C’est en les découvrant que le passage au niveau supérieur se fera. Le collaborateur prend conscience de ses valeurs et façonne son unicité. Il prend la responsabilité de ses choix, décisions et de ses résultats. À l’instar de son manager, il accepte l’erreur comme partie intégrante du processus d’apprentissage et de l’indépendance. En effet, il doit sentir le soutien de sa hiérarchie dans cette prise d’autonomie. Véritable étape de séparation et de maturité avancée, elle se traduit parfois par une démission et le démarrage d’une nouvelle aventure professionnelle.