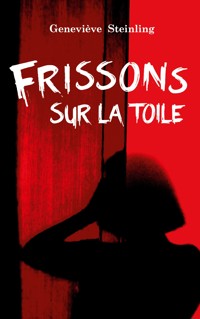Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Fuyant un père tyrannique et malveillant, Marie-Jeanne rencontre un homme qui l'héberge et prend la place de sa fille disparue. Deux années s'écoulent pendant lesquelles elle circule librement dans toutes les pièces de la maison excepté au grenier, lieu qui lui est interdit. Parfois, quand elle est seule, elle entend du bruit qui vient de là-haut. Un jour, elle monte. Un roman captivant qui tient en haleine jusqu'à l'étourdissante révélation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Diana, ma fille Pour toi
Sommaire
Dans le Jura – 1978
En région parisienne – 1978
En région parisienne – 1979
En région parisienne – 1980
Dans le Jura – 1980
Bibliographie
Dans le Jura – 1978
Le vent était glacial.
La voix grave et solennelle du curé ressemblait à une chanson triste, je l’écoutais à peine, trop occupée à observer le jeu de la mouche posée sur ma main et qui me ramenait au noir de ma vie.
Mes yeux redessinaient le ruban adhésif scotché au plafond de la cuisine sur lequel tous ces insectes s’agglutinaient, pris au piège.
Ça bourdonnait dans ma tête...
La mort s’était emparée de mon père, la vraie mort, celle que l’on ne peut nier et j’ai fait le rapprochement avec cette autre mort, invisible et sournoise, celle qui vous fait croire que vous êtes vivants : vous bougez, vous parlez, vous respirez mais vous êtes morts à l’intérieur, tout ça parce que quelqu’un vous a rendus si insignifiants que vous êtes là à vous demander si vous existez vraiment.
La ronde infernale du passé m’a rattrapée.
Et je me suis apparue.
J’ai presque huit ans.
C’est le jour de la rentrée des classes.
J’étrenne une jupe plissée à carreaux jaunes sur fond gris et un pull noir, tous deux achetés spécialement pour l’occasion. Aux pieds, je porte des chaussettes en laine couleur ocre dans des bottines en cuir qui sentent le neuf. Les deux nattes serrées qui tombent derrière mes oreilles arrivent à mi-hauteur de mon dos. Ma mère s’est particulièrement appliquée à les tresser. À l’extrémité de chacune, elle a noué un ruban vichy jaune et blanc.
La veille, elle a ciré mon cartable en cuir, celui que je traînerai jusqu’à la fin de ma scolarité. Elle l’a lustré avec un chiffon doux. Il brille et dégage une odeur de miel.
C’était devenu le rite de chaque veille de rentrée des classes. Ma mère donnait à ce jour une importance particulière, il était primordial que je fasse bonne impression, je devais paraître aux yeux de la maîtresse une petite fille propre et bien élevée, il en allait de sa réputation et de celle de notre famille.
« C’est pas parce qu’on est pauvre qu’on n’est pas des gens bien », qu’elle disait.
Je revois ses yeux qui voyagent sur moi.
Après chaque détail minutieusement inspecté, elle me dit :
— On dirait un sou neuf. Tu peux y aller ! Et fais attention à tes chaussures, ne les salis pas !
Comme je ne réponds pas, elle insiste :
— Tu entends ?
— Oui, maman, je te le promets.
Elle me tend un goûter, un morceau de pain avec une barre de chocolat noir et termine par :
— Allez ! Va maintenant !
Elle oublie de m’embrasser. J’ai le cœur gros.
— Viens ! me dit mon frère en me prenant la main.
Pendant la pause de midi, il nous fallait faire vite car vingt minutes de marche séparaient notre maison de l’école. De plus, comme notre mère mettait un point d’honneur à ce que ses enfants ne soient pas en retard, nous arrivions en avance et nous attendions patiemment que les grilles de l’école s’ouvrent.
Hors de question de nous plaindre.
Le plus dur, c’était en hiver.
Le cercueil était en place, prêt à combler la fosse. Vêtu d’une aube blanche sur laquelle était posée une étole violette, le curé ressemblait à une moitié d’aubergine. Il lisait le livre de rituel des funérailles.
Tous l’écoutaient.
Sauf moi.
Je remontais le temps.
Je me souviens du soir de cette première journée de classe, je suis fière, je n’ai pas sali mes chaussures. Quand en fin de journée, je regagne la maison, mes chaussures sont aussi propres que le matin. Je les troque contre des pantoufles.
Le curé a élevé la voix.
Mes yeux se sont posés sur le cercueil.
Mon père était à l’intérieur. Il n’en sortirait pas. Plus jamais, il ne me ferait du mal. J’aurais pu en rester là mais le souvenir de ce premier soir de rentrée scolaire refusait d’être enterré avec lui et je suis repartie dans le passé.
Mon père m’observe par la porte de la cuisine restée ouverte en grommelant :
— Quelle note, aujourd’hui ?
Je fais la sourde oreille, il me repose la question avec impatience et agacement :
— Alors, quelle note ? Tu deviens sourde ou quoi !
Je devais absolument dire quelque chose qui lui convienne, je me rappelle avoir menti.
— Je n’ai pas eu de note mais j’ai levé le doigt, la maîtresse m’a interrogée et j’ai répondu juste.
Il n’a pas cherché à en savoir davantage. Je le revois bouger la tête de haut en bas et de bas en haut. Il paraît content.
Le sujet est clos.
Mon père ne s’éternisait jamais sur le programme scolaire. Et pour cause ! C’est à peine s’il savait lire et quand il écrivait, il ne pouvait mettre bout à bout deux mots sans les émailler de mille et une fautes d’orthographe, il ignorait les accents, confondait le verbe être conjugué au présent de l’indicatif avec la conjonction de coordination. Il écrivait comme on prononce.
Un jour, mon frère et moi avions ri - à ne plus pouvoir nous arrêter - après avoir lu le papier que mon père avait punaisé sur la porte des WC du fond du jardin. Il avait écrit « vidé le sot ».
Personne n’osait s’aventurer à lui faire la moindre remarque. Et surtout pas sa femme ! Elle savait, qu’écorché dans son amour-propre, il se serait vengé en la rabaissant plus bas que terre devant le premier venu Il devait malgré tout s’apercevoir de ses lacunes car il clamait haut et fort qu’il était « plus maths que lettres ».
Il déléguait à ma mère les tâches administratives en lui faisant croire que cette responsabilité était une faveur qu’il lui accordait.
Mon père gardait jalousement la gestion des comptes. Il calculait mentalement à une vitesse prodigieuse, il faut dire qu’il jouait souvent à la belote et son cerveau était entraîné à compter les points. Tout comme Georges, Léon et Marco, il était l’un des piliers du café de la grande place.
Contrairement à lui, ma mère avait acquis une certaine culture, non pas qu’elle ait fait de grandes études mais elle avait toujours suivi les cours avec assiduité. Elle avait obtenu le Certificat d’Etudes Primaires avec des notes plus qu’honorables, ce qui lui avait valu de poursuivre son cursus scolaire dans une école ménagère catholique tenue par des religieuses. Elle y avait appris à coudre, tricoter, repasser, cuisiner et surtout à user de bonnes manières. À la fin du cycle, elle s’était présentée à l’étude de Maître Sironato avec une lettre de recommandation de la Mère Supérieure et elle avait été engagée sur le champ. Deux ans plus tard, elle rencontrait celui qui allait devenir son mari. Il réparait la toiture de la maison du curé. Il l’avait sifflée. Une jeune fille bien éduquée ne devait pas se retourner. Elle l’avait ignoré ; il l’avait attendue devant la porte cochère.
À l’époque elle était jolie, fraîche et pas encore abîmée ; lui, n’a jamais été beau ni féru de savoir-vivre pourtant elle l’a épousé. Trouver un mari en ce temps-là était encore une fin en soi. Il fallait assurer la descendance.
Il y a eu Christian.
Il y a eu moi.
****
Ce soir-là, ce premier jour de rentrée scolaire, je déballe le contenu de mon cartable sur la table de la cuisine, c’est là que nous faisions nos devoirs. Je couvre mon livre de lecture avec du papier bleu indigo et je m’applique à coller une étiquette blanche en haut à droite. Dessus, j’écris au stylo bille Marie-Jeanne Schmitt. Je souligne mon nom au crayon rouge avec la règle. Le trait que j’ai tracé est droit. Je suis fière.
Ma mère s’affaire à ses fourneaux.
Il commence à faire nuit dehors. Mon père entre dans la pièce, ferme les volets et allume le plafonnier. Le repas est prêt. Je range mes affaires. Christian s’installe à table à côté de moi devant la place inoccupée et réservée à ma mère. Mon père s’assied en face de moi.
Chacun sa chaise. L’assise paillée était garnie d’une fine galette en tissu vert. Traitement de faveur : mon père avait droit, en plus, à un coussin couleur safran. Ce siège prenait pour moi emblème de trône : mon père était le seigneur des lieux, je lui devais obéissance et satisfaire ses moindres désirs.
La pièce avait une odeur particulière due aux émanations des glandes sébacées du chien qui avait fait de cette pièce son territoire.
Mais ce soir-là, l’odeur a quelque chose d’inhabituel à cause des saucisses fumées - qu’on appelle chez nous « Belle de Morteau » - qui mijotent dans la casserole au milieu des lentilles, pommes de terre et carottes.
D’un coup, le curé m’a ramenée dans le moment présent.
Il venait de dire :
— Repose en paix.
Ainsi, il suffisait de mourir pour que la vie de chacun soit blanchie ?
Ma respiration s’est accélérée, mon cœur s’est emballé.
J’ai crié :
— Non !
Le curé a sourcillé.
Ma mère m’a regardée et a baissé la tête.
Mon frère a marmonné entre ses dents :
— Qu’est-ce qui te prend ?
Je les ai ignorés et j’ai enjambé la barrière du temps.
Chaque détail est revenu.
Les images se sont reconstituées l’une après l’autre, les mots se sont plaqués sur elles.
Le film s’est remis en marche.
Ma mère partage le plat. Chacun mange de bon appétit. Quand les assiettes sont vides, il reste une saucisse dans la casserole.
Mon père demande qui la veut.
Ma mère fait non de la tête.
Christian semble repu, il se tait.
Je lance timidement :
— Moi !
— T’as encore faim ? s’étonne mon père.
— Oui.
Il s’adresse à sa femme :
— Pour la rassasier, donne-lui le restant des patates d’hier.
— Je les avais gardées pour le chien, répond ma mère.
— Si elles sont bonnes pour le chien, elles sont bonnes pour elle aussi.
Mon père était grand, du moins je le voyais grand à cette époque, par la suite, j’ai appris qu’il ne mesurait qu’un mètre soixante-dix.
La petite fille que j’étais le trouvait laid et gros. Ses doigts courts et larges se terminaient par des ongles souillés taillés au carré. Ses yeux soulignés de poches malaires attestaient son penchant pour l’alcool. Le tissu adipeux de ses joues relâchées entrainées vers le bas butait sur les extrémités de sa lèvre supérieure. Quand il buvait trop, la couleur de sa peau s’harmonisait avec le vin rouge de mauvaise qualité qu’il ingurgitait. C’est à cette période que ses cheveux noirs ont commencé à virer au gris. Les jours où il ne se rasait pas, il ressemblait à l’ogre du Petit Poucet.
Je me demandais parfois s’il ne s’était pas échappé de mon livre de contes. J’étais persuadée que cet homme-là ne pouvait être mon père.
Je revois ma mère, petite, menue, effacée et obéissante, se lever pour aller jusqu’à la gazinière réchauffer les pommes de terre de la veille.
Elle les pose dans mon assiette.
Elle les avait réservées pour le chien mais son mari venait de décréter qu’elles étaient pour moi alors soit, on ne discutait pas les ordres de Roger Schmitt.
Tant pis pour le chien !
Je regarde avec envie la saucisse. Je sens les yeux de mon père posés sur moi, je lève la tête plus haut, les mouches sont là, engluées sur le ruban adhésif.
Les bestioles à moitié ou complètement mortes sur le papier tue-mouches imprégné de colle et d’une substance empoisonnée m’écœuraient. C’était toujours ce même dégoût qui me gagnait.
Je connaissais leur fonctionnement par cœur, elles essayaient de reprendre leur liberté en se débattant de leurs ailes mais très vite, elles se résignaient à mourir.
Quand le ruban était noir de tous ces cadavres, mon père le brandissait devant mes yeux, je hurlais, il riait comme un débile.
Je repensais à cet épisode de mon enfance et l’intérieur de mon corps me brûlait, il devenait un volcan en éruption avec une remontée de bile, un goût amer et qui fait mal. Je me trouvais dans cette cuisine contrainte à manger les pommes de terre alors que la saucisse me faisait saliver.
L’image de mon père s’impose.
Il s’empare de la louche de service, se sert une montagne de lentilles encore chaudes qu’il engloutit en une fraction de seconde.
Les pommes de terre posées dans mon assiette sont à peine tièdes, elles sont sèches, d’un jaune anémié et elles sentent le rance. Je les mange toutes pour éviter la colère de mon père pour le cas où j’aurais laissé ne serait-ce qu’une demie moitié de patate.
Mon père rote sans retenue.
Il rit la bouche ouverte. Je le regarde, il cesse mais c’est pour mieux vociférer.
Il pousse un rugissement guttural et me dit :
— T’as encore faim ?
L’odeur de la charcuterie restée dans la casserole titillait mes narines au point que déjà le goût des pommes de terre avait disparu.
— Alors, tu réponds ! T’as encore faim ? Oui ou non ?
Je lui réponds « oui » dans un mouvement lent de tête, les yeux collés sur la casserole.
— Georgette, tu n’as pas un bol de soupe qui traîne par là ?
Ma mère va jusqu’au buffet en chêne récupéré de chez ma grand-mère.
Dedans, elle avait entreposé le bol contenant un reste de soupe de la veille à côté du beurre, du lait et du camembert.
Nous ne disposions pas de réfrigérateur. Le chef de famille n’en voyait pas la nécessité et puis il était du genre à se plaindre « qu’il lui manquait le sou pour faire le franc ». C’était une de ses expressions favorites.
Le cercueil était devant moi mais je ne le voyais pas. J’entendais à peine les prières du curé. J’étais là sans être là.
Je me rappelle cette odeur si particulière quand ma mère ouvrait la porte du buffet.
L’arôme piquant des épices variées posées sur une des étagères me revient encore aujourd’hui. Il se confondait avec celui des gouttes de lait qui avaient caillé, du camembert qui coulait, d’une moitié d’oignon de la veille, des cubes de bouillon déshydraté.
Je revois ma mère récupérer la soupe. Elle soulève l’assiette posée sur le bol en guise de couvercle et donne un petit coup avec son doigt, sans doute venait-elle d’écraser une araignée.
Le chien jappe, son maître lui ordonne de se taire.
— Pas la peine de réchauffer la soupe ! ordonne mon père. Marie-Jeanne a faim et quand on a faim on ne fait pas la « fine mouche ».
Parfois, il s’embrouillait dans son soi-disant savoir et prenait un mot pour un autre. Il avait appuyé lourdement sur les deux derniers pour défier sa femme. Ça voulait dire : tu vois, moi aussi, je sais parler comme dans les livres.
Ma mère lui jette un œil sans rien dire.
Puisqu’il parlait de mouche, j’ai eu peur soudain que l’une d’elles se soit noyée dans la soupe et se glisse incognito à l’intérieur de ma gorge.
Ma mère me tend une grosse cuillère.
Je remue la soupe en examinant l’intérieur du bol, je ne vois aucun intrus, je suis soulagée et je commence à manger.
Je surveille en même temps les mouches qui sont collées au tue-mouche en me persuadant qu’aucune ne pourra s’échapper et tomber dans mon bol. L’autosuggestion a ses limites et, par deux fois, j’ai un haut-le-cœur.
— T’as encore faim ? me demande mon père.
Mon ventre était prêt à exploser.
— Non.
— Dommage !
Il attrape la saucisse avec ses doigts et la dévore en deux coups de crocs.
Je fixe mes yeux sur lui.
— Baisse tes yeux !
Ils restent grands ouverts.
Mon père fulmine :
— Baisse tes yeux, je te dis !
Je ne l’écoute pas, je pense à la saucisse.
— Tu sais ce qui t’attend ? Oui ? Tu le sais ?
J’opine de la tête.
Et ce que je redoute arrive, il me dit :
— Ce soir, tu viendras dans ma chambre.
Le chien a aboyé.
****
La chambre de mes parents était aménagée sans goût : lit de deux personnes en teck vernis, la tête plaquée contre le mur ; de chaque côté, une table de nuit et face à la fenêtre, l’armoire à boutons dorés. Le désordre était omniprésent car la chambre servait aussi de pièce à coudre. La machine de marque Singer siégeait au milieu d’une coiffeuse à tiroirs. Elle était placée entre une bougie blanche, sur laquelle était collée une décalcomanie représentant l’apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous et un flacon d’eau bénite de la Grotte de Massabielle. Tous les deux étaient des cadeaux de madame Michanin, notre voisine, à ma mère pour la remercier d’arroser ses plantes vertes en son absence. Une fois par an, elle accompagnait son mari criblé de rhumatismes jusqu’à Lourdes espérant qu’un miracle s’opère.
Ma mère gardait l’eau précieusement. Elle nous interdisait d’y toucher et nous racontait qu’elle avait le pouvoir de nous brûler les doigts si nous nous en servions. Christian et moi en avions une peur bleue à tel point que, petits, les jours d’orage, quand elle répandait son élixir dans les pièces de la maison, nous nous cachions sous la table de la cuisine.
L’éducation dispensée par les religieuses dictait les faits et gestes de notre mère. Croyante et pratiquante jusqu’à l’excès, elle avait planté un Crucifix sur le mur de sa chambre, de celle de Christian et de la mienne.
Chaque année, le dimanche des Rameaux, elle achetait du buis sur le parvis de l’église. Elle le faisait bénir par le curé et remplaçait les branches, intercalées entre chaque Crucifix et le mur, par de nouvelles, toutes belles, toutes vertes, au pouvoir de protection tout neuf. Elle ne jetait pas les anciennes à la poubelle.
— On ne met pas à la poubelle ce qui a été béni, nous affirmait-elle.
— Pourquoi ? lui avais-je demandé un jour.
— Parce que c’est comme ça !
Elle faisait brûler le buis, de l’année précédente, le jour du mercredi des Cendres (fête religieuse qui suit le mardi gras et qui débute le Carême dans la religion catholique) et dessinait une croix sur notre front avec ses doigts imprégnés de cette poussière puis elle jetait le reste dans le jardin.
Je ne lui ai jamais demandé ses motivations car au fond, je pense qu’elle accomplissait ce rite sans trop savoir pourquoi. Les choses devaient se faire ainsi : accepter sans comprendre. Elle se limitait à n’être que femme au foyer humble et docile, soumise au maître des lieux.
À l’époque je trouvais ça normal aussi, maintenant quand j’y repense, je déplore son manque d’ambition tout en admettant que le Mouvement de libération de la femme n’était qu’à son tout début.
Madame Michanin, dont la maison comportait une cheminée, jetait les branches de buis au feu, récupérait les cendres et les éparpillait au pied de son cassissier qui « recevait la bénédiction du Seigneur ». Elle se vantait de posséder dans son jardin le plus bel arbuste de la région même si le nôtre pouvait largement le concurrencer.
Christian et moi, nous nous goinfrions des petites baies violettes de notre cassissier. Entre nous, nous les appelions les FCC parce que notre mère nous répétait que le fruit était riche en Fer, en vitamine C et en Calcium. Nous n’avions cure, bien évidemment, de ses propriétés, ce que nous aimions, c’était juste son goût.
Quant à madame Michanin, si elle avait planté un cassissier, c’était uniquement pour en récupérer les feuilles et les infuser en tisane. Elle obligeait son mari à boire son breuvage chaque soir avant de se coucher.
— Bon pour tes rhumatismes ! lui répétait-elle.
Et elle ajoutait :
— Sans sucre. Sinon, gare au diabète !
— Oui, oui, répondait la voix lasse de monsieur Michanin.