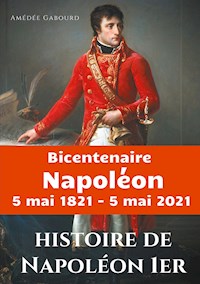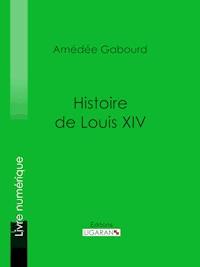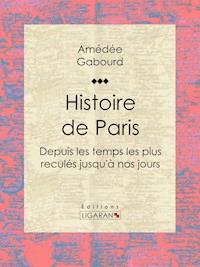
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Histoire de Paris est un ouvrage incontournable pour tous les passionnés de la capitale française. Écrit par l'historien Amédée Gabourd, ce livre retrace de manière captivante l'évolution de Paris à travers les siècles. De l'époque gallo-romaine à nos jours, l'auteur nous plonge au cœur de l'histoire de la ville lumière, en nous dévoilant ses grandes figures, ses événements marquants et ses transformations architecturales.
Grâce à une plume fluide et documentée, Amédée Gabourd nous transporte dans les rues de Paris, nous faisant revivre les grands moments qui ont façonné son identité. De la construction de la cathédrale Notre-Dame à la Révolution française, en passant par les grands travaux haussmanniens, chaque période est décrite avec précision et passion.
Que l'on soit amateur d'histoire, touriste curieux ou habitant de la capitale, Histoire de Paris est un ouvrage qui permet de mieux comprendre et apprécier la richesse et la diversité de cette ville emblématique. Avec ses nombreuses illustrations et ses anecdotes savoureuses, ce livre est une véritable invitation à plonger dans le passé de Paris et à en apprécier toute la grandeur. Une lecture indispensable pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la fascinante histoire de la ville de l'amour.
Extrait : ""Avant d'aborder le récit des faits historiques nous croyons indispensable de placer ici quelques détails sur le sol et le climat de Paris ; nous mentionnerons les conditions topographique dans lesquelles cette grande capitale se trouve placée, les rivières traversent ou la baignent, la configuration de son bassin et ses collines."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335012316
©Ligaran 2015
HISTOIREDE PARIS
Avant d’aborder le récit des faits historiques nous croyons indispensable de placer ici quelques détails sur le sol et le climat de Paris ; nous mentionnerons les conditions topographiques dans lesquelles cette grande capitale se trouve placée, les rivières qui la traversent ou la baignent, la configuration de son bassin et de ses collines.
Paris est situé sur les deux rives de la Seine et occupe aujourd’hui une surface de plus de sept mille hectares ; la région septentrionale est plus considérable que l’autre ; les parties de la ville que sépare le fleuve forment deux vastes demi-cercles, appuyés l’un et l’autre sur la Seine.
La ville actuelle s’élève dans une vallée que terminent du côté de l’ouest, du sud et du nord, des collines inégales et accidentées, dont quelques-unes aboutissent au fleuve par un plan incliné, tandis que d’autres dominent de grands plateaux. La ligne méridienne de l’observatoire de Paris est un point de départ et donne zéro pour longitude ; la latitude septentrionale est d’environ quarante-huit degrés, cinquante minutes. Le climat est sain et tempéré ; les froids les plus rigoureux atteignent très rarement vingt degrés centigrades ; les plus fortes chaleurs ne dépassent jamais trente-huit degrés. La moyenne donne par année cinquante-sept jours de chaleur, cinquante-huit de gelée, douze de neige, cent quatre-vingts de brouillard et cent quarante de pluie. La quantité d’eau qui tombe, année commune, est de cinquante-trois centimètres. Les hivers sont longs, les printemps humides et froids, les étés chauds et les automnes d’une beauté remarquable. Le sol se compose de marnes, de craies, et sa base est formée de calcaire marin grossier dont les bancs énormes environnent Paris et se prolongent, par la rive gauche, jusques aux bords de la Seine. Le fleuve passe à travers une vallée formée de dépôts de sables, de cailloux roulés, de terrains d’atterrissement et de transport. Par-delà les collines du nord s’étend une plaine très fertile et qui est comme le jardin potager de la ville. Du calcaire siliceux, des sables rouges et du grès, de l’argile et des marnes marines complètent cette énumération des principales formations dont se compose le sol de Paris et de ses environs. La Seine coule à Paris avec une vitesse ordinaire de quarante-deux centimètres par seconde ; la largeur moyenne du fleuve est de cent quatre-vingt-huit mètres, et sa pente de deux mètres trente centimètres. L’eau de la Seine est de bonne qualité et sert à tous les usages domestiques.
Un peu au-dessus de la ville la Marne se jette dans la Seine. Une très petite rivière, large à peine de trois mètres, et qu’on appelle la Bièvre, traverse les quartiers de la rive gauche, du côté de l’est, et vient déverser dans le fleuve, vers le quai de l’Hôpital, ses eaux empuanties par de nombreux établissements de blanchisseurs, de tanneurs et de teinturiers. Il existait deux autres ruisseaux moins considérables qui arrosaient les environs de cette ville et en rendaient les abords marécageux au nord et au sud ; ces cours d’eau ont disparu pour faire place à des habitations et à des cultures, et servent tout au plus à alimenter l’un des égouts de la ville, lorsqu’ils ne sont pas absorbés par les carrières a plâtre ou par l’arrosement des jardins
La contrée dans laquelle s’élève Paris est peut-être, au témoignage de Cuvier, l’une des plus remarquables qui aient été observées, par la succession des divers terrains qui la composent et par les restes extraordinaires d’organisation ancienne qu’elle recèle. Des milliers de coquillages marins, avec lesquels alternent régulièrement des coquillages d’eau douce, en font la masse principale ; des ossements d’animaux terrestres entièrement inconnus, même par leur genre, en remplissent certaines parties. D’autres ossements d’espèces considérables par leur grandeur, et dont nous ne trouvons quelques congénères que dans des pays fort éloignés, sont épars dans les couches les plus superficielles. Un caractère très marqué d’une grande irruption venue du sud-est est empreint dans les formes des corps et dans la direction des principales collines.
Le savant illustre à qui nous empruntons ces observations décrit en ces termes la composition des collines groupées sur la rive droite : La longue colline qui s’étend, dit-il, de Nogent-sur-Marne à Belleville, appartient entièrement à la formation gypseuse ; elle est recouverte, vers son milieu, de sables rouges, argilo-ferrugineux, sans coquilles, surmontés de couches de sables agglutinés, ou même de grès renfermant un grand nombre d’empreintes de coquilles marines… Cette disposition est surtout remarquable dans les environs de Belleville et au sud-est de Romainville ; le grès marin y forme une couche qui a plus de quatre mètres d’épaisseur. – Cette colline renferme un très grand nombre de carrières qui présentent peu de différence dans la disposition et la nature de leurs bancs. L’escarpement du cap qui s’avance entre Montreuil et Bagnolet n’est pris que dans les glaises, les bancs de plâtre de la première masse s’enfonçant sous le niveau de la partie adjacente de la plaine, qui, dans cet endroit, est un peu relevée vers la colline, et qui s’abaisse vers le bois de Vincennes. Les marnes qui recouvrent la première masse ont une épaisseur de dix-sept mètres ; la marne verte qui en fait partie a environ quatre mètres. On y compte quatre lits de sulfate de strontiane ; on voit un cinquième lit de ce sel pierreux dans les marnes d’un blanc jaunâtre qui sont au-dessous des vertes, et, peu après ce cinquième lit, se rencontre la petite couche de cythérées ; elles sont ici plus rares qu’ailleurs, et mêlées de petites coquilles à spire qui paraissent appartenir au genre spirorbe. Les autres bancs de marne ne présentent d’ailleurs rien de remarquable ; la première masse a neuf à dix mètres d’épaisseur.
« En suivant la pente méridionale de la colline dont nous nous occupons on trouve les carrières de Ménilmontant, célèbres par les cristaux de sélénites que renferment les marnes vertes et par les silex mélinites des marnes argileuses feuilletées. Ces silex se trouvent à environ quatre décimètres au-dessus de la seconde masse, par conséquent entre la première et la seconde. Enfin à l’extrémité occidentale de cette colline sont les carrières de la butte Chaumont. »
Cuvier ajoute encore :
« La butte Chaumont, qui est le cap occidental de la colline de Belleville, n’est point assez élevée pour offrir les bancs d’huîtres, de sables argileux et de grès marins qu’on observe à Montmartre. Nous avons dit qu’on trouvait le grès marin près de Romainville ; nous ne connaissons les huîtres que dans la partie de la colline qui est la plus voisine de Pantin, presque en face de l’ancienne seigneurie de ce village ; on les trouve à six à sept mètres au-dessous du sable, et un peu au-dessus des marnes vertes : c’est leur position ordinaire. »
(Nous ne saurions trouver des indications plus exactes, sur la formation et la nature du sol dans le département de la Seine, que dans l’intéressant ouvrage publié par MM. Cuvier et Brongniart sur la Géographie minéralogique des environs de Paris. À l’exemple de Dulaure nous résumons les traits principaux de cette exploration scientifique.)
Le fond de la plaine de Pantin présente des bancs de gypse, et la colline de Montmartre se compose de couches analogues ; on y remarque, en descendant du sommet à la base, des bancs de sable et de grès quartzeux, un banc de sable argileux, des bancs de marne calcaire et de marne argileuse de diverses couleurs, à travers lesquelles on rencontre de nombreux amas de coquilles marines. Au-dessous de ces bancs, dont l’ensemble atteint une épaisseur de vingt-trois mètres, on trouve une énorme masse de gypse marneux entremêlée de couches de marne calcaire et qui est exploitée par les plâtriers. Se présentent ensuite, successivement, plusieurs autres couches gypseuses, de différents aspects et de diverses natures, se terminant par une couche de craie argileuse, épaisse de huit à neuf mètres. Par-delà cette colline de Montmartre la chaîne des buttes calcaires se continue en s’abaissant jusqu’à Passy, et les bancs calcaires se prolongent au-delà d’Auteuil, en présentant des masses de douze à treize mètres.
Sur la rive gauche de la Seine le plateau qui domine le fleuve est percé de carrières dans une multitude de points et fournit le plus grand nombre de pierres employées dans les constructions de Paris ; il comprend la partie méridionale de Paris et s’étend de l’est à l’ouest depuis Choisy jusqu’à Meudon. La Bièvre le sépare en deux petites régions : celle de l’est forme la plaine d’Ivry, celle de l’ouest la plaine de Montrouge et les collines de Meudon. Le plateau de la plaine d’Ivry se prolonge, au nord, dans Paris, jusqu’à l’extrémité orientale de la rue de Poliveau ; le plateau de Montrouge s’avance dans la partie méridionale de la ville, et ses bancs forment une ligne qui, après avoir atteint l’extrémité du Muséum d’histoire naturelle, suit les rues Saint-Victor, des Noyers, des Mathurins, de l’École de Médecine, des Quatre-Vents, de Saint-Sulpice et de Sèvres, jusqu’à Vaugirard. Jusqu’à cette limite les bancs calcaires marins ont peu de solidité, et sont minces, marneux et friables. Après une masse de trois mètres d’épaisseur, composée de dix-huit lits de marne calcaire et argileuse, on trouve, dans les carrières situées entre Vaugirard et Montrouge, des bancs considérables de formation marine, abondants en coquilles de diverses espèces. Entre ces deux bancs existe une couche de calcaire marneux. Sur la rive gauche de la Seine les couches du sol diffèrent fort peu, dans leur ordre et par leur nature, de celles qui composent le sol de la partie septentrionale de Paris. Une vaste superficie de quartiers et de rues, entre le boulevard Saint-Germain et Montrouge, et depuis le Muséum jusqu’à la barrière de Vaugirard, repose sur d’immenses carrières dont les plus connues sont les caves de l’Observatoire et les Catacombes. Un géologue, explorateur expérimenté du bassin de Paris, M. Radiguel, estime que l’emplacement de cette ville, avant l’époque diluvienne, c’est-à-dire avant que la Seine n’y eût creusé son lit actuel, formait un plateau d’environ cent quatre-vingt-quatre mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer et faisait suite aux hauts plateaux de Versailles. Vint la grande inondation diluvienne, dont les courants entamèrent le vaste plateau parisien et finirent par former la grande coupure dont la Seine actuelle occupe le fond.
Le creusement de la vallée s’étant arrêté à six mètres au-dessous de la place du parvis Notre-Dame, point qui n’est plus élevé que de vingt-quatre mètres au-dessus de la mer, c’est donc de cent soixante mètres de profondeur à peu près que les courants ont creusé, pendant la période diluvienne, le plateau qui existait primitivement à l’endroit où l’on a bâti Paris. On a constaté, par les rapports des couches de terrains qui les composent, que les buttes de Belleville, de Montmartre et du mont Valérien, sont les débris de ce plateau primitif, et la révolution qui les a isolées, en donnant naissance au cours actuel de la Seine, date du dernier âge géologique, celui où se sont déposés les terrains diluviens, plus communément nommés alluvions, qui nous supportent.
Lorsque, à la suite de creusements successifs et répétés, le fond de la vallée de la Seine se fut abaissé au niveau des plateaux inférieurs de Montrouge, Bicêtre, Bercy, Vincennes, les courants ne charrièrent plus guère que du caillou provenant, soit des débris des meulières des plateaux supérieurs, soit des fragments siliceux de la craie de Champagne, dénudée aussi par l’action des eaux. Aussi n’est-ce pas sur ces plateaux que l’on exploite de préférence le caillou pour l’empierrement des routes, pour le macadam des rues et le béton des constructions. Les derniers courants qui achevèrent de creuser la vallée de la Seine ne transportèrent plus que des graviers et des sables ; la preuve nous en est fournie par ces nombreuses sablières que l’on trouve presque exclusivement au fond de la vallée, et d’où l’on extrait tout le sable qui sert au pavage, au macadam et à la bâtisse.
Chacune des couches du terrain diluvien a sa valeur agricole spéciale ; ce sont les plus caillouteuses, comme celles du plateau de la Grand-Pinte, que les maraîchers recherchent principalement pour y établir leurs cultures, et cela par la raison bien simple que ce sol a la propriété d’emmagasiner le jour la radiation solaire pour en restituer la chaleur aux plantes pendant la nuit. Les pépiniéristes, au contraire, choisissent de préférence les pentes douces des coteaux revêtus de limons diluviens ; c’est là surtout que prospèrent les plantations de jeunes arbres dont les racines pénètrent profondément dans un sol riche où l’eau ne séjourne pas.
Nous venons de mentionner l’utilité industrielle des cailloux charriés et des sables accumulés en immenses sablières par les courants diluviens ; il est une autre roche de la même provenance dont l’importance industrielle est plus considérable encore ; nous voulons parler de la meulière, cette pierre silicieuse, grisâtre ou brune, riche en ciment calcaire, qui a la singulière propriété d’offrir avec un faible poids une résistance supérieure. Son nom lui vient de ce qu’on l’emploie à faire des meules pour moudre le blé, qu’on exporte jusqu’en Amérique ; on ne fait servir a cet usage que les blocs les plus considérables. Les fragments de moindre dimension sont très recherchés pour le parement des constructions solides, telles que ponts, viaducs, forts et bastions. La meulière a été d’un emploi très utile dans la construction des fortifications de Paris. On choisit principalement pour cet usage la plus légère, celle qui est perforée de la plus grande multitude de trous et d’anfractuosités, en raison de ce qu’elle charge peu les murs et se lie très bien au mortier. La meulière compacte est la plus estimée pour les constructions souterraines et hydrauliques. Charriée par les courants de l’époque diluvienne, la meulière se trouve par bancs interrompus dans ses principaux gisements, toujours situés au milieu des sables ou de l’argile. Le bassin de Paris a pour ainsi dire le monopole de ces gisements, et principalement les départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne.
Les grès, qui abondent dans le bassin de Paris, servent de couronnement à des masses de sables fins et blancs de quarante à cinquante mètres d’élévation. Dans la vie domestique on les emploie au récurage des ustensiles de cuisine et on s’en sert pour sabler les appartements. Dans l’industrie ils servent à la fabrication du verre et au moulage ; mêlés avec de la terre glaise ils entrent dans la composition de la brique. C’est au-dessous de ces gisements de sables que se trouvent, par masses épaisses, les glaises vertes, qui sont aujourd’hui d’un si grand usage dans la briqueterie ; elles sont aussi fort employées dans la poterie.
Des couches inférieures on tire plusieurs substances utiles d’un emploi spécial ; ainsi on trouve à Montmartre la strontiane sulfatée qu’on fait entrer dans la composition des fusées d’artifice pour les colorer en beau rouge. C’est aussi du sol de Paris que provient cette argile marneuse, appelée terre à foulon, ayant la propriété d’absorber les corps gras et dont font usage les dégraisseurs pour enlever les taches des étoffes. Enfin on extrait encore diverses substances en usage dans les arts pour le polissage des métaux et des bijoux.
Les marnes qu’on rencontre à cet étage sont très employées en agriculture pour l’amendement des terres. La marne calcaire, qui s’émiette à l’air et à la gelée, offre une abondante ressource pour la fabrication d’une chaux hydraulique fort recherchée pour les constructions. La marne argileuse est employée dans la poterie et la verrerie.
Le gypse, appelé aussi pierre à plâtre, est presque entièrement composé de sulfate de chaux ; par la calcination du gypse on obtient le plâtre, qui, délayé dans l’eau, sert, dans la maçonnerie, à enduire les murs ou à cimenter les pierres. On sait que cette pâte en séchant acquiert une dureté presque égale à celle de la pierre.
Mélangé avec de la colle forte il constitue le stuc et prend le poli du marbre. On emploie le plâtre le plus fin, provenant du gypse feuillet, à prendre des empreintes et à faire des moulures. Ce dernier est un gypse cristallisé en grandes lames.
Au-dessous du gypse se trouvent des lits de marnes si calcaires qu’on pourrait les prendre pour de la chaux grasse ; du reste, comme engrais, elles pourraient presque en tenir lieu. Plus bas viennent les sables moyens, aussi fins que les sables supérieurs, mais plus argileux. À ces sables se trouve mêlée une argile plastique susceptible de cuire sans se fendre et que les poêliers emploient à la confection des fours ; c’est pour cette raison qu’on l’appelle terre à four.
L’étage inférieur est occupé par le calcaire grossier, dont l’épaisseur n’est pas moindre de vingt à vingt-cinq mètres ; on y trouve une foule de matériaux propres à la construction : moellons pour la maçonnerie courante, pierres d’appareil, liais pour les sculptures, etc. Le liais est une pierre calcaire dure et d’un grain très fin, qui est une production spéciale des carrières des environs de Paris, et notamment de Saint-Cloud et d’Arcueil. C’est avec du liais de très belle qualité qu’ont été faits les bas-reliefs de la fontaine des Innocents et qu’a été construite la chapelle de Versailles.
La série des terrains tertiaires finit par un important gisement d’argile plastique très fine, et, comme telle, très précieuse pour la céramique ; les parties les plus grossières de cette argile servent à la fabrication d’excellentes tuiles.
Enfin la dernière couche, la couche la plus profonde des terrains exploitables du bassin de Paris, est la craieblanche, qui forme sous cette ville un énorme banc de deux cent vingt mètres d’épaisseur. Ce banc, qui constitue le territoire de la Champagne, vient affleurer le sol, tout près de Paris, au bas Meudon, par exemple, et à Bougival. Cette craie est un carbonate de chaux presque pur.
En ce qui concerne le fleuve qui traverse Paris, son niveau, pris au zéro du pont de la Tournelle, est de trente-trois mètres au-dessus de la mer, et l’élévation moyenne du sol au-dessus de ce niveau est de vingt-deux mètres. Cette élévation est due, en grande partie, aux travaux humains, le terrain marécageux des bords du fleuve ayant été considérablement exhaussé pour devenir habitable et surtout pour l’établissement des ponts. On en trouve la preuve dans les anciennes chaussées que des fouilles ont fait découvrir à cinq ou six mètres du sol actuel, et dans la situation de certains édifices, où l’on n’arrivait jadis que par de nombreux degrés et qui se trouvent à peine aujourd’hui au niveau du sol. C’est aussi à la main des hommes qu’est due la plus grande partie des inégalités du terrain, comme les boulevards, formés des anciens remparts, les buttes Bonne-Nouvelle et Saint-Roch, formées de dépôts d’immondices, etc.
La Seine déborde rarement ; cependant, depuis que les montagnes où elle prend naissance ont été déboisées, depuis que les marais qui la bordaient jadis ont été desséchés, enfin depuis que le fond de son lit s’est successivement exhaussé, elle garde un niveau moins égal que dans les anciens temps ; mais ses débordements ne présentent plus rien de redoutable depuis qu’elle est enfermée dans deux hautes murailles de pierre infranchissables.
Un cours d’eau artificiel, le canal Saint-Martin, traverse les quartiers septentrionaux de la ville et unit la Seine au canal de l’Ourcq ; c’est la deuxième partie du canal de la Seine à la Seine, dont la première partie est le canal Saint-Denis. Nous le décrirons plus tard.
La Seine n’était pas autrefois retenue par les fortes digues dans lesquelles nous la voyons aujourd’hui renfermée : elle formait donc, avec les sables et les pierres qu’elle entraînait, des atterrissements, des bancs, des îles, qui la plupart ont été emportées dans les débordements, ou réunies au rivage, ou jointes entre elles. Dans le Moyen Âge on en trouvait dix, dont il ne reste que deux, l’île Saint-Louis et la Cité.
Cette dernière, plus grande que l’autre, a été le berceau de Paris ; elle a plus de deux cent mille mètres de superficie. L’île Saint-Louis, beaucoup moins étendue, a été formée de la réunion de deux petites îles (l’île Notre-Dame et l’île aux Vaches) que séparait alors un canal très étroit de la Seine, occupé de nos jours par l’emplacement de la rue Poultier. À l’extrémité occidentale de la Cité on remarquait deux îlots considérables qu’on appela, durant le Moyen Âge, l’île aux Juifs et l’île du Louvre. Le premier de ces îlots est aujourd’hui réuni à la Cité ; l’autre a disparu à la suite des travaux de canalisation et d’endiguement entrepris pour faciliter la navigation du fleuve.
Rome, qui a subjugué le monde, fut dans l’origine un amas de cabanes où s’abritaient des pâtres obscurs, où des esclaves fugitifs cherchaient un asile contre la loi. Paris, après Rome la ville par excellence, a commencé par être une bourgade, située dans une île de la Seine, et formée de huttes grossièrement construites.
Combien de fois les grandes choses n’ont-elles pas eu un pauvre berceau !
Aucune notion historique ne nous révèle vers quelle époque s’éleva Lutèce (Lutetia), principale ville des Parises (Parisii, Parisiens).
La Gaule était déjà une contrée couverte de villes fortes et habitée par des peuples nombreux lorsque César fit pour la première fois mention de cette petite cité, peu connue des Romains. Nous lisons au livre VI des Commentaires que, vers l’an 700 de la fondation de Rome (l’an 53 avant J.-C.), « l’assemblée des Gaulois ayant été convoquée à Samarobrive (Amiens), pour le commencement du printemps, selon la règle établie, tous les peuples s’y trouvèrent, excepté les Sénones, les Carnutes et les Trévires. » Le conquérant de la Gaule ajoute : « César, pensant que c’était là un symptôme de défection ou de guerre, pour montrer toute l’importance qu’il y attachait, transféra l’assemblée à Lutèce, ville des Parises ; ceux-ci étaient limitrophes des Sénones, avec lesquels ils avaient autrefois fait alliance, suivant la tradition, mais ils n’avaient point approuvé la résolution que les Sénones venaient de prendre. »
Ptolémée, qui écrivait plus d’un siècle après César, désigne la capitale des Parises sous le nom de Lucotèce (Λουϰοτεϰία). Les Parises appartenaient à la région celtique ; leur territoire, dont les limites ne peuvent être exactement déterminées, était de peu d’étendue. Ils confinaient au nord avec les Silvanectes, à l’est avec les Sénones, au sud et à l’ouest avec les Carnutes. Tout indique, d’après la faiblesse numérique de leur population, qu’ils étaient rattachés à la grande confédération des Sénones par les liens de la clientèle et du patronage. Quoi qu’il en soit, César vint lui-même à Lutèce présider l’assemblée nationale des Gaules, et les Sénones, intimidés par sa présence, se résignèrent à y envoyer des députés.
L’année suivante (52 av. J.-C.), tandis que César était retenu en Italie par la prévision d’une guerre civile, les nations et les cités gauloises se soulevèrent contre le joug romain et placèrent à la tête de leur confédération le célèbre Vercingétorix, d’origine arverne. Durant le cours de cette guerre, dont nous n’avons point à raconter les incidents, Labiénus, l’un des principaux lieutenants de César, se porta sur Lutèce avec quatre légions, après avoir laissé dans Agendicum (Sens ou Provins), pour la garde de ses bagages, un petit nombre de soldats récemment arrivés d’Italie. Le Gaulois Camulogène, vieillard énergique et dévoué, fut chargé de barrer le chemin à Labiénus, au moyen des contingents fournis par les cités voisines de Lutèce ; il prit position sur la rive gauche de la Seine, alors couverte par un large marais, vraisemblablement formé par la Bièvre. Labiénus essaya vainement de forcer le passage ; après d’inutiles tentatives il rétrograda et se porta sur Melodunum (Melun), dont il se rendit maître. Là il fit passer ses troupes sur la rive droite de la Seine et les dirigea de nouveau sur Lutèce. Camulogène, craignant que les Romains n’enlevassent la cité des Parises et ne s’y fortifiassent, livra aux flammes Lutèce et se maintint dans ses positions de la rive gauche, sous la protection des marais que l’armée ennemie ne pouvait franchir.
Labiénus déroba sa marche aux Parises ; ses barques, chargées de troupes, descendirent la Seine pendant la nuit jusques au point où se trouve aujourd’hui le pont de Sèvres, et lui-même ne tarda pas à les rejoindre avec trois légions. Les Parises, ne se rendant pas un compte exact de ce mouvement, partagèrent leur armée en trois corps, destinés à contenir les Romains sur trois points différents. L’un de ces corps occupait les hauteurs qui s’élèvent entre Issy et Meudon. Là se trouvait Camulogène. La septième légion, commandée par Labiénus, commença l’attaque. La lutte fut opiniâtre et meurtrière, et Camulogène périt avec l’élite de ses Gaulois. Sa mort fut le signal de la défaite, et Labiénus, après avoir taillé en pièces les Parises, vint rejoindre César, qui campait alors auprès d’Agendicum. Cette journée fut glorieuse pour les vainqueurs et pour les vaincus. Peu de temps après, lors de la mémorable lutte qui eut lieu sous les murs d’Alesia, le contingent fourni par les Parises à l’armée nationale de la Gaule ne s’éleva pas à moins de huit mille combattants ; ils continuèrent par leur courage à retarder la déchéance de la commune patrie.
Nous serons sobres de détails sur les mœurs et les coutumes des Parises durant la période qui précéda la conquête de la Gaule par les armes romaines ; c’est dans les histoires générales de la Gaule qu’il faut chercher ces renseignements, applicables à toutes les grandes races kimri-gaëliques aussi bien qu’à la peuplade assez obscure dont Lutèce était la principale bourgade.
En creusant le sol sur lequel vécurent les Parises on découvre, comme dans le reste de la Gaule, les traces premières de la condition de nos ancêtres : des haches et des massues de pierre, des flèches armées d’une pointe de silex, les ornements ou les instruments vulgaires d’une société à demi sauvage. Aussi bien que les autres nations gauloises celle des Parises avait évidemment perdu peu à peu de sa barbarie et s’était laissée initier aux usages et aux habitudes des peuples déjà civilisés avec lesquels les évènements et le commerce l’avaient mise en contact. C’est l’histoire de toutes les familles humaines. Les Parises, comme les autres Kimris-Gaëls, étaient hospitaliers, hardis à la guerre, pleins d’intelligence, doués d’une imagination vive, d’un goût prononcé pour les aventures extraordinaires, nobles penchants auxquels se mêlaient la frivolité, l’orgueil et les vices des sociétés que n’avait point éclairées la lumière de la vérité religieuse.
Ne se distinguant en rien des Gaulois de la race sénonaise et des autres Celtes septentrionaux, les Parises étaient des hommes de haute taille, ayant la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds, le regard méchant et farouche. Les riches donnaient à leur chevelure une couleur d’un rouge très prononcé en la lavant avec de l’eau de chaux, ou en l’enduisant d’un cosmétique composé d’huile et des cendres de certaines plantes. Le peuple portait les cheveux longs et flottants ; les guerriers les relevaient en touffe sur le haut de la tête. La coutume était de laisser croître la barbe, mais les hommes d’une haute origine se rasaient le visage et se bornaient à porter de longues moustaches. Leur vêtement national était un pantalon appelé braie, assez étroit. La blouse, encore populaire dans nos ateliers et dans nos campagnes, faisait essentiellement partie de leur costume. Par-dessus ce vêtement les riches et les nobles portaient une casaque ou saie tantôt simplement rayée, tantôt revêtue de broderies ou de peintures, selon la condition sociale du personnage, qui la jetait sur ses épaules ou l’agrafait autour de son cou. Cette espèce de manteau court était remplacé, dans le peuple, par des peaux de mouton ou de bêtes fauves. Les hommes riches et les chefs militaires aimaient à se parer d’anneaux, de bracelets et de colliers. Leurs armes défensives étaient le casque, le bouclier et, plus tard, des cottes de mailles ; leurs armes offensives, le gais, sorte de pieu durci aux flammes, le matras, la lance, le sabre de cuivre, et une sorte de faux au fer large et recourbé en croissant, et dont l’emploi était terrible. Tantôt ils ornaient leurs casques de cimiers et de panaches, et tantôt ils les surmontaient de cornes d’élan ou de buffle. Sur leurs boucliers on peignait des figures bizarres, quelquefois d’un aspect horrible, et c’était là le blason de nos barbares ancêtres. Les maisons étaient rondes, peu spacieuses, meublées avec simplicité. Chaque guerrier suspendait à la porte ou rangeait dans des coffres les têtes et les crânes desséchés des ennemis qu’il avait tués ou qui étaient morts sous les coups de ses ancêtres. Leurs repas étaient plus copieux qu’élégants, mais l’étranger et l’hôte y avaient toujours une place d’honneur. L’usage voulait que la cuisse de l’animal servi sur la table fût le mets réservé au plus brave, et c’était là une source de contestations sanglantes. Ils méprisaient la vie, ou du moins ils bravaient la mort avec une folle témérité. Le mari avait droit de mort sur sa femme, le père sur ses enfants, et, lorsqu’il y avait présomption qu’un homme avait péri victime d’un empoisonnement ou d’un crime, sur ce simple soupçon on livrait sa veuve à d’effroyables tortures. La polygamie était autorisée par la loi ; mais cet abus était restreint, parce que la communauté des biens existait entre les époux et que le mari devait apporter une part égale à celle de sa femme.
Chez les Parises, comme dans le reste de la Gaule, le premier apprentissage de la jeunesse noble était celui des armes. Ceux qui, dans le combat, prenaient la fuite ou perdaient leurs boucliers, étaient notés d’infamie. La barbare coutume du duel était chez eux en honneur ; c’était, pour eux un moyen de vider tous les différends et d’établir la justice des causes. Comme les autres Gaulois, les jeunes Parises s’exerçaient à la nage ; de bonne heure on leur apprenait l’art de monter à cheval ; on les formait aux évolutions militaires. La chasse dans les forêts était l’un de leurs délassements favoris ; ils l’aimaient jusqu’à la passion, et ce jeu endurcissait leurs corps et tenait en haleine leur courage. Ils empoisonnaient quelquefois leurs flèches. Le reste du temps était consacré aux festins ; l’usage des Gaulois était de manger assis, selon la coutume moderne, et non d’après l’habitude des Romains. Les repas se terminaient souvent par des combats singuliers, amenés par l’ivresse, et quelquefois par le chant des hymnes nationaux qu’entonnaient les bardes et qui célébraient la gloire des ancêtres.
Le vol était puni de mort lorsqu’il avait été commis dans l’enceinte de la ville ; dans le cas contraire on l’excusait comme une industrie propre à former le courage ou à entretenir le mépris du danger. L’homicide de l’étranger était châtié plus rigoureusement que le meurtre du concitoyen. Le maître était juge de ses esclaves, mais il ne pouvait leur appliquer que les lois ordinaires du pays. Il était défendu de s’entretenir des affaires publiques hors du conseil et des assemblées de la nation ; on devait se borner à informer confidentiellement le magistrat de tous les évènements graves dont on avait le premier connaissance. Les tribunaux étaient présidés par les druides, qui semblaient ainsi s’être réservé le monopole de la justice. Les druides excluaient des sacrifices ceux qui ne s’en tenaient pas à leurs décisions, et cette excommunication plaçait les interdits au rang des scélérats et des impies que chacun fuyait avec horreur. Quant aux esclaves, ainsi qu’on vient de le voir, leur condition était loin d’être odieuse et intolérable comme à Rome ; ils étaient plutôt des valets de ferme ou des serfs tributaires que de véritables esclaves. On payait un droit pour les marchandises que transportait le commerce, et c’était une source importante de revenus pour les habitants de Lutèce.
La noblesse était héréditaire et formait un ordre à part, au-dessous des prêtres et au-dessus du peuple. Soit qu’elle fût un patriciat basé sur des traditions religieuses, soit qu’elle ne résidât que chez les descendants des anciens chefs, elle ne conférait aucune prépondérance légale dans le gouvernement ni dans l’administration de la cité. « Tous les chevaliers, dit César, devaient prendre les armes dès que la guerre était déclarée. Ils avaient toujours autour d’eux un nombre d’ambactes et de clients proportionné à l’éclat de leur naissance et aux ressources de leur patrimoine. C’était là, pour eux, la seule marque de crédit et de puissance. » Chaque noble Parise commandait à un certain nombre de familles ; de là une hiérarchie de prescriptions et d’obéissance, un lien permanent et sacré, qui n’était, au demeurant, sous des appellations différentes, que la féodalité avant le christianisme. « Chez les Gaulois, dit encore César, ce n’est pas seulement dans chaque ville, dans chaque canton et dans chaque campagne qu’il existe des factions, mais aussi dans chaque maison… La raison de cet antique usage paraît être d’assurer à chacun, dans le peuple, une protection contre des hommes plus puissants, car nul ne souffre que l’on opprime ou que l’on circonvienne ceux qui sont sous sa tutelle. »
Le peuple, chez les Parises comme dans toute la Gaule, comprenait ceux de la nation qui n’appartenaient ni à la caste des druides, ni à l’ordre des équités ou nobles ; il embrassait donc dans sa généralité les hommes libres et les colons.
La langue des Parises, comme les autres idiomes gaulois, n’a point survécu aux siècles ; mais quelques débris de ce langage, qui fut celui des peuples du Nord, subsistent encore dans la Grande-Bretagne et dans nos départements armoricains. L’art de l’écriture ne leur était point étranger ; ils s’en servaient dans leurs actes publics et dans les transactions civiles. Il paraît qu’ils employaient des caractères à peu près semblables à ceux qui étaient en usage chez les Grecs, mais ils leur donnaient une signification différente. Il est probable que les caractères dont ils se servaient pour écrire avaient été introduits dans la Gaule par les navigateurs phéniciens. Les druides s’abstenaient de se servir de ces caractères pour transmettre aux peuples leurs maximes et leurs doctrines ; ils usaient d’un langage hiéroglyphique, dont les éléments étaient empruntés au règne végétal : c’était la langue des Rhin ou Run, c’est-à-dire des mystères, « Je connais, dit un chant des bardes, la signification des arbres dans l’inscription des choses convenues. Les pointes des arbres imitateurs, que murmurent-elles si puissamment, ou quels sont les divers souffles qui murmurent dans les troncs ? Lorsque les rameaux furent marqués sur la table des sentences, les rameaux élevèrent la voix. »
La religion des Parises était évidemment celle des Kimris-Gaëls qui peuplaient la Gaule centrale et la Gaule armoricaine. César et les Romains qui combattirent sous ses ordres crurent reconnaître, parmi les divinités de la Gaule, la plupart des dieux de l’Olympe grec et latin ; or, en dépit de cette croyance du guerrier qui conquit la Gaule, il est aujourd’hui bien avéré que les dieux adorés par nos ancêtres n’avaient aucune similitude avec ceux de l’Olympe homérique ; on ne leur attribuait ni les passions ni la forme de l’homme ; on ne les associait point aux querelles des rois et des chefs, et on avait une idée assez élevée de leur nature pour ne leur attribuer aucune des aventures étranges que les Grecs et les Romains prêtaient si complaisamment à leurs dieux suprêmes. Les divinités de la Gaule, en rapport avec les mœurs farouches et sauvages de leurs sectateurs, se plaisaient au sang et au carnage ; elles étaient insatiables de larmes et d’hécatombes humaines, mais elles n’empruntaient ni le corps des mortels ni celui des animaux pour satisfaire leurs amours et dégrader leur essence.
Les origines du paganisme gaulois paraissent se rattacher aux théogonies de l’Orient, même à celles de l’Inde. Le nom de Teutatès, qu’ils donnaient au plus formidable de leurs dieux, rappelle le dieu Theut des Phéniciens. L’adoration ou la personnification des forces de la nature, l’une des formes essentielles de leur polythéisme, semble empruntée aux idolâtries des Perses et des Scythes, tandis que leurs mystères, inaccessibles autant que redoutés, rappellent les orgies de Samothrace, trop fameuses dans l’histoire des aberrations de l’homme.
Les druides, comme les prêtres païens de l’Inde et de l’Égypte, enseignaient l’éternité de l’esprit et de la matière ; ils croyaient à la transmigration des âmes, à un Olympe Walhalla moitié mystique, moitié sensuel, où les guerriers retrouvaient leurs armes, leurs chars, leurs chevaux, se livraient de joyeux combats, et buvaient un céleste hydromel dans le crâne de leurs ennemis.
Les druides étudiaient avec soin le cours des astres et les phénomènes de la nature ; habiles dans l’art de connaître les plantes médicinales, ils guérissaient les malades et acquéraient sur l’imagination des peuples une puissance très étendue ; ils avaient la prétention de ne rien ignorer de ce qui concernait l’ordre des choses, la magie, l’essence des dieux et de l’âme, et les forces qui prêtent une sorte de vie à la matière.
Le chêne était l’arbre sacré du druidisme ; tous les ans, et probablement le premier jour de l’année, qui correspondait, dit-on, au sixième de la lune de mars, les druides et le peuple se rendaient dans les forêts, et coupaient avec une faucille d’or un rameau de gui que des prêtresses recueillaient religieusement dans un drap, avant qu’il fût tombé à terre.
À la mort d’un guerrier ou d’un grand on égorgeait sur son tombeau ou l’on jetait dans les flammes qui dévoraient ses restes un cheval de guerre, des esclaves, sa femme elle-même. Quelquefois ces sacrifices étaient volontaires.
À partir de la conquête romaine, et durant trois siècles, les souvenirs historiques sont muets à l’égard de Lutèce. César avait rangé cette ville au nombre des vectigales, c’est-à-dire des cités soumises à un tribut ; c’était la condition commune à toutes les villes de la Gaule celtique, à l’exception d’un très petit nombre que Pline énumère et parmi lesquelles il ne range pas la capitale des Parises. Cette cité n’en était pas moins assez importante, au moins comme position stratégique et comme place commerciale.
La Gaule tout entière étant placée sous le joug de Rome, César se montra doux et clément envers les vaincus. Le tribut qu’il leur imposa fut déguisé sous le nom honorable de solde militaire ; il respecta l’organisation intérieure, les habitudes et les mœurs, et, pour flatter l’esprit guerrier de ces peuples, enrôla à tout prix l’élite de leur jeunesse dans les légions romaines.
Octave, après la mort de César, traita durement la Gaule. Par une mesure habile il entreprit d’affaiblir le sentiment national en donnant une division nouvelle au territoire. La Gaule fut partagée en quatre vastes régions, désignées sous les noms de Narbonnaise, d’Aquitaine, de Lyonnaise et de Belgique. Lutèce fit partie de cette quatrième région. Un peu plus tard les empereurs romains substituèrent à cette première répartition du territoire conquis une nouvelle division géographique qui partagea la Gaule en dix-sept provinces. Les Parises et Lutèce appartinrent alors à la quatrième Lyonnaise, dont le chef-lieu était Sens. Devenu empereur sous le nom d’Auguste Octave donna à la Gaule pour capitale la ville de Lugdunum. Par ses soins l’intérieur du pays fut désarmé, et deux camps de quatre légions furent établis sur le Rhin pour contenir à la fois et les Germains, déjà ligués contre Rome, et les populations de la Gaule septentrionale, au nombre desquelles figuraient les Parises. L’empereur institua pour la Gaule un régime d’impôt régulier, mais oppressif. Il s’attacha à détruire le druidisme ; il interdit aux Gaulois les sacrifices humains et fit adopter, peu à peu, par les classes élevées, un paganisme qui était comme une transaction entre la sauvage idolâtrie des Celtes et le polythéisme d’Athènes et de Rome.
En l’an 68 Galba, pour récompenser les Gaulois de leur dévouement, qui l’avait appelé à l’empire, accorda le droit de cité à toute la Gaule, à l’exception des villes riveraines du Rhin, qui s’étaient prononcées pour Néron. On présume que dès cette époque Lutèce fut rangée au nombre des villes municipes. Quoi qu’il en soit, l’histoire particulière de Lutèce continue à se perdre dans l’histoire générale de la Gaule romaine, et celle-ci est presque toujours absorbée par l’histoire de l’empire romain ; elle ne s’en détache de loin en loin que par des incidents tels que des révoltes locales, et l’adhésion à des Césars ou à des candidats impériaux arborant contre Rome le drapeau des guerres civiles. Le récit de ces évènements ne rentrerait pas dans le cadre qui nous est assigné.
Un détail se rattache particulièrement aux annales de Lutèce : sous le règne de Tibère les Nautes Parisii avaient élevé un autel a Jupiter ; ce n’étaient point de simples bateliers, mais une corporation puissante de négociants par eau.
En 1711 on retrouva les débris du monument que les Nautes avaient élevé en l’honneur de Jupiter. Ce monument se composait de neuf pierres sculptées, pour la plupart, et portant des inscriptions. Les sculptures présentaient un bizarre mélange de la mythologie romaine et de la religion gauloise. À côté de Jupiter, de Vulcain, de Castor et de Pollux, on remarquait Æsus, le taureau sacré, couvert d’une draperie en forme d’étole et portant trois figures de grue, et le dieu gaulois Cernunnos, protecteur de Lutèce.
La compagnie des Nautes a éveillé, à juste titre, l’attention des annalistes de Paris. Une pareille société ne pouvait subsister que dans une ville devenue centre commercial, ayant des marchés, des ports, des entrepôts, et, conséquemment, une police des juges et une administration municipale. Les fonctions principales des inspecteurs de la société étaient de protéger le commerce, de pourvoir à la liberté de la navigation et d’assurer la police des ports. C’était là comme l’origine des attributions municipales du Paris du Moyen Âge et du Paris moderne. Les compagnies des Nautes avaient une grande utilité alors que, la Gaule étant presque entièrement couverte de forêts et dépourvue de routes, les rivières étaient les voies les plus sûres et les plus commodes pour le transport des marchandises.
On appelait Nautes, dit le Code Théodosien (livre XII, titre 3), naviculaires ou scaphaires, ceux qui faisaient leur principale occupation du commerce par l’eau ; ce n’étaient pas de simples bateliers, comme quelques-uns ont voulu le faire croire ; leur profession était plus élevée. Ils comptaient parmi eux des sénateurs, des décurions, des questeurs et des chevaliers.
Les gens de commerce, chez les Parises, étaient distribués en différents corps, indépendants les uns des autres et seulement unis par les liens du commerce.
L’Allemand Gruter nous apprend que chacune de ces sociétés avait son district et devait être soumise à un patron, qui lui-même était naute. Ainsi, Marcus Fronton, quoique sévir d’Aix, c’est-à-dire un des six premiers magistrats de cette ville, prend le titre de patron des nautes de la Durance, de même que Jalvin Sévérian, patron et directeur de ceux du Rhône, et Lucius Bésius, chevalier romain, patron des nautes de la Saône, était naute lui-même.
Ces corps avaient de très beaux privilèges ; les lois romaines les déclaraient exempts de toutes charges publiques, comme tutelles, curatelles et contributions ; les marchandises qu’ils faisaient voiturer étaient exemptes de plusieurs droits, et il n’était plus permis de les saisir, même pour dettes, lorsqu’une fois elles étaient rendues aux marchés pour lesquels elles étaient destinées. Survenait-il quelque différend entre eux : il était terminé par des arbitres, qui étaient alors des juges de commerce.
C’est à peu près tout ce que nous savons des annales de Lutèce sous les premiers Césars et aux jours de la Gaule païenne. Cependant une ère nouvelle allait s’ouvrir pour ce pays avec la régénération religieuse de l’empire romain. L’idolâtrie avait fini son temps ; le culte de Jésus-Christ commençait le sien, et le sang des martyrs, comme une merveilleuse rosée, fécondait cette religion sainte.
Les savants ne sont point d’accord sur l’époque où le christianisme fut introduit à Lutèce par saint Denis, principal apôtre des Gaules ; on a diversement interprété le texte de Grégoire de Tours qui mentionne cet évènement, avec la mission de plusieurs autres saints, envoyés de Rome, et qui prêchèrent la foi chrétienne a Arles, à Tours, à Narbonne, à Toulouse, en Auvergne et à Limoges. Il est vraisemblable que les missions confiées à ces hommes apostoliques eurent lieu à des époques très différentes, tandis que Grégoire de Tours, en les rappelant dans une seule phrase, semble leur assigner une même date, ce qui n’est guère admissible et ce que d’autres monuments historiques contredisent. L’apôtre qui prêcha le premier à Paris la foi chrétienne fut-il saint Denis l’Aréopagite, disciple de saint Paul ; fut-il un évêque du troisième siècle, mis à mort sous le règne de Dèce ? Ce point historique est tellement controversé que nous n’osons espérer le résoudre à l’aide de nos faibles lumières. Nous nous en rapportons à l’autorité de l’Église, si elle daigne se prononcer directement et affirmativement à cet égard. En attendant nous hésiterons à croire que le christianisme n’ait été introduit chez les Parises que vers le milieu du troisième siècle. La vérité ne mettait pas deux cents ans à faire le chemin de Rome à Lutèce, et nous ne pouvons admettre que la Gaule, étant une province romaine traversée par des routes, enrichie par un immense concours de commerçants et de voyageurs, bien plus à portée des premiers papes que l’Amérique du Sud ne l’est aujourd’hui de Rome, soit demeurée si longtemps étrangère aux bienfaits de la foi. Dès le premier siècle on avait évangélisé la Perse, l’Éthiopie et les Indes. Pourquoi, lorsque Rome comptait dans ses murs un si grand nombre de Gaulois, s’en serait-il trouvé si peu d’initiés a la connaissance de la religion des martyrs Pierre et Paul, si peu qui eussent la généreuse pensée de rapporter dans leur pays la bonne nouvelle ?
Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’incertitude sur le lieu où saint Denis et ses deux compagnons, Rustique et Eleuthère, furent martyrisés pour la gloire de Jésus-Christ. D’après des monuments qui ne remontent pas au-delà du sixième siècle, on croit qu’ils furent décapités, hors des murs de Lutèce, sur la colline qui, en leur honneur, fut plus tard appelée Mont des Martyrs, et par abréviation Montmartre. Suivant la légende les persécuteurs ordonnèrent qu’on jetât les trois corps dans la Seine ; mais une femme pieuse parvint à les enlever et les fit secrètement inhumer dans un champ qu’elle possédait à Catolacum ; puis, lorsque la persécution eut cessé, elle leur fit dresser un tombeau près duquel fut élevée, sous les Mérovingiens, la célèbre basilique de Saint-Denis. Hilduin, qui écrivait au neuvième siècle, d’après des traditions populaires dont l’origine nous est inconnue, avança le premier que saint Denis, après son martyre, avait porté sa tête entre ses mains ; c’est toujours ainsi que le représentent les naïves effigies du Moyen Âge, et cette croyance est demeurée chère aux multitudes.
Vers le même temps la Gaule fut en proie à des tentatives anarchiques et à des soulèvements populaires qui sont fameux dans l’histoire sous le nom de révolte des Bagaudes. Ce nom, qui paraît avoir eu la signification de brigand ou de rebelle, fut donné à des paysans poussés à l’insurrection et à la vengeance par une longue série d’exactions et de misères, inévitable conséquence des révolutions et des guerres intestines dont la Gaule fut le théâtre depuis l’avénement de Gallien jusqu’à celui de Dioclétien. Pillés et opprimés par les agents du fisc, livrés aux excès d’une soldatesque sans frein, ne trouvant aucune garantie dans l’ordre social, sans cesse exposés aux effroyables incursions des barbares, trop souvent trahis par leurs propres maîtres, les paysans en étaient venus, dans plusieurs provinces gauloises, à chercher des ressources dans le brigandage à main armée. Ces rassemblements se donnèrent des chefs, dont les principaux, Célianus et Amandus, prirent les titres de César et d’Auguste et firent frapper des médailles à leur effigie. Tous deux se maintinrent longtemps, avec leurs troupes, dans une position fortifiée, sorte de presqu’île que forme la Marne avant de se jeter dans la Seine, et qui, longtemps appelée Château des Bagaudes, a conservé de nos jours le nom de Saint-Maur-les-Fossés. De ce point, où ils étaient à l’abri des attaques de l’armée romaine, les Bagaudes faisaient des excursions dans les vallées de la Marne et de l’Oise, et jusque sur la Saône. Le César Maximien, à la tête d’une armée, assaillit les Bagaudes, les dispersa dans plusieurs rencontres, en fit un grand carnage et rejeta leurs débris dans les bois et dans les montagnes. Nonobstant ces sanglantes défaites la bagauderie ne fut point détruite ; elle se perpétua sous d’autres chefs ; elle renouvela ses brigandages, et toutefois ne se trouva plus en état de lever des armées et de tenir tête aux troupes réglées.
Le prétoire des Gaules avait pour chef-lieu la ville de Trêves. Les barbares, qui ne cessaient de menacer le Rhin, pouvaient d’un jour à l’autre se rendre maîtres de cette capitale. Les empereurs cherchèrent une position moins exposée aux tentatives des Germains et des Francs, et ils reconnurent que Lutèce, dominant à la fois les vallées de la Seine, de la Marne et de l’Oise, pouvait fort à propos servir de campement d’hiver aux troupes romaines. Ils y construisirent un palais, une place d’armes, des aqueducs et un amphithéâtre ; le quartier romain, qui se composait de ces établissements et de leurs accessoires, s’étendait de la rive gauche de la Seine à la hauteur connue alors sous le nom de Locutitius et plus tard de montagne Sainte-Geneviève. Il formait comme le faubourg méridional de la ville, toujours confinée dans la grande île de la Seine, avec laquelle il communiquait par un pont de bois où convergeaient les principales routes militaires de la Gaule. Si l’on veut se faire une idée à peu près exacte de ces diverses positions en les comparant au Paris moderne, on verra que le camp retranché des Romains couvrait la place Saint-Michel (récemment démolie pour faire place au boulevard de Sébastopol) et une partie des terrains du Luxembourg. Sur le Locutitius s’élevait un temple de Mercure ; près de là, sur un emplacement que traverse aujourd’hui la rue des Fossés-Saint-Victor, était le cirque ou l’amphithéâtre destiné aux courses de chevaux. Le palais impérial, appelé les Thermes, était au lieu où ses débris subsistent encore ; un aqueduc amenait aux Thermes l’eau du village d’Arcueil. Sur la rive droite un temple de Mars s’élevait vers les hauteurs où saint Denis avait souffert le martyre. Lutèce était renfermée dans l’île de la Cité, un peu moins étendue qu’elle ne l’est aujourd’hui. Un palais s’élevait dans la région occidentale de l’île, au lieu où existe de nos jours le Palais de justice ; à l’autre extrémité de l’île se trouvait l’autel des Nautes. Une voie romaine, venant du midi, pénétrait dans Lutèce par le petit pont, et traversait des rues qui, à cette heure, ont fait place au boulevard de Sébastopol ou vont disparaître pour favoriser, dit-on, la construction d’une immense caserne. La voie romaine sortait de là ville par le Grand-Pont (le Pont-au-Change), aboutissait à ce que nous appelons la place du Châtelet, et de là prenait une voie oblique dans la direction qu’indiquent aujourd’hui Clichy et Saint-Denis. D’autres voies aboutissaient à Lutèce, du côté du nord et au midi, mais leur importance était moindre.
L’évêque de Paris, martyr de la foi chrétienne, avait eu des successeurs dont on cite les noms : c’étaient Mallo, Massus, Marcus, Adventus et Victorin, qui assista, en 347, au concile de Sardique. De meilleurs jours étaient venus pour le christianisme ; la foi s’était assise sur le trône en la personne de Constantin. Cet empereur, son père, ses fils séjournèrent successivement dans les Gaules et campèrent vraisemblablement sous les murs de Lutèce. Cette ville ne devint toutefois le théâtre d’évènements importants que vers le temps où le César Julien y établit sa résidence.
Nommé César en l’an 355, Julien hiverna à Lutèce en 358 et en 359. Il habitait le palais des Thermes, avec son épouse Hélène, fille de l’empereur Constance. Voici dans quels termes il raconte lui-même le séjour qu’il fit en cette ville : « Je me trouvais, pendant un hiver, à ma chère Lutèce (c’est ainsi qu’on appelle dans les Gaules la ville des Parises). Elle occupe une île au milieu de la rivière. Rarement la rivière croît ou diminue : telle elle est en été, telle elle est en hiver ; on en boit volontiers l’eau très pure et très riante à la vue. Comme ses citadins habitent une île, il leur serait difficile de se procurer d’autre eau. La température de l’hiver est peu rigoureuse, à cause, disent les gens du pays, de la chaleur de l’Océan, qui, n’étant éloigné que de neuf cents stades, envoie un air tiède jusqu’à Lutèce. Par cette raison, ou par une autre que j’ignore, les choses sont ainsi. L’hiver est fort doux aux habitants de cette terre ; le sol porte de bonnes vignes ; les Parises ont même l’art d’élever des figuiers en les enveloppant de paille comme d’un vêtement et en employant les autres moyens dont on se sert pour mettre les arbres à l’abri de l’intempérie des saisons. Or il arriva que l’hiver que je passai à Lutèce fût d’une violence inaccoutumée ; la rivière charriait des glaçons comme des carreaux de marbre. Vous connaissez les pierres de Phrygie ? Tels étaient, par leur blancheur, ces glaçons bruts, larges, se pressant les uns contre les autres, jusqu’à ce que, venant à s’agglomérer, ils formassent un pont. Plus dur à moi-même et plus rustique que jamais, je ne voulus point souffrir que l’on échauffât à la manière du pays la chambre où je couchais. » Il dit ailleurs que, s’étant déterminé à user de ce moyen de chauffage, il faillit être étouffé par la vapeur du charbon. Quoi qu’il en soit, après avoir reproduit, à la suite de tous les historiens, les détails que Julien donne sur Paris au quatrième siècle, nous n’hésiterons pas à dire qu’ils offrent un médiocre intérêt et ne révèlent pas l’effort d’une observation bien attentive.
En l’an 360 un concile fut tenu à Paris sous l’épiscopat de Paul, successeur de Victorin. Cette assemblée adhéra au Symbole de Nicée, avec toute l’Église catholique, et rejeta la profession de foi des ariens. Pour la première fois, comme le témoigne la lettre synodale du concile, le nom de Paris fut attribué à Lutèce, et nous ne cesserons plus de le lui donner.
Un grave incident eut lieu dans cette ville et en la même année ; voici dans quels termes Julien le raconte : « Constance, jaloux de mes succès, m’écrivit une lettre, non seulement pleine d’outrages pour moi, mais encore menaçant la Gaule d’une complète ruine. Il m’ordonnait de retirer de la Gaule presque tout ce qui s’y trouvait de bonnes troupes, en me priant de ne rien empêcher… Je me soumis. Les Celtes et les Pétulans, mes meilleures légions, arrivèrent à Paris pour se rendre vers l’Orient. Au déclin du jour le palais fut subitement assiégé par la foule des soldats poussant des cris, tandis que je réfléchissais à ce qu’il fallait faire et n’étais nullement rassuré. Je m’étais retirée, avec mon épouse, dans une chambre haute, et j’y étais couché. Là j’adorai Jupiter par une ouverture qui se trouvait dans le mur ; mais, comme les clameurs augmentaient et que tout le palais retentissait du tumulte, je demandai au dieu un signe de sa volonté. Il me le donna sur-le-champ et m’avertit de ne point m’opposer aux désirs de l’armée. Malgré ces ordres du Ciel je ne me rendis pas ; je résistai tant que je pus, et refusai le titre d’auguste aussi bien que la couronne qu’on m’offrait. Mais enfin, comme je ne pouvais vaincre seul la persistance de cette foule et que d’ailleurs j’avais les dieux pour moi, je finis, vers la troisième heure, par me laisser couronner d’un collier que me présenta un soldat et je rentrai au palais gémissant au fond du cœur. » On voit percer dans ce récit l’ambition hypocrite de Julien, qui feignait de désavouer une sédition secrètement attisée par ses affidés et ses complices.
Un historien moderne résume ainsi les évènements qui s’accomplirent ensuite.
Assis sur un tribunal élevé aux portes de la ville, Julien invite les soldats à obéir aux ordres d’Auguste ; les soldats gardent un silence morne et se retirent à leur camp. Julien caresse les officiers, leur témoigne le regret de se séparer de ses compagnons d’armes sans les pouvoir récompenser dignement. À minuit les légions se soulèvent, sortent en tumulte du banquet donné pour leur départ, environnent le palais, et, tirant leurs épées à la lueur des flambeaux, s’écrient : Julien auguste !
« Il avait ordonné de barricader les portes ; elles furent forcées au point du jour. Les soldats se saisissent du césar, le portent à son tribunal, aux cris mille fois répétés de Julien auguste ! Julien priait, conjurait, menaçait ses violents amis, qui, à leur tour, lui déclarèrent qu’il s’agissait de la mort ou de l’empire. Il céda. Une acclamation le salua maître ou compétiteur du monde. Il fut élevé sur un bouclier comme un roi franc, couronné comme un despote asiatique ; le collier militaire d’un hastaire lui servit de diadème, car il refusa d’user à cette fin (étant chose de mauvais augure) d’un collier de femme ou d’un ornement de cheval que lui présentaient les soldats. Afin qu’il ne manquât rien d’extraordinaire à l’avénement du restaurateur de l’idolâtrie, Julien écrivit au peuple et au sénat d’Athènes la relation de ce qui s’était passé à Paris. »
La plupart des historiens se sont complu à vanter ce qu’il y eut de sincère dans la résistance de Julien ; évidemment il faut se tenir en garde contre leur admiration de commande. Julien résista aussi longtemps que cela fut nécessaire, soit pour stimuler l’enthousiasme des légionnaires, soit pour se mettre à couvert en cas d’insuccès ; mais il aspirait au fond du cœur à gouverner l’empire, et il était heureux d’un soulèvement prétorien qui lui donnait la pourpre.
Peu de temps après on vit arriver à Paris le questeur de Constance, chargé d’annuler tout ce qui s’était passé au profit de Julien ; sa mission échoua, grâce à l’enthousiasme des légions révoltées et aux adroites combinaisons du chef qu’elles avaient proclamé auguste. Cependant il fallait soutenir par les armes l’élection militaire qui opposait Julien à Constance. Julien marcha en toute hâte au-devant de son ennemi. Constance étant mort, Julien se fit proclamer empereur par le sénat et commença un règne fatal au christianisme, et dont il plut à Dieu d’abréger la durée.
L’empereur Valentinien vint à Paris et y passa l’hiver de 365-366. Là, il reçut l’avis que Procope s’était fait proclamer empereur en Illyrie ; il voulut s’y rendre pour étouffer la sédition, mais les prières des principaux habitants de la Gaule le retinrent dans ce pays menacé par de nouvelles invasions. Trois lois de Valentinien sont datées de Paris ; l’une réglemente la distribution des vivres, l’autre l’or et les autres métaux, et la troisième le service des officiers des monnaies. Dans le texte de ces lois l’ancienne Lutèce continue d’être appelée Parisii. Ce fut dans la même ville que Valentinien reçut la tête de Procope ; elle lui fut envoyée d’Asie par Valens, où le tyran avait été mis à mort au mois de mai 366. Gratien, que Valentinien, son père, avait associé de son vivant à l’empire, paraît avoir aimé le séjour de Paris pendant qu’il était dans les Gaules. Retiré dans son palais des Thermes, il avait fait renfermer dans ses vastes jardins un grand nombre de lions, et s’adonnait, dit-on, à sa passion pour la chasse. Ce fut près de cette ville qu’il livra la dernière bataille contre Maxime : la victoire demeura à l’usurpateur.
Position stratégique d’une haute importance pour la défense de la Gaule, alors sans cesse menacée par les barbares, Paris n’était ni une colonie romaine, ni une métropole de province. Réduite, durant trois siècles, à l’humble condition des vectigales, elle n’était devenue municipe que vers la fin du quatrième siècle. Zozime, Ammien Marcellin et Julien lui-même se bornaient à la qualifier de petite forteresse (castellum, oppidulum).
Vers le même temps deux préfets résidaient à Paris : celui des navigateurs sur la Seine, établis à Andresy (prœfectus classis Anderecianorum, Parisiis), et le préfet des Sarmates