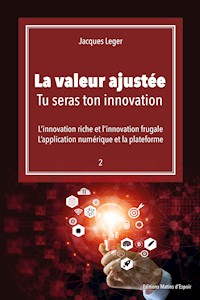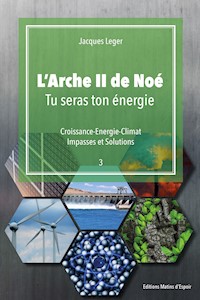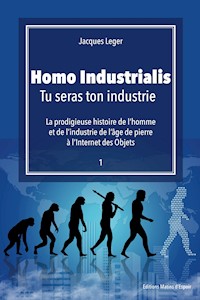
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
L'épopée de l'Homme industriel au travers des époques, de l'âge de pierre à aujourd'hui.
La vie des hommes est trop courte pour leur permettre de vivre eux-mêmes toutes les périodes de l’histoire. Et pourtant, Homo Industrialis a vécu et travaillé à toutes les époques, depuis l’âge de pierre jusqu’à l’industrie 4.0 et la digitalisation.
Homo Industrialis nous fait revivre ses différentes vies, à tous les âges et dans toutes les civilisations. Il nous délivre une autre histoire de l’homme, celle qu’il a partagée avec l’industrie, mère de tous les progrès.
Toutes les civilisations sont en effet l’œuvre des industriels qui ont construit les temples et les palais, fabriqué les armes et les outils, créé les richesses et les savoir-faire, qui ont permis la réalisation des œuvres d’art, tels les bronzes et les statues, ceux-là même qui trônent aujourd’hui dans nos musées.
Au travers d’une fresque couvrant les millénaires, l’auteur nous fait partager une description vivante, informative et générale des mondes d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
A l’heure où l’Occident doute de son modèle, à l’heure de la mondialisation de l’économie et des cultures,
Homo Industrialis nous délivre un message d’espoir et de courage : une fois de plus c’est le travail et l’industrie qui nous sauveront. Un vrai programme d’avenir pour nos temps incertains.
Premier tome d'une série d'ouvrages de l'auteur Jacques Leger,
Homo Industrialis
vous amènera à découvrir le parcours de l'Homme industriel au travers des âges.
EXTRAIT
Avant moi étaient venus d’abord les animaux marins, puis les mammifères et les dinosaures. Il y a soixante-cinq millions d’années, selon les experts, un grand cataclysme, détruisit tous les dinosaures, et seuls quelques mammifères survécurent. Ces mammifères étaient mes lointains ancêtres.
Il y a six millions d’années j’avais un ancêtre commun avec mes cousins chimpanzés. Mais nos routes se séparèrent et se séparèrent encore.La terre était riche de milliers d’animaux qui accompagnaient la vie des Hommes : des éléphants, des lions, des tigres, des girafes, des buffles et des crocodiles, mais aussi des oiseaux de toutes sortes comme les aigles, les condors, les mésanges, les cigognes et les pinsons qui chantaient toute la journée pour égayer nos vies. Il y avait aussi les papillons, les libellules et les abeilles qui
butinaient les fleurs des champs. Nous avions toujours eu besoin d’eux. Enfin il y avait les mers et les rivières qui étaient remplies de poissons comme les carpes, les anguilles, les requins, les baleines et les mérous, pour assurer notre nourriture.
Les animaux faisaient preuve d’une intelligence certaine, même si celle-ci était différente de la nôtre. Par exemple les chevaux, les éléphants et d’autres animaux apparemment calmes pouvaient attendre des mois ou des années pour se venger de mauvais traitements. Les animaux (les grands singes par exemple) avaient dû élaborer des règles de vie sociale très sophistiquées pour pouvoir survivre entre eux. Si nous étions seuls dans l’univers, nous étions loin d’être seuls sur la Terre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ingénieur et financier,
Jacques Leger a passé cinquante années dans le monde de l’industrie, au sein de grandes entreprises industrielles, opérant dans les divers pays d’Europe, aux USA, au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Il a vécu lui-même les différentes étapes de la mondialisation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Publishroom
www.publishroom.com
ISBN : 978-2-900370-04-9
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Jacques Léger
Homo Industrialis
Tu seras ton industrie
La prodigieuse histoire de l’homme et de l’industrie, de l’âge de pierre à l’internet des objets
homoindustrialis.wixsite.com/blog
Éditions des Matins d’Espoir
49, avenue de la République 75011 Paris-France
– 7 –
Aux dirigeants politiques.
Aux dirigeants du patronat et des syndicats.
Aux entrepreneurs et aux industriels de toute nature.
Aux dirigeants des entreprises, aux cadres et aux opérateurs.
Aux acteurs de toutes les manufactures, de l’agriculture et des services.
À tous les employés de tous les secteurs de l’industrie.
À tous les Homo Industrialis de l’histoire.
À mes anciens collègues de travail.
Vive l’Industrie !
En hommage,
à Pierre Bilger, ancien Président d’Alstom,
à Jean Pierre, Michel Rist, Walter Fieni, anciens dirigeants de Valeo.
– 9 –
Sommaire
INTRODUCTION
La rencontre
Moi, Homo Industrialis
L’industrie est la source du progrès
TITRE I : L’INDUSTRIE 1.0 : L’ARTISANAT
TITRE II : L’INDUSTRIE 2.0 : LA PRODUCTION DE MASSE
2.0 / 1 : L’énergie
2.0 / 2 : Les Machines
2.0 / 3 : Chicago
2.0 / 4 : Ford
TITRE III : L’INDUSTRIE 3.0 : LA PRODUCTION FLEXIBLE
3.0 / 1 : Toyota
3.0 / 2 : Les Robots
TITRE IV : LA MONDIALISATION
M1 / Les origines de la mondialisation vues de l’Occident
M2 / Les origines de la mondialisation vues de la Chine
M3 / La mondialisation des échanges
M4 / Les conséquences de la mondialisation
– 10 –
TITRE V : L’INDUSTRIE 4.0 : LA DIGITALISATION DE L’INDUSTRIE
4.0 / 1 : L’ordinateur
4.0 / 2 : Internet
4.0 / 3 : IPhone
4.0 / 4 : Internet des Objets
TITRE VI : L’INDUSTRIE 5.0 : L’ ÈRE DES MATÉRIAUX RARES
5.0 / 1 : Les Matériaux rares
5.0 / 2 : L’Economie circulaire
PRÉPARATION DU RAPPORT AU CHEF DE L’ÉTAT
– 13 –
INTRODUCTION
LA RENCONTRE
MOI HOMO INDUSTRIALIS
L’INDUSTRIE
– 15 –
LA RENCONTRE
Deux jeunes garçons faisaient route vers un village, à deux heures de marche de la capitale, et ils parlaient ensemble de ce qu’ils venaient de vivre. Or, tandis qu’ils parlaient et discu-taient, un homme s’approcha, et marcha avec eux. Mais, tout entiers à leur discussion, leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le virent pas.
L’homme leur dit :
De quoi parliez-vous donc, tout en marchant ?
Alors, ils s’arrêtèrent et l’un des deux répondit :
Tu es bien le seul à ignorer les événements de ces jours-ci.
L’homme leur dit :
À quels événements faites-vous allusion ?
Ils répondirent :
Nous avons un nouveau Président de la république. Il est jeune et vient d’être élu au terme d’une campagne épique ! Il n’était pas donné gagnant au départ mais, au fur et à mesure des épreuves, il a éliminé tous ses concurrents.
Vous devez être contents, répondit l’homme ! C’est une bonne nouvelle. La jeunesse est signe de dynamisme et de volonté. Ce n’est pas la première fois qu’un pays fait confiance à un homme jeune pour le diriger. Le plus célèbre des jeunes ayant réussi est sans doute Alexandre le Grand qui constitua
– 16 –
un gigantesque empire, de l’âge de 20 ans à 32 ans. Alexandre fut un grand chef militaire, capable de vaincre des armées prestigieuses, dirigées par des généraux beaucoup plus âgés et beaucoup plus expérimentés que lui.
Tu as raison, dit l’un des deux jeunes. En France nous avons eu Napoléon qui dirigeait déjà la France à l’âge de 30 ans.
Mais Alexandre et Napoléon ont surtout été des chefs d’armées, répondit le second jeune. Alexandre est mort à la fin de ses conquêtes, et son empire ne lui a pas survécu. Napoléon a été un grand organisateur. Nombreuses de ses réalisations existent encore aujourd’hui : la Banque de France, les préfets, les lycées, la Légion d’honneur, les Chambres de commerce, le Code civil et le Code pénal, les Conseils de prud’homme, la Cour des comptes, le baccalauréat… On se demande même ce que serait notre organisation nationale aujourd’hui si Napoléon n’avait pas existé ! Mais Napoléon n’a pas laissé une France stable. Le chaos lui a succédé.
Mais pourquoi donc être si inquiet, demanda l’homme ? La jeunesse est l’époque de l’insouciance. Profitez donc de votre jeunesse !
Nous profitons de notre jeunesse, répondit le plus bavard, mais nous nous préoccupons aussi de notre avenir et de celui du monde. Tout ne va pas si bien sur la Terre et le fait que nous poursuivions nos études, et que nous prenions des vacances, ne nous empêche pas de nous interroger sur la situation. Car aujourd’hui tout est lié : une guerre quelque part et c’est presque tout le monde qui est en guerre, et des guerres, le monde n’en manque pas !
L’autre jeune reprit la parole et dit :
Et il n’y a pas que les guerres qui soient préoccupantes. Il y a le réchauffement climatique, l’endettement massif du pays qu’on ne sait plus comment rembourser, les tensions entre certains états : l’Europe et la Russie prennent chacune des mesures de rétorsion l’une contre l’autre, les États-Unis et la
– 17 –
Chine qui se disputent le leadership mondial, Internet qui est en train de changer toutes les façons de travailler. Les jeunes comme nous, connaissons un peu le sujet, mais ce n’est pas le cas de toutes les catégories de la population. Enfin, on ne peut pas rester insensible au terrorisme islamique. On ne pourra pas vivre durablement dans ces conditions. Tous ces sujets nous préoccupent et nous souhaiterions contribuer d’une manière ou d’une autre à faire avancer les choses.
Le premier jeune reprit la parole :
Nous faisons des études d’ingénieur et nous espérons travailler un jour dans l’industrie. En espérant, ajouta-t-il, qu’il en restera encore. Quand nous voyons le nombre d’usines qui ferment et le nombre de grandes sociétés qui passent sous pavillon étranger, nous nous disons qu’il ne restera bientôt plus, chez nous, que des postes de fonctionnaires. Nombreux jeunes de notre âge partent ou pensent partir à l’étranger. D’autres n’aspirent qu’à entrer au service de l’ État ou des collectivités locales. Alors quand nous disons que nous souhaitons travailler dans l’industrie, tout le monde nous rit au nez !
Que comptez-vous faire, reprit l’homme ? Avez-vous un plan ? Avez-vous parlé du sujet avec l’un de vos professeurs ?
C’est le cas, répondit le second. La plupart des conseillers d’ État n’ont pas d’expérience industrielle. Les grandes entre-prises qui pourraient convaincre l’État sont jugées partisanes. D’ailleurs, la situation du pays ne les préoccupe qu’à moitié. Elles sont désormais mondiales, et si un pays n’est pas assez performant, elles vont faire des affaires dans un autre. Un de nos professeurs nous a donné une idée : faire un rapport sur l’industrie, son histoire, ses étapes, sa situation à travers le monde et faire parvenir ce rapport au chef de l’ État. Le professeur pourra corriger notre rapport, si besoin, et le faire parvenir au plus haut niveau, en mettant en avant la valeur de l’initiative.
– 18 –
Excellente idée ! répondit l’homme. Ce sera une bonne façon de vous exprimer librement, de proposer des idées de réformes et de vous faire connaître. Je n’y vois que des avan-tages. Le chef de l’ État doit être bombardé de rapports en tous genres, mais peut-être très peu sur le sujet de l’industrie.
Le problème, répondit le second, c’est que nous man-quons d’expérience concrète sur l’industrie. Le professeur nous a conseillé de nous mettre en rapport avec un industriel expé-rimenté qui pourrait nous aider. Mais dans les grandes entre-prises les patrons ont autre chose à faire. Et puis un rapport piloté par une grande entreprise restera suspect. Les mauvaises intentions y verraient une volonté d’influencer le chef de l’État, d’une manière ou d’une autre. Non, il nous faudrait quelqu’un d’indépendant, quelqu’un qui ait travaillé longtemps dans l’industrie, à différents niveaux et dans différents secteurs.
Autant dire qu’il nous faudrait quelqu’un qui n’existe pas, ajouta le premier. Une fois de plus ce seront les techno-crates qui joueront de leur influence. De toute façon, c’est bien connu : les industriels on ne les écoute jamais, avons-nous seulement un seul industriel au gouvernement ?
Le petit groupe arrivait près d’un village et l’homme fit semblant de s’éloigner du chemin, mais les deux jeunes le pressèrent, en disant : « reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc dans une auberge, pour rester un moment avec eux.
L’aubergiste leur apporta à manger et à boire, et ils reprirent la discussion qu’ils avaient engagée sur le chemin.
C’est de cela aussi dont nous parlions quand tu nous as rejoints, dit l’un des jeunes. Nous nous disions justement : comment faire pour trouver quelqu’un qui pourrait nous aider ?
L’homme parut tout à coup saisi par un étrange sentiment. Il se disait : pourquoi ne pas les assister dans leur démarche ? J’ai si longtemps et si souvent travaillé dans l’industrie. J’en connais
– 19 –
toutes les époques et toutes les étapes. Les yeux fermés, il sem-blait revivre une longue histoire. Il se disait aussi : depuis long-temps, je m’interroge sur l’une des phrases du texte biblique. Dans un verset de la Genèse (3 : 17/19), Dieu avait dit à l’Homme : « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». J’ai toujours travaillé pour vivre se dit-il, mais aujourd’hui, avec l’énergie, avec les machines et les robots et avec Internet, on ne transpire plus forcément au travail. Ceux qui ont écrit l’An-cien Testament ne pouvaient pas employer les mots du monde moderne. Personne ne les aurait compris. Ils ne pouvaient pas parler des machines à vapeur, de machines à contrôle numé-rique, des imprimantes 3D et des objets connectés. J’ai souvent pensé que l’ordre divin devrait voir sa traduction actualisée aux conditions de travail contemporaines. En fait, le texte signifiait « tu gagneras ton pain par ton travail » et même mieux encore « tu seras ton industrie » car c’était bien par son travail et par son industrie que l’Homme avait toujours nourri les siens et développé le monde dans lequel il avait vécu.
L’homme resta encore un moment silencieux puis prit à nouveau la parole :
Si vous le voulez bien, je peux essayer de vous aider ! En fait j’ai vécu à toutes les époques. Vous aurez sans doute du mal à comprendre comment et pourquoi, mais je ne suis pas seulement un homme d’aujourd’hui. Je suis Homo Industrialis. Je suis moi-même, mais je suis aussi tous ceux qui ont vécu dans l’industrie avant moi. Ce sont eux qui m’ont transmis leur histoire et leur savoir en me demandant de me l’approprier. Il est maintenant devenu le mien et je peux vous le transmettre pour qu’il devienne aussi le vôtre.
Les deux jeunes ouvrirent de grands yeux. Eux aussi avaient le sentiment de vivre un moment étrange et irréel. Que voulait bien dire cet homme ? Comment pouvait-il avoir vécu à toutes les époques ? Nul ne pouvait dire cela. Mais peut-être la trans-mission d’expérience avait-elle permis que le vécu des uns et
des autres, à toutes les époques, soit intégrable et transmissible à une même personne ? L’heure n’était pas à la philosophie mais à la décision.
Raconte-nous ton histoire ! dirent les deux jeunes d’une même voix. C’est la providence qui t’a mis sur notre chemin.
Alors l’homme prit la parole et dit :
Je vais vous présenter le résumé de ma vie d’Homo Industrialis. J’en ferai d’abord une rapide synthèse et je la détaillerai ensuite selon les 12 étapes qui ont jalonné toutes mes vies dans l’industrie. Mais avant de commencer, j’aimerais que vous me présentiez de manière succincte et structurée vos sujets de préoccupation pour l’avenir. Cela me permettra de mieux adapter mon discours à vos attentes.
D’accord, répondirent les deux jeunes gens. Nous allons prendre un moment pour nous concerter et préparer notre sujet, puis nous viendrons te présenter nos sujets d’inquiétude.
Les deux jeunes s’installèrent à une table voisine et com-mencèrent à discuter. L’homme les regardait avec admiration et bienveillance. Il se disait que la jeunesse restait bien le symbole de l’espoir. La force, le dynamisme, la naïveté de la jeunesse étaient autant de raisons de croire en l’avenir de l’Homme.
Une heure passa et les deux jeunes revinrent à la table.
Voilà, nous sommes prêts, dit l’un d’eux. L’un de nous évoquera tout d’abord ce qui concerne l’économie et l’industrie en général et l’autre listera ensuite nos questions concernant l’avenir de l’Homme et de la civilisation occidentale.
Très bien, dit l’homme. Commencez tout de suite si vous le voulez bien ! Je suis impatient de vous entendre.
– 21 –
LA RENCONTRE / L’EXPOSÉ DES ÉTUDIANTS
Le premier des deux jeunes s’éclaircit la voix et se concentra sur son exposé. Il sortit un crayon de sa veste et nota quelques mots sur la nappe en papier qui recouvrait la table.
Concernant l’économie et l’industrie, je vois quatre points principaux à évoquer, annonça-t-il. Je voudrais parler de la gestion générale de notre économie, de notre présence dans les secteurs industriels clés, de notre dépendance vis-à-vis de certains facteurs de développement et enfin de la question environnementale.
Je t’écoute, répondit l’homme, bien campé sur sa chaise.
Tout d’abord, poursuivit-il, je voudrais rappeler que la croissance du monde occidental est en panne et nous nous inquiétons que tout le monde semble trouver cela normal. Comment pourrons-nous continuer à progresser, si l’éco-nomie ne croît plus pour nous en donner les moyens ? La croissance signifie aussi l’emploi. Nous ne pourrons pas nous développer sans créer des emplois. Il nous semble que, depuis que l’Homme existe, il travaille pour vivre et pour construire. C’était autrefois sa vie, tout simplement. Il ne travaillait pas forcément au sens où nous l’entendons aujourd’hui, il vivait sa vie d’agriculteur ou d’artisan, et n’en ressentait aucune alié-nation. L’attitude négative de l’Homme moderne vis-à-vis du travail nous inquiète beaucoup.
– 22 –
Nous sommes aussi inquiets de noter nos faibles investis-sements dans les infrastructures (réseaux internet, data centers, cloud computing, etc.). Nous sommes déjà allés dans la Silicon Valley en voyage d’études et nous avons effectué un semestre d’études en Chine. Nous avons pu constater les efforts des USA et de la Chine dans ces domaines.
Avec le deuxième point, je voudrais m’inquiéter de notre absence dans de nombreux secteurs de l’industrie. Nous ne devons certes pas, chercher à être présents et leaders partout, mais il faudrait que l’Europe dispose, au moins dans chaque secteur, d’une place à la hauteur de son rôle dans le monde. Nous lançons des fusées et des satellites, mais pourrons-nous participer à la, conquête de l’espace sans doute nécessaire pour y trouver de l’énergie ? L’Allemagne assure la présence de l’Eu-rope dans le secteur de la machine-outil, mais pour l’électro-nique nous semblons dépendre de l’Asie, et pour internet et ses applications, nous nous plaçons sous la tutelle des USA. Nous avons été puissants dans le domaine des télécommunications mais nous avons disparu de ce secteur. Nos sociétés d’équi-pements pour la production d’énergie sont aussi passées sous contrôle étranger. Il n’est pas question d’être décliniste, mais cela nous semble constituer beaucoup de handicaps.
Mon troisième sujet d’inquiétude concerne justement notre dépendance. Il nous semble que liberté et indépendance vont de pair. Ce ne sont plus les standards de l’Europe qui font les standards du monde. Notre système social semble nous priver de moyens financiers. Nous sommes dépendants des importations pour les matières premières nécessaires à nos productions et pour nos besoins en énergie. Il en est de même pour les réseaux internet. Que se passerait-il si ces robinets se fermaient ? D’où viendra notre valeur ajoutée dans le futur ?
Mon dernier point concerne la question environnemen-tale. On annonce une population mondiale qui va se trouver multipliée par 6 en cent cinquante ans ! Ce ne sera pas le cas des
– 23 –
ressources disponibles sur la terre. La gestion de la population mondiale ne devrait-elle pas être un sujet à confier à l’ONU ? Les réserves d’énergies fossiles se réduisent dangereusement et la pollution de l’air, de la terre et de l’eau progresse. Aurons-nous encore la capacité de nourrir l’humanité ?
Merci, dit l’homme, de m’avoir fait partager tes pré-occupations. Tu as mis sur la table de nombreux points sur lesquels je reviendrai dans mon histoire. Continuons avec ton ami, proposa-t-il.
Je suis prêt, répondit le second jeune homme. Pour ce qui me concerne, j’aimerais évoquer quatre questions au sujet de l’Homme et de la civilisation occidentale.
Allons-y, dit l’homme à nouveau attentif à ce qu’il allait entendre.
Le monde d’aujourd’hui est largement inspiré par les choix effectués par l’Homme occidental. L’énergie, les machines, les transports, les langues, les modes d’échanges, etc., sont souvent venus d’Occident. Pourrons-nous continuer à jouer ce rôle ?
Nous entendons nos responsables politiques dire que notre éducation se délite, que la paresse et les loisirs s’ins-tallent mettant en péril le niveau de notre intelligence qui, faute d’exercice suffisant, s’atrophierait avec l’inactivité, avec les ordinateurs, avec l’intelligence artificielle et avec les robots.
Sans intelligence pointue, l’Homme occidental sera-t-il encore capable d’innover aux frontières de la connaissance, ou laissera-t-il à d’autres le soin d’écrire l’histoire de demain ?
La Révolution Française nous a apporté les droits de l’Homme. Nous en avions bien besoin. Mais elle a aussi lar-gement effacé les devoirs de l’Homme, fondations de notre société occidentale depuis des millénaires. Notre séjour en Chine nous a montré que la culture confucianiste donnait aux jeunes Chinois, le sens du devoir avant celui du droit.
– 24 –
La question du multiculturalisme nous semble aussi devoir être évoquée. Il nous apparaît que l’histoire des civilisa-tions est celle de creusets qui ont forgé des cultures communes et non des différences incompatibles entre elles. Dans son dernier livre (Changer la vie), la journaliste Natacha Polony ne dit-elle pas : « Le multiculturalisme condamne l’espace public à n’être qu’un lieu d’affrontement, où chaque communauté se compte, en s’affichant avec ses symboles ». Que faut-il en penser, et quelles peuvent être les conséquences de ces expé-riences sociétales à plus long terme ?
Je voudrais aussi évoquer la question de la cohabitation avec deux puissances qui se présentent, en concurrentes au rôle de l’Occident. Il s’agit de la Chine et de l’Islam, bien que ces deux forces du futur n’aient rien de commun entre elles, si ce n’est l’importance des conséquences qu’elles font peser sur notre futur.
La Chine nous apparait comme une puissance écono-mique démesurée à laquelle rien ne peut résister. Face à la Chine, la mosaïque occidentale ne nous semble pas une force, mais plutôt un handicap. Comment garder une place face à ce rouleau compresseur ? Deng Xiaoping disait à chaque Chinois de « cacher ses talents en attendant son heure ». L’heure de la Chine n’est-elle pas arrivée ?
Nous décririons l’Islam comme une puissance cultu-relle, fruit d’une religion globale et expansionniste qui inclut non seulement une croyance divine mais aussi un système de gouvernance politique, un système juridique, une mode ves-timentaire comme signe d’appartenance et de prosélytisme, un régime alimentaire et une politique de natalité appropriée à une ambition de développement mondial. La permissivité des pays occidentaux n’est-elle pas une porte grande ouverte à l’expansion de la culture et du mode de vie islamique dans nos pays ?
– 25 –
Le deuxième sujet de préoccupation que je voudrais évoquer concerne la situation de la classe moyenne occidentale. Celle-ci est la grande perdante de la mondialisation. Elle ne se laissera sans doute pas détruire sans réagir.
Cette classe sociale, qui travaille et qui souffre pour enri-chir les gagnants de la mondialisation dans le monde entier, ainsi que les bénéficiaires de notre système de redistribution, continuera-t-elle à se sacrifier pour les autres ?
La politique de la famille nous semble aussi devoir être revue. Le temps consacré par les parents à l’éducation de leurs enfants semble se réduire considérablement, laissant chacun communiquer, en solo, avec son propre ordinateur. Par ailleurs, la faible natalité relative ne change-t-elle pas radicalement la situation économique sans que nous en prenions véritablement conscience ?
L’Homme européen a bâti un système social qualifié de généreux. Peut-il le conserver ? Ne faut-il pas protéger les citoyens occidentaux contre les effets de la mondialisation, au même titre que les Chinois, les Américains, les Russes sont protégés dans leur pays ?
Dans ce contexte, nos dirigeants devraient peut-être redéfinir les conditions qui font que chacun appartient à une nation. Le concept millénaire de nation, qui a forgé les cultures, est en danger. Il aurait sûrement besoin d’être redéfini.
Arrive maintenant la question de la laïcité. Après avoir marginalisé la valeur du travail et raillé la notion de culture nationale, nos élites nous imposent maintenant la laïcité asy-métrique. Il nous semble juste que chacun ait le droit de prier le Dieu qu’il souhaite mais doit-on obliger les uns à être ano-nymes dans leur façon de s’habiller et laisser les autres faire un prosélytisme vestimentaire ?
Que dira-t-on, le jour où tous les chrétiens du monde, porteront la tunique rouge du Christ, se coifferont avec un
– 26 –
bonnet imprimé à l’image de la croix d’épines et marcheront avec un grand bâton télescopique en forme de croix ?
Conséquence de cette marginalisation démographique, parlera-t-on un jour des chrétiens d’Europe comme on parle aujourd’hui des chrétiens d’Orient ou de certains pays d’Afrique ? Les chrétiens d’Europe devront-ils s’expatrier dans un nouveau monde pour pouvoir pratiquer librement leur foi, comme l’ont fait, en leur temps les pèlerins du MayFlower ?
Le risque n’est-il pas la balkanisation des nations ? Partout, les communautés essaient de se regrouper par affinité culturelle, linguistique et religieuse. Un État judéo-chrétien ici, un État laïc là et un État musulman plus loin. Chine, Inde, Pakistan, Russie, ex-Yougoslavie, Afrique, nous donnent de nombreux exemples de provinces ou d’ États créés pour être communautaristes. Qu’en sera-t-il pour l’Europe ?
Enfin, je ne voudrais pas clore ce chapitre sur la classe moyenne, sans évoquer notre crainte au sujet de la sécurité nationale. Nous avons tous perdu des amis ou des connais-sances, victimes du terrorisme. Ce cataclysme est une nouvelle épreuve pour la classe moyenne qui en est à nouveau la prin-cipale victime. Que faire pour corriger cette situation, si cela est encore possible ?
En troisième point, je voudrais insister sur le fait que les Occidentaux devraient mieux connaître les forces en présence dans le monde. Nos voyages d’études et notre semestre d’études à l’étranger, nous ont beaucoup appris. Nos classes d’Affaires Internationales nous ont également été très utiles.
Nous avons étudié les USA, leur fondation récente, leur absence de racines, leur puissance financière, leur décentrali-sation créatrice, leur capacité d’adaptation aux nouvelles cir-constances et leur absence d’assistanat, résultat d’une histoire de l’Homme américain toujours responsable de lui-même.
Nous avons vu la Chine, son histoire éternelle, sa culture confucianiste, son sens du devoir avant celui du droit, sa
– 27 –
renaissance après sa quasi-implosion, son système de gouver-nance si particulier, sa taille gigantesque, son amour du travail et de l’argent, sa volonté d’indépendance et son sentiment discret de supériorité par rapport au reste du monde.
Nous avons étudié la Russie, sa construction historique et laborieuse, ses grands Tsars, sa dimension orthodoxe et sa multi-culturalité régionale, son ancrage occidental, l’énormité de son territoire et de ses ressources naturelles, son amour de la patrie, son sens du sacrifice, son amputation récente et sa nostalgie du passé.
Nos professeurs nous ont présenté l’Inde, sa diversité ethnique, ses 22 langues officielles, son attachement aux reli-gions, sa densité humaine inégalée, la pauvreté de certaines de ses populations, ses invasions fréquentes, sa mousson, sa complexité démocratique, son manque d’infrastructures, sa créativité informatique et sa volonté de rayonnement en Asie.
Nous avons aussi étudié l’Afrique, sa diversité ethnique, ses frontières nationales artificielles, son système clanique, ses conflits religieux, sa richesse minière, sa pauvreté agricole, son manque d’infrastructures, ses systèmes de corruption, sa croissance démographique explosive et son passé colonial.
Nous pensons qu’avec la mondialisation, tous les citoyens et tous les dirigeants devraient bénéficier de ces formations à la connaissance des autres nations.
Pour conclure, je voudrais parler de notre préoccupation vis-à-vis de l’Europe. Face aux grands blocs que constituent les USA, La Chine, la Russie et l’Inde, l’Europe ne doit-elle pas se constituer en une force qui compte ? L’addition d’in-térêts ponctuels ne nous paraît pas faire un État. Peut-on, en outre, diriger un bateau à 27 pilotes quand, selon le port de destination, certains décident ou non de participer au voyage, et d’autres de quitter définitivement le navire ? L’Europe est-elle tellement puissante pour se considérer indestructible ? Il nous semble que l’Europe a besoin de la taille et du système
de pilotage des grands États. L’Europe dispose de la taille, si elle savait intégrer les 27 économies qui la composent. Elle doit, sans doute, se doter d’institutions comparables à celles des USA, de la Russie ou de la Chine pour mieux se diriger.
Voilà, dit le jeune homme, la liste de nos préoccupations. Puisses-tu nous aider à les éclairer par ton histoire et nous dire comment les présenter à notre Président.
L’homme parut très ému. Il était visiblement impres-sionné par la maturité des deux jeunes garçons et par leur volonté de contribuer au destin de leur pays.
Je vais commencer le récit de ma longue histoire, dit-il. Au travers des étapes, j’essayerai de répondre à toutes vos inter-rogations. Il y a longtemps que l’homme œuvre à son destin sur la terre. Il serait dommage qu’il ne continue pas.
– 29 –
MOI, HOMO INDUSTRIALIS
1-L’univers / 2-Les quatre éléments / 3-La lumière / 4-Les plantes / 5-Les animaux / 6-Homo Habilis / 7-Homo Erectus / 8-Homo Sapiens / 9-Le temps des voyages et des découvertes / 10-La révolution agricole / 11-L’élevage / 12-Les guerres / 13-Le temps / 14-Les régimes politiques / 15-L’éducation / 16-L’argent / 17-Le travail / 18-L’Etat et les infrastructures / 19-La femme et la famille / 20-L’art / 21-L’écriture / 22-Les mathématiques / 23-La musique / 24-Les religions / 25-La vie, l’amour, la mort / 26-la chance / 27-Les sciences / 28-La médecine / 29-La conquête spatiale / 30-L’écologie et le chan-gement climatique / 31-Les ONG et les médias / 32-La justice / 33-Homo Industrialis : son patrimoine, ses douze vies et son testament.
– 30 –
Au tout début de mon histoire était l’homme mais avant lui le monde existait depuis longtemps.
1 - L’UNIVERS
L’univers avait été créé il y a environ quatorze milliards d’années.
Mais la Terre n’existait que depuis moins de cinq milliards d’années. Et moi, je n’étais apparu que beaucoup plus tard en n’étant d’ailleurs pas le seul type d’hominine de l’époque.
Je compris beaucoup plus tard que l’univers était en expan-sion, ce qui signifiait qu’à son origine, tous les composants de l’univers (terre, métaux, air, eau…), avaient été concentrés dans un volume plus petit que celui d’une tête d’épingle. Ils attendaient là, on ne sait pas depuis combien de temps, et tout à coup, un « Big Bang » fit tout sortir de la tête d’une épingle. L’univers commençait sa course folle à la vitesse de la lumière.
Je découvris peu à peu que la terre sur laquelle j’habitais depuis des millions d’années n’était pas seule, mais que l’uni-vers était peuplé de centaines de milliards de galaxies (dont la voie lactée qui était notre galaxie), elles-mêmes formées de centaines de milliards d’étoiles (dont le soleil qui était notre étoile). Chacune de ces étoiles disposait de plusieurs planètes satellites comme la Terre. Comme la Terre ? Pas vraiment ! Car en dépit des recherches nombreuses avec des télescopes ultra performants pouvant scruter le ciel jusqu’à des milliards d’années-lumière, personne n’avait jamais trouvé de planète « comme la Terre ». Nulle part il n’y avait de rivières, de fleurs, d’Hommes ou d’oiseaux. Je me disais avec bonheur que j’étais sans doute le seul être à pouvoir contempler les lacs, à pouvoir cueillir les roses et les coquelicots, à pouvoir entendre le chant des oiseaux et à pouvoir boire l’eau fraîche des sources.
Dans l’univers, je découvris aussi les trous noirs (desquels nul corps ne pouvait s’échapper), les naines blanches (les étoiles mortes) ou les géantes rouges (les étoiles en fin de vie) qui
– 31 –
séquençaient la vie de l’univers. J’appris que les traces de feu dans le ciel étaient des comètes (des corps de glace qui, en s’approchant d’une planète, laissaient des traces lumineuses sur plusieurs millions de kilomètres).
Plus tard, d’autres Homo Industrialis découvrirent aussi l’infiniment petit qui constituait toutes les matières de la terre : les molécules, les atomes, les électrons, les quarks, les cordes vibrantes. Toutes les choses visibles, aussi différentes soient-elles semblaient toutes constituées des mêmes composants élémentaires. Ces Homo Industrialis modernes inventèrent la physique quantique et découvrirent les quatre grandes forces qui maintenaient l’univers en place : la gravité (qui expliquait que nous nous tenions debout, que les marées soient en phase avec la lune et que les planètes suivent une orbite elliptique), l’électromagnétisme (qui expliquait l’électricité et l’attraction de la boussole vers le nord), les forces nucléaires fortes ou faibles (qui retenaient les électrons entre eux pour en faire de la matière) et enfin l’énergie noire (que l’on disait présente dans tout le vide sidéral et que l’on n’avait pas encore très bien compris).
Malgré cela, beaucoup de choses restaient encore à décou-vrir dans l’univers.
2 - LES QUATRE ÉLÉMENTS
Depuis toute éternité, la terre, l’eau, l’air et le feu régnaient sur la planète. Selon Empédocle au ve siècle av. J.-C., tous les matériaux constituant le monde étaientcomposés de ces quatre éléments. Les rédacteurs de la Genèse (Ancien Testament) décrivaient aussi les étapes de la création du monde, à partir de ces éléments. Dans toutes les civilisations, les quatre éléments eurent une place importante dans l’explication des phénomènes de la nature et dans la cosmologie. Les Chinois retenaient eux cinq éléments mentionnés dans leur propre cosmologie : le métal, le bois, l’eau, le feu et la terre.
– 32 –
La terrereprésentait la solidité et la sécurité et servait de fondations à toute chose. Elle s’exprimait dans ce qui est dur, dense, figé, fixé. La terre était la source de la vie matérielle et symbolisait nos racines et notre nourriture. Elle évoquait le sec et le froid et matérialisait les émotions comme la peur ou la dépression. Elle exprimait aussi tous les sentiments qui nous liaient au monde physique comme la froideur, l’égoïsme, la sensualité, l’envie exacerbée de possessions matérielles.
L’eauétait humble. Elle prenait la forme de tous ses réci-pients et s’installait toujours à la place la plus basse. L’eau était mobile, curieuse et persévérante et essayait toujours de pénétrer tous les espaces vides de la terre. L’eau était symbole de mobilité et de flexibilité car l’eau pouvait prendre tous les états : solide, liquide ou gazeux. L’eau gagnait toujours : elle érodait la terre et dessinait ses formes, elle traversait l’air sous forme de pluie et pouvait éteindre le feu. L’eau symbolisait le froid et l’humidité. Elle recouvrait 85% de la surface du globe terrestre et formait 75% du corps humain. Sans eau, il ne pouvait y avoir de vie.
L’air nous entourait, partout où nous étions. L’air était insaisissable, léger et sensible au mouvement. L’air était invi-sible, impalpable, extensible et apparemment sans poids. L’air contenait pourtant l’oxygène nécessaire à toute vie. Avec le vent, il représentait la puissance du dragon mais il évoquait aussi la liberté, et la transparence. L’air matérialisait notre esprit et l’état de nos pensées (on changeait d’air pour changer de pensées). Enfin l’air, de caractère humide et chaud, pouvait porter l’image de la haine, de la jalousie et de la colère.
Le feuétait très actif, il possédait une chaleur qu’il pouvait communiquer à son environnement immédiat. Il transformait la matière qui, à son contact pouvait devenir liquide, gazeuse ou s’enflammer à son tour. Le feu évoquait le chaud et le sec. Il était l’énergie apportée à nos corps notamment par l’ali-mentation. Il exprimait l’amour, l’enthousiasme et la passion.
– 33 –
Le feu était à la fois le destructeur pour renouveler la vie et dispensateur de la chaleur nécessaire à la vie.
……………………
Première strophe du poème de Claude Roy :
L’air c’est rafraîchissant,Le feu c’est dévorant,La terre c’est tournant,L’eau - c’est tout différent.
3 - LA LUMIÈRE
La lumière était l’un des phénomènes les plus extraordi-naires de l’univers. La lumière était connue pour être le jour, le temps pendant lequel les Hommes travaillaient, par opposition à la nuit, le temps pendant lequel les Hommes dormaient. Mais la lumière était aussi le symbole de la vie et de la connaissance alors que l’absence de lumière (les ténèbres) était associée à la mort. La lumière avait été liée à la manifestation de Dieu. La lumière était l’esprit de la construction des cathédrales gothiques et de leurs vitraux (la théologie de la lumière).
En science, c’est Euclide, un mathématicien grec qui vécut voilà vingt-cinq siècles, qui s’intéressa le premier au phénomène physique de la lumière. Il parla de sa capacité de réflexion et de sa propagation en ligne droite. Héron d’Alexandrie supposa déjà que la vitesse de la lumière était infinie. Autour de l’an 1000, Ibn Al Haytham, un mathématicien musulman, comprit que la lumière provenait de sources lumineuses et que ses rayons venaient ensuite illuminer l’œil. L’optique progressa brutalement avec la découverte des lentilles, par des artisans ita-liens du xiiiesiècle et, vers 1600, Galilée, un physicien italien, observa la lune pour la première fois.
Huygens, un mathématicien et astronome hollan-dais, comprit que la lumière était une onde. Les ondes
– 34 –
électromagnétiques étaient connues depuis longtemps. Elles étaient réparties en fonction de leur longueur ou de leur fré-quence. La longueur d’onde de la lumière ne couvrait qu’une toute petite partie des ondes électromagnétiques (depuis les rayons Y, les rayons X, les UV, les infrarouges, les petites, les moyennes et les grandes ondes) mais la lumière était la seule onde que l’Homme pouvait voir de ses yeux. Et, quelle chance pour nous, l’onde de lumière couvrait toutes les cou-leurs. Comme la somme de toutes les couleurs était le blanc, la lumière était blanche. Les jours de pluie et de soleil associés, un rayon de lumière pouvait traverser une goutte d’eau. La lumière entrant dans la goutte d’eau était alors réfractée et ressortait en fonction des propres longueurs d’onde de chacune des couleurs. Ainsi apparaissait l’arc-en-ciel et ses 7 couleurs : le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet.
Nous savions depuis longtemps que la lumière transportait une grande partie de l’énergie solaire jusqu’à la surface de la Terre. La lumière nous permettait non seulement de voir et de nous réchauffer, mais elle permettait aussi, grâce à la photosyn-thèse, de maintenir l’équilibre de l’environnement naturel avec la régénération de l’oxygène par la chlorophylle des plantes.
La physique du xxesiècle montra que l’énergie transportée par la lumière était mesurable. On appela photon à la fois la particule élémentaire de la lumière et le quantum d’énergie (la quantité d’énergie indivisible) qu’elle portait.
Le photon était de l’énergie à l’état pur. Notre photon dépo-sait donc son énergie dès qu’il rencontrait un atome de quoi que ce soit sur la Terre et c’est pour cela que l’on avait plus chaud au soleil qu’à l’ombre. Et le processus était réversible ! Dès que dans une réaction nucléaire, un atome perdait de l’énergie, il émettait des photons qui contenaient l’énergie perdue par l’atome.
Le photon circulait dans le vide, à la vitesse dite de la lumière, soit à 300 000 km par seconde, et il était le seul à
– 35 –
pouvoir voyager à cette vitesse. Il pouvait se propager pendant des millions d’années sans jamais ralentir. Selon Einstein, le photon, qui voyageait à la vitesse de la lumière, ne connaissait pas le temps. Le passé, le présent ou l’avenir étaient pour lui la même chose. Le photon était intemporel. Et comme pendant le temps où il ne vieillissait jamais, il parcourait des milliards de km, le photon, qui était le temps, était aussi l’espace.
L’avis de Dieu : une poésie de Jacques Réda
Ayant mesuré tout ce qui se mesurait,
Le savant a bien dû se rendre à l’évidence,
La matière est mystère et la vie un secret,
Il appelle chaos ce qui vit et qui danse.
Sur soi soudé par le proton et le neutron,
Le noyau vire au spin des quarks dans sa rotonde.
L’électron vole autour et, moqueur ou poltron,
Le photon détecté se défend d’être une onde.
4 - LES PLANTES
Avec la terre, l’eau et la lumière, les plantes purent appa-raître, et avec les plantes, l’Homme put exister. Les premières algues (pluricellulaires) apparurent sur Terre il y a un virgule deux milliards d’années. Puis, il y a près de cinq cents millions d’années, certaines algues, qui produisaient de la chlorophylle, donnèrent naissance aux algues vertes. C’est à cette époque que les premières plantes terrestres apparurent. Les plantes allaient pouvoir coloniser la planète.
La première difficulté rencontrée par les plantes fut la sécheresse. Certaines développèrent un arrêt du métabolisme de photosynthèse, jusqu’à ce que l’eau revienne. D’autres développèrent des systèmes de réduction des pertes en eau.Les premières plantes multicellulaires avaient deux cycles de reproduction : la production de gamètes (mâle ou femelle) et
– 36 –
la production de spores. Les spores étaient utilisées pour la reproduction asexuée (par elle-même) et les gamètes pour la reproduction sexuée (entre gamètes de sexe différent). Cette double méthode de reproduction permit aux plantes de faire face à toutes les situations.
Pour pouvoir effectuer la photosynthèse, les plantes devaient absorber du CO2atmosphérique. Les feuilles furent une adap-tation destinée à accroître la quantité de lumière solaire utili-sable par la photosynthèse. Pour atteindre des formes arbores-centes, les plantes primitives durent aussi développer des tissus ligneux (imperméables et rigides) fournissant un support et transportant l’eau, vers les feuilles. Les racines fournissaient une source d’eau et de nutriments venus du sol. Le développement des plantes modifia le climat en réduisant sa part de CO2.
Tous les types de plantes modernes pouvaient alors se développer : les fougères, les plantes à graine nue (surtout les conifères) et les plantes à graine protégée (elles portaient des fleurs qui étaient leur partie sexuée et attractive pour que les insectes assurent leur fécondation). Les orchidées furent de véritables stratèges.
La nature put alors proposer : les algues, les arbres fruitiers ou d’ornement, les palmiers, les arbustes, les céréales, le coton, les agrumes, les légumes, les plantes aquatiques, les plantes carnivores, les plantes médicinales,… Toutes ces plantes par-ticipaient à la vie de l’Homme : production de son oxygène respiratoire, captage de son CO2et apport de nourriture à tous les êtres vivants. S’y ajoutait, la formation du bois pour la construction et la lutte contre l’érosion des terres. Sans les plantes il n’y aurait tout simplement jamais eu d’Homo Industrialis.
– 37 –
5 - LES ANIMAUX
Avant moi étaient venus d’abord les animaux marins, puis les mammifères et les dinosaures. Il y a soixante-cinq millions d’années, selon les experts, un grand cataclysme, détruisit tous les dinosaures, et seuls quelques mammifères survécurent. Ces mammifères étaient mes lointains ancêtres.
Il y a six millions d’années j’avais un ancêtre commun avec mes cousins chimpanzés. Mais nos routes se séparèrent et se séparèrent encore.
La terre était riche de milliers d’animaux qui accompa-gnaient la vie des Hommes : des éléphants, des lions, des tigres, des girafes, des buffles et des crocodiles, mais aussi des oiseaux de toutes sortes comme les aigles, les condors, les mésanges, les cigognes et les pinsons qui chantaient toute la journée pour égayer nos vies. Il y avait aussi les papillons, les libel-lules et les abeilles qui butinaient les fleurs des champs. Nous avions toujours eu besoin d’eux. Enfin il y avait les mers et les rivières qui étaient remplies de poissons comme les carpes, les anguilles, les requins, les baleines et les mérous, pour assurer notre nourriture.
Les animaux faisaient preuve d’une intelligence certaine, même si celle-ci était différente de la nôtre. Par exemple les chevaux, les éléphants et d’autres animaux apparemment calmes pouvaient attendre des mois ou des années pour se venger de mauvais traitements. Les animaux (les grands singes par exemple) avaient dû élaborer des règles de vie sociale très sophistiquées pour pouvoir survivre entre eux. Si nous étions seuls dans l’univers, nous étions loin d’être seuls sur la Terre.
6 - HOMO HABILIS
On m’avait nommé un jour « Homo Habilis » pour mieux faire remarquer mon habilité. C’était il y a environ deux virgule cinq millions d’années. J’étais déjà bipède mais mes membres postérieurs étaient trop courts pour que je puisse marcher
– 38 –
durablement. J’étais l’homme de la pierre taillée. Et puis voilà environ deux millions d’années, je me suis mis debout, dans la plaine du Rift de l’Ouest Africain et je décidais d’y rester. J’en avais assez, tout habilis que j’étais, de marcher à quatre pattes et de ne rien voir de ce qui se passait dans la savane.
En 1974, on découvrit le squelette de l’une de mes cousines de cette époque, une jeune femme bipède de la corne d’Afrique, qui vivait en Ethiopie et s’appelait Lucy.
C’est à ce moment-là que je suis devenu Homo Erectus.
7 - HOMO ERECTUS
« Homo Erectus », j’ai continué à évoluer. J’étais cueilleur de fruits et de racines.
Voici quatre cent mille ans, j’ai inventé le feu. Cela a changé toutes mes habitudes alimentaires. C’était soudainement meil-leur et je n’avais plus besoin de m’arracher les dents pour me nourrir. Le feu m’aida à mieux me défendre des animaux sau-vages, ce qui n’était pas toujours facile.
Par la suite, on ne se posa plus la question de la nourriture, mais pendant des millénaires, il a fallu chasser, prendre des risques, quelques fois se faire tuer pour attraper la nourriture nécessaire à nos familles.
8 - HOMO SAPIENS
Il y a environ trois cent mille ans, j’ai pris la forme d’ « Homo Sapiens », ma famille biologique définitive. J’aimais déjà voyager, non pas pour le plaisir de voir du pays, mais pour suivre les animaux que je devais tuer pour me nourrir.
C’est ainsi que j’ai quitté l’Afrique, il y a soixante-cinq mille ans, et que je me suis installé en Chine (il y a soixante mille ans) et en Indonésie (il y a quarante-cinq mille ans). On me trouva également en Europe il y a quarante-cinq mille ans.
– 39 –
J’ai été l’Homme de Néandertal, mais cette lignée-là n’a pas survécu.
Il y a trente-cinq mille ans, je suis devenu l’Homme de Cro-Magnon, dernier état des Sapiens. C’est sous cette forme biologique que je me suis alors développé. J’ai éliminé peu à peu toutes les autres formes d’humanité qui auraient pu me faire concurrence.
J’étais Homme et j’avais une conscience. J’avais surtout conscience de mon existence et j’étais capable de penser. « L’Homme était un roseau pensant » dirait plus tard Pascal. J’allais donc pouvoir inventer une multitude de sciences. Mais je devais aussi rester modeste car « sciences sans conscience n’était que ruine de l’âme », avertirait un jour François Rabelais.
9 - LE TEMPS DES VOYAGES ET DES DÉCOUVERTES
Il y a quarante-cinq mille ans, je devins aussi navigateur, bien sûr avec de simples radeaux mais à l’époque, ce n’était pas si mal ! Cette nouvelle compétence me permit de traverser les océans et de découvrir de nouveaux continents, comme l’Australie (il y a quarante-cinq mille ans) ou les Amériques, via la Sibérie (il y a plus de quinze mille ans).
Je n’ai pas toujours eu une bonne attitude écologique, et le respect de la biodiversité n’a pas toujours été mon fort. J’ai apporté de nouvelles plantes qui modifièrent les paysages et les ressources végétales. J’ai aussi détruit de nombreuses espèces locales, quand cela facilitait mon approvisionnement alimen-taire. C’est ce que j’ai fait et que je regrette, en Australie et dans les Amériques. En quelques milliers d’années j’ai détruit la plupart des espèces spécifiques à ces continents. Plus tard je militerai pour que telles choses ne se produisent plus, mais à l’époque on ne pensait pas beaucoup au futur. On voyait de nombreux animaux, on les tuait pour les manger. C’était tout !
– 40 –
Mes découvertes géographiques furent peu à peu oubliées, au point qu’il y a peu de temps encore, certains hommes ne savaient plus que la Terre était ronde, alors qu’Eratosthène en avait calculé le diamètre pratiquement exact (39 375 kilomètres ou 250 000 stades) il y a deux mille trois cents ans.
Il a fallu qu’à partir de 1405, les Chinois, avec l’Amiral Zheng He, visitent l’Indonésie, le Golfe Persique, la Mer Rouge, l’Afrique de l’Est et peut-être plus encore, avec des armadas regroupant 700 bateaux de plus de 100 mètres de long, équipés de 9 mats et de 12 voiles, et embarquant quelque 30 000 hommes d’équipage et de passagers.
Il a fallu qu’en 1492 Christophe Colomb parte vers l’ouest, avec trois petits rafiots de 28 mètres de long et une centaine d’hommes, pour découvrir l’Amérique (pensant jusqu’à sa mort avoir découvert les Indes), que Bartolomé Dias vérifie en 1487 l’existence du Cap de Bonne Espérance, que Vasco de Gama, en 1498, poursuive le voyage de Dias pour atteindre les Indes, que Pedro Alvares Cabral découvre le Brésil en 1500 et que Magellan fasse le premier tour du monde en 1521 en partant vers l’ouest.
Il a en effet fallu tous ces grands navigateurs, pour que la découverte de la planète reprenne la dynamique que j’avais engagée quarante-cinq mille ans plus tôt.
Figure : Le type des 400 bateaux de Zheng He et la Santa Maria (3 bateaux) de Christophe Colomb.
– 41 –
Ces découvertes changèrent beaucoup le monde. Colomb avait ouvert la route à l’arrivée massive des Européens en Amérique du Nord. Hernan Cortes avait conquis le Mexique et Teotihuacan sa capitale de 250 000 habitants. Francisco Pizarro fut le tombeur de l’Empire Inca et le Brésil de Cabral devint Portugais. Pour l’or ou pour les matières premières, les Européens s’installèrent peu à peu, partout en Amériques, en Afrique, en Asie, en Australie, avec pour but de constituer des empires et de se substituer aux populations locales.
10 - LA RÉVOLUTION AGRICOLE
Et puis, un jour, il y a plus de dix mille ans, je me suis sédentarisé. J’ai alors créé des fermes, j’ai planté des céréales, et je suis devenu agriculteur. J’ai commencé au Moyen-Orient car là-bas il y avait des fleuves et des terres fertiles. Labourage, semailles, épandage des engrais ou irrigation, récolte et battage marquèrent pour des siècles le rythme de mes saisons. Peu à peu j’ai déployé ma « révolution agricole » et le monde tout entier est devenu un monde d’agriculteurs. Selon les régions, j’ai planté le blé, le riz, la pomme de terre…
Ce fut pour nous une métamorphose considérable. D’hommes libres allant où le vent nous appelait, nous sommes devenus des sédentaires, au service de nos productions agri-coles. Oui nous avons alors perdu notre liberté. Oui, nous sommes devenus dépendants : une bonne année (eau et soleil) et tout allait bien, une mauvaise année (sécheresse et mauvaises herbes) et nous mourrions de faim.
Fini l’insouciance du chasseur-cueilleur ! Bienvenue aux soucis du propriétaire. Pourquoi avoir accepté ce changement ? Par instinct sans doute, plus que par raisonnement.
Le chasseur-cueilleur ne pouvait pas se développer à grande échelle. Nous étions condamnés à rester de petites troupes, dans divers endroits du monde. Sans la sédentarisation, nous n’aurions jamais existé comme espèce dominante. Les gènes
– 42 –
qui nous ont poussés à devenir sédentaires, étaient les gènes de l’humanité conquérante.
Avec le blé (en Occident) et surtout le riz (en Orient) nous avons développé des aliments d’une grande capacité nutritive. De tels aliments nous ont permis un développement à grande échelle, nous faisant passer de quelques centaines de milliers d’hommes sur la Terre, il y a dix mille ans, à plus de 10 milliards d’hommes à la fin du xxiesiècle. Et pourtant, les experts ne disaient-ils pas que la Terre ne pouvait pas supporter plus de 2,5 milliards d’individus !
Sédentaires, nous avons pu travailler, produire des outils et élever des enfants. Ce fut le début du progrès. J’avais de la nourriture et j’étais désormais assez stable pour pouvoir entreprendre des choses durables.
11 - L’ ÉLEVAGE
Après la production agricole, je me suis mis à l’élevage. J’ai d’abord capturé des animaux sauvages : les moutons, les cochons, les poules, les vaches, les ânes et les chevaux. L’élevage a profondément modifié notre mode de vie. Nous pouvions manger de la viande plus régulièrement et, avec la vache, la chèvre et la poule, nous disposions régulièrement de lait, de fromage, de graisse et d’œufs. Les animaux nous fournissaient aussi la laine, les boyaux et le cuir. C’est ainsi que nous pûmes fabriquer des chaussures, du parchemin, des draps et des habits.
Mais plus encore, les animaux domestiqués comme le bœuf, l’âne, le cheval, pouvaient nous aider dans les travaux agricoles, comme le labourage ou la récolte, et dans tous les travaux jusqu’alors effectués à la force de nos bras. Le cheval devint le moyen de transport des hommes et des marchandises.
Nous vivions souvent avec nos animaux, surtout l’hiver pour profiter de leur chaleur. Dans la journée les poules cou-raient entre nos huttes et les chiens nous accompagnaient dans
– 43 –
nos travaux et pour garder nos troupeaux. Avec nos greniers remplis de grains, les animaux représentaient notre richesse.
12 - LES GUERRES
La sédentarisation agricole nous a aussi apporté la guerre. Nous avions dès lors quelque chose à protéger, quelque chose que les autres pouvaient nous envier. Comme cultivateur, je faisais des stocks pour pallier aux périodes de disette. C’était dans les périodes où il n’y avait pas assez, que chacun voulait prendre les réserves de l’autre. Les guerres étaient toujours brutales et même mortelles. On brûlait les villages, on tuait les habitants, on violait les femmes, on enlevait les enfants qui devenaient de nouveaux bras.
Avec le temps, les états constituèrent des armées considé-rables de centaines de milliers de soldats. J’ai été soldat en Chine (200 av. J.C.), dans l’Empire Romain ou encore dans les nations européennes. J’ai assisté à des batailles faisant des dizaines de milliers de morts : à Troie où l’invincible Achille tua le brillant Hector, au nord de l’ Égypte (à la bataille de Kadesh avec Ramsès II contre les Hittites), au Moyen-Orient (lors de la chute de Jérusalem), en Perse (à la victoire d’Alexandre sur Darius), en Chine (à l’unification de la Chine sous les Qin), dans l’Empire Romain (à la destruction de Carthage, à la guerre des Gaules de Jules César, à la guerre entre Claude et Marc-Antoine et au siège de Massada), à la Guerre de Cent ans, à la Première Guerre Mondiale, à la Seconde Guerre Mondiale, à la Guerre du Viêt-Nam, au terrorisme, etc… Il y a toujours eu des guerres.
La guerre fut l’un des principaux moteurs du développe-ment des techniques. Les rois et les seigneurs voulaient tou-jours des armes plus puissantes. Les guerres entre les hommes commencèrent avec de simples gourdins de bois, puis avec des massues assemblant une grosse pierre bien pointue à un manche en bois. Je fabriquais ensuite les lances en bois qui
– 44 –
permettaient de tenir les adversaires à distance et les arcs qui lançaient des flèches depuis des positions protégées.
Je franchis une marche importante avec la métallurgie. Je pus dès lors réaliser des lances et des épées en métal toujours moins lourdes et plus résistantes.
Je commençais à fondre le bronze en Chine, mille huit cents ans avant que mes collègues occidentaux ne le fassent de leur côté. Mes flèches disposèrent alors de pointe en bronze ce qui les rendait encore plus destructrices. Je transformais l’arc en arbalète, en y ajoutant une gâchette en bronze qui permettait d’envoyer des flèches à plus de 200 mètres. La guerre se trans-forma encore avec l’invention de la poudre à canon. C’est en Chine que j’ai inventé cette poudre noire mais, curieusement, les Empereurs ne l’utilisèrent que très peu. La technologie de la poudre arriva en Europe par la route de la soie, et donna lieu à la construction des premiers canons. Les canons (sur la terre ou sur les bateaux) lançaient des boulets ou de la mitraille.
J’ai souvent utilisé des fusils (que l’on rechargeait d’abord par le canon et qui étaient équipés d’une baïonnette pour mieux enfourcher l’ennemi rapproché). Par la suite, nos fusils disposèrent d’une réserve de plusieurs balles. Les révolvers de poing, les mitraillettes et les mitrailleuses entrèrent rapidement dans la panoplie de toutes les armées. La fameuse mitrail-lette Kalachnikov permettait à n’importe qui de tuer en série. Les mitrailleuses (à canon simple ou multiple) purent, dès 1870, tirer plus de 1000 balles à la minute puis, un peu plus tard, 4000 balles à la minute. En bonne position, on pouvait décimer une armée entière en un instant.
Avec l’invention de l’énergie et des moteurs, je vis arriver les tanks et les avions de combats. Avec le tank je pouvais tuer sans être tué, et avec l’avion je pouvais bombarder du haut du ciel des villages et des infrastructures stratégiques, sans prendre de risques. Le summum de l’horreur de la guerre arriva les 6 et 9 août 1945, avec la bombe atomique américaine qui détruisit
– 45 –
deux villes japonaises et tua plus de 200 000 personnes. J’étais japonais à cette époque et je vis de nombreux habitants griè-vement brûlés.
Les avions de chasse organisèrent la guerre du ciel, comme de simples fantassins pouvaient le faire sur terre. Ils pouvaient décoller et atterrir en n’importe quel point de l’océan, à partir de porte-avions à moteur atomique qui n’avaient jamais à refaire le plein de carburant. Les sous-marins devinrent ato-miques, eux aussi en vue de rester actifs des mois durant, sans avoir à se ravitailler en carburant et sans jamais faire de bruit. Ils étaient équipés d’ogives nucléaires à tête multiples, capables d’être lancées de n’importe quel point des océans. Chaque sous-marin disposait de 16 ogives et chaque ogive, une fois lancée, pouvait se séparer en 10 sous-ogives, toutes équipées d’une charge nucléaire. En quelques minutes, un seul sous-marin pouvait donc détruire 160 villes dans le monde. La France avait 4 sous-marins de ce type, le Royaume-Uni 4, la Chine 4, la Russie 11, les USA 14. Soit un total de 38 sous-marins lanceurs d’ogives atomiques. C’était sans compter les 17 sous-marins lanceurs de missiles, et les 89 sous-marins d’attaque. Il fallait aussi ajouter les bombes atomiques largables d’un avion. 16 000 engins de destruction atomique étaient en poste !
Pour se prémunir contre de telles attaques, certains pays développèrent le système de la guerre des étoiles. Il s’agissait de satellites tueurs, capables de détecter le lancement des ogives nucléaires et de les intercepter pour les détruire, avant que celles-ci n’arrivent à leur destination. Le monde engloutis-sait ainsi des millions de milliards de dollars à préparer son autodestruction.
La guerre chimique fut d’une autre dimension. Il s’agissait de détruire l’ennemi en lui faisant respirer des gaz mortels. L’Homme commença à les employer pendant la Première Guerre Mondiale. Pendant la guerre du Viêt-Nam, les Français
– 46 –
et les Américains firent usage de bombes au napalm. Les armes chimiques furent interdites par les conventions internationales à partir de 1980. On accusa cependant la Syrie d’en faire usage vers 2015.
Mais le xxiesiècle allait changer le cours de l’histoire de la guerre. Jusqu’alors on pouvait localiser un ennemi géogra-phiquement. C’était un état, une nation, un pays. Il avait une armée et on pouvait l’attaquer ou s’en défendre. Avec le terrorisme islamique, dont le premier acte de guerre fut l’at-taque des tours jumelles de New-York qui fit 3 000 morts le 21 septembre 2001, l’ennemi n’avait ni pays, ni nation. Il était donc impossible de riposter. De ce fait, tout l’arsenal militaire construit au cours des décennies précédentes ne servait plus à rien. Inutiles les chars, inutiles les ogives nucléaires, inu-tiles les autres armements sophistiqués. L’ennemi utilisait des kamikazes le plus souvent de la même nationalité que celle du pays qu’il attaquait. Il tuait à l’arme blanche, avec de simples véhicules pour écraser les piétons, ou avec ce que l’on appelait les « engins explosifs improvisés » pour détruire des bâtiments et faire le maximum de victimes. Il n’y avait plus de riposte militaire possible et tous les pays étaient touchés par cette guerre : les pays occidentaux comme les autres. Malgré cette menace barbare, les états civilisés continuaient de s’équiper massivement en fusées, en avions de chasse et en bateaux de guerre, sans doute pour s’autodétruire plus rapidement encore. L’Homme n’a jamais bien su identifier son véritable ennemi.
13 - LE TEMPS
Depuis le Big Bang, le temps avait toujours coulé. Sa marche inéluctable avait permis à l’univers de se construire, et aux hommes de réaliser leurs ambitions. Mais le temps était aussi une cause de réflexion. Que restait-il de la vanité, de l’ambition et de la grandeur, après que le temps se soit écoulé ? Une chose était certaine : le temps ne mourait pas et suivait son cours quoi
– 47 –
qu’il arrive. Rien ou presque ne résistait au temps, et l’Homme aurait souvent dû rester plus modeste.
Le temps des empires :
La plupart des empereurs ou dirigeants des grands états eurent l’ambition de conquérir le monde. Leur vanité aurait été mise à l’épreuve, s’ils avaient pu assister à l’avenir de leur création, une décennie, un siècle, un millénaire plus tard.
Nabuchodonosor aurait été plus humble s’il avait pu assister à ce que deviendrait Babylone et ses splendeurs. De même Ramsès II pour l’ Égypte et sa civilisation avancée, Alexandre le Grand pour ses conquêtes, Jules César pour l’Empire Romain, Attila pour les ravages des Huns, et Lénine pour le soviétisme. Tous avaient construit sur du sable. Rien ne resterait de leur construction. Le temps effaçait tout, sauf quelques monu-ments, comme pour mieux témoigner de leur chute.
Un seul Empire pouvait se vanter d’avoir survécu aux mil-lénaires : la Chine. Crée en 221 av. J.C., la Chine- État existait encore au xxiesiècle. Sa civilisation avait cinq mille ans d’his-toire. Elle avait traversé de multiples catastrophes qui auraient dû lui être fatales, mais elle avait survécu. Le confucianisme (structure durable pour la société) d’une part et son sens de la cybernétique (autorégulation) d’autre part, lui avaient permis de traverser les siècles. Cela aurait pu être un sujet d’étude pour les autres nations si celles-ci n’avaient pas été elles-mêmes, si vaniteuses.
Le temps des révolutions :
Tous les pays avaient connu leurs révolutions. Certains pays en avaient même connu de nombreuses. Les révolutions cherchaient la destitution du pouvoir en place, pour en installer un autre. De toutes les révolutions, trois voulurent changer non seulement le pouvoir dans leur pays mais aussi et surtout le monde.
– 48 –
La révolution américaine annonça le temps de la libération des peuples. La plus évoluée des colonies mettait fin à la période de colonisation qui avait dirigé le monde, depuis la période des grandes découvertes. Venait alors le temps des nations libres.
La révolution française voulut imposer le principe des Droits de l’Homme à l’humanité tout entière, fut-ce par la guerre. Elle réussit à diffuser ses idées « des lumières » au monde et ouvrit un nouveau chapitre de l’histoire. La révolution fut cependant régicide, ultra anticléricale envers les curés, les moines et les provinces pieuses comme la Vendée. Les biens de l’église furent confisqués. Il fallut du temps pour juger les choses. Quand en 1973, Zhou Enlai qui visitait la France dut répondre à la ques-tion « que pensez-vous de la révolution française ? », celui-ci répondit habilement qu’il était encore beaucoup trop tôt pour se prononcer ! Tout ne fut pas lumière dans