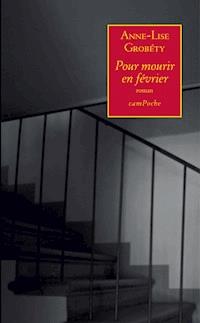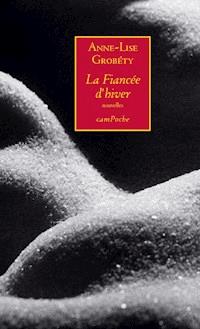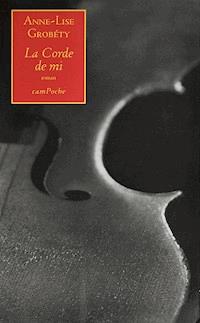Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Une confession émouvante, criante de vérité, écrite avec délicatesse
"L’itinéraire autobiographique d’une adolescente puis d’une jeune femme traquée par l’angoisse et la dépression. Elle essaie d’en sortir par la danse. Les plus belles pages du livre sont celles sur les cours et les auditions, cet univers de la danse classique, univers clos, asphyxiant, fascinant. (…) Le travail à la barre, le « dédale aveuglant du miroir » sont admirablement évoqués. (…) Elle a finalement abandonné la danse pour se consacrer à l’écriture et au tissage. Désir d’échapper à cette emprise, de se définir et de se « soigner » autrement ? En tout cas, un itinéraire et un texte attachants." -
Claude Pujade-Renaud, Heures Claires
Un roman dont le récit joue avec les mots, leur sens, leur importance et nous pousse à une lecture active
EXTRAIT
La première chose — je ne m’y attendais pas ! — cette question : comment savoir où, très exactement, faire commencer l’histoire ? à quelle section du fil sur la bobine qui se dévide ?
Un jour plus tôt — pourquoi pas ?
Car l’enchaînement des gestes et des paroles, l’enchaînement des jours et des heures ne peuvent aisément se briser comme on rompt un pain en morceaux…
Pourtant, il faut bien décider d’une première bouchée. Mais alors, quel mot vaut-il plus qu’un autre dans cette histoire pour qu’on lui donne la priorité sur tous les autres ?
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Un récit puissant dans lequel elle dit à la fois soi et profondément nous." -
Monique Balmer, Fémina
A PROPOS DE L’AUTEUR
Anne-Lise Grobéty (1949-2010) étudie à la Faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel et effectue un stage de journalisme. Elle commence à écrire très tôt, et elle a dix-neuf ans lorsque paraît son premier roman. Après un deuxième roman, elle ralentit son activité littéraire pour s’occuper de ses enfants. Dans le même temps, elle s’engage politiquement et siège pendant neuf ans comme députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois. Son mandat achevé et ses filles devenant plus autonomes, elle renoue avec l’écriture dès 1984.
Anne-Lise Grobéty se fait connaître du grand public dès son premier roman,
Pour mourir en février, couronné par le Prix Georges-Nicole. La suite de son œuvre remporte le même succès. Ses narratrices cherchent à affirmer leur identité féminine, à une époque où la présence des femmes en littérature commence à s’affirmer. Anne-Lise Grobéty est donc aussi fortement concernée par la condition de la femme écrivain, par les aspects historiques, formels et politiques de l’écriture féminine, mais elle poursuit surtout une exploration de la langue dans une tonalité bien à elle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne-Lise Grobéty
Née en 1949 à La Chaux-de-Fonds, Anne-Lise Grobéty étudie à la Faculté des lettres de l’université de Neuchâtel et effectue un stage de journalisme. Elle commence à écrire très tôt, et elle a dix-neuf ans lorsque paraît son premier roman. Après un deuxième roman, elle ralentit son activité littéraire pour s’occuper de ses enfants. Dans le même temps, elle s’engage politiquement et siège pendant neuf ans comme députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois. Son mandat achevé et ses filles devenant plus autonomes, Anne-Lise Grobéty renoue avec l’écriture dès 1984.
Anne-Lise Grobéty se fait connaître du grand public dès son premier roman, Pour mourir en février, couronné par le prix Georges-Nicole. La suite de son œuvre connaît le même succès : le prix Rambert et deux prix Schiller lui ont notamment été décernés. Parmi ses publications les plus importantes, les romans Zéro positif et Infiniment plus, tous deux traduits en allemand, et les recueils de nouvelles La Fiancée d’hiver et Belle dame qui mord. Elle a reçu le Grand Prix C. F. Ramuz en 2000, et le Prix Saint-Exupéry-Valeurs Jeunesse de la Francophonie 2001 pour Le Temps des mots à voix basse.
Ses narratrices cherchent à affirmer leur identité féminine, à une époque où la présence des femmes en littérature commence à s’affirmer. Anne-Lise Grobéty est donc aussi fortement concernée par la condition de la femme écrivain, par les aspects historiques, formels et politiques de l’écriture féminine, mais elle poursuit surtout une exploration de la langue dans une tonalité bien à elle.
Anne-Lise Grobéty
Infiniment plus
roman
« Infiniment plus »,a paru en édition originale en 1989chez Bernard Campiche Éditeur, à Yvonand
Ce livre a été subventionné par la Fondation suissepour la culture Pro Helvetia dans le cadre de la promotionde livres de poche suisses en langue française
« Infiniment plus »,cent soixante-dix-neuvième ouvrage publiépar Bernard Campiche Éditeur,le dix-septième de la collection camPoche,a été réalisé avec la collaboration de Line Mermoud,Huguette Pfander, Daniela Spring et Julie WeidmannCouverture et mise en pages : Bernard CampichePhotographie de couverture : Philippe PachePhotogravure : Bertrand Lauber, Color+, Prilly,& Cédric Lauber, L-X-ir Images, PrillyImpression et reliure : Imprimerie Clausen & Bosse, Leck(Ouvrage imprimé en Allemagne)
ISBN papier 2-88241-179-0ISBN numérique 978-2-88241-365-9Tous droits réservés© 2006 Bernard Campiche ÉditeurGrand-Rue 26 – CH-1350 Orbewww.campiche.ch
Ainsi,en un instant,j’ai noué à ma mère ;ainsi,sur la pointe d’épingle du temps,j’ai noué à la vie et au printemps.
Mais,
nouer à soi-même et nouer au monde
— nouer à l’amour ! —
prend beaucoup plus de temps.
Infiniment plus de temps…
UN
Dans la serre de l’instant,le corps,doucement,à éclore…
Inavoués vertiges,vrilles intestines !
La première chose — je ne m’y attendais pas ! — cette question : comment savoir où, très exactement, faire commencer l’histoire ? à quelle section du fil sur la bobine qui se dévide ?
Un jour plus tôt — pourquoi pas ?
Car l’enchaînement des gestes et des paroles, l’enchaînement des jours et des heures ne peuvent aisément se briser comme on rompt un pain en morceaux…
Pourtant, il faut bien décider d’une première bouchée. Mais alors, quel mot vaut-il plus qu’un autre dans cette histoire pour qu’on lui donne la priorité sur tous les autres ?
Quels mots, quel instant, poussés en avant les premiers ?
Et, en fin de compte, s’agit-il bien d’une histoire
— ou seulement d’un peu d’espace dérobé au temps, détourné du flux intestin de la mémoire au profit du présent ?
D’ailleurs, pourquoi faudrait-il toujours qu’il y ait une histoire et un commencement ? On devrait pouvoir s’en tirer autrement puisque chaque instant est lui-même le début d’une autre histoire, segmentée différemment…
Et encore : pour celle-ci — si c’en est une — faut-il décider également, dès maintenant, de sa distance ?
Même avec si peu d’expérience, je sens bien à quel point c’est déjà l’orienter que de choisir l’instant où elle commence ! Et combien, selon sa durée présumée, combien elle pourra être différente…
Différente.
Le plus simple,
cela se fait parfois,
serait de faire commencer l’histoire à ma naissance. Mais, à l’évidence, ce n’est pas là qu’elle commence ! Et s’il faut vraiment en arriver à cette extrémité, comment être certaine, alors, que cette histoire n’a pas déjà précommencé avant que je sois née, insérée dans la petite mécanique de ceux qui m’ont mise au monde ?…
Mise au monde !
J’étais sûre qu’il n’y aurait pas long à attendre avant le premier accroc : mise au monde !
Si peu mise au monde, justement… Seulement déposée
précautionneusement
(chaque syllabe comme autant de gestes décomposés en mouvements pour éviter les à-coups, les secousses)
dans la corbeille d’osier de leur petit monde à eux, protégée par ces épaisses tentures à fleurs déployées tout autour de moi pour cacher les vilenies du vaste monde sur lesquelles, deux précautions valent mieux qu’une, on ne cesse de coudre ces housses cossues tout exprès pour moi, on ne sait jamais ce qui pourrait avoir la perfidie de dépasser de toute la laideur de son ourlet, ah si j’avais à blesser mon jeune regard aux vilaines choses du monde, ah si j’avais à déchirer ma chair de guimauve aux gravillons trop durs de la réalité !
— et tous ces coussins cossus poussés à mes genoux, et cette vigilance de tous les instants pour que je ne voie jamais l’autre versant sombre de la vie, et cette vigilance, car leur petite fée, notre petite Iona chérie, si on n’y prend garde, ne risque-t-elle pas de se transformer, comme les autres enfants, en un petit être diabolique ?
Déjà, je m’égare.
Mais, quelle ivresse de goûter sans délai au luxe de se tenir en équilibre sur le mince câble d’acier qui retient ensemble réel et imaginaire, en équilibre sur le fil d’une histoire, plume en main comme un balancier,
en équilibre ! Moi qui ai dû,
aux alentours de ce qui pourrait tenir lieu de fin à cette histoire,
me lancer sur ce même câble les mains vides et les pieds gelés, oscillant tantôt d’un côté, vacillant dangereusement de l’autre, et la chute finale sous le regard incrédule, puis rempli de souffrance, de mon public clairsemé…
Et ce luxe, désormais :
décider en toute impunité de ce qu’on retient,
en toute lucidité de ce qu’on écarte ;
décider de cette réalité injectée, en quelque sorte, de cette vérité de contact, « de cette vérité superficielle et d’accident »…
Décider aussi du précieux, pour moi, de tout ce qui n’y apparaîtra peut-être pas.
Mais y lira-t-on le poids de l’absence et du manque, et tout ce qu’ils ont pesé sur moi pour que naisse cette histoire ?
Y lira-t-on ce qu’il faut de silence autour de soi pour ronger l’os de la mémoire ?
De toute façon, les faits sont les faits
et on ne peut les modifier sans pincement de cœur. On peut, certes, les escamoter, on peut les amener par la tangente, les poser de travers…
Mais peu importe, puisque le plus souvent les faits ne sont pas l’essentiel : ils ne sont que le support de l’essentiel qui, lui, se tient à distance, hors du champ visible. En sous-traitance, ce sont les mouvements intérieurs, les glissements du terrain des pensées les unes vers les autres, l’implosion qui précède l’émergence du sentiment menant au geste, la pulsion esquissant l’attitude qui va s’inscrire dans l’espace, la progression intestine des muscles, l’ébauche des sensations,
tout ce travail invisible à l’œil et au souffle,
ce tracé comme celui dans le ciel du trajet des étoiles,
les vrilles du dedans,
le vertige des grands fonds d’avant les mots,
la certitude du manque,
l’angoisse au bout de sa branche morte
— tout ce qui finalement forme l’essentiel sur quoi s’agrippe cette histoire, comment le retrouver après toutes ces années ?
Car il a fallu attendre longtemps que les turbulences de l’air se soient calmées, que gestes et paroles dispersés loin à la ronde soient refondus ensemble…
Mais retrouver ce qui, au milieu des gestes et des mots de tous les jours, s’était mis à manquer ? Il y avait toujours quelque chose de franchement absent qui rôdait dans le plein des journées — et c’était mon histoire qui commençait, mais où exactement ?
Si je me pose ces questions, c’est que je ne me les suis jamais posées jusqu’ici ; et qu’il faut bien commencer par là si l’on veut aller de l’avant, comme j’en ai l’intention.
Alors,
où commence cette histoire ? à laquelle des bobines arrêtées sur leur axe ?
On pourrait peut-être dire : le jour de mon arrivée là-haut, au lendemain de Pâques, tant pendant très longtemps il y a eu, au fond de moi, la certitude que c’étaient bien eux
— cette ville, ce lieu —
qui avaient tout déclenché en sous-sol, dès l’instant où j’avais posé le pied sur le trottoir, ce soir-là, vers dix-huit heures je crois,
— alors que la ville, dans sa sournoiserie qui ne cesserait de se confirmer de mois en mois, s’était déjà jeté sur les épaules une cape de grosse laine rêche et noire, détrempée par une longue course tout le jour sous la pluie… Ah, cette présence de bête mouillée et souillée, ces soies puantes, à épier mes premiers pas, ceux d’une proie facile, s’est-elle sûrement dit, je sens encore son souffle épais, son poil de nœuds durcis qui se soulève dans l’ombre, le poids de son regard caché au fond de son grand capuchon de forêt noire, cette odeur de branches détrempées, de vieille neige négligée qui ne fait plus le ménage ni sa toilette : une gifle aux narines encore orgueilleusement tapissées des fragrances d’un printemps clinquant de frais, noué en fleurs et en bouquets…
Bien qu’il paraisse plus logique, quand on y songe, de faire prendre son envol à cette histoire avant, au moment de la décision
— ta lubie, disaient-ils, surpris et contrariés par ce qui n’était pas dans l’ordre des choses pour eux —
de prendre ce poste in extremis pour une année scolaire et d’aller m’installer dans cette ville étrangère, à mille mètres d’altitude, tandis que Maurizio terminerait ses derniers examens avant notre mariage. Ta lubie : oui, c’est vrai que cette envie de partir a percuté ma cervelle comme une balle élastique ! Bong ! La secousse immense, une fraction de temps ridicule et tout ce que ce choc allait, plus tard, entraîner… J’entendais Marcelle parler de ce poste lâché brutalement par l’une de ses amies tombée malade, j’entendais le nom de la ville impossible à retenir la première fois, je l’entendais me demander : et toi ? le poste ne t’intéresse pas pour un an ?… Bong, ma lubie !
Mais,
pour faire mouche du premier coup,
il faut bien que cette idée se soit déjà exercée sur moi, il faut bien qu’il y ait eu, tout au fond, au moins une cellule vivante déjà, une infime levure de cette idée-là sur laquelle allait pousser cette histoire ; pourtant, dans l’herbier de ma mémoire, rien : aucune trace nulle part…
Et c’est peut-être ce qui m’effraye le plus avec le recul, de n’avoir pas eu la moindre intuition, aussi fine qu’un filament, de ce qui me poussait à cette grossière séparation provisoire d’avec eux, ma mère, Maurizio, mes oncles, mes tantes, mes amis,
grossière
quand on la ramassait par pleines poignées dans leurs regards, grossière,
indécente même — ces choses qui ne se font pas ! — cette décision de m’installer loin d’eux
— ailleurs…
Dans les quelques semaines qui ont suivi, toute ma concentration a porté sur la réalisation du projet, en occultant les causes, sûre d’être dans le juste en me disant qu’apprendre à vivre seule avant de vivre à deux est une bonne expérience, que se séparer un peu n’est pas une mauvaise chose et que se plonger dans un univers scolaire différent ne peut être que stimulant… D’autant plus que tout semblait s’imbriquer sans que j’aie à faire un quelconque effort : en me cédant son poste, l’amie de Marcelle me laissait un petit appartement meublé dans le nord de la ville et le directeur de l’école, du Gymnase comme on disait là-haut, tout heureux de trouver quelqu’un au pied levé, avait cru sur parole à mes qualités !
Mais commencer l’histoire ici
— alors que je ne soupçonnais même pas l’existence de cette flaque de liquide trouble tout au fond duquel s’agitait à peine, informe encore, une unique cellule en attente ? alors que je n’entendais ni petit grincement discordant ni roulis de roue dentée et que, pire, je n’aurais même pas eu l’idée ou l’envie d’écouter au plus profond s’il pouvait s’y passer quelque chose de troublant ?…
Je fis les préparatifs du départ dans une inconscience totale, à peine portée par un sentiment étrange que j’attribuais à l’investissement minimal qu’exigeait la situation.
Et, de toute façon, le bruit de leurs voix, le bruit de leurs paroles,
qui en faisaient encore plus que d’habitude pour se rassurer,
aurait couvert n’importe quel fracas intérieur !
Bien sûr, leur inquiétude suffirait peut-être à justifier qu’on place le début de l’histoire ici ; car inquiets, ils l’étaient… Et avec le recul, j’en suis à me demander si eux n’avaient pas eu à ma place l’intuition de la fissure que j’ouvrais en même temps que mes valises.
Si j’avais tenté d’écrire ces lignes peu après ou pendant ces événements, j’aurais probablement choisi de commencer mon récit au moment de la rentrée scolaire, à mi-côte d’avril, un de ces matins qui promet tant qu’on entend déjà, là-haut, quelques fillettes miauler pour que leurs mères les laissent troquer leurs collants contre une paire de longues chaussettes…
Mais, franchement, quelle importance peuvent bien avoir ces premières journées d’école dans cette histoire ? Quelle importance que cette nouvelle fournée d’élèves dont je ne me souviens guère : d’eux tous, de leur agitation gentille, de leurs pitreries douces, que me reste-t-il
sinon eux deux ?
Eux deux…
Être à nouveau si près de leurs noms et ne pas oser, pas encore, les tâter du bec de la plume, ne pas encore oser glisser sur les boucles des lettres de leurs noms, hésiter aussi à écrire
leurs vrais noms,
hésiter à leur en broder un autre…
Ces hésitations qui s’égrènent et dont la grappe est à peine entamée… Tout vient à son heure me surprendre. La griserie m’entaille tout de même un peu face à ces libertés nouvelles avec lesquelles négocier à chaque phrase et qui flottent devant mes yeux comme les milliers de floconnets des peupliers noirs, qui s’accrochent en duvets de nains dans l’air d’été ; mais le vertige aussi : jusqu’où s’élancer derrière eux ? jusqu’où s’élever à leur poursuite,
eux qui se déversent dans l’air trop bleu au-dessus du lac
— alors qu’ils ne sont qu’ébauches de formes ?
Le doute, pourtant, me saisit : ne serait-il pas mieux de ne pas chercher sur la bobine emmêlée où se tient debout le début
et de s’arrêter là ? de ne pas parler d’eux, repousser cette histoire en sous-sol où elle sait reposer silencieuse depuis si longtemps, et continuer à marcher par-dessus sans s’en soucier ?
Mais, pour renoncer maintenant, il n’aurait pas fallu remonter dans la ville ni arpenter de nouveau ses trottoirs après toutes ces années, car trop de choses sont venues par les pieds et trop de choses, déjà, y sont remontées ! Déjà, la voûte plantaire sent au milieu de quelles tensions ces couches profondes continuent de se chercher sous la croûte ; certes, ce n’est plus guère la menace de jadis, celle d’être broyée dans les frottements d’écorce et engloutie dans le bouillonnement d’entrailles, mais ne s’en obstinent pas moins quelques secousses bien senties parfois qui rappellent le souvenir des vieux séismes…
Alors,
l’histoire pourrait-elle avoir commencé quand ils ont surgi devant moi pour la première fois, d’une pâleur argentée dans la poudre de lune de ce soir tiède, sous la soie noire des marronniers, la fête aux tempes ?
Naturellement, à ce stade je pourrais encore renoncer à frictionner mon corps avec l’onguent brûlant de cette histoire et laisser ma peau sans l’odeur de ces événements ; ce serait accepter d’être, comme tant d’autres, quelqu’un qui n’a rien à raconter,
rien,
et me taire ; mais cette histoire pourrait tout aussi bien commencer quand mon corps traçait derrière eux, dans l’axe éblouissant du désir, que rien ne pouvait me retenir de surprendre leur étreinte entre les fentes du bois, avec le soleil déjà moite de cette fin d’après-midi d’octobre huilant mes épaules,
commencer là,
peu importe,
et se terminer quand sur l’herbe humide, les ombres des sapins, des souches et des buissons s’étaient rejointes, peu avant que la nuit ne les noue pour les tenir serrées ensemble jusqu’au matin…
Mais je vois déjà vers quel bourbier je marche si je cadre de cette manière et que je vise pour seule distance de cette histoire cet après-midi d’octobre : s’il n’y avait que cela à raconter, combien de choses n’auraient pas besoin d’être dites !… Ce serait trop beau si les gestes n’avaient fait qu’imploser sur cette étroite bande de fréquence du temps ! Ce n’est pas le cas, évidemment, et même si je décidais que c’est là, dans l’incontournable treillis des fils d’or de la lumière, que cette histoire a commencé, rien ne serait résolu. Car, à peine aurai-je décidé où commence l’histoire qu’il faudra déjà savoir où elle s’est terminée…
Peau élastique tendue sur le tambour du temps, laque brillante à étirer patiemment sur la surface des jours devenue mate, du bout du pinceau usé de la mémoire, aux poils collés ensemble et durcis après toutes ces années,
me voilà donc au travail avec mon histoire ! à tendre le tissu sur le tambour, à étaler la laque à la pointe d’une plume neuve sous laquelle virevolte maintenant une nouvelle hypothèse : et si cette histoire avait commencé au moment où je me suis trouvée à l’entrée de cette grande pièce sombre, sentant leur présence contre les murs, quand la lumière les a sortis brutalement de l’ombre, quand j’ai compris, comme un autre rebond dans ma conscience, leur longue attente de morts vivants, dans l’ocre rose et le gris bleu, tous arrêtés dans la chrysalide de leur image à l’heure où le peintre était au travail ? Ces êtres dont on avait pris la beauté de la vie pour les épingler dans la souffrance de l’immobilité, ce trouble profond, cette flaque de malaise comme lorsqu’on respire une colle de poisson, ce quelque chose de vivant détourné sournoisement de son état premier…
C’est autour de cet instant qu’il faut chercher pour commencer ; là ou juste à côté,
un rebond,
un choc,
quelque chose de violent dans l’œil et le ventre,
un mélange d’émotions extrêmes, leur prostration et le mouvement d’un ballon, j’y suis, il ne s’agit plus de reculer,
autant le dire : c’est très précisément là, sur le terrain de sport, juste à côté de l’école,
on était fin juin,
où ce garçon
il était presque six heures
ils jouaient, tout un groupe de garçons, bruyamment, la bonne grossièreté de leurs bourrades, j’écoutais sans vraiment les regarder
à l’instant où ce ballon
mais où avais-je donc la tête pour passer sous le cheval de bronze cabré et non pas en haut à côté de lui comme d’habitude ?
à l’instant où ce garçon a tendu la jambe en arrière, pointe du pied vers le sol, tension des muscles de sa cuisse nue,
où ce ballon
a jailli
contre le paysage arrêté de mon corps
blanc dans l’air rose ocre
et moi qui le voyais arriver, j’étais juste dans son axe, oui : c’est là et à cet instant précis que cette histoire a commencé,
quand ce ballon a décollé
c’est avec la secousse dans le ventre
et le ventre brutalement réveillé
— que commence cette histoire.
Mais la pré-histoire ?
Tomba ininterrompue une pluie fine et sans force qui cassait le paysage en fines lamelles,
tombant à peine de biais parfois, sous la poussée moite d’un brouillard couvert d’engelures,
tombée des heures avec la même insistance…
Voilà, après toutes ces années, ce qui reste dans ma tête de mes premières journées là-haut : j’étais debout face à une ville engoncée dans un vieux tailleur à rayures grises, attablée à un silencieux banquet.
Des journées immensément immobiles où la pluie remontait inlassablement la clé de sa mécanique,
des journées piétinant sur place dans leurs flaques,
où rien n’avance,
ni l’heure
ni la pluie
ni le brouillard gris qui enfonce sans bouger la forêt sous son pouce…
Même les corneilles
— et comme je les ai tout de suite détestées — même les corneilles semblent retenir leur vol dans l’escarre incolore du ciel, les corneilles un instant à la rigidité d’un fusain,
rien ne bat,
ni ne frémit
aucune aile ne cille
dans l’espace bas…
Je suis au centre d’un vide immense, déjà en perte d’existence.
Installer mes vêtements et mes livres, mes quelques affaires tirées des valises, dans ce petit appartement me prit beaucoup trop peu de temps.
Encore quatre plates journées avant la rentrée.
À pluie
et à lire un peu.
À regarder dehors pour inspecter la ville. Et je retrouvais ce qu’avait tenté de dire Marcelle : la ville coincée dans la vallée qui s’y étend rectiligne…
Bien entendu, de chez moi, elle n’offre d’abord que ses toits sépia et rouille, l’invincible armada de ses cheminées, ses lucarnes comme des chouettes guettant arrimées de biais sur les tuiles.
On sent bien la descente jusqu’à l’artère principale d’où les rues remontent vite contre la pente sud et le gris, le blanc, le jaune des façades en face… Tout près d’ici, à droite de la maison, un long escalier dont on ne voit pas les pieds relie la dernière longue rue au nord, qui s’étire d’ouest en est de tout son long, au quartier ici en haut, fait de petites rues et de villas qui renoncent bientôt, acculées à la pente de la forêt.
Une piste de renard irascible,
de la fenêtre du nord aux deux fenêtres du sud,
des regards sans complaisance à un alignement de rues qui ne me dit rien de bon ;
une piste qui se creuse dans un pitoyable désœuvrement où chaque bouchée à mâcher était déjà un geste de trop, dans une désastreuse inquiétude, avec roulé en boule, serré,
le lent déroulement des anneaux du sentiment de m’être fait piéger,
un étroit bandeau de colère et de peur au front, à la racine des cheveux, comme un animal dont une grosse touffe de poils vient juste de se prendre dans une mâchoire de fer,
fâchée contre moi d’avoir à rester là pour longtemps, reculant chaque heure l’instant où il faudrait sortir, sentir peser sur soi les yeux des gens derrière les fenêtres, affronter la ville détestable à ras les trottoirs ; et, attelée à une somnolence d’hibernée, je guettais soupçonneuse le jour reprendre ses droits en noir et blanc
— avec la certitude que, partout ailleurs, il savait les reprendre en couleurs !
Le troisième matin, derrière les carreaux au réveil, une curieuse débandade d’énormes flocons, une bousculade gaie après toute cette pétrification grise ! Boucles et vrilles, culbutes : on croit les entendre rire dans leur chute en se bousculant !
Et le tournis si l’on se met en tête de les suivre à la trace de haut en bas pendant quelques minutes, ce gros là, bien gras ?… déjà disparu, dissous dans le sol, la mort au bout du vol, l’écrasement
s’élancer, ébauche de forme,
se déverser du haut du ciel, sublime voltige
— au risque de disparaître ?
Un petit garçon sous son capuchon vert, comme un gnome sur le trottoir (a-t-il même un visage ?) un petit garçon sans visage, quelques parapluies qui se hâtent, une neige d’opérette, crâlées de corneilles,
— sonnerie du téléphone : Maurizio.
Et les seules paroles qui me reliaient au monde étaient aussi mascarades verbales. Était-ce à cause de moi que tout sonnait faux ou à cause de la ville, déjà ?
Je disais : tu me manques, Maurizio…
Je faisais de Maurizio l’acteur principal de ces tréteaux vides où le rideau était levé depuis longtemps, j’attendais sa première réplique avec impatience : qu’il dise quelque chose d’important, quelque chose qui donne vie au décor !
Car, pour la première fois, m’apparaissait le contour de ce manque en moi,
l’absence de quelque chose d’essentiel, et c’est là que je commis déjà ma première erreur,
puisque, sur le moment, je crus que c’était l’absence des miens,
de ma mère, de Maurizio surtout, qui était la cause de ce sentiment de manque, de cette levée d’absence dans mon ventre…
Je donnais au manque le visage de Maurizio, ce qui, je ne pouvais le savoir, compliquerait singulièrement les choses ; si au moins j’avais pu comprendre que je croyais l’aimer davantage uniquement parce qu’il n’était pas là…
Mais le déracinement, du moins c’est ce que je pensais, cognait trop dur dans ma tête ; j’étais, c’est ce que je croyais, plus marquée par le changement que ce que j’avais imaginé
— et peut-être, après tout, était-ce bien cela, le choc du changement, qui avait lancé dans mon corps cette première vibration qui allait s’amplifier, plus tard, en un long frisson courant le long de l’échine…
En attendant,
j’étais muette devant ces jeux de brouillards se travaillant au ventre, faisant vaciller tout le paysage au rang de lémure, les squelettes des sapins brassant la brume de leurs basses branches, ces ombres me travaillant au corps et m’y enfonçant l’insoutenable sensation de la dissolution des mots dans l’espace, de l’enfoncement dans le sol, à fonds perdus, de la parole…
Car ce que je voyais de mes fenêtres, ces projections grises, cette géométrie de perpendiculaires, ce théâtre d’ombres et de brouillards, cette mise en scène grotesque de flocons trop gros pour être vrais, ces écoulements dans les grilles,
ce tout blanc ou ce tout noir qui, par capillarité, mouille la forêt,
cet immobilisme tragique, les traits accusés du paysage, ce chœur wagnérien de pluies amplifiées,
— tout cela, c’était certes le monde dans ses derniers retranchements, tentant de masquer au plus pressé son effondrement intérieur,
mais plus encore ?
C’était, malgré ses artifices, le monde démasqué, dépouillé de l’illusion du langage ! Le symbole, sous mes yeux, le symbole grossier de l’économie extrême du fond de la parole et de l’incessante dévastation de la forme…
Et le manque,
je mis tellement de temps à comprendre ces choses simples,
y était aussi : il aurait suffi de faire déferler sur ce pauvre décor un flot de beaux mots, de discours attendris et habiles, l’inonder de paroles pour en dérober, une fois de plus, le pitoyable…
Mais voilà, le manque était là et cette fois — ai-je bien saisi à ce moment-là toute la portée de cette révélation ? — plus personne ne se livrait pour moi à une quelconque opération de travestissement verbal !
Ici, j’étais seule et je n’avais pas de parole à moi. J’avais cru emporter la leur avec moi dans mes bagages, celle dont ils tartinaient généreusement de larges tranches de monde pour moi depuis ma naissance, celle dont ils me nourrissaient sans relâche depuis toutes ces années, et je voyais qu’elle n’avait pas suivi et que, de toute façon, ici, elle n’aurait servi à rien, comme si l’on arrivait avec des habits d’été au Groenland…
Je n’avais donc pas de parole à moi. Là-bas, la leur et maintenant je n’en avais pas. J’étais dépossédée comme le paysage
— et il m’avait fallu attendre toutes ces années pour échouer sur le bord de moi-même, dans ce lieu inconnu où il me faudrait, c’était une certitude déjà, remonter toute seule la pente de la parole…
Voilà que l’hiver, vidangeant ses entrailles, emportait dans son écoulement les déchets des vieilles paroles déposées par les miens depuis des générations,
les miens qui ne savaient pas,
qui ne savent sûrement toujours pas,
que l’habitude en gestes et en paroles, que toute habitude est déficit au fond de soi.
Sous les crâlements des corneilles (qui étaient sous mes fenêtres à rouspéter toujours sur le même ton, puis front bas, pattes bien tendues sous elles, à se lancer pour traverser une portée de ciel, butées et râleuses, comme je les détestais !) je commençais à prendre conscience de l’étendue de la perte qui me tourmentait déjà certainement en sourdine, tentant d’attirer discrètement mon attention depuis longtemps ; et moi qui n’avais rien remarqué jusque là, j’avais continué à avancer sur leurs traces sans broncher, je n’avais pas vu que cette perte irréversible ne cessait de gagner du terrain, ouvrant toujours plus la porte au manque en sous-sol
— et leurs paroles, toujours, venaient se poser par-dessus et le masquaient…
Et maintenant,
je n’y pouvais rien : ce sentiment de perte, d’absence, ce vide intense, ce manque, étaient ensemble debout dans le gris petit jour, sous mes fenêtres, au creux de mon oreiller, épiçant ma nourriture, devant mes yeux, formes au travail dans l’horrible putréfaction liquide du printemps en marche, ils se pavanaient devant moi, remontant l’escalier, pressant contre ma porte, s’imposant dans l’entrée.
Et moi, sans voix devant eux, sans parole.
Démunie.
Le troisième jour, il me manquait même les mots, pour me dire qu’il me faudrait de toute urgence me refaire une parole… Je guettais tout le jour la ville s’extirpant du cocon laiteux de l’hiver, toujours peu décidée à lui donner une chance de se faire aimer : je ne voulais rien savoir d’elle, ni façade, ni parc, ni fontaine, ni vitrine, ni visages.
Mais le quatrième jour me fit faire un petit pas en avant.
La solitude emmène parfois de bien curieuses choses dans ses bagages…
Qui parle ici ? dit une voix dans ma cuisine…
Qui parle ici ? Était-ce moi qui parlais ? Oui, c’était ma voix, et j’avais de la peine à la reconnaître !…
Mais j’avais donc une voix à moi qui n’était pas celle haut perchée de la petite Iona ?
Et c’est de cette mince faille sonore dans la paroi de la cuisine que ma parole allait suinter, froide, hésitante d’abord,
combien de temps s’était-elle retenue dans la pente raide avant de se mettre à goutter ?
Alors,
la voix dans la gorge m’a poussée dehors.
Une calotte bleue s’était ouverte dans le ciel gris et j’y suspendis mon regard. Mais ce n’était toujours pas vers la ville que j’allais : les lèvres encore serrées, vers la forêt…
Les restes du banquet que l’hiver quittait en renversant la table s’étaient répandus sur la nappe souillée de la vieille neige et c’était une confusion d’écailles de pives brunes et rouille, de roses et fines aiguilles de pin, miettes de lichen gris et vert, de brindilles, de barbe et de mousse humides, de crin, de cheveux d’ange qui s’était coiffé là… De bris d’insectes, d’araignées à demi résignées à ne plus avancer, des bâtonnets tremblés, de petites feuilles presque roses, toutes fripées d’avoir trop tourné dans les bourrasques et, par-dessus tout cela, d’un coup : un empan de soleil ! En même temps, cette bouffée de sang dans la tête, cette bouffée de larmes dans la gorge
— quelle digue brise-t-il en brillant ?
À peine le bruit d’un verre qui se casse et cette poussée de voix d’eau hors des lèvres forcées à s’entrouvrir enfin sous les ondulations de la langue, je m’entends dire quelque chose, à peine le souffle d’un soupir trop longtemps rentré
— pourquoi, pourquoi, dit ma voix à peine née, pourquoi faut-il toujours que l’hiver finisse en printemps ?
L’oiseau, en dessus, l’oiseau secoue ses ailes comme un chiffon d’où tombe une poussière grise et
s’envole…
L’air m’avait ravivée et, sitôt rentrée, j’écrivis avec un orgueil démesuré le premier vers de mon premier poème ! Je ne savais pas ce qui m’arrivait. Je me sentais à la fois complètement vide et capable de grandes choses. Peut-être que j’éprouvais pour la première fois le poids de l’enveloppe de mon être. Je ressentais enfin la nécessité de l’épaisseur. Je me sentais en partie justifiée par cette première parole cueillie au vol entre les pattes du soleil. Je savais confusément qu’elle était le début d’une longue quête faite de ratures et de bégaiements ; comme pour tant d’autres, partir à la recherche de sa parole prendrait du temps, beaucoup plus de temps que d’écrire le premier vers de mon premier poème, mais je me sentis capable, en ce court instant, de la meilleure bonne volonté au monde !
Pourtant, les autres remuements épars en moi, la nature de la perte cette absence charnelle, les vraies causes de mon départ n’étaient, pour l’heure, qu’une image indéchiffrable dans la cuve ; le révélateur mettait du temps à faire son effet.
Il prendrait encore des mois.
Voilà comment débuta mon séjour dans cette ville qui sortait à peine du bidon de fer de l’hiver, mouillée et grise comme une vieille serpillière,
voilà comment précommence cette histoire :
dans un terrible vide,
dans un terrible tourment.
Dans le souffle d’une voix.
Précommença dans un terrible
tourment…
Mais qui aurait pu s’en douter ?
Même moi, j’avais de la peine à mettre un nom sur cette sensation !
La plupart du temps, le tourment se tenait dans son cantonnement camouflé bien au fond, laissant les grandes manœuvres de surface à la solitude.
Et celle-ci ne se privait pas de créer l’événement : au début, les gestes de la vie les plus simples qu’elle épaissit à l’extrême, cette extrême attention au moindre des bruits qu’on produit, le plus petit pet, le caca qui chute, elle entraîne cette nécessaire grossièreté… Ajuster le volume de son corps à l’espace alors qu’on est sûr de ne pas s’y heurter à quelqu’un d’autre, absorber les chocs de l’air qui se déplace avec soi… Même le masticage prend, au début, une autre tournure dans la bouche ! Toutes ces choses auxquelles le bruit des autres nous évitait de faire attention.
Bien sûr,
je n’oserais dire que je n’avais jamais été seule auparavant. J’avais connu mes jours solitaires ici et là. Mais, cette fois, je savais que les données de la solitude étaient différentes. La brèche dans mes habitudes était planifiée et j’avais à tester ma résistance à supporter un lieu étranger,
ce lieu infesté de corneilles qui raillaient mon désarroi, râh ! râh !…
Et si j’avais pu comprendre à quel point l’enjeu de cette solitude était tout autre cette fois, si j’avais pu sentir quelle part de moi avait fait ce choix de partir, nul doute que beaucoup de choses, dès les premiers jours, auraient été facilitées ; peut-être même que je n’aurais pas été tellement en rogne contre la corneille, son crâne de vigie, son cri de mégère…
L’effet de la solitude ? Curieusement, de nouveau, je ne ressentais aucune nécessité de manger… Je grignotais mes quelques provisions du bout des dents.
D’où venait la résistance, cette fois, alors que je n’avais pas, comme à quinze ans, à défendre ma bouche contre l’agression de sa nourriture et à lutter contre sa voix ?…
Mais peut-être, comme pour la parole, me fallait-il retrouver une nourriture à moi.
Et, pour cela, il aurait fallu descendre en ville…
Comment expliquer ce refus, cette appréhension râpeuse ?… Tout se tenait sur le même fil, comme les perles ternes d’un chapelet d’ennui qu’il me fallait rouler entre les doigts dans l’ordre, l’une après l’autre.
Alors, j’essayais de biaiser. Je me parlais de cafard dû à l’éloignement de la maison. En réalité, je n’avais encore aucune habitude à moi et je ne cherchais pas à me distraire. Si j’avais donné une chance à la ville, j’aurais eu tout de suite mille choses à y faire. Mais je me trouvais, au contraire, mille raisons de ne pas y descendre et plus on ajourne les choses simples — celles qu’on a toujours faites sans réfléchir tant elles vont de soi, sortir, par exemple — plus elles se recouvrent d’une croûte de calcaire chaque jour plus épaisse, plus difficile à gratter pour les retrouver dans leur poli et leur simplicité premiers.
Pourquoi est-ce que je n’arrivais pas à faire l’enchaînement de gestes si simples :
ouvrir la porte,
la refermer sur le palier,
descendre l’escalier,
ouvrir la porte de l’immeuble et poser le pied sur le trottoir ?…
Ce n’était pas seulement la pluie et le froid, la cavalcade des gros flocons qui me retenaient dans l’appartement ; c’était, chaque fois que je pensais aux rues de la ville, cette oppression vague mais tenace dans la nuque et les tempes.
Le regard des autres qui pèserait sur moi, sur ma démarche ? Toutes ces fenêtres derrière lesquelles tant de paires d’yeux pourraient me dévisager
— et se poser sur quel visage de moi ?…
Car une partie de moi devait déjà sentir le léger décalage qu’avait dû subir mon image depuis mon arrivée, sous le choc du paysage qui s’en allait en longs gargouillis ; sous le choc aussi de l’évidence du manque en moi et de la perte irréversible. Si l’émotion m’avait saisie à la gorge au point de me faire parler devant la mort d’un hiver que je n’avais même pas connu, si je m’étais sentie partie prenante de sa souffrance, c’est que celle-ci devait être le reflet démultiplié de la perte de ma propre substance intérieure et que je croyais, alors, ne jamais pouvoir régénérer… Le tourment qui ravageait le vieil hiver et le faisait passer, je le sentais en écho broyer mon intestin.
Mais je n’allais pas plus loin dans mon analyse : la perte de quoi ? quelle absence au ventre ? J’aurais été incapable de le dire !
En fait,
qu’aurais-je bien pu me dire d’autre, à ce moment-là, sinon que j’étais une pauvre vieille petite fille qui souffrait de la séparation d’avec sa maman et son gentil fiancé ?… Qui pleurait sa jolie ville aux vertèbres attachées par le soleil et les fleurs…
Et je ne perdrai pas de temps, ici, pour montrer à quel point je me méprenais. Il suffit de savoir que je n’avais aucune idée de ce qui se passait en moi. Et de savoir aussi que c’est cette totale incompréhension de ma situation qui allait me jeter, dans les mois à venir, dans la plus extrême fragilité !
Si je ne voulais pas me frotter à la ville, ce n’était pas non plus parce que je pressentais ce qu’elle allait me faire subir plus tard…
Non : je ne me doutais de rien. Et, d’ailleurs, mes premiers trajets dans ses rues m’ont plutôt rassurée.
J’ai pu, assez vite même, poser quelques points de repères sur les toits et me souvenir du nom des rues qu’on croise dans l’ordre en remontant de l’avenue Léopold-Robert jusqu’à la rue du Nord.
Mais aucun nom de rue ne me faisait rêver.
À l’image de la ville qui apparaissait, dans sa rectitude compassée, comme le refus de la dispersion inutile, de l’économie en tout et surtout en couleurs. On sentait qu’il fallait y marcher au doigt et à l’heure.
Et je voyais, comme partout, inscrite dans ses rues, la configuration du sol, dite souvent en mots du lieu, Colline, Arètes, Recrêtes, Belle-Combe, Rocher, Creuze, Crêtets ; le terrain, les eaux, l’histoire et son dérapage vers l’anarchie, le goût de la liberté, le virage pris du socialisme, le sens du travail bien fait et du progrès.
Comme dans toutes les villes du monde, on pouvait aussi y traverser la place du Marché et celle de la Gare, longer la rue du Collège, la rue du Parc ou la rue du Pont.
M’étonnaient davantage, sur les plaques d’émail bleu foncé, les noms de Gibraltar ou de Jérusalem…
Et j’ignorais tout de ces hommes et de ce qu’ils avaient fait pour mériter qu’on donne leur nom à une rue. Certains, je l’appris plus tard, avaient eu leur destin lié à l’horlogerie qui faisait osciller la région entre prospérité et revers ; d’autres avaient été de la conquête de la liberté, arrachée au roi de Prusse, le premier jour de mars de l’an 1848 où le Château avait été pris sans qu’un coup de feu ne soit tiré, sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée ; une ville émancipée dans une révolution tranquille où « l’Ancien-Régime, était-il écrit, est tombé à son heure comme un fruit mûr ».
Curieusement, je ne rencontrai qu’une seule femme qu’on ait jugée digne d’offrir son nom à une rue finissant, d’ailleurs, en cul-de-sac à l’entrée de l’ancien hôpital ; ce n’était pas un hasard : Sophie Mairet avait, semble-t-il, offert son premier hôpital à la ville…
Mais aucun nom de rue ne me faisait rêver.
Surtout pas la rue du Progrès ou celle du Succès ! L’impasse des Hirondelles peut-être ?
Si, il y en avait un quand même, je crois : la rue de la Fusion…
Mais je ne savais pas trop pourquoi.
Et de toute façon,
déjà une corneille devait appareiller quelque part, cirant le ciel pâle de ses ailes sombres.
— Et son cri, sirène de l’absence ?
Oui : dans un terrible tourment tout au fond, mais cela ne se voit pas, je crois ; bien moins, en tout cas, que la malice du lieu…
Ciel d’un bleu onctueux ! Me voilà à me précipiter tout heureuse dehors, sous le soleil, en jaquette fine, éblouie par ce cadeau de lumière. Ce devait être un matin de la première semaine d’école. Et si j’avais mieux connu le lieu, j’aurais tout de suite saisi l’agitation de l’air transparent ; les branches grêles prosternées vers l’ouest, je les aurais vues, la nervosité des sapins remuant en tous sens, mais là encore, je ne savais rien,
car me voilà rappelée à l’ordre comme une vieille débutante : fendue en deux par l’espadon de la bise,
gifles barbares qui mettent le sang aux joues,
heurtée au front,
sabrée au menton,
meurtrissures aux oreilles,
orties aux narines,
langée dans la bise comme un bébé dans des draps mouillés en quelques minutes et le rââh de la corneille en prime : bien fait pour toi !…
Ce fut ma première rencontre avec la bise,
encore pleine de dignité si je la compare avec l’atroce familiarité avec laquelle elle me traitera, plus tard, quand elle déboulera sur moi comme une cinglée, m’agrippant par la taille et cherchant à me faire tournoyer contre elle sur le quai froid…
Mais, nous n’en sommes pas là !
Je n’en suis qu’à parler de cette piste tracée les premiers jours pour me rendre à l’école, que je serai longue à faire varier d’une rue et même d’un trottoir. Longer notre rue jusqu’aux grillages du Bois du Petit-Château, les suivre en quêtant du regard le mouvement de quelque bête enfermée, glissade d’un canard, geste d’aile lent d’un cygne plus très blanc, certains matins deux daims alourdis broutant bas… Puis, devant l’entrée du Bois, la traversée du carrefour, descendre sur le trottoir gauche jusqu’au bâtiment de l’École Technique qui fait face à l’école de ses cent cinquante fenêtres toutes pareilles, alors je n’étais plus séparée du collège aux façades jaunes que par le terrain de sport au revêtement légèrement rosé