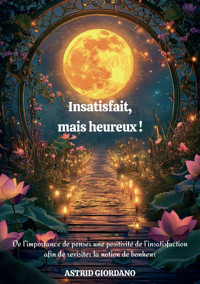
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Et si le bonheur résidait dans l’insatisfaction ?Dans un monde où la quête de satisfaction semble être le moteur de nos vies, ce livre propose un renversement radical : et si le bonheur ne se trouvait pas dans l’assouvissement des désirs, mais dans l’insatisfaction elle-même ? À travers une réflexion profonde sur notre époque de consommation, l’autrice explore une nouvelle vision du bonheur, où l’insatisfaction devient un principe fondateur, un lieu de joie et de liberté. Une invitation à repenser nos désirs, à redéfinir la quête de sens et à accueillir l’infini potentiel du manque, de l’absence de prise, comme source véritable de bonheur.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Franco-italienne, Astrid Giordano est une amoureuse des lettres et des sciences humaines. Enseignante de littérature, philosophie et sciences politiques, elle parcourt le monde avec l’humilité de partager ce qu’elle apprend, tout en cherchant à mieux comprendre ses propres contradictions. L’exploration vibrante d’inconnus, sous diverses formes, l’a menée du soleil espagnol jusqu’au Moyen-Orient. Son écriture devient ici un moyen profond de sonder les notions fascinantes et universelles de désir, de bonheur et d’insatisfaction. À travers cet essai, l’autrice ne cherche pas à imposer des réponses, mais à offrir une réflexion sincère, ancrée dans son propre cheminement, à laquelle chaque lecteur pourra notamment s’identifier, la complétant de son individualité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
Publishroom Factory
www.publishroom.com
ISBN : 978-2-38625-724-7
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Giordano Astrid
Insatisfait, mais heureux !
De l’importance de penser une positivité de l’insatisfaction afin de revisiter la notion de bonheur
Remerciements
J’aimerais témoigner ma gratitude aux diverses personnes m’ayant aidée dans la réalisation de cet ouvrage.
Je voudrais remercier Mme Tauty, ayant accepté de m’accorder de son temps afin de m’aiguiller dans la rédaction de ce travail. Ses conseils méthodologiques furent précieux.
J’aimerais exprimer toute ma reconnaissance à ma famille, Mme Maria Giordano, M. Raffaele Giordano, M. François Giordano, ainsi que Mme Laura De Saint-Jean et Mme Elisabeth Rodriguez pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements.
Un grand merci également à toutes les personnes ayant participé à l’enquête menée dans le cadre de cet ouvrage. Leur contribution, très intéressante, permit de mettre en lumière des perspectives nouvelles de réflexion ou d’étayer notre propos, en plus d’apporter un échantillon représentatif des pensées de notre temps.
Enfin, plus généralement, je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de l’équipe pédagogique de l’Université Catholique de Lyon dans le domaine de la philosophie. Si ce livre a pu prendre forme, c’est aussi grâce à eux et aux connaissances qu’ils m’ont transmises.
Table des matières
Remerciements
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : De la valorisation d’une décroissance, entendue comme désinvestissement volontaire effectif et retour à l’essentiel, pour une entrée et installation durable dans une existence heureuse
CHAPITRE I : Mise en avant du caractère bénéfique d’un dépouillement ainsi que d’une reconnexion à la seule nécessité à l’égard d’une existence heureuse
CHAPITRE II : Exposition de la méthode requise, unie à cette perspective : entre travail de définition, maîtrise de la classification et raisonnement sur l’avantageux afin d’atteindre l’équilibre
CHAPITRE III : Traductions dans la réalité de cette pensée d’une positivité de l’insatisfaction pour un bonheur du bien-être : sur le mouvement minimaliste ainsi que sur l’art de vivre de la simplicité volontaire
SECONDE PARTIE : Pour un bonheur de la non-quiétude : des bienfaits d’une insuffisance perpétuelle et de son investissement dans le domaine de la connaissance, comprise dans un processus d’affirmation et d’enrichissement illimité du sujet
CHAPITRE I : A propos de la positivité d’un “non-assez” épistémologique sans cesse renouvelé et investit, impulsion d’un désir continu de l’intellect et d’une dynamique heureuse chez un sujet s’inscrivant dans un horizon téléologique
CHAPITRE II : Une pensée de l’effort, de l’action et de la joie sous le signe de la raison ainsi qu’une mise en lumière d’une affirmation du sujet dans ce cheminement volontaire, en lien avec une notion de perfectibilité
CHAPITRE III : Concernant la distinction à noter entre le schème présenté et un hédonisme immodéré : une investigation à l’égard d’autres figures de l’insatiabilité et la désignation de leurs caractéristiques différenciantes
TROISIÈME PARTIE : Épochè et dépassement de la satisfaction : acceptation d’une saisie impossible absolument et mouvement de conversion au cœur pour un bonheur du décentrement, de l’ouverture et de l’accueil ainsi qu’un épanouissement dans l’amour
CHAPITRE I : L’homme dans son rapport vertical avec le Tout-Autre : considération d’une disposition intérieure au bonheur de la rencontre et de la communion métaphysique, à travers l’embrassade d’une impuissance et d’une invitation à la contemplation
CHAPITRE II : Réflexion sur la modification heureuse d’un paradigme horizontal du fait d’une révélation divine ; lien à une existence empreinte d’éthique et insistance sur la question du soin vis-à-vis d’autrui
CHAPITRE III : Illustration et appui de cette pensée au moyen d’un document iconographique : présentation et analyse d’une oeuvre picturale
Conclusion
Bibliographie
Annexes
Introduction
Durant le XXe siècle, et après la seconde guerre mondiale, l’Europe connaît une période de forte transformation et de croissance, que l’on nommera les Trente Glorieuses (1945-1975). Cette période marque un tournant. Elle ancre notamment la France dans le développement d’une société de consommation. Si quelques prémisses peuvent se noter avant-guerre qui ont permis une certaine entrée dans ce schème, c’est véritablement après cette dernière que l’accent est mis pour de nombreux pays que de se caractériser par les grandes tendances qui seront désignées ensuite comme propres à des sociétés de consommation. L’on note ainsi alors, par exemple, de nouvelles pratiques, telles que la fabrication et la circulation en nombre de produits inédits et génériques (produits d’équipement entre autres) ou encore des phénomènes de marchandisation.
La montée en puissance du pouvoir d’achat des ménages accroît en parallèle la consommation ; une massification survient qui retranscrit notamment un souhait de la part des classes moyennes d’accéder à plus de confort de vie. D’autre part l’influence de l’évolution déjà à l’œuvre chez les américains et propagée par les médias incite également à des changements dans les mœurs, qu’il s’agisse de la mise en avant des loisirs ou du penchant à la valorisation et à la célébration du matériel, des objets dits de consommation. Nombre de sociétés occidentales se voient en ce temps marquées par des progrès techniques, une puissante urbanisation et industrialisation ainsi que la proposition et la consommation de biens et de services innovants. Avec l’augmentation des richesses et la profusion des biens apparaissent peu à peu de nouvelles structures attrayantes et captivantes, aménagées spécifiquement pour faciliter la consommation des ménages mais aussi pensées pour l’inciter, dans un souci d’efficacité et de rentabilité. Il s’agit alors de produire et de consommer massivement.
De nos jours, la plupart de nos sociétés occidentales s’inscrivent dans le schème d’une société de consommation, dans un système capitaliste qui sollicite dans son activité de distribution de biens et de services énormément de protagonistes variés, tels que des consommateurs/trices, des entreprises, des commerciaux ou encore des des publicitaires par exemple.
Le terme même de “société de consommation” apparaît dès les années 1950-1960s, pour caractériser le phénomène sociétal qui prend de l’ampleur et se joue en rapport au domaine des finances (augmentation du capital par exemple et consommation massive), des moeurs et de la culture (entrée dans la culture de masse). Ce concept, qui prend naissance autour de sociologues et philosophes américains et français, tels que Riesman ou Lefebvre, sera développé et rendu célèbre par la suite par Jean Baudrillard, à la fois sociologue et philosophe. Ceci notamment du fait de son ouvrage intitulé : La Société de consommation : ses mythes, ses structures (1970), dans lequel il présente, décrit et analyse les mécanismes d’une société de consommation de laquelle il est le contemporain et dont il voit le schème se mondialiser. Il souligne notamment dans son ouvrage la dimension d’opulence dans ce type de société et d’ “abondance’’ de produits ainsi que de services1. Il s’agit d’autre part d’une société où à ce phénomène d’ “amoncellement” de biens2 se lie l’image d’une mère nature généreuse, d’un trop-plein de richesses flagrant, et “la négation magique [...] de la rareté”3. Les ressources sont en effet perçues comme étant intarissables ; et bien que l’offre déjà à disposition de la population se révèle supérieure à sa demande, ce système exprime le souhait de croître plus encore, dans une illusion de possibilité de croissance illimitée et de toute-puissance. Dans cette société caractérisée donc notamment par l’abondance (à comprendre comme excès), l’individu est pensé surtout sur le mode du consommateur, spécifique à ce système, c’est-à-dire d’un potentiel acheteur et/ou utilisateur d’un produit ou d’un service dans une perspective de satisfaction et de jouissance. Il est avant tout question de marchés, de ventes et d’achats, de consommation finalement pour l’individu baigné dans ce système. L’on peut définir celle-ci avec Laurent Fourquet comme l’action de “s’approprier à titre temporaire ou définitif une chose à des fins de jouissance”4. Consommer renvoie ainsi au fait de chercher la satisfaction par le biais de l’achat, de l’usage ou de l’échange d’un produit ou d’un service. Précisons que cela n’implique pas nécessairement de devenir propriétaire de l’objet convoité. En effet, la finalité du consommateur “est la consommation des choses et non la détention de celles-ci. S’il faut posséder les choses pour en jouir, il n’hésitera pas à devenir propriétaire pour les posséder. Mais, en règle générale, le mode de détention des choses l’indiffère. Ce qui compte, pour lui, est l’arraisonnement des choses aux fins de jouissance”5.
Nous avançons ainsi dans un mode de vie où tout semble avoir pris la forme d’une consommation potentielle, où le rapport le plus envisagé se révèle être celui du rapport à la marchandise et où l’on nous incite sans cesse à la prise.
Par ailleurs, une certaine représentation type du bonheur se lie intrinsèquement à nos sociétés de consommation et est largement diffusée au sein de celles-ci. A savoir que le bonheur résiderait assurément, seulement et tout entier dans la satisfaction, la consommation satisfaisante. L’homme se voit martelé de slogans dans sa vie quotidienne qui tous lui rappelle une chose : il faut consommer pour être heureux ; il faut chercher à satisfaire ses désirs multiples et variés. Il est poussé à se définir lui-même ainsi que son niveau de bonheur par sa consommation. Baudrillard d’expliciter notamment dans son ouvrage La Société de consommation (1970) qu’il est vendu à la population autant de produits contenant tous dans leur consommation la promesse du bonheur. L’on nous communique que chaque objet se voudrait fabriqué pour notre bonheur ; l’on semble entendre partout : consommer tel produit ou tel service et vous serez heureux. Et s’offrent à nous avec ce discours de nombreux secteurs de consommation, qui sont tous autant de possibilités d’exploration, autant de domaines investis par cette promesse d’un bonheur de la satisfaction (qu’il s’agisse par exemple du domaine de la beauté ou bien du confort technique, etc).
Ainsi, dans cette idéologie consumériste, une grande place est faite aux désirs, qui se trouvent valorisés et incités. Il s’est mis en place un véritable commerce des désirs, car si le bonheur se trouve dans la satisfaction, il est par là même notamment rendu possible par ces tensions intérieures présentes en l’individu de façon antérieure.
Il sera donc question, de manière intéressée, de maximiser les opportunités de désirs, entendues alors comme ces tensions en vue d’objets particuliers dont les individus pensent que leur obtention leur procurera satisfactions, plaisirs et par là même généralement jouissances. Autrement dit et plus globalement, des tensions au fond conçues comme synonymes de bonheur par ce qu’elles permettent. Il faut en effet qu’il y ait d’abord des manques pour qu’il y ait ensuite remplissages de ceux-ci, satisfactions, et plus.
Dans notre société occidentale actuelle de la marchandisation, du surnombre et du surplus, il ne s’agit pas tant du désir que des désirs considérés sous cet angle pluriel. L’homme moderne qui pense que la satisfaction équivaut au bonheur recherche de ce fait à se remplir de diverses façons et par divers objets ; il aspire par là même aussi à des jouissances nombreuses et les souhaite d’ailleurs les plus instantanées possibles. Avoir ainsi quantité de désirs, ce serait autant d’opportunités pour cet homme consommateur d’être heureux et autant de possibilités de ressentir effectivement des plaisirs portés à leur paroxysme une fois tel ou tel désir réalisé. Notons qu’il est aussi question ici de désirs divertissants ainsi que des désirs dans lesquels l’individu s’implique effectivement tout entier, croyant à leurs promesses de bonheur.
Ces tensions intérieures qui s’attachent à des objets d’une pluralité de genres, qui naissent et périssent sans cesse, reflètent finalement leur ancrage dans un système spécifique, qui sous des aspects du multiple et du différencié ne nourrit en fin de compte que de l’homogénéisation, de l’uniformisation ; ces tensions se révélant en effet modelées par une culture de masse. Elles amènent par ailleurs chacun à se centrer sur soi-même, alimentant l’ego et entretenant un certain narcissisme. Les egos rivalisent et s’affrontent dans cette course de plaisirs variés en nombre, dans ces déplacements d’objet en objet, dans ces nombreuses recherches de satisfactions pour la plupart superficielles.
Ainsi, voici ce qui se veut une pensée commune concernant la notion de bonheur : le bonheur serait bien positif, au sens de présence effective d’une satisfaction, d’un plein contentement ressenti et permis par l’assouvissement d’une tension désirante. L’entier comblement du manque par l’obtention de l’objet délimité désiré, comme aboutissement effectif d’une tension désirante et correspondant par là même à son annihilation, laisse alors place à un large plaisir également convoité, provenant de cet état de complétude, de plénitude que nous éprouvons provisoirement. Mais ce plaisir comme effet du plein remplissage de ce qui était en défaut du fait d’un désir, n’est qu’évanescent et se détériore rapidement. C’est pourquoi le sujet vise à manquer à nouveau, pour pouvoir à nouveau se remplir, se combler, et par là même possiblement aussi in fine atteindre la jouissance, comme ce qui vient parfaire la satisfaction obtenue.
Nous notons la prégnance donc de cette idée que la satisfaction, au sens d’atteinte du comblement total d’une tension désirante, est le cœur du bonheur ; elle est conjointement ce qui le rend présent, qui le fait advenir, ce sans quoi ce dernier n’est pas. Lorsque la satisfaction dépérit, l’état de bonheur disparaît peu à peu du même fait. Il s’épuise avec elle, si bien que lorsqu’elle n’est plus, il n’est plus non plus. Il s’agit donc ici de la conception d’un bonheur entièrement contenu et concentré dans les satisfactions, qui dépend de l’effectivité de celles-ci ; qui naît avec celles-ci, puise toute sa force d’être en elles et se termine avec elles. L’état heureux et les notions de totalité, de plénitude sont ainsi étroitement liés jusqu’à coïncider. Par là même il est couramment opposé au bonheur la notion d’insatisfaction, la présence d’un manque qui ne peut être totalement comblé, ne l’est pas encore, ou ne le sera pas in fine. En cela résiderait notamment le malheur.
Pourtant nous sommes en droit de nous demander : le bonheur tient-il irrémédiablement dans la satisfaction dans une sorte d’adéquation stricte et systématique ? Se réduit il seulement aux pleines satisfactions de nos désirs ? La notion d’état heureux s’épuise -t-elle véritablement dans cette considération, sans à-côtés, sans autres ouvertures ?
Mais si à-côtés il y a, n’est-ce pas peut-être là même le lieu fondamental et non pas tant accessoire pour penser le bonheur ?
Si donc nous ne nions point que le premier type de bonheur exposé ci dessus existe effectivement, ne pouvons-nous tout de même aller en dehors ou au-delà de celui-ci, en proposant une autre interprétation possible de la notion de bonheur, et peut-être par là même entrevoir un type de bonheur plus nourrissant? Pourrions-nous explorer une autre facette du bonheur, qui se voudrait contraire à la première, à savoir un état de bonheur permis par une insatisfaction cruciale? En effet, l’absence de satisfaction condamne-t-elle forcément au malheur?
Plus encore, y aurait-il quelque chose qui se jouerait du côté de l’insatisfaction vis-à-vis du bonheur qui rendrait cette voie préférable ou plus goûteuse pour l’homme en quête du bien suprême? Pourrait-on penser quelque chose de plus grand, de plus profond, véritable ou authentique qui se tiendrait pour l’être humain dans l’insatisfaction?
Nous posant la question du lien légitime entre bonheur et satisfaction, nous ferons dans cet ouvrage la proposition d’une autre interprétation, allant au-delà de ce qui se veut communément admis et qui peut être n’est pas assez remis en question.
Partant d’une réflexion critique à l’égard de la notion de bonheur comme elle se veut généralement entendue en notre temps, c’est-à-dire en rapport étroit à celle de complétude, nous nous proposons de souligner les bénéfices d’un renversement de perspective et par là-même d’un bonheur lié à la notion d’insatisfaction.
Ainsi nous refuserons de nous limiter dans la pensée du manque à la simple considération de ce dernier comme d’un moyen en vue du bonheur, sans le comprendre aussi comme un lieu même de celui-ci. Loin donc que la satisfaction soit l’unique et exclusive substance en laquelle résiderait un état de bonheur pour l’homme, nous traiterons également de ce qu’il en est de l’insatisfaction comme autre ressource pour entrer dans une existence heureuse, comme source nourricière et demeure où l’homme peut s’inscrire pour son bonheur.
Finalement, notre sujet nous interroge sur la signification que nous pourrions donner au fait de mener une vie profondément heureuse. Nous touchons à un enjeu anthropologique et existentiel primordial.
Notre essai de définition nous renvoie par là-même à la question du désir : comment comprendre et envisager le désir humain, mais aussi quelle place lui accorder, pour pouvoir espérer accéder au bonheur? Et en fonction de cela, de quel type de bonheur alors s’agit-il?
Il en va du type d’existence à envisager pour pouvoir être heureux, comprise dans son rapport au désir.
Deux thèmes essentiels seront donc abordés qui touchent tout être humain : celui du bonheur et celui du désir. Ce sont là des thèmes forts qu’il est intéressant d’envisager dans leurs possibles rapports, qu’il s’agisse de relations d’alliances ou de divergences. Cela nous conduira notamment du côté de la métaphysique.
D’autre part, si nous envisageons cette piste de réflexion, c’est aussi car nous percevons les difficultés de la représentation d’un bonheur telle qu’exposée plus tôt et véhiculée par notre société de consommation contemporaine. En effet, cette pensée semble avoir ses limites et peut-être est-il désormais urgent de changer de paradigme, de s’autoriser à penser autrement, de mettre en avant une critique du schème établi. Un schème de pensée qui, prôné et poussé à l’extrême dans notre système, ne fait plus sens et engendre des difficultés. En effet, de par cette idée tenace, épinglée trop fortement dans les esprits, que le bonheur ne se trouverait seulement et forcément que dans les satisfactions ainsi que les jouissances qu’elles peuvent procurer, nous constatons actuellement un mal de vivre prégnant. Une fatigue de vivre se fait sentir chez les nouvelles générations, engendrée notamment par cette représentation du bonheur portée à son paroxysme que l’on trouve diffusée partout. Loin d’être libératrice et de leur procurer effectivement le bonheur, celle-ci les plonge en réalité dans un épuisement, une lassitude et un mal-être palpable. L’on pourrait dire, dans un état de crise où se mêlent nausée, désorientation et recherches d’issues (finalement préjudiciables) face au malaise. Mentionnons qu’il est apparu de nouvelles pathologies, spécifiques à notre temps, telle que l’oniomanie (se voulant une addiction liée à l’achat excessif de biens de consommations) qui pour une part mettent en avant une conception marquée du bonheur et par là même de la notion de désir devenue problématique pour l’homme contemporain habitant cette forme de société de consommation.
Penser absolument que le bonheur se consume dans la satisfaction des désirs, et cela à un niveau excessif, critique, voire pathologique, pourrait bien nous conduire à une sorte de bonheur mortifère, entre exténuation et vide existentiel. Il peut être alors question de saturation, d’errance, de confusion ou de dépression face à un système du multiple et du varié ; un système qui prônant tant de jouissances nous conduit par exemple à l’écoeurement, ou qui nous sollicitant de trop et ouvrant à nous l’impression d’un monde sans limites, baigné dans l’excès de choix, nous angoisse.
C’est donc aussi une problématique actuelle qui nous motive à traiter notre question. Car sous l’apparente prospérité et homogénéisation de notre société se décèle plus profondément une fragmentation entre les individus, le sentiment de ne plus être tant enraciné dans une existence faisant sens et l’impression que quelque chose de la notion de bonheur se perd ou se dérobe.
Il en va donc également pour nous en un sens de la nécessité de penser un rapport au monde qui puisse aider à extirper les hommes contemporains se retrouvant malheureux de la situation où ils se sont immergés, notamment du fait de leurs représentations.
Nous dirons pour finir que si pour une part cela se voudrait un bonheur de la facilité qui nous est proposé et dans lequel il est attendu que l’on s’inscrive6 celui-ci se révèle paradoxalement, par des aspects, bien difficile à vivre.
L’attirance pour ce travail de réflexion proposé ici est notamment issue d’un vécu personnel. En effet, face à une exténuation ressentie dans l’application de ce schème de pensée (à savoir que le bonheur résiderait tout entier dans les satisfactions multiples) ou face à la réception d’un bonheur plutôt vide de sens et d’un sentiment de superficialité, l’autrice de cet ouvrage a été amenée à remettre en question cette représentation, jusqu’à prendre le contrepied de ce qui nous est communément proposé et diffusé. Le choix de ce sujet se veut donc en lien avec un parcours de vie, il vise à ouvrir des perspectives et à renverser l’impossibilité non absolue mais bien provisoire d’entrevoir les choses autrement.
Notre problématique pour ce livre sera la suivante : Comment comprendre une positivité de l’insatisfaction et par là même redéfinir la notion de bonheur ? A entendre ici : redéfinir la notion de bonheur par rapport à la façon dont elle se trouve communément conçue actuellement, en le sens déjà explicité plus tôt.
Nous allons soutenir la thèse selon laquelle il serait important de penser la positivité de l’ insatisfaction afin de revisiter la notion de bonheur. Nous nous attacherons à valoriser l’insatisfaction, trop souvent perçue négativement en elle-même ; nous penserons son poids et son rôle dans et pour le bonheur. Nous inviterons le lecteur à la considérer comme principe et lieu même du bonheur.
Nous tâcherons de démontrer qu’il y aurait sans doute aussi, voire surtout, un bonheur de l’insatisfaction et que cet état de bonheur différent se veut peut-être plus grand ou plus nourrissant que le bonheur des satisfactions nombreuses et diversifiées. Quelle sorte de bonheur pourrait-on concevoir qui trouverait sa source et résiderait dans la notion d’insatisfaction?
Notre vision des choses invitera ainsi notamment à réexaminer les notions de manque et d’absence et à les apprécier autrement. Nous argumenterons en le sens d’un bonheur lié à une valorisation de l’absence en elle-même, perçue sous différentes approches. Quels bienfaits associer à une sorte de bonheur négatif, au sens d’absence de satisfaction? Quelle positivité entrevoir pour ce qui est d’ordinaire perçu comme une douleur et dit néfaste?
Des perspectives différentes sur la notion de désir également et sa compréhension nous amèneront à considérer un bonheur rejoignant la privation, l’insuffisance et la frustration ou encore l’impuissance heureuse. Nous expliciterons la manière dont nous pouvons penser une existence heureuse liée à du non-assez, à de l’inassouvissement ou encore à une prise impossible. Notons aussi que bien qu’il s’agisse de penser un bonheur lié à quelque chose d’une négation, cela ne contredit pas, nous le verrons, une affirmation du sujet, au contraire.
En fin de compte, en considération de ces diverses approches, le regrettable consisterait à penser que le bonheur tiendrait strictement et uniquement dans un minimum d’insatisfaction possible, dans une recherche d’annihilation de toute présence de celle-ci dans nos existences ; cette dernière n’étant alors considérée seulement qu’en tant que synonyme de souffrance.
Cela du moins nous condamnerait au seul type de bonheur uni à la plénitude, à la satisfaction, sans parvenir à distinguer et à cheminer possiblement dans d’autres voies d’existence heureuse, peut-être d’ailleurs moins fades.
Réapprenons donc entre autres à relationner avec le manque et l’insatisfaction, autrement, et sans que cela soit une douleur malheureuse pour notre être.
Pour traiter notre sujet, nous procéderons tout d’abord à un travail de définitions préliminaires dans cette introduction, concernant les notions de désirs, de satisfaction et de plaisir, mais également la notion de jouissance et enfin celle de bonheur. Celles-ci étant importantes à poser pour notre réflexion.
Ainsi, en premier temps, les désirs pourraient se définir en tant que tensions intérieures vers des objets que l’on imagine être source d’une sensation plaisante. Ils peuvent s’entendre comme tensions vers la recherche de satisfactions, de plaisirs ou de jouissances ; plus largement des tensions en vue du bonheur si l’on considère que le bonheur réside en cela. Ces désirs, en tant que tensions vers des plaisirs, s’accompagnent donc en ce sens d’une visée, d’une finalité associée à un accaparement. Ils insufflent à l’homme de parvenir à leurs assouvissements, qui fourniront de plaisantes sensations. Ce sont des désirs dont chaque sujet a pu faire un jour l’expérience.
Ils seront cependant à distinguer d’un désir d’un autre type dont nous viendrons à parler, un désir différent car ne se liant pas à l’ego, au centrement sur soi, un désir qui n’est pas une tension de la domination ni une tension cherchant la possession.
Concernant la satisfaction, il est important de noter que celle-ci suppose la prise au préalable. Etre satisfait implique d’avoir pris. C’est un état rendu possible par la saisie et découlant de celle-ci. Il s’agit d’autre part d’avoir pris assez, d’avoir pris ce qui a permis de combler entièrement le manque premier ressenti. Tel sujet a saisi tel un objet qui a été suffisant pour assouvir un désir ou besoin, un objet qui a fait assez en somme, comme l’indique l’étymologie même du terme (provenant de “satis” et “facio” en latin que l’on pourrait traduire par “ce qui fait suffisamment”). Dans cette même idée, le plaisir se définira comme “l’effet d’un processus” de “restauration” d’une “harmonie” parvenu à terme, ce qui est le propre de la satisfaction (et ce qui rejoint également ici l’idée d’une certaine stabilité). Une satisfaction ayant elle-même eu lieu à la suite d’une prise, laquelle était recherchée par un sujet du fait d’un désir ou d’un besoin éprouvé. Mais notons que le plaisir pourra aussi être perçu en tant que lié pour une part à l’activité progressive de remplissage même d’un manque, une activité encore en cours, dans une dynamique qu’on dira alors plutôt de “réplétion”. Toutes ces précisions quant à une définition de la notion de plaisir pourront se retrouver notamment chez Socrate, dans le Philèbe de Platon7.
Le plaisir peut donc s’entendre en un premier sens comme cette sensation agréable que l’homme ressent une fois son désir ou besoin parfaitement assouvi. Lorsqu’on le considère alors ainsi, comme découlant de la satisfaction de tel désir ou besoin, il se joint au terme éprouvé d’une tension intérieure et se veut obtenu à un moment précis par un homme, qui ne le possédait pas mais qui finit par le conquérir intérieurement ; cette conquête étant le fruit d’une action externe qu’il a posée à cette fin.
En un second sens, il est cette sensation agréable que l’homme ressent conjointement à une dynamique de remplissage dans laquelle il se trouve.
Néanmoins, il est possible d’approfondir encore la définition du plaisir. Remarquons que Platon distinguera différentes espèces de plaisirs, essentiellement encore dans le Philèbe, dont des plaisirs seulement physiques ou seulement psychiques, mais aussi et surtout des plaisirs purs, à comprendre comme des plaisirs ne survenant pas à la suite d’une douleur éprouvée (distincts donc des plaisirs mélangés et de l’idée d’un rétablissement d’une quantité manquante). Cela sera intéressant pour nourrir notre réflexion par la suite.
Concernant désormais la jouissance : elle est à comprendre comme un plaisir intense effectif chez un individu, découlant d’une satisfaction. Elle est un état de plaisir porté à son degré maximal et éprouvé par un sujet, ce qui incite d’ailleurs par la suite l’individu à vouloir retrouver cette sensation. Dans notre société de consommation, les désirs sont recherchés pour ces ressentis de plaisirs intenses, donc toujours liés à une perspective intéressée, de convoitise ; et tel que le présente Laurent Fourquet dans son ouvrage L’ère du consommateur (2011), il est alors question pour l’individu d’être balloté sans cesse entre désirs et jouissances dans sa quête de bonheur, les uns allant de paire avec les autres. Il s’agit toujours de jouir encore par la satisfaction, et de jouir plus.
Mais qu’en est-il alors de l’insatisfaction ? Nous nous attacherons à la définir surtout dans nos différentes parties du livre ci après, mais nous pouvons d’ors et déjà mentionner que le préfixe “in” en réfère à une privation, un manque ou encore une absence (que l’on pourra relevée en tant qu’absolue ou contingente).
Enfin, définissons le bonheur entendu ici dans un sens globalisant. Le bonheur se veut un état recherché pour lui-même (non pas recherché comme un instrument en vue d’une autre fin) et spécifiquement par l’homme ; il est le bien suprême que l’homme recherche de façon universelle. Il correspond à un état intérieur positif ressenti subjectivement, de façon singulière, compris dans un temps long, dans une durabilité, une certaine continuité. Mentionnons néanmoins que l’on peut penser dans cette stabilité heureuse des périodes plus ou moins intenses ; les périodes d’intensité plus minimes pouvant alors être perçus par les sujets comme des temps de bonheur moindres mais aussi possiblement presque de tristesse (paradoxalement, en rapport à l’intensité positive vécue précédemment). Il peut s’agir ainsi de penser dans cette globalité heureuse quelques moments d’affaiblissement pour le sujet, que l’on associera à des sentiments moins enjoués, plus maussades, qui viennent comme vallonner un sentiment global de positivité chez le sujet, sans le détruire dans son ensemble. Il est fait mention de cela quant au bonheur de l’homme afin de rappeler que le seul Être absolument et éternellement bienheureux n’est autre que Dieu ; et qu’un tel bonheur demeure inatteignable pour l’homme, qui a accès à d’autres formes de bonheur, mais qui peut cependant essayer de s’en approcher effectivement, au plus possible.
Précisons que nous pensons dans cet ouvrage un bonheur en vue duquel l’homme peut poser des actions et pour lequel il peut s’orienter. Si l’homme peut être l’agent de ses joies, cela signifie que son bonheur dépend de lui, il en va de sa responsabilité que d’être heureux. Nous nous distinguons donc ici de l’étymologie du terme en ce qu’elle fait référence au bon augure, à un hasard favorable, à la chance, ou bien aussi au contraire à une fatalité qui s’abat sur nous et face à laquelle nous nous pourrions rien. Notre présupposé tient ici en ceci que l’homme peut être l’acteur de son bonheur. Cela notamment par les choix qu’il pose, les pratiques dans lesquelles il s’installe, par sa manière d’appréhender le monde extérieur mais aussi et encore par le type de relation qu’il entretient avec son univers intérieur. Nous proposerons ainsi une réflexion sur des existences heureuses vers lesquelles chaque individu peut tendre de lui-même.
Pour ce qui est des sources principales et du corpus bibliographique irriguant notre sujet, nous le traiterons notamment en lien avec la pensée d’Epicure, de Spinoza et de Descartes, selon le moment de réflexion dans lequel nous nous inscrirons. D’autres auteurs seront également mentionnés et utilisés de façon plus secondaire, tels que Lévinas par exemple ; enfin notons que nous nous appuierons également sur ce peintre réaliste du XIXe siècle François Bonvin.
A propos de méthodologie, et afin d’éclaircir notre traitement du sujet, il est important de souligner que nous partirons de trois définitions spécifiques du terme d’insatisfaction pour en venir à trois conceptions différentes du bonheur, associées respectivement à chaque définition précédemment proposée. Ainsi ces différentes explorations de la notion d’insatisfaction nous mèneront à diverses représentations du bonheur, qui seront précisément définies à chaque fois, selon le temps de la réflexion où l’on s’inscrira.
Notons par ailleurs que la notion de bonheur est un classique étudié par la philosophie, qui a toujours suscité beaucoup de réflexion, dès les pensées de l’Antiquité. Pour notre propos, nous nous appuierons sur certaines philosophies du bonheur, telle que celle d’Epicure mentionnée ci-avant, que nous réinterpréterons. Il s’agira de reprendre tel passage précis et considération intéressante de tel auteur et de voir comment l’inscrire dans notre pensée propre, comment elle peut être un appui pour traiter notre sujet ; ceci tout en ayant conscience des positions profondes de l’auteur ainsi que des précisions de sa pensée. Nous serons donc amenés à discuter avec les auteurs, à les détourner, à les revisiter, pour défendre notre sujet, cependant faisant cela nous demeurerons avertis de leurs positions personnelles de réflexion et de ce qu’ils proposent à travers leur œuvre.
Finalement, et afin de montrer que notre problématique touche tout un chacun et qu’elle s’inscrit réellement dans la vie, dans un souci pratique et commun de notre existence, nous indiquons ici qu’une enquête a été menée dans le cadre de cet ouvrage. Cette enquête reprend deux notions principales de notre questionnement, à savoir celle de bonheur et celle de désir. Sous la forme d’un questionnaire, elle a été soumise à un public divers et de tout âge, par le biais des réseaux sociaux ainsi que du bouche à oreille. Notons que toutes les questions étaient facultatives, chaque participant pouvant répondre à telle ou telle demande et passer sur une autre. Le résultat de ce questionnaire se décline en réponses libres ainsi qu’en graphiques formés à partir de questions à choix multiples. Nous nous appuierons parfois au cours de notre dossier sur cette enquête et sur ce qu’elle a pu révéler, ceci dans le but de fournir des pistes de réflexion concrètes à notre pensée, qui se veut une pensée pour la vie et non hors de celle-ci, mais aussi en vue de développer ou d’étayer notre propos en analysant les réponses obtenues. Nous tenons à retranscrire littéralement et avec exactitude les propos des participants, c’est pourquoi quelques fautes d’orthographes pourront être présentes au sein des citations. Nous respectons également l’anonymat des sujets.
Nous en venons pour terminer notre introduction au plan de ce livre.
Dans une première partie, nous traiterons de la positivité d’une décroissance, entendue comme désinvestissement volontaire effectif et retour à l’essentiel, pour une entrée et installation durable dans une existence heureuse. A cet effet, nous nous attacherons notamment à la notion de dépouillement et préciserons aussi ce que contient alors ici pour nous l’idée de nécessité. Nous soulignerons également la méthode attachée à cette perspective, qui comprendra entre autres une distinction clé entre désirs et besoins ; après quoi nous relèverons la transposition dans la pratique de cette première réflexion pour le bonheur, en faisant mention de mouvements effectifs, notables actuellement.
Dans une seconde partie, nous mettrons en avant un bonheur de la non-quiétude. Dans cette autre conception, nous considérerons les bienfaits d’une insuffisance perpétuelle et de son investissement dans le domaine de la connaissance, comprise dans un processus d’affirmation et d’enrichissement illimité du sujet. Pour cette idée, des concepts clés seront mis en œuvre tels que ceux de joie et de perfectibilité ; nous insisterons d’autre part sur la dimension d’un élan et sur un désir intellectuel. Nous nous attacherons ensuite à rendre manifestes les divergences présentes entre cette pensée spécifique et une doctrine qui pourrait sembler approchante de prime abord. Ceci permettra finalement de mieux mettre en lumière notre thèse.
Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous travaillerons une épochè, un dépassement de la satisfaction. Il s’agira ici de s’orienter tout d’abord vers une acceptation d’une saisie impossible absolument et de mettre en avant un mouvement de conversion au cœur. Ceci pour un bonheur du décentrement, de l’ouverture et de l’accueil ainsi qu’un épanouissement dans l’amour. Nous étudierons alors un bonheur de la verticalité mais aussi de l’horizontalité, à comprendre comme une rencontre véritable avec Dieu et avec autrui. Nous convoquerons un appui documentaire pour ce qui sera d’expliciter notre idée ; cela nous permettra par exemple de mettre en avant et d’enrichir notre propos quant au concept de soin, rapporté directement à une dimension éthique.
1 Baudrillard, 1970, La Société de consommation, p.19, partie 1, la profusion et la panoplie
2ibid., p.19
3ibid., p.19
4 Fourquet, L’ère du consommateur, 2011, chapitre 8 : Désir, jouissance et consommation, p.63
5ibid., p.63
6 Ce qui sera soulevé et présenté négativement par Baudrillard en 1970 dans son ouvrage La Société de consommation, partie 1, Parly 2
7 p.40-41 de la traduction de J-F. Pradeau parue en 2002
PREMIÈRE PARTIE : De la valorisation d’une décroissance, entendue comme désinvestissement volontaire effectif et retour à l’essentiel, pour une entrée et installation durable dans une existence heureuse
CHAPITRE I : Mise en avant du caractère bénéfique d’un dépouillement ainsi que d’une reconnexion à la seule nécessité à l’égard d’une existence heureuse
Dans cette première partie, nous abordons cette notion d’insatisfaction sous une première définition, qui nous amènera à penser une perspective autre de bonheur. Cette définition ici considérée se veut la suivante : une insatisfaction au sens de non réalisation, de non assouvissement de tensions désirantes qui pourraient être poursuivies dans cet assouvissement et assouvies effectivement. Elle s’allie à un refus d’entrer dans ce processus de recherche d’un comblement de la part de l’individu en ce qui concerne spécifiquement les tensions désirantes, celles-ci demeurant insatisfaites (non assouvies effectivement car non poursuivies pour leur comblement). Notons que le terme d’insatisfaction pris en ce sens peut se décomposer étymologiquement en deux entités : à savoir le préfixe privatif “in” combiné à ce qui se veut un dérivé du verbe latin “satisfacere” signifiant “satisfaire”. En anglais, la notion d’insatisfaction comprise en ce sens là d’inassouvissement prend la désignation spécifique de “dissatisfaction” : c’est ce que nous souhaitons ici retranscrire. Du non satisfait en tant que non réalisé ou exécuté par un individu, qui n’a pas œuvré dans le sens d’une réalisation. L’individu ne s’engage pas dans ces prises pourtant possibles, en tant qu’elles ne sont pas mais pourraient être. Nous avons pour une part une idée d’inaction ici par rapport aux désirs, un renoncement volontaire dans lequel l’individu se place. Il s’autodétermine à se retirer de la poursuite de ces satisfactions spécifiques. Cette démarche bien menée, il fait ainsi la place intérieurement à un véritable désencombrement, dans le double sens d’une simplification et d’une libération. Nous pouvons employer également le terme de dépouillement en tant que notion clé pour comprendre ce qui se joue ici. Ce terme fait alors référence dans notre pensée à la fois à l’idée d’un engagement qui est posé par un individu de laisser de côté des objets superflus qui recouvraient l’essentiel (l’étouffant) et l’en distanciaient, mais aussi à cet état dans lequel cet individu se situe après s’être délesté de ces objets. Le dépouillement apparaît ici comme le qualificatif d’un mode de vie lié à une résolution forte et tenace, ayant dans un premier temps conduit à son émergence puis soutenant son inscription dans la durée. Renoncer de soi-même à s’investir dans ces préoccupations énergivores que sont les recherches d’assouvissement des désirs, c’est aussi notamment retrouver et se réapproprier une certaine nudité ; le vivre se voyant ôté de certains aspects, l’individu se défaisant de certains investissements intérieurs (comme autant de couches qu’il revêtait auparavant) rejaillissant sur l’extérieur.
Pourtant, par cette mise à nu, il ne se rendrait pas plus vulnérable. Au contraire, cela se veut ici synonyme d’un refaire corps avec un soi profond, accepté et aimé dans son absence d’artifices, non plus tant atteint par ce qui pourrait tenir de futilités et bien en un sens fortifié. Il s’agit paradoxalement, dans cet exercice de fracture, de revenir à un mode de vie plus nourricier, dans lequel l’individu pourrait expériencer un bonheur plus pénétrant. Car s’inscrire à l’inverse dans la recherche prégnante d’obtention de divers et multiples objets de désirs et par là même des satisfactions des tensions désirantes, c’est l’on pourrait dire, de façon critique, s’aventurer dans une forme de bonheur non tant consistante ; c’est aussi prendre le risque de s’y épuiser, ou encore de se perdre soi dans son authenticité au travers de ce vivre dans le superflu et le mouvement de son acquisition.
Partant alors dans cette partie de cette première définition que l’on peut attribuer à ce terme d’insatisfaction, c’est-à-dire de cette négation volontaire de la poursuite de la réalisation de cette catégorie spécifique de tensions intérieures que sont les désirs, entraînant par là même leur non accomplissement, nous mettrons donc en avant une pensée du désinvestissement, d’un exercice du détachement choisi, dans ce que cela peut avoir de bénéfique et de profondément heureux. Une perception positive de ce qui n’est pas (et ce de façon délibérée), nous amènera à concevoir une forme différente d’existence heureuse, en contraste avec le type de bonheur largement véhiculé vu précédemment en introduction (dans cette autre perspective l’insatisfaction est considérée comme malheureuse, désavantageuse et seulement cela, à rejeter). Notre idée rejoint en fait ici un mouvement de décroissance, bien loin des fonctionnements types prônés dans les sociétés de consommation. Nous voulons mettre en avant une courbe de réduction dans laquelle l’individu peut se placer, considérée ici en tant que véritable richesse pour ce dernier. Ce qui pourrait bien être perçu comme de la pauvreté, apparaître malheureux dans l’opinion commune et se voir qualifié ainsi, se révèle au contraire pour nous un retranchement fécond et profitable. Nous nous positionnons dans la perspective d’un manque positif, heureux et non douloureux, au sens d’absence de (non-être, non-lieu) et absence délibérée, choisie : ce manque de l’inessentiel étant bien réfléchi et volontaire. Bien plutôt que de causer des tracas chez l’individu, comme l’on semble associer communément le manque à une souffrance à laquelle il faudrait remédier au plus tôt, ce dernier prend dans notre pensée la forme d’une condition pour l’accès mais aussi l’installation dans un bonheur de la simplicité et d’une paix intérieure ; condition de l’habitation d’un type d’existence que nous voyons heureuse. Appréhendé comme favorable, celui-ci, en tant qu’absence délibérée de recherche de satisfactions et satisfactions effectives des désirs (lieu de délaissement) se voudra fréquenté sans affliction ni frustration par le décroissant. L’accent est donc mis dans cette première partie sur ce manque tel que précédemment défini, présenté sous un jour bénéfique, et sur le lien pouvant par là être établit avec le côtoiement d’un bonheur spécifique. Le bonheur ne résiderait pas tant en effet dans une obtention diversifiée et multiple de tout type de satisfactions, ou du moins pas exclusivement. Il pourrait bien se trouver aussi ou surtout pour l’individu dans un art de vivre prônant un accord paisible intérieur avec l’absence de l’inessentiel, du superflu (qui n’est pas mais aurait pu être) et l’entretien de cela.
Il est ainsi question d’une insatisfaction sélective et dirigée permettant un vivre heureux autrement. Celle-ci se décidant plus spécifiquement dans la pratique, c’est-à-dire en relation avec des cas particuliers, en fonction d’un classement établi au préalable en raison entre différentes catégories de tensions comprises dans leurs spécificités et définitions propres. Un jugement sera apposé par l’individu quant à une tension précise en référence à ce tableau de distinction présent en son esprit qui décidera de sa satisfaction ou non. Ceci par la catégorisation de la tension dans l’un ou l’autre côté, autrement dit dans un type de tensions à réaliser effectivement ou non.
Finalement, s’il s’agit certes de veiller à combler certaines tensions primordiales, nous choisissons ici de nous centrer sur cet autre pendant de ce bonheur d’un dépouillement : une insatisfaction mise en application, tenant une place cruciale pour ce vivre heureux précisément. Celle-ci est soulignée dans sa positivité. Et le décroissant de rejoindre finalement un bonheur que l’on pourrait dire en quelque sorte de la négation, car s’alliant pour une part au fait de ne pas se situer dans les désirs, que l’on apprendra et veillera également à ne pas inciter au plus possible, et se trouvant d’autre part dans le ressenti d’un équilibre, permis par la prise de plaisirs limités et cruciaux, se définissant eux-mêmes en tant qu’absences de douleur, négations de celle-ci.
Ce bonheur, rejoint dans le non investissement de ces troubles éphémères et superflus qui pourraient apparaître en l’individu et que sont les tensions désirantes, se verrait également maximiser selon notre pensée par l’évitement parallèle de l’apparition de celles-ci. Il est abordé en tant qu’état intérieur de paix, de repos ou d’équilibre, que l’on désignera également comme une absence de troubles de l’âme, dite ataraxie, conjointe à une absence de troubles du corps, dite aponie. Dans cette perspective, nous opérons un retour à la seule zone définie du vital, c’est-à-dire à ce qui se veut indispensable au vivre biologique. Notre pensée touche de ce fait à la question primordiale du corps et à sa juste compréhension, l’âme étant aussi entendue ici comme matérielle. Elle est intimement liée à un déchiffrement de l’ordre physique, atomique.
Il s’agit pour l’individu souhaitant entrer dans une décroissance pour s’installer par là dans une existence heureuse, de cerner correctement ce qui relève véritablement de la nécessité afin de ne plus chercher qu’à se connecter avec celle-ci. Il en va d’un retour à l’essentiel, à savoir d’un retour à ce sans quoi l’on ne peut être ou l’on n’est plus. Autrement dit encore, du discernement de ce qui nous est nécessaire : ce qui est et ne peut pas ne pas être ou être autrement pour que nous subsistions ; non pas contingent.
Dans cette perspective du détachement de la recherche de certains assouvissements de tensions en lien avec une existence heureuse, nous distinguerons alors désirs et besoins dans leurs définitions propres, en tant que ce sont là deux types différents de tensions. Nous pouvons d’ors et déjà souligner la correspondance des besoins avec des inclinations innées en l’homme, spontanées pour tous universellement, se révélant les mêmes de tous temps, qui sont et ne peuvent pas ne pas être si celui-ci est vivant. Elles renvoient à quelque chose de premier, de fondamental, que l’on ne peut éliminer sans par là même condamner l’homme vivant à la mort. Il s’agit d’éléments indispensables pour le vivre de l’homme au sens biologique, sur lesquels il repose et qui rejoignent sa définition.
Saisir la positivité de l’insatisfaction dans cette première définition que nous lui proposons , qui permet d’envisager le bonheur autrement, s’allie ainsi aussi au fait de saisir rationnellement nos tendances naturelles, d’en avoir connaissance pour pouvoir ensuite déceler en celles-ci le profondément favorable et s’orienter heureusement par rapport à celles-ci. Il s’agit de s’inscrire dans un accord harmonieux et au plus heureux avec notre nature.
Notons par ailleurs que ce bonheur qui suppose généralement pour l’individu pour une part, dans une première étape, de remanier ses conduites et ce faisant de suivre une pente quotidienne descendante, se voit ensuite surtout imprimé dans une horizontalité, représentant alors cette vie différemment menée par cet individu, impliqué dans ce nouveau schème avec rigueur et constance. Ainsi, si nous utilisons ici le terme de décroissance, cela se veut surtout dans sa mise en contraste avec un fonctionnement contemporain de la surconsommation. Notons également qu’il imprègne surtout, compris littéralement, l’un des deux grands moments qui seront expériencés par l’individu s’attachant à se placer dans ce vivre selon notre pensée. En effet, cette trajectoire de vie que nous défendons peut s’appréhender comme recouvrant une ligne descendante pour qui est d’abord inscrit dans du surplus, cependant ceci jusqu’à rejoindre un stade d’équilibre dans lequel elle s’applique à s’établir ensuite avec constance, se maintenant alors (si l’on voudrait le figurer) dans une ligne de stabilité horizontale unidirectionnelle, après avoir retranscrit une réduction. Le caractère de diminution à proprement parler se rencontre ainsi surtout dans cette première phase où séjourne l’individu de façon transitoire, autrement dit dans sa pénétration progressive et notable vers cet autre mode de vie ici mis en avant, dans son ralliement toujours plus marqué à une certaine simplicité par un débarras de l’inessentiel.
Par ce terme de décroissance, nous voulons appuyer sur le contraste entre cette orientation spécifique et ce qui se joue généralement dans le monde contemporain. Il nous semble d’ailleurs intéressant par là de présenter quelque peu cet autre paradigme heureux largement assumé actuellement ; ceci afin de mieux saisir cette opposition qui se tient avec la perspective que l’on soutient et par là même, dans cet écart, d’entendre véritablement l’enjeu contemporain de notre pensée, celle-ci revêtant une teinte et signification particulière comprise dans un contexte spécifique. Ce dernier se verra d’ailleurs d’autant plus souligné ensuite par l’examen de certaines limites inhérentes à la définition communément intériorisée d’une existence heureuse. Également par l’évocation, dans un constat critique, des problèmes rencontrés effectivement par notre monde contemporain qui rejoignent notre thématique. Notre pensée s’en trouvera par là mise en relief dans ses bénéfices et sa portée.
Ainsi, attachons-nous brièvement à expliciter ce qu’il en est actuellement globalement : quelle définition du bonheur se voit prisée et largement adoptée? Quelle place est accordée à l’insatisfaction dans les conduites ? Comment celle-ci est-elle considérée, perçue ?
Tout d’abord, marquant cette opposition, nous l’observons, une véritable économie des désirs se tient de nos jours à un niveau mondial, dans une valorisation également des plaisirs dynamiques et de l’excès, après un virage important pris d’une production et consommation de biens transformés de masse dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette économie au fonctionnement fluide, stimulée par les individus imprégnés dans ce schème autant de par leur contribution professionnelle que dans une sphère plus personnelle, se voit encore en pleine “expansion”8. Les désirs, non plus seulement des “médium[s] entre le consommateur” et des produits, tiennent également désormais le “rôle de matière[s] première[s]” ; ils sont devenus des “marchandise[s]” en eux-mêmes, exploités méthodiquement en tant que telles, soutenant surconsommation et profits9. Abordés ainsi différemment et se trouvant au coeur de l’économie, les désirs et leur sphère se voient posés comme l’un des fondements du système actuel. La vision d’une existence heureuse diffusée par le capitalisme et largement récupérée par les individus est vraiment bien celle d’une existence imprégnée de désirs en nombre et de toutes sortes, que l’individu serait en capacité d’assouvir au plus tôt (et ce à quoi il s’attacherait). Ceci étant compris dans un renouvellement permanent : renouvellement de ces tensions, de leurs poursuites, de leurs assouvissements. Il y a la considération massive d’un bonheur résidant en fait uniquement et totalement dans la satisfaction des désirs. Par là même, un soutien de nos désirs se tient fortement qui se voudrait dans notre intérêt, pour notre bonheur ; ceci passant par une stimulation constante de notre part désirante, autrement dit une incitation quotidienne à ces ressentis, également par la facilitation de leurs assouvissements, l’effectivité d’une offre variée et abondante pour y répondre, etc...
Les jouissances sont ainsi valorisées, en tant qu’elles sont des effets possibles des satisfactions des désirs (traduisant le vécu d’un extrême au sein même d’un plaisir obtenu ; perçues en tant que délicieuses inflammations de l’être, aussi synonymes d’un vif ressenti d’être pleinement au monde). Plus largement, la sphère de l’excès et du surplus (même si nous le verrons, celle-ci se trouve généralement présentée sous un autre aspect dans un souci de plus de rentabilité pour les entreprises). Dans cette perspective du bonheur, où l’individu se situe dans une sorte de tension permanente vers la recherche de comblements de tous genres et superficiels, il semble qu’il n’y ait pas de place pour l’insatisfaction : celle-ci étant véritablement à éviter, liée alors entièrement à des sentiments malheureux.
La publicité joue d’ailleurs un rôle non négligeable dans ce fonctionnement capitaliste où règne la notion de satisfaction dans l’outrance. Le superflu est vanté et les individus orientés vers celui-ci par le biais de stratégies visuelles ou sonores par exemple, mises en œuvre en permanence, permettant autant de suggestions accrocheuses. La création de désirs d’objets ou de services particuliers chez eux est visée, qui va de paire avec la volonté de les situer massivement dans la sphère de l’inessentiel, ceci à des fins économiques. Dans une volonté de séduction et de persuasion par le cœur, les sentiments, les publicités jouent alors principalement sur ce fait que les désirs se trouvent associés au domaine de la représentation et de l’imagination. S’il imagine en effet que l’acquisition de tel objet lui amènera satisfaction, jouissance, par là même et comme on le lui promet : le bonheur, l’homme en vient parallèlement à désirer tel objet ; un objet qui a été en fait pensé en amont pour lui apparaître tant désirable. Dans un fonctionnement par les signes, indiquant vers autre chose qu’elles-mêmes, appelant l’individu à se tourner vers tel ou tel signifié (tel bien ou tel service), ces dernières vantent ainsi les mérites de nombre de produits de tous types, les présentant comme des alliés fantastiques dans la recherche individuelle du bonheur, ou dans le meilleur des cas : des items en capacité de leur fournir en eux-mêmes ce bonheur. Elles promettent donc dans le renvoi à tel objet ou tel service et sa consommation effective par l’individu la destination du bonheur pour ce dernier : l’on pourra notamment se référer ici par exemple au fameux message : “ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur”. Servant ainsi de médiation, sollicitant des relations de conscience spécifiques entre des sujets et des objets, usant du croire des individus, elles renvoient les individus à leur part intérieure désirante, et créant ou modelant en eux des désirs, façonnent par là même leurs orientations dans l’action. S’ils sont donc bien actifs en tant que consommateur dans leurs démarches, ceux-ci se révèlent néanmoins largement influencés pour et dans celles-ci. Notons d’ailleurs que les messages élaborés dans ce domaine sont conçus sous un double aspect : visant à la fois à plaire au potentiel consommateur pris de manière individuelle (qui doit en effet se sentir personnellement appelé par celui-ci, attiré car s’identifiant lui-même au message véhiculé), mais également à toucher le plus grand monde possible, dans une cible d’un public large, et ainsi à résulter en de nombreuses ventes jusqu’au gain de bénéfices. Concernant ce premier aspect évoqué, Baudrillard mettra en lumière le fait que le consommateur se voit réellement pris dans des systèmes de signes qui le renvoient continuellement à son égo, qui le retranchent dans ce dernier10.
L’on peut ici parler d’un individualisme exacerbé, d’intérêts personnels privilégiés, ceci notamment au détriment d’une ouverture généreuse à l’altérité et de sa considération bienveillante et approfondie. Celle-ci se voudra bien plutôt perçue par exemple à travers le prisme de la compétition et de la concurrence dans la recherche de reconnaissance individuelle. L’appui sur les egos tend pour une part en effet à susciter et alimenter chez chacun un certain rapport de rivalité avec autrui, ce qui se perçoit et se retranscrit notamment dans le développement d’une consommation ostentatoire désormais (reflétant ce combat d’egos consumans), également en lien avec la montée en puissance d’un monde de l’esthétisme et d’une primauté accordée à l’apparaître sur l’être. Les objets sont alors autant d’outils à acquérir permettant de renvoyer des messages à ses pairs concernant son intégration, son statut, tout ce qui nous concerne soi, et notamment le message d’un bonheur acquis, dans un art finalement du savoir paraître heureux quand bien même on ne le serait pas (largement permis par le développement récent des réseaux sociaux). En effet l’image de bonheur attire et se veut profitable pour celui qui la porte : tout le monde cherchant à l’être, cette image peut se vendre, et l’on peut citer ici par exemple les influencers sur instagram qui usent pour la plupart de ce jeu d’apparence, se mettant en avant dans leur meilleurs moments et offrant parallèlement des services de coaching pour atteindre le bonheur ou encore faisant la promotion d’objets matériels à leurs followers qui se voudraient orientés en ce sens d’une aide à l’existence heureuse.
Le bonheur se révèle en somme une notion profondément exploitable par le capitalisme, entre autres de par sa recherche universelle, une notion qui se trouve revisitée spécifiquement par celui-ci. Tous les domaines de ce système semblent désormais investir cette dernière, sous cette définition qui lui a été conférée, pour leur profit, ayant perçu en celle-ci des opportunités de rentabilité11. Des marchés sont en ce sens fréquemment créés et développés, rendus attrayants et accessibles pour les consommateurs ; facilités également dans la pertinence de leur création par le recueil de données numériques spécifiques par les entreprises (parmi les mégadonnées désormais disponibles). Celles-ci permettant par leur étude de déterminer à l’avance ce qui plairait potentiellement aux consommateurs, d’après leurs tendances, autrement dit d’anticiper leurs désirs, ou de répondre à des attentes générales se dégageant de l’analyse de statistiques massives.
Participant à cette incitation à la surconsommation et aux ressentis de tensions désirantes dans une promesse de bonheur, notons aussi ces algorithmes qui s’exercent sur nous à travers nos outils numériques. Ceux-ci, après le recueil de certaines données personnelles, vont être à la source de suggestions personnalisées de produits à consommer, directement envoyées sur nos téléphones personnels par exemple. Sans oublier les propositions de crédits ou paiements en différés ou en plusieurs fois, l’utilisation de promotions sur les produits, les packagings alléchants de ces derniers, l’agencement orienté des rayons en supermarchés, etc… : autant d’encouragements et de sollicitations aux désirs et à leurs assouvissements pour les individus, plus profondément : à la consommation.





























