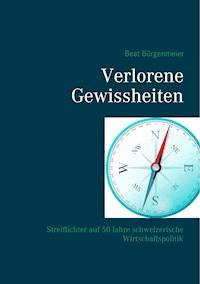Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
La science économique ne peut plus ignorer le contexte sociétal et environnemental actuel.
La science économique domine nos sociétés actuelles, et finit par être un moyen et une fin à la fois. L’économisation de nos relations sociales progresse et pénètre des domaines de plus en plus lointains de son champ initial. L’éducation, au lieu de former des citoyens instruits, devient un investissement dans le capital humain ; la médecine doit moins guérir qu’être rentable ; la culture n’est pas une forme d’épanouissement créatif mais un marché. Bref, notre société est envahie par le jargon économique, et les relations sociales sont justifiées uniquement si elles sont pratiquées au moindre coût et à profit immédiat.
Pourtant, un défi sans précédent se présente maintenant à elle. Il n’est aujourd’hui plus possible d’analyser l’économie pour elle-même, en faisant abstraction du contexte sociétal. Se laisser séduire par les intérêts onomiques à court terme revient à faire l’autruche face aux bouleversements écologiques ainsi que sociaux et à rester inactif. Cet ouvrage analyse les conséquences néfastes de cette attitude, et invite à une politique active dans une optique de développement durable. L’auteur retrace l’évolution récente de la pensée économique, avant d’éclairer le lien entre économie et société. Il plaide ensuite pour une réforme en profondeur de la politique économique actuelle.
Cet ouvrage de sciences économiques, rédigé par un professeur émérite d’économie de l’Université de Genève, souligne les impasses d'une économie à court terme et invite à adopter une nouvelle politique économique dans une perspective de développement durable.
EXTRAIT
C’est une façon commode de concilier les pratiques économiques actuelles avec les exigences environnementales, sans devoir changer les premières : c’est le progrès technique qui protégerait le mieux l’environnement tout en soutenant la croissance économique. La politique environnementale n’aurait qu’à miser sur le « tout technologique ».
L’effort intellectuel visant à comprendre le milieu naturel comme un vaste écosystème dont dépendent nos activités économiques est donc détourné pour soutenir la thèse inverse : le marché qui ne s’intéresse à l’environnement que sous sa forme de ressources productives résout les problèmes environnementaux. Une fois de plus, un problème qui gêne la modélisation économique est délégué à d’autres disciplines.
Une spécialisation scientifique de plus en plus pointue en est la conséquence. Les économistes se concentrent sur l’économie et laissent le domaine environnemental aux sciences naturelles et aux ingénieurs, tel serait la stratégie de recherche la plus prometteuse. Ils restent cloîtrés dans leurs propres modèles et ne cherchent pas à mieux comprendre l’interdépendance entre l’économie, l’environnement et le social. Au lieu d’une curiosité intellectuelle, ils offrent une seule perspective : imposer leur raisonnement à tous les problèmes environnementaux et sociaux sous le seul angle économique.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Beat Bürgenmeier est professeur émérite d’économie de l’Université de Genève. Il a été président du comité scientifique de « Fondaterra », fondation européenne pour des territoires durables, et du Conseil de l’Association allemande des professionnels de l'environnement. Il préside en Suisse l’organe consultatif de l’Office fédéral de l’environnement pour la recherche fondamentale. Il est également expert auprès d’instances gouvernementales de plusieurs pays et auteur de nombreuses publications sur le sujet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’économie au pluriel
Beat Bürgenmeier
L’économie au pluriel
Les théories économiques face aux défis environnementaux et sociaux
Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire à la fin de l’ouvrage
Préface
La science économique est devant un défi intellectuel sans précédent : elle ne peut plus analyser l’économie pour elle-même, en faisant abstraction du contexte sociétal. Elle doit se montrer capable de proposer des recommandations opérationnelles pour réussir la transition écologique qui est socialement perçue comme juste.
Cet essai est un plaidoyer pour une ouverture interdisciplinaire des sciences économiques. Il argumente en faveur d’une plus grande pluralité des approches. Il contient quatrechapitres :le premierretrace l’évolution de la pensée économique récente et s’interroge sur l’orientation qu’elle a prise ;ledeuxième éclaire le lien entre l’économie et la société et thématise la justice sociale en relation avec la protection de l’environnement ;letroisième et lequatrième s’interrogent sur la politique économique actuelle et plaident pour une réforme en profondeur.
Dans une pièce de théâtre écrite par Max Frisch il y a soixante ans,Monsieur Bonhomme et les incendiaires,un bon citoyen laisse s’installer chez lui des incendiaires. Pour ne pas déranger son tranquille confort, il se convainc qu’ils sont inoffensifs et croit pouvoir les amadouer. Il va droit dans le mur :sa maison finit par brûler comme le reste de la ville.
Cette puissante parabole sur les conséquences d’un aveuglement face au danger garde toute son actualité. Se laisser séduire par les intérêts économiques à court terme revient à faire l’autruche face aux bouleversements écologiques et sociaux en cours et à rester passif, au lieu d’agir à temps.
Le courant de pensée économique dominant, qui fait confiance au marché, joue le rôle de ce bonhomme. L’économie au pluriel*, par contre, constate un échec de marché d’une grande ampleur. Cet ouvrage analyse les conséquences néfastes de cette confiance, invite à une politique active et contribue à étudier de nombreuses interactions entre l’économie, le social et l’environnement. La pesée politique des intérêts en jeu s’opérera de plus en plus dans l’optique du développement durable*. Au fur et à mesure que le social et l’environnement gagnent de l’importance, l’économie perd la sienne en termes relatifs. Le débat scientifique en économie finit par être un débat de pouvoir.
Introduction
« La science économique est à la barre »1. Elle domine, envahit tout et finit par être moyen et fin à la fois. L’économisation de nos relations sociales progresse et pénètre des domaines de plus en plus lointains de son champ initial : l’égalité devant le droit doit faire place à la différenciation individuelle au nom de l’efficacité économique. L’éducation, au lieu de former des citoyens instruits, devient un investissement dans le capital humain. La médecine doit moins guérir qu’être rentable. La culture n’est pas une forme d’épanouissement créatif, mais un marché. L’art, au lieu de nous interpeller, entre dans les actifs de la gestion de portefeuille. L’État doit appliquer des règles d’optimisation, ne plus se référer à des citoyens, mais à des clients et se faire aussi petit que possible. Bref, notre société est envahie par le jargon économique qui exerce un véritable matraquage des relations sociales, seules justifiées si elles sont pratiquées au moindre coût et à profit immédiat. Dans cette optique, notre salut ne dépendrait que de l’économie.
Cette économisation envahissante rétrécit le champ de l’économie et semble ne concerner que les entreprises privées, même si par ailleurs elle touche également d’autres facettes de l’organisation de notre société comme le secteur public, le bénévolat, les employés, les consommateurs ou encore les contribuables. Elle ne s’intéresse pas au droit, mais aux bénéfices des avocats, non pas à l’éducation publique, mais à la rentabilité des écoles, non pas à la médecine, mais au profit des assurances médicales, des cabinets médicaux et des hôpitaux, non pas à la culture, mais aux résultats financiers des établissements qui se prétendent être à son service, non pas à l’art, mais à son commerce, et enfin pas à l’État, mais à sa gestion dans la seule optique marchande.
L’univers de l’économie devient celui des entreprises qui seules assureraient notre prospérité. C’est cette exclusivité qui est gênante, comme si la célèbre affirmation « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis et vice-versa »2 était devenue vérité universelle.
Cette affirmation est à l’origine du mythe américain selon lequel l’État doit être au service des entreprises, seules capables de créer la richesse. Comme dans tout mythe, ce n’est pas la véracité scientifique qui est demandée, mais sa capacité narrative mise au service d’une croyance : nous devons tout à l’économie.
Le courant de pensée dominant en science économique a certainement contribué à renforcer ce mythe. Il est aujourd’hui mis en question, accusé de ne promouvoir que le marché au lieu de se mettre au service de l’intérêt général défini par la démocratie. Que lui reproche-t-on d’autre ?
• Une priorité donnée à l’efficacité économique et non pas à l’équité sociale (Kuznets, 1955).
• Une analyse économique hors contexte sociétal (Coleman, 1990).
• La réduction des problèmes environnementaux aux ressources naturelles et au progrès technique (Tietenberg, 2003).
• La promotion d’un dogme unique au lieu d’une pluralité des approches (Hayek, 2011).
Ces critiques n’ébranlent pas ceux à qui elles s’adressent. Selon les économistes orthodoxes, elles doivent être discutées au sein même de la science économique qui se soumet aux critères adoptés par ses meilleurs journaux. Il n’y aurait pas besoin de distinguer, au nom de la pluralité des approches, entre école orthodoxe d’une part et écoles hétérodoxes d’autre part. Une telle distinction ne serait utile que pour désigner la première comme scientifique et les deuxièmes comme idéologiques. Imaginons la dégradation des compétences d’une Faculté d’économie où le militantisme politique remplacerait la science, voire la recherche de vérité tout court. Il serait inutile de s’interroger sur le contenu idéologique du courant principal, car il serait d’emblée déclaré comme scientifique et libre de toute valeur. Son seul objectif serait d’étudier des lois naturelles censées régir la vie économique. Il ne pourrait être soupçonné d’être au service d’une cause partisane.
C’est bien ce qui se passe : le nombre d’expertises économiques complaisantes ne cesse d’augmenter, et si certains s’interrogent sur la crise de la science, ils trouvent de nombreux exemples surtout dans la science économique dominante* (Saltelli et Funtowicz, 2017). Cela n’a pas échappé aux étudiants, qui, dans une lettre ouverte, réclament plus de pluralité dans l’enseignement de l’économie (International Student Initiative for Pluralism in Economics3). En se basant sur une enquête portant sur une centaine de programmes d’études universitaires dans douze pays, ces étudiants se plaignent d’un véritable lavage de cerveau leur imposant une pensée unique au lieu de les inciter à une réflexion critique.
En France, c’est l’Association française d’économie politique (AFEP) qui mène le combat. En se demandant « À quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? », elle polémique contre ce manque d’ouverture d’esprit des économistes qui défendent leur discipline contre toute souillure venant d’ailleurs, afin de bien la vendre à tous ceux qui pensent comme eux (AFEP, 2016).
J’ai assisté, il y a quelques années, à un déjeuner-débat entre banquiers et professeurs d’économie dans un château de vignerons dominant le lac Léman, pour mesurer moi-même le degré de complicité atteint au nom de la science. La beauté du lieu et la vue étendue auraient dû inviter à moins de complaisance et à une plus grande ouverture d’esprit. C’était avant la crise financière de 2008. Les profits du secteur financier étaient encore justifiés scientifiquement.
Jusqu’à présent, la proposition de l’AFEP visant la constitution d’une nouvelle section « Économie et société » au Conseil national des universités n’a pas abouti, notamment à cause de l’opposition d’un économiste français animant ce déjeuner. À cette époque, il n’avait pas encore reçu le prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel, mais il était pressenti. Aujourd’hui, après l’attribution de ce prix, son avis a forcément plus de poids, en tout cas nettement plus pour le ministère en charge du dossier, que tout avis contraire.
En Allemagne s’est formé en 2011 un réseau en faveur d’approches plurielles en économie, qui entretient une plateforme Internet, organise des écoles de formation d’été et veille scrupuleusement à l’évolution des plans d’études dans un esprit interdisciplinaire4. Conscient que la critique la plus pertinente n’est pas encore une alternative théorique crédible, ce réseau propose des perspectives inédites, comme la place des femmes dans l’économie, la relation de pouvoir et de dépendance entre employé et employeur – pudiquement appelée de « l’offre et la demande sur le marché du travail » dans l’orthodoxie économique dominante – et la monétarisation des valeurs intrinsèquement non monétaire. Elle fait l’inventaire des programmes universitaires européens qui offrent déjà à l’heure actuelle des formations dans cet esprit.
En Suisse, l’Association pour Renouveler la Recherche et l’Enseignement en Économie et Finance (AREF) a vu le jour en 20185. Elle propose notamment une école d’été afin de promouvoir la pluralité des approches. Soucieuse de centrer les débats scientifiques sur l’éthique économique, elle cherche à son tour à combattre le positivisme dominant qui se manifeste notamment par un réductionnisme excessif et un recours naïf au big data.
Cependant, la revendication pour une économie au pluriel* ne peut se contenter d’énumérer les critiques à l’égard de la science économique dominante, souvent connues de longue date, sans montrer sa capacité à formuler des recommandations de politique économique plus pertinentes.
Un agenda de réforme pour le XXIe siècle inclut notamment la réduction des inégalités sociales, la transition écologique et la mise en place d’un cadre institutionnel à la hauteur des relations économiques internationales contemporaines (Raworth, 2018). La recommandation de la science économique dominante de résoudre ces problèmes par la croissance, le progrès technique et par la globalisation rencontre de plus en plus de résistances et contribue ainsi à la montée d’un populisme se méfiant de toute forme d’expertocratie.
« Sans débat, pas de science », telle devrait être la devise de la science économique. Au lieu de s’enfermer, au nom de la science, sur sa propre logique, elle doit devenir plurielle, pour ne pas perdre définitivement le statut auquel elle aspire avec tant d’obstination.
1. L’expression provient d’André Hurst (2015) qui rappelle les racines de la science économique dans l’antiquité grecque.
2. Affirmation attribuée à Charlie Wilson, directeur général de GM en 1955.
Source : www.ino.com/blog/2008/06/what-is-good-for-general-motors-is-good-for-america
3. www.isipe.net
4. www.plurale-oekonomik.de
5. www3.unifr.ch/aref
CHAPITRE 1 Quelle économie ?
Depuis ses origines, la science économique est traversée par des courants de pensée idéologiques qu’elle a cherché à réduire par son aspiration au statut de véritable science. Or, malgré les efforts continus des économistes pour plus de rigueur et une claire séparation entre contenu normatif et ambition scientifique, le soupçon que la science économique a un contenu idéologique s’est maintenu jusqu’à nos jours. Il sert tantôt à justifier une approche plurielle de l’économie, tantôt à soutenir un relativisme culturel qui reproche à la science économique d’être au service d’intérêts de lobbies, de pays, de doctrines ou du capitalisme tout court.
L’évolution récente de la pensée économique montre que cette discipline ne peut être réduite à un seul courant de pensée. Périodiquement, elle donne lieu à des controverses, même si ses développements récents suggèrent qu’elle est arrivée à la « fin de son histoire » 6 et qu’il suffirait dès lors d’appliquer correctement ses principaux enseignements. Son futur progrès ne consisterait qu’à affiner les résultats théoriques sans que leur contenu et leur objectif soient à mettre en question.
Or, c’est un fait connu, la science économique est issue de la philosophie sociale. Elle s’en est émancipée au début du XIXe siècle pour délimiter son propre domaine d’application avec plus de précision. Elle a eu longtemps besoin d’un adjectif pour être caractérisée. Son origine l’a désignée d’abord comme une science « morale », soulignant son contenu normatif lié à ses racines dans la philosophie, mais également à son objectif de contribuer à la richesse d’un pays par le libre-échange, ce qui était révolutionnaire à l’époque où la liberté individuelle était contrainte par les intérêts du « prince ».
Elle a ensuite connu un classement parmi les sciences « sociales » qui se sont également démarquées de la philosophie à peu près à la même époque. Dans ce processus, c’est surtout la sociologie naissante qui a défié la science économique en proposant des théories d’organisation sociale (Tönnies, 1889). Dans ce courant se situe sans doute Max Weber qui a profondément réfléchi sur l’organisation économique de nos sociétés (Weber, 1922). Classé aujourd’hui parmi les sociologues7, cet auteur ne trouve plus de place dans les enseignements économiques de nos jours. Ses réflexions se situent à cheval entre économie et société et se nourrissent des disciplines qui étudient les règles de la vie en commun, comme le droit, la science politique, la sociologie et l’économie. De surcroît, elles se nourrissent de l’histoire qui nous a légué une expérience commune et des règles de vivre ensemble qui reflètent plus une pratique vécue qu’une théorie préétablie. Elles ne se prêtent donc pas à soutenir l’ambition des économistes d’être au service d’une « vraie » science.
Les travaux de Max Weber ont sans doute conduit à désigner, au début du XXe siècle, l’économie comme une science de régulation et à l’appeler économie « politique » tant les lois et les règlements l’ont façonnée. Sur le chemin d’une véritable science, cette dénomination pose problème, car elle admet implicitement que cette discipline est tournée vers des recommandations de politiques économiques et doit prendre en compte des arguments normatifs divergents propres à tout débat politique.
Par une spécialisation accrue, notamment par une différenciation entre « micro- » et « macro- » économie, les économistes américains ont commencé après la Seconde Guerre mondiale à parler de science économique sans adjectif. Cela n’a pas duré longtemps. Il a suffi que l’ingénierie financière se développe d’une manière spectaculaire quelques décennies plus tard, introduisant des connaissances de physique appliquée dans l’analyse financière. Du coup, la science économique a retrouvé un nouveau qualificatif en devenant une science « d’ingénieur ».
À son tour, la crise financière de 2008 a discrédité cette interprétation. Peut-être ce discrédit n’est-il que temporaire. Grâce à des algorithmes de plus en plus sophistiqués, à la standardisation robotique et au progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle, la finance connaîtra peut-être un tel bouleversement que de nombreux mathématiciens, physiciens, statisticiens, informaticiens et ingénieurs remplaceront définitivement les économistes.
Cependant, cette évolution est peu probable. Face à des exubérances spéculatives, il est devenu commode de se référer aux émotions et aux errements irrationnels du comportement humain. C’est ainsi que la dernière mode est née : la science économique est devenue une science « comportementale ». La finance est ainsi un nouveau champ d’études réunissant psychologues et économistes. Dans cette collaboration, tous deux trouvent leur compte. Les premiers espèrent une respectabilité scientifique accrue et les seconds cherchent à se faire pardonner leurs erreurs d’ingénieurs financiers.
Selon ce nouvel adjectif, la quête de statut d’une « vraie » science passerait donc forcément par la psychologie. L’ambition d’être une discipline sans adjectif s’est à nouveau affaiblie. S’est également affaibli le traitement adéquat et explicite des implications normatives de la science économique sur le plan de ses recommandations pour la conduite concrète de la politique économique.
Pourtant, il y a des acquis scientifiques sur lesquels la plupart des économistes s’accordent. Ces acquis, tout en alimentant sans cesse la discussion menée sur le plan politique, sont peut-être plus nombreux que ce que laissent soupçonner les désaccords, souvent exagérément médiatisés, sur les prescriptions économiques. Ce sont ces désaccords qui contribuent à la méfiance du public à l’égard de bon nombre d’économistes dont la discipline se trouve discréditée. Ce phénomène est surtout visible en France, où des notions comme « libéralisme », « marché », « bourse » sont utilisées fréquemment comme des injures par une partie de l’opinion publique.
Ces acquis scientifiques ont été obtenus en isolant de plus en plus la science économique de son contexte sociétal8. Nous sommes donc au cœur de notre thèse : la science économique ne gagne en pertinence que si elle se comprend dans ce contexte. Dans ce sens, son avenir se situe non pas dans une spécialisation accrue, mais dans son ouverture interdisciplinaire.
Les différents adjectifs qui ont été utilisés pour qualifier la discipline semblent témoigner de cette ouverture tout au long de son histoire, mais à y regarder de près, le recours à la psychologie est à mon avis une fermeture, le recours à l’expérimentation ne faisant qu’ouvrir une boîte de Pandore.
L’idée que la nature humaine est à l’origine de tous les malheurs de l’humanité ne conduit pas forcément à des recommandations de politiques économiques plus pertinentes. Les études comportementales ne peuvent que constater la complexité des comportements. Cela suffit à renvoyer la science économique à sa vieille réputation d’être une science lugubre (dismal science), dans le sens qu’elle s’inscrit dans une vision pessimiste de l’homme (Malthus, 1798). Au lieu d’être tournée résolument vers de meilleures règles facilitant la vie en commun, elle s’enlise dans une introspection stérile de la nature humaine9.
Or, la science économique n’est utile que si elle est une science de l’action dans le sens anglo-saxon (policy oriented). Pour éviter l’étouffement dû à ses partis pris idéologiques et ses dérives scolastiques, elle doit démontrer qu’elle contribue d’une manière significative à améliorer la régulation économique de nos sociétés.
L’opinion répandue dans les débats publics selon laquelle nos économies fonctionneraient mieux sans économistes n’est pas seulement l’expression d’une large méconnaissance de cette discipline, mais rend une fois encore visible la méfiance d’une partie des citoyens. Cette méfiance envers la science économique se nourrit certes d’un « soupçon scientifique » plus généralement émis envers toute science (Ricœur, 1974), mais la science économique est particulièrement visée, car elle ne rend pas assez transparentes ses positions normatives. La rigueur de pensée ne peut être prétexte pour éviter un débat sur les valeurs et les fins de la science économique.
En mettant les politiques économiques à l’épreuve des faits, un problème de méthode redoutable se pose. Ce problème concerne non seulement la vérification empirique de la modélisation proposée au nom de la rigueur scientifique, mais également de la démarche scientifique la plus prometteuse.
Entre des approches déductives et inductives, la science économique préfère les premières. Or, quels sont les faits en économie qui permettent de « tester » une théorie ? Si des positions idéologiques, des intérêts particuliers et des influences culturelles importent, quels faits faut-il sélectionner et sur quelle théorie faut-il s’appuyer pour soutenir une politique économique ? Ces questions relèvent d’un débat méthodologique jamais clos, les réponses ayant varié tout au long de l’histoire de la science et pas seulement en économie (Blumenberg, 2000).
1. Évolution récente de la pensée économique
Quelles sont la nature et la signification de la science économique ? Cette question a été posée, en pleine période de la Grande Dépression, par Lord Robbins10, professeur à la célèbre London School of Economics11. Elle a conduit à une définition largement acceptée aujourd’hui :
« L’économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares susceptibles d’être utilisés différemment » (Robbins, 1932, p. 15).
La relation entre fins et moyens est ainsi définie comme un problème d’allocation des ressources productives et s’étudie par un calcul d’optimisation.
Cette définition remet en question le fondement moral de cette discipline, pourtant voulu par son fondateur Adam Smith. Ses Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (Smith, 1776) sont complémentaires à sa Théorie des sentiments moraux (Smith, 1761). Elles portent en germe la dispute sur la nature et la signification de la science économique que reprendra Robbins deux siècles plus tard.
Dans quelle mesure cette discipline parvient-elle à dissocier l’analyse objective de son contenu normatif et idéologique ? Aujourd’hui, il est courant de la traiter à la fois comme scientifique et normative, sans trop se soucier des critères de délimitation. Pourtant, le progrès de la science économique a porté sur le développement de méthodes largement empruntées aux sciences naturelles, en écartant de son champ d’analyse tout un courant de pensée qui s’interrogeait sur la justice sociale. Or, les questions de distribution des revenus et des fortunes se sont développées dans le sillage d’une interprétation de la science économique en tant que science morale12, l’économie étant considérée comme une science et la justice distributive comme une idéologie. L’économie est donc aujourd’hui souvent étudiée pour elle-même, soigneusement séparée de ses implications normatives.
Pourtant socialiste dans sa jeunesse, Robbins devint, après la Guerre, membre de la Société du Mont-Pèlerin13 fondée par des militants libéraux pour lutter en pleine guerre froide contre l’idéologie collectiviste. La science économique a été pleinement mise au service d’une cause. Elle devint largement « économie politique » dans le sens où elle mélangeait à nouveau l’objectivité scientifique aux croyances idéologiques. Dans cette optique, l’économie ne serait scientifique qu’aussi longtemps qu’elle sert la cause défendue par la Société du Mont-Pèlerin.
Le courant principal de la discipline s’inspire aujourd’hui de cette conception, tout en revendiquant à nouveau une séparation entre science et normes, entre rigueur et croyances et entre modélisation et récit descriptif. Il conduit à une compréhension tronquée de la doctrine libérale, réduite à la seule dimension économique.
La promotion du marché est la conséquence logique d’une étude de l’économie en tant que mécanisme d’optimisation. Le lien avec la démocratie, autre institution libérale, mais cette fois-ci dans le domaine politique, n’a pas besoin d’être pris en compte. Au pire, la démocratie apparaît comme un obstacle au bon fonctionnement des marchés (Fitoussi, 1998).
Paradoxalement, la prétention du courant principal de la science économique d’être le plus rigoureux laisse de côté tout effort de fournir à l’économie des instruments de mesure et de planification. Un torrent de littérature en témoigne14. De toute évidence, la définition de l’économie chère à Robbins ne permet pas de trancher entre « marché » et « plan ». Les deux peuvent être compris comme des mécanismes allouant des ressources productives. Seul le recours à une approche normative, notamment quant au régime de propriété de ces ressources, permet de distinguer l’un de l’autre.
En réduisant la doctrine libérale à une économie de marché, le courant principal de la science économique s’est également éloigné de l’observation, même sommaire, de l’organisation économique de nos sociétés contemporaines. Cette organisation comprend le marché, l’économie publique, l’économie solidaire et les activités au noir qui représentent une catégorie difficilement saisissable. Tous participent d’une manière ou d’une autre à l’effort productif.
En abordant les pratiques économiques actuelles dans toute leur diversité, nos sociétés contemporaines ont toutes adopté une économie mixte où l’économie publique, le tiers-secteur15 et l’économie au noir contribuent également à la création de la valeur ajoutée. Ces différents secteurs ont certes un poids différent d’un pays à l’autre, mais si le marché était si supérieur, pourquoi l’organisation économique de nos sociétés, qui s’est décantée lentement ou parfois brutalement de l’expérience du passé, est-elle si diversifiée aujourd’hui ?
Une réponse est sans doute que, sans cette diversification, l’économie de marché pure ne serait pas fonctionnelle. Elle a besoin d’être enchâssée dans des pratiques sociétales. Plus que jamais, nous avons donc besoin d’un enseignement pluraliste et non pas d’enseignements qui ne font que transmettre le courant principal.
Les différentes facettes de cette organisation mixte ont des fondements théoriques différents. Elles ne peuvent donc pas être analysées exclusivement par le prisme du marché. Elles se sont décantées lentement et reflètent un processus d’apprentissage « par tâtonnement » et expériences du passé, plus que des références théoriques immuables.
Enfin, la science économique, si elle n’est mise qu’au service d’une idéologie qui réduit le libéralisme au marché, contribue à discréditer toute forme de régulation publique de la vie économique et finit par ériger le marché autorégulateur* en dogme. Elle manque donc son objectif principal qui consiste à proposer des politiques économiques plus pertinentes que celles qui existeraient si la science économique ne s’était pas développée.
Ce développement a bel et bien eu lieu. Il a transformé sans cesse la science économique. Tantôt il l’a modifiée à l’intérieur de son courant principal. Tantôt il s’est inspiré d’autres courants et disciplines. On est donc loin de la caricature fournie par les membres militants de la Société du Mont-Pèlerin, qui ne comprenaient la science économique que dans une optique dogmatique. Une doctrine libérale issue des Lumières n’a pas besoin d’agitateurs, mais d’économistes qui la mettent en pratique et qui ne cherchent pas querelle idéologique en son nom.
2. Innovations dans la recherche économique dominante
Le courant principal a connu plusieurs apports qui sont peut-être le mieux documentés dans un article publié par un collectif d’économistes qui ont sélectionné les vingt meilleures contributions parues dans l’American Economic Review à l’occasion du centenaire de ce prestigieux journal (Arrow et al., 2011). Il n’y a pas eu développement continu, mais une contribution importante tous les cinq ans en moyenne16.
Il est frappant de constater que la dernière choisie date de 1981 et porte sur la volatilité des prix de titres financiers échangés en bourse. Nous sommes maintenant en 2019. Pendant plus de 38 ans, aucun progrès notable de la science économique n’est donc enregistré par cette revue scientifique phare de la discipline. Est-ce que cela signifie que la science économique s’enferme sur elle-même et que dorénavant, elle n’a qu’à répéter inlassablement que « le marché a toujours raison »17 ?
Cela pourrait être vérifié sans doute par d’autres revues de référence (dites de catégorie A, B, etc.). Le résultat ne serait pas fondamentalement différent. Le constat est affligeant : le courant de pensée et l’approche méthodologique dans lesquels se situe aujourd’hui la quasi-totalité de la recherche et de l’enseignement d’économie n’ont pas progressé. Jusqu’à quand va-t-on persévérer sur cette voie sans issue ? Même la crise économique et financière de 2008, qui a secoué le monde et dont les conséquences se font encore sentir pour le commun des mortels, n’a pas permis d’ouvrir de nouvelles voies.
Au lieu d’une mise en question, les projets de recherches continuent à explorer les mêmes sujets comme si rien ne s’était passé. Certes, il y a un changement : on constate un désintérêt croissant pour la théorie, remplacée par un déluge d’empirisme facilité par la disponibilité de données massives, notamment de panels. La science économique est devenue une sous-discipline de la statistique. Elle cherche refuge dans une science auxiliaire pour affirmer son statut scientifique selon des critères qu’elle ne fait qu’emprunter ailleurs.
Le biais américain et néoclassique18 des articles retenus est également frappant, ce qui s’explique certainement par le comité d’experts choisis.
Une explication triviale est que d’autres économistes qui ont façonné la discipline, et que nous présenterons par la suite, n’ont pas publié dans l’AER, et qu’en général le biais idéologique, pris durant la guerre froide, a d’emblée écarté des économistes s’occupant du développement (Hirschman, 1958), de la coopération sociale (Simon, 1947) ou du comportement humain (Kahnemann et Tversky, 2000).
La domination américaine continue à influencer la science économique. Pour contrer d’autres doctrines, comme l’école de régulation française, le modèle scandinave ou encore l’économie de marché sociale allemande, il a fallu promouvoir une seule approche montrant « scientifiquement » la supériorité du marché (… et de l’économie américaine !). Il vaut la peine de reprendre quelques articles retenus pour montrer le chemin idéologique suivi. Je les présente succinctement dans un ordre chronologique pour retracer l’évolution de la pensée économique vue par son courant principal19.
2.1. Modélisation de la production
Le premier article retenu, paru en 1928, concerne l’offre globale et propose une fonction de production « Cobb-Douglas », appelée selon ses auteurs (Cobb et Douglas, 1928). Cette fonction est devenue une référence incontournable et continue à influencer notre compréhension du lien entre les ressources productives « travail » et « capital ». Elle est commode pour la modélisation, car elle est compatible avec l’hypothèse idéalisée de la concurrence parfaite et permet de se faire une idée sur les facteurs fondamentaux régissant la croissance économique.
Cette fonction de production a été critiquée par ceux qui lui reprochent de ne pas tenir compte des variables comme les ressources naturelles ou la qualification professionnelle, et plus récemment de l’information ainsi que plus généralement des différentes formes du progrès technique. Ces critiques n’ont pas réussi à détrôner cette référence. Cette fonction de production est tellement conforme à la modélisation dominante qu’elle incarne à elle seule le parti pris idéologique à peine caché de ce type de modélisation : la croissance économique doit tout à la concurrence parfaite.
2.2. Individualisme
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation de l’information dans la société a fait l’objet d’une publication (Hayek, 1945). Après la folie meurtrière, le besoin de réfléchir sur un ordre économique rationnel se faisait pressant. Sur le plan de la logique pure, cela paraît simple. Si nous étions parfaitement informés, notamment sur toutes les ressources productives, et si nous pouvions raisonner à partir de préférences données, cet ordre se définirait facilement. Il est le résultat d’un simple calcul d’optimisation dont serait capable un individu rationnel.
Pour qu’il puisse s’appliquer également au niveau sociétal, il faut se servir d’une hypothèse supplémentaire : la société ne serait composée que d’individus sachant eux-mêmes ce qui est dans leur intérêt. Il se pose donc immédiatement un problème d’agrégation : les décisions économiques prises au niveau collectif ne sont que le résultat des décisions individuelles.
Cette affirmation est en parfaite conformité avec la façon dont les différents systèmes économiques ont été comparés durant la guerre froide : l’économie de marché promeut la liberté individuelle tandis que l’économie planifiée la supprime au nom du collectif. On oublie dans les deux cas que l’économie devrait être non pas une fin en soi, mais un moyen au service du « vivre ensemble ».
2.3. Inégalités sociales
Pour « vivre ensemble », il ne suffit pas d’être économiquement efficace, encore faut-il être socialement juste. En 1955 paraît l’article de Simon Kuznets sur le lien entre la croissance économique et les inégalités de distribution des revenus (Kuznets, 1955).
Cet auteur a fourni un travail de pionnier en recensant de longues séries statistiques de la croissance économique tout en les mettant en relation avec un indice captant les inégalités de distribution des revenus. Il a ensuite illustré cette relation à l’aide d’une courbe qui porte toujours son nom. Cette « courbe de Kuznets » montre qu’au fur et à mesure que la croissance économique par tête augmente, les inégalités augmentent également, mais seulement dans un premier temps. Elles diminuent ensuite.
Cette corrélation statistique suggère que la croissance économique à elle seule finit par réduire les inégalités distributives, une suggestion qui est à l’origine des recommandations de politiques, non seulement dans le domaine économique proprement dit, mais également dans celui du développement, du social et plus récemment de l’environnement. Cette dernière extension est peut-être la plus surprenante, car elle affirme sans vérification statistique concluante que la poursuite de la croissance économique conduirait à la longue à une diminution de la pollution (Gill et al., 2017) ! La foi du charbonnier est requise.
2.4. Financement de la firme
En 1958 parut le troisième article influent (Modigliani et Miller, 1958). Ces auteurs ont formulé un théorème selon lequel la valeur d’une firme serait indépendante de son financement par des fonds propres ou étrangers. Autrement dit, le degré de son endettement ne détermine pas sa valeur boursière.
Ce résultat théorique a ouvert la porte à la compréhension actuelle du secteur financier. Basée sur une modélisation rigoureuse, mais malheureusement trompeuse, elle a contribué à justifier des pratiques culminant dans la recherche par certaines grandes banques d’un taux de rendement des fonds propres de 25 %, voire plus, négligeant toute évaluation sérieuse des risques ainsi courus.
Pour réaliser un tel résultat, il faut que l’endettement exerce un effet levier considérable. Si aujourd’hui le régulateur cherche à imposer aux banques des fonds propres plus élevés, c’est évidemment pour réduire cet effet et les risques liés à l’endettement, afin qu’il ne soit pas à nouveau contraint d’intervenir pour éviter la faillite du système financier international. Ce n’est pas le théorème de Franco Modigliani et Merton Miller qui justifie cette régulation, mais la leçon tirée de la dernière grande crise financière de 2008.
La conception de la science économique comme « science de l’action » se trouve la mieux servie par une approche pragmatique. Certes, la modélisation est nécessaire pour analyser le financement d’une firme ou d’une banque sur le plan théorique, encore faut-il comprendre ses hypothèses sous-jacentes, ses limites et sa portée réelle. En fait, la pratique des affaires est également riche d’enseignements pour la conduite d’une politique.
2.5. Zone monétaire
Une zone monétaire optimale a été étudiée théoriquement par Robert Mundell qui est l’auteur le plus cité (Mundell, 1961), malgré le fait que d’autres économistes ont eu aussi des idées à ce sujet avant lui (Lerner, 1944). Durant mes études, j’ai suivi des conférences de Robert Mundell à l’Institut universitaire des relations internationales à Genève et j’ai eu l’impression d’un génie mal compris, parfois plus soucieux des innombrables règlements à respecter pour rénover sa villa en Toscane que de la clarté de ses exposés.
La création de la zone euro a suivi une logique plus politique qu’économique. En tout cas, les vieilles querelles idéologiques entre monétaristes et keynésiens étaient au rendez-vous. Robert Mundell est monétariste, tandis qu’Abba Lerner prône une combinaison de politiques monétaire et budgétaire dans une optique keynésienne. Entre la vénération du marché et les conditions d’unification restrictives exigées par une autorité publique, c’est toute la croyance en une faisabilité politique qui est en jeu. Dans le premier cas, ce sont les arguments de la science économique dominante qui priment. Dans le deuxième, c’est la politique qui fixe un objectif d’unification en se servant des arguments économiques. Au fond, l’enjeu porte sur la primauté de la politique sur l’économie et la naissance de la zone euro en est bien l’illustration.
Une zone monétaire optimale exige la création d’une seule banque centrale, ce qui implique l’abandon des politiques monétaires nationales. Une des conséquences immédiates est l’installation d’un régime de change fixe entre les pays membres, qui ne peuvent plus compter sur une variation du taux de change de leur monnaie en cas d’évolution disjointe de leurs économies. Afin de compenser ce manque, la mobilité parfaite des facteurs de production à l’intérieur de la zone monétaire devient indispensable.
Les conflits très présents à l’heure actuelle liés surtout à la libre circulation du travail en sont les conséquences. Ils peuvent conduire à des majorités politiques qui revendiquent le retour à des monnaies nationales dont les taux fluctuent librement, mais comme les flux économiques internationaux fonctionnent en vases communicants, cette revendication entraverait forcément les courants d’échange de biens et services à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone euro. On voit que cette pesée d’intérêts reste clairement affaire de la politique et non pas de l’économie.
2.6. Inflation – chômage
Dans la même veine, un autre article retenu, paru dans la même décennie, thématise le rôle que joue la politique monétaire dans le lien entre inflation et chômage (Friedman, 1968). Si, à court terme, une politique monétaire laxiste ayant recours à la planche à billets réussit peut-être à réduire le chômage au risque de raviver l’inflation, elle est sans effet sur l’emploi à long terme. Le taux de chômage serait donc « naturel », sans que cet article précise clairement ce qu’il faut entendre par ce terme.
Cet article contient moins une explication du fonctionnement du marché du travail qu’un credo : une politique monétaire active n’a pas d’effet sur l’économie réelle à long terme, mais se traduit par une variation nominale du niveau général des prix. Pendant des décennies, ce credo du monétarisme a marqué le comportement de nombreuses banques centrales jusqu’à ce que la crise financière mette brutalement fin à la politique simpliste qu’il avait inspirée. La crise a obligé les banques centrales à changer leur priorité. Au lieu de se concentrer sur la lutte contre l’inflation, elles ont soudainement pratiqué une expansion monétaire massive afin d’éviter l’effondrement du système financier international.
Cela ne fit pas taire les monétaristes, qui continuèrent à s’alarmer plus de l’inflation que de la montée du chômage. La conséquence de cette attitude ne se fit pas attendre : dans de nombreux pays, ce fut la montée du populisme estampillé au sceau de l’extrême droite. Des participants à l’Assemblée annuelle de l’American Economic Association à New York en 1978, qui avaient ovationné Milton Friedman, presque aucun n’avait probablement imaginé une telle conséquence, mais bon nombre militaient pour la pensée néolibérale, en affichant une grande fierté scientifique. Dans la salle, je me sentais bien seul.
2.7. Principal agent
Au cours de la décennie suivante, la recherche économique fut marquée par la volonté de sortir petit à petit des modèles binaires de la guerre froide et de s’ouvrir sur des problèmes posés par le fonctionnement réel des marchés. L’article phare qui thématise les problèmes liés à des informations asymétriques en économie est paru en 1973 (Ross, 1973). Ces problèmes se posent dans de nombreux domaines et concernent la relation entre un « principal » et un « agent », comme entre un acheteur et un vendeur censé être mieux informé. Ils éclairent des marchés du point de vue organisationnel et stimulent encore aujourd’hui des recherches en économie industrielle.
Cette théorie montre les conflits d’intérêts qui rendent le marché moins efficace, notamment dans des situations où un « principal » (par exemple un actionnaire) poursuit des objectifs différents de ceux d’un « agent » (par exemple un gestionnaire ou un employé).
Elle s’avère également fertile pour comprendre le marché sous l’angle des coûts de transaction. Toute relation organisationnelle entre « principal » et « agent » engendre des coûts. Parmi plusieurs formes d’organisation, celle qui engendre le moindre coût est la plus susceptible d’être retenue. La logique propre à la science économique est ainsi préservée, mais elle ne suppose plus un marché en équilibre par les seules forces de l’offre et de la demande et fait place à des « faiseurs de marché » qui constituent des bataillons d’intermédiaires destinés à faire fonctionner l’économie. Ces « faiseurs de marché » se manifestent par un nombre croissant de consultants, de distributeurs, de juristes et de gestionnaires. Cette augmentation des coûts de transaction liés « à la rencontre de l’offre et de la demande » nous éloigne du monde parfait des marchés. Elle a d’ailleurs stimulé l’étude approfondie de la concurrence imparfaite.
2.8. Rentes et privilèges
Dans la même perspective, l’article d’Anne Krueger paru en 1974 thématise la recherche de rentes (Krueger, 1974). De nombreuses décisions économiques cherchent à échapper à la concurrence et visent des privilèges et des positions d’influence. Le clientélisme voire la corruption généralisée en sont la conséquence. Ces pratiques ont forcément un coût pour la collectivité en termes de bien-être matériel. Elles profitent à des individus ou à certains groupes sociaux tout en en lésant d’autres, sans être au service de l’intérêt général.
Les décideurs de politiques économiques ont plusieurs options pour combattre ces pratiques. Ils sont invités à choisir les instruments qui minimisent ces coûts. En augmentant entre autres la sécurité du droit, ils renforcent notamment le marché compris comme un univers contractuel. Sans le respect des contrats, l’économie ne fonctionne pas d’une manière efficace.
La sécurité du droit exige que la relation contractuelle entre un vendeur et un acheteur soit transparente. Elle se trouve affaiblie en situation d’informations asymétriques : des informations pertinentes sont unilatéralement retenues pour défendre des rentes, ce qui induit le plus souvent des acheteurs en erreur, victimes qu’ils sont de tentatives de manipulation par un marketing omniprésent.
Plus généralement, cet article démontre que des mesures incitatives, conformes au marché, sont préférables aux contrôles directs. Sans aucun doute, il a orienté la science économique à nouveau vers la politique.