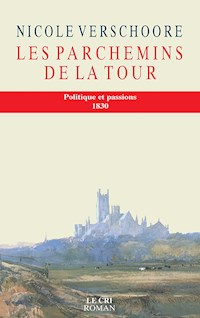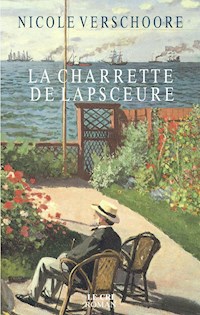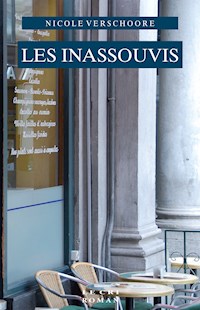Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Récits d’apparence anodine qui, en quelques phrases assassines, rappellent les questions et la réflexion de l’être en devenir dans un monde trop humain : faut-il s’intégrer ? comprendre le mystère des victimes ? le mal et le bien faits à autrui ? la raison et le but des comportements ?
Grâce au silence de la solitude, mais aussi au rire, découvrons ici avec un personnage central l’efficacité libératrice d’une candeur plus tout à fait innocente…
À PROPOS DE L'AUTEURE
Nicole Verschoore, née à Gand en Belgique, est docteur en philosophie et lettres, anciennement boursière du Fonds national belge de Recherche scientifique, assistante à l’université de Gand. Elle publie régulièrement dans diverses revues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'ÉNIGME MOLO
DU MÊME AUTEUR
CHEZ LE MÊME ÉDITEUR
Les Parchemins de la tour,roman, 2004
Le Mont Blandin,roman, 2005
Vivre avant tout !,nouvelles, 2006
La Charrette de Lapsceure,roman, 2007
CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
Le Maître du bourg,Gallimard, 1994 (rééd. 2000)
Nicole Verschoore
L’Énigme Molo
Nouvelles
Catalogue sur simple demande.
www.lecri.be [email protected]
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
© Le Cri édition,
Av Leopold Wiener, 18
B-11170 Bruxelles
ISBN 978-2-8710-6663-7
En couverture : Léon Spilliaert,Kursaal, 1 janvier 1909(détail).
© Sabam Belgium 2009.
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
L’ÉNIGME MOLO
Première partie
I
Nous étions en 1945.
Les rues étaient désertes, les enseignes rares, la publicité si modeste qu’il fallait passer sur le trottoir pour distinguer le dessin et lire le texte. Le cinéma était réservé aux adultes, et les enfants, s’ils ne faisaient paspour la familleune course dans le voisinage immédiat ou prenaient le chemin de l’école, ne s’aventuraient pas seuls en ville. Cela ne se faisait pas. Pour prendre un tram ou un train, il fallait une grande occasion, et on y allait en groupe. À la maison, les adultes représentaient le monde. Comme il y avait peu à voir à part l’itinéraire quotidien de la lumière, la saison des arbres du boulevard, les moineaux qui picoraient dans le bas et les pigeons qui salissaient les toits et les gouttières, les adultes étaient notre théâtre. L’enfant n’avait pas le droit à la parole — sauf urgence. J’écoutais donc, j’observais. Côté théâtre, il y avait les parents et les grands-mères. Côté public : ma sœur et Émilienne.
Émilienne ?
À Bruxelles, on appelaitservantela bonne à tout faire, et le terme faisait exactement l’affaire pour Émilienne. Elle faisait tout. Elle remplaçait maman qui, du matin au soir, comme papa, était occupée dans l’affaire.
Une chance pour nous d’ailleurs, car Émilienne, bien qu’adulte, n’était pas une adulte. Elle ne comptait pas. Mieux encore et bien plus important pour ma sœur et moi, elle ne se comportait pas en adulte. Elle savait trop bien ce qu’il fallait penser d’eux et nous disait toutes ses pensées.
Là aussi, elle était seule de son espèce, car avant l’âge des leçons de choses doctement enseignées par maman, gentiment par papa et délicieusement par nos grands-mères, les enfants ne devaient pas tout savoir, pas tout entendre. Au sujet de certaines choses, subitement, les adultes se taisaient. Ils réservaient leurSavoirpour les confidences qu’ils se feraient au bureau ou, selon l’heure, dans leur chambre à coucher.
Émilienne, par contre, distribuait royalement ses opinions. Nous étions toujours fourrées à la cuisine — l’expression était dénigrante et venait de maman. Ou à l’étage. Il y avait pas mal à apprendre pendant qu’Émilienne faisait les chambres. Et nous riions beaucoup… Elle était tout sauf subalterne de nature.
Qu’elle n’aimât pas Molo, nous le comprenions. De son côté, elle savait que nous adorions notre grand-mère. Elle n’attaquait donc jamais Molo, mais ne cachait pas pour autant combien sa présence l’énervait.
Molo ?
Il y avait deux Molo, la nôtre, et celle des adultes, cellequi dérangeait tout le monde. Notre Molo était une fée, elle nous apprenait des tas de choses, nous faisait la lecture, nous aimait, ne disait que ce qui nous faisait plaisir. Si elle nous réprimandait, c’était pour notre bien. Elle l’expliquait longuement, avec notre façon de voir et de penser. Pour que tous ces miracles opèrent, il fallait être chez elle, sans parents.
À la maison de nos parents, pour nous aussi il était évident que Molo ne se tenait pas comme il aurait fallu. Elle n’était pas prudente. Elle se croyait experte en toutes sortes de matières alors qu’elle ne l’était pas. Elle ne comprenait pas maman. Elle ne connaissait pas l’art d’amadouer les adultes. Elle n’avait pas, comme nous, appris à mentir et à louvoyer.
Papa s’énervait quand sa mère entrait dans son bureau. Elle venait l’ennuyer avec ses histoires de rien du tout. Régulièrement, il la mettait à la porte. Nous la savions alors, debout, immobile et muette, exilée dans le couloir. Nous ne l’approchions pas, nous nous cachions, ignorant comment faire pour la distraire de sa terrible excitation. La scène était toujours pareille. D’abord, nous entendions la voix de notre père, on aurait pu croire qu’il criait. Papa ne criait jamais.Il haussait le ton. Le ton de l’autorité. Crier, c’était pour les faibles, pour les victimes. La victime, en l’occurrence, était Molo. Nous l’entendions, de la voix haute et perçante des femmes qui se défendent. Ensuite, papa reculait son fauteuil pour se lever, les pattes glissaient brutalement sur le parquet. Il y avait des pas. Nous entendions claquer la porte. Et puis, silence. Le corridor n’était pourtant pas désert. Molo devait s’y trouver derrière la porte refermée.
À certaines époques, papa lui défendait même l’accès à la maison. Bien que maman n’affectionnât pas non plus sa belle-mère, elle était plus coulante. Elle laissait entrer Molo —oui, les enfants sont là. Mais ils travaillent.Ce travail n’était pas très sérieux, nous n’étions qu’en classes élémentaires. Ma sœur aînée lisait déjà. Moi non. J’écrivais encore entre deux lignes.
Maman se laissait prendre par une sorte de pitié, bien malgré elle. Molo n’y pouvait rien si elle était ce qu’elle était, Paul — notre père — l’avait mise à la porte, d’accord, mais quand même. Molo était un être humain.
— Je les appelle. Montez au salon. Elles descendront.
Les enfants habitaient sous les combles, et trop d’escaliers essoufflaient Molo.
De son côté, maman, oubliant que nous étions témoins de la scène, amèrement et longuement se plaignait de Molo à sa mère. Le faisait-elle, au contraire, sciemment ? Pour que nous puissions, nous aussi, nous mettre à détester Molo ? Les deux femmes se jalousaient l’une l’autre, je le sentais, mais n’en comprenais pas l’origine.
Ce que maman racontait à sa mère était toujoursépouvantable.Maman n’inventait rien, tout était vrai. Nous savions qu’elle souffrait à chaque visite de Molo. La belle-mère s’adressait à notre mère comme à une subalterne totalement crétine. Or, selon maman, c’était Molo la demeurée. Papa partageait cet avis. D’habitude avare lorsqu’il s’agissait de louer autrui, il ne tarissait pas d’éloges concernant notre mère, posant son épouse en exemple pour l’organisation du ménage, ses méthodes, ses talents culinaires — alors qu’elle n’était jamais à la cuisine — et l’économie de sa gestion domestique. De Molo, par contre, il n’avait que le contraire à accuser.
Il n’ignorait pas que notre grand-mère ne pouvait s’abstenir de visites quotidiennes. Elle se croyait l’aînée, destinée à faire des recommandations aux jeunes. Il s’agissait de méthodes ménagères et de la façon dont maman nous habillait, nous nourrissait et nous éduquait. Mon enfant, disait Molo à maman, il faut… et le conseil qui suivait, selon le rapport que maman en faisait à sa mère, était stupide,une fois de plus typique pour cette sorte de bourgeoisie arriérée qui n’a jamais mis elle-même la main à la pâte. L’expression était compliquée, mais elle revenait souvent. À Molo, maman rétorquait toujours à peu près la même chose : elle avait eu des parents modernes, tous deux enseignants déjà avant la première guerre. Sa mère lui avait appris tout ce qu’il fallait savoir pour la santé des enfants, et pour leur éducation. Elle avait eu des frères, avait fait des études comme eux. Ses filles jouiraient du même modernisme, il préparerait leur avenir. Les initiatives de notre mère étaient irrémédiablement à l’encontre de celles de Molo, et Molo avait oublié qu’elle n’avait plus droit au chapitre. Nous aussi connaissions sa façon d’inspecter la cuisine, le panier à linge sale, les seaux à la cour, et ses commentaires,idées désuètes,conseils inutiles.
Notre bonne Émilienne appelait Molo laTouche-à-tout.
Quand nous parlions de Molo avec Émilienne, nous l’appelions aussiTouche-à-tout.
Molo énervait Émilienne à la faire éclater. Émilienne le manifestait vigoureusement dans son dos, les poings à la taille, la bouche ouverte et la tête battant de droite à gauche comme le métronome du piano de notre mère. La Touche-à-tout inspectait l’odeur des toilettes ! Posait des questions que d’innombrables fois déjà elle avait posées ! Vérifiait avec le thermomètre de cuisine la température des chaudrons de linge qui chauffaient sur les réchauds ! Pas croyable, la température de la lessive, ça se voit et ça se sent, faut pas de thermomètre ! Et derrière le dos de notre grand-mère, Émilienne se retournait pour lui tourner le dos, faisant le geste de soulever ses jupons pour honorer le mêle-tout par le salut de ses fesses. C’était une insulte ahurissante, dont nous avions saisi la signification dès sa première apparition. Heureusement, Émilienne, fort experte en la matière et manquant de temps, ne faisait qu’esquisser la manœuvre, les jupes étant redescendues lorsque Molo se détachait des chaudrons. La façon d’éclater d’Émilienne différait donc sensiblement de celle de maman, ainsi que des violents rabrouements de papa. Nous apprîmes ainsi, par l’expérience des fesses d’Émilienne, l’efficacité libératrice de la vulgarité populaire, ainsi que celle des paroles. Quand Émilienne voyait arriver Molo, elle marmonnait, soi-disant pour elle, en réalité pour que nous l’entendions :
— Voilà la tourte qui s’amène.
Sur ce, nous pouffions de rire.
Parfois, elle y ajoutait une réflexion :
— Pas étonnant que vot’ mère soit sur ses nerfs. Une pareille tourte. On n’en fait pas deux comme ça. Moi, je ne tiendrais pas le coup.Excuse pour vot’ père,ajoutait-elle, sibylline.
Quand maman se lamentait, nous devinions ce qui la chagrinait. Nous avions toujours assisté à une scène. Notre grand-mère maternelle essayait d’apaiser sa fille, jusqu’à plaider en faveur de Molo. Les conseils de Molo n’étaient pas vraiment des critiques déguisées, expliquait-elle, la belle-mère croyait bien faire, pour le bien des enfants. À ce point, maman se rebiffait, sa jérémiade changeait de ton. Non, elle ne croyait pas aux bonnes intentions de Molo. Un après-midi, pour prouver qu’il ne fallait pas y croire, elle répéta une histoire que j’avais déjà entendue à une autre occasion, me consolant à l’idée que j’en avais mal saisi le sens. Cette fois-ci, c’était clair.
Molo n’avait pas de cœur, s’indigna maman, ni pour sa belle-fille, ni même pour un de ses petits-enfants, moi en l’occurrence.
Maman reproduisit l’histoire que je n’avais pas voulu comprendre. Elle reviendrait régulièrement, comme tous les méfaits de Molo.
La voici : quand je n’avais que quelques jours et que maman avait voulu me mettre dans les bras de Molo, pour que la grand-mère puisse serrer contre son cœur le nouveau petit être qui remplissait mes parents de joie et de tendresse, après quelques instants Molo m’avait rendue à maman, disant :
— Reprenez-la. Je ne veux pas m’attacher à cet enfant. Elle va mourir.
Je n’avais donc pas mal entendu.
Je n’y comprenais rien.
Ce fut difficile d’oublier ce rejet de Molo, maman répéta la scène à intervalles réguliers, chaque fois qu’elle ressentit le besoin de se plaindre. Bien malgré moi, la scène du bébé et de la funèbre prévision resta gravée dans ma mémoire. Chaque fois qu’elle rejaillissait, je me rappelais à l’ordre. Il fallait oublier cette histoire, Molo avait changé d’avis. Je n’étais pas morte, j’avais tenu le coup, je vivais. Molo s’occupait de moi comme de ma sœur. Elle m’aimait. De temps à autre, je la surveillais, comparant la façon dont elle m’embrassait à son embrassade de ma sœur, ses éloges de mes dessins à ceux qu’elle distribuait à ma sœur. Il n’y avait aucune différence, mais ce mesurage m’apprit ce qu’étaient les affres de la jalousie. Comme maman continua à répéter qu’au début de mon existence Molo ne m’avait pas regardée avec amour, et que cela avait duré des années, qu’elle ne s’était pas attendrie sur mes faits et gestes, ne m’avait pas fait sauter sur ses genoux et partait en promenade avec ma sœur aînée sans que je pusse accompagner — en effet, dans l’album des premières photos de notre existence, je découvris rétrospectivement une jalousie totalement inutile et ne pus m’en défaire en regardant ma jolie sœur blonde dans la poussette de Molo, sur les genoux ou aux mains de Molo, et moi, noiraude et sans sourire, sur un tricycle seule dans un coin de la cour, ou, seule encore, tripotant avec une pelle et un petit seau dans la terre noire d’une plate bande.
II
— Les enfants vont chez Molo, annonçait maman quand il était question d’une activité qui l’obligeait à quitter la maison.
Nous aimions tant ces après-midi chez Molo que l’habitude fut prise de nous y envoyer régulièrement. Elle habitait de l’autre côté du parc. Nous le traversions en courant, de chez nous jusqu’à sa porte.
Après la guerre, les jouets étaient rares. Les mamans confectionnaient elles-mêmes, avec des restants de tissu, de nouvelles robes pour les poupées de leurs filles. Chez Molo, pas de poupées. Nous recevions d’anciennes revues, chacune une paire de ciseaux, de la colle faite à la cuisine, deux pinceaux et des crayons de couleur. Nous dessinions, colorions, découpions des images que nous collions dans de grands cahiers cartonnés, anciens répertoires ou registres de comptabilité dont Molo avait soigneusement découpé les pages utilisées. Ma sœur avait le sien, moi le mien. Molo se penchait au-dessus de notre épaule pour deviner ce que nous voulions représenter, une histoire ou simplement quelque chose de beau, pourune page artistiquede fleurs et de guirlandes, de papillons et de libellules qui rappelaient les vitraux de ses fenêtres, l’encadrement du miroir sur la cheminée, les frises au-dessus des portes. Les images que nous choisissions nous suggéraient la viedes autres, que nous pouvions imaginer à notre guise. Chez Molo, cette occupation ne s’appelait pas, comme chez nos parents, « inventer des choses qui n’existent pas », phrase chargée de mépris, mais tout au contraire « faire une belle histoire ». Un garçon venait de recevoir un nouveau cartable, une fille pleurait, des oiseaux chantaient mais ne la consolaient pas, il fallait un petit chien qui la fit sursauter. Son frère avait un voilier qui naviguait sur l’étang. De belles dames exhibaient la nouvelle mode et allaient au bal. Des musiciens attendaient le chef. Un clown faisait le pitre… Molo approuvait nos découpures, inspirait nos fantaisies, suggérait la composition de nos pages, et lorsque nos fictions s’arrêtaient sans suite, nous fournissait les sauts nécessaires pour coller l’un à l’autre les épisodes disparates.
La couleur était presque totalement absente de l’imprimé de l’époque. Nous colorions les sujets trop ternes et tracions une portée de lignes pour clore une péripétie ou suggérer le temps qui passe. Travailler à nos albums était un but en soi. Molo ne reprenait la lecture du livre en cours que si notre inspiration faiblissait. Pour le goûter, elle nous faisait de la crème, vanille ou chocolat, dans des petits raviers individuels, munis d’une jolie cuiller.
Après le goûter, la lecture reprenait, et si le livre était terminé avant l’heure de notre départ, nous demandions sonalbum de photos.
— Cela ne t’ennuyait pas d’être photographiée, lui demandions-nous ?
— Mais pourquoi donc ? Votre bon-papa adorait son jardin, nous y étions toujours ensemble.
Molo faisait donc partie du paysage au même titre que l’air qu’elle respirait et que le gazouillis des oiseaux. Elle regardait vers l’objectif et ne faisait rien, sereine et disponible. À huit ans, elle ressemblait déjà auxgrandes