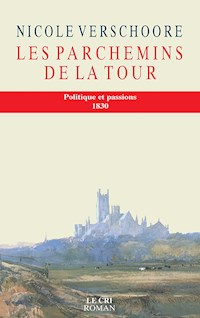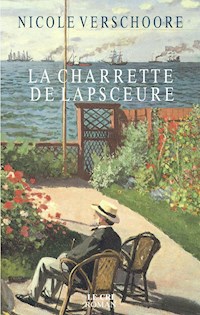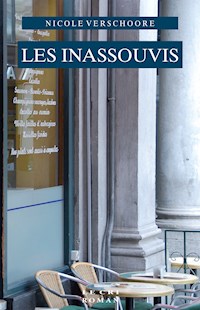
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sur la route du retour, je m'éloignais de son village fantôme. Le ciel reprenait son immense omniprésence. Qu'il fut étoilé ou embrasé par les feux rouges du couchant, il couvrait la vie, vaste, universelle et partagée. Ma voiture n'était plus qu'une coccinelle et je pouvais me perdre dans l'anonymat. Le lendemain s'emparait de ma pensée. Je récapitulais l'agenda, organisais l'emploi du temps, soupesais les promesses du jour, et le courant fragile des choses à venir se remettait en marche. Dans ce mouvement réel d'heures et de jours, le passé n'était pas aboli. Il ne s'était pas détérioré, l'ancien Luis pouvait réapparaître.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Nicole Verschoore, née à Gand en Belgique, est docteur en philosophie et lettres. Boursière du Fonds national belge de Recherche scientifique et assistante à l'université de Gand, dès les années soixante-dix elle opte pour la presse quotidienne et publie toujours, entre autre, dans la
Revue générale.
À Paris,
Nicole Verschoore obtint pour son premier roman
Le Maître du bourg (Gallimard 1994) le prix franco-belge de l'Association des Écrivains de langue française et, en mars 2008, à Bruxelles, le prix Michot de l'Académie royale de langue et de littérature françaises pour sa trilogie
La Passion et les Hommes (Le Cri).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LES INASSOUVIS
Du même auteur
chez le même éditeur
Les Parchemins de la tour,roman, 2004
Le Mont Blandin,roman, 2005
Vivre avant tout !,nouvelles, 2006
La Charrette de Lapsceure,roman, 2007
L’Énigme Molo, nouvelles, 2009
Autobiographie d’un siècle,2010
Ainsi donc, une fois encore, roman, 2013
chez d’autres éditeurs
Le Maître du bourg,Gallimard, 1994 (rééd. 2000)
Nicole Verschoore
les inassouvis
roman
www.lecri.be
ISBN 978-2-8710-6790-0
© Le Cri édition,
Av Léopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
En couverture : Arcadi II (photo © Anne-Catherine Labrique, 2012)
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
J’étais correspondante extérieure pour les pays de l’Est, l’Allemagne et les Pays-Bas, mais je cherchais un emploi fixe de journaliste, décidée à quitter mon emploi à l’université. Le premier août 1972, le rédacteur en chef, Lius De Man, m’invita à Bruxelles. On disait de lui beaucoup de bien – et tout autant de mal. Pendant la dernière guerre, il avait été dans la résistance avec les deux frères de ma mère. Je fus convoquée par politesse, invitée dans l’intention de refuser mes services. J’ignorais ce détail.
La politique extérieure me passionnait. Lius me fit l’aumône de l’espoir, de l’heureuse excitation qui précède les entrevues dont on attend tout.
— Une rédaction n’est pas un endroit pour une universitaire, m’annonça-t-il d’emblée. Vous souffririez trop de l’épouvantable médiocrité de vos collègues.
Il s’était trompé, j’ai mis des années avant de me lasser de ce qu’il avait appelé la médiocrité des gens.
J’essayai de le détromper.
— Je suis robuste, dis-je.
— Naïve, jugea-t-il.
— Pas tant que ça.
Pour mettre fin au dialogue, il appela la secrétaire, la priant de réserver une tableen face. Pour deux, oui, en face. Toujours sans m’associer à ses initiatives, il prit le téléphone et appela un certain Willy, rédacteur en chef d’un mensuel d’art qui ne m’intéressait nullement.
— J’ai ici dans mon bureau une jeune personne assez savante, désireuse de faire du journalisme, annonça-t-il.
Le mépris était à peine voilé. Il m’atteignit comme une flèche empoisonnée. Le type voulait se débarrasser de moi, c’était clair.
— Je veux qu’elle comprenne, enchaîna-t-il, qu’elle ferait mieux de travailler chez toi. D’accord ? Je te l’envoie. Oui, c’est Dominique Carton, oui, qui signe la critique des livres allemands.
— Je vous invite, fit Lius en déposant l’appareil, c’est l’heure du déjeuner.
— Je voulais te donner quelque chose chez mon ami Willy, pour ne pas te renvoyer les mains vides, m’expliqua-t-il quelques mois plus tard, lorsque nous étions devenus amis et complices. J’ai changé d’avis au restaurant. A quoi tiennent les choses…
Qu’il eut changé d’avis au restaurant, je m’en étais rendu compte…
Je portais mon complet vert pomme. Fermée, la veste faisait un effet sérieux. Debout, ma ligne était accentuée par le pli du pantalon. Il n’aimait pas les petites femmes. Lors d’une visite au bureau de Gand j’avais vu qu’il était très grand, du moins pour sa génération. Il avait traité avec condescendance une de nos rédactrices, petite et boulotte. Je mis des haut-talons.
Assise en face de lui, je vis à son regard que le couturier s’était permis d’agréables libertés. La couleur, accueillante comme l’herbe au printemps. La légèreté du tissu, qui épousait la fluidité des gestes. Il faisait épouvantablement chaud, on parlait de 30 degrés à l’ombre. Le chemisier était largement échancré, la veste ouverte.
Puisqu’il ne voulait pas m’embaucher, le chef ne m’interrogea pas sur mes intérêts. Il me raconta d’innombrables histoires sur ses années à l’université de ma ville natale, un ramassis d’anecdotes ennuyeuses. Fort déçue du résultat de ma démarche, je le laissai parler, sans me fatiguer à répondre. La qualité du plat et des vins dépassait de loin mon quotidien. Les libations me grisèrent, je m’entendais rire. L’homme était un convive agréable. Il voulait plaire, c’était évident. J’avais perdu ma prudence habituelle et ne contrôlais plus ce que je disais. Au dessert, je me surpris à le contredire en m’esclaffant, presque méprisante. Je n’avais plus rien à perdre. Puisqu’il parlait de ma ville, je savais des choses qu’il ignorait, deux générations nous séparaient, ses histoires avaient vieilli. Je ne me fis pas prier pour le lui indiquer. Je lui en voulais de m’avoir éconduite. Sa superbe au téléphone !J’ai ici dans mon bureau une jeune personne assez savante…
Je pris amplement ma revanche. Il ne disait plus grand-chose.
En quittant le restaurant, j’avais un rendez-vous pour le lendemain, à 9 heures du matin. Je commençais mon stage à la rédaction.
Mon interlocuteur avait oublié l’horrible Willy.
Trois mois plus tard, je seraisrédactriceà la culture.
Je cachai soigneusement ma surprise et ma joie.
— Mais pourquoi vous appelle-t-on par votre prénom ? lui demandai-je la première fois qu’il me convoqua dans son bureau.
— J’aime mon prénom.
— Personne ne s’appelle Lius, hasardai-je.
— Justement. Je suis unique. Lius est le diminutif de Julius. Jules César. Mon père vénérait la Rome antique. Il n’était pas le seul. Il y a pas mal de Césars et d’Augustes dans nos campagnes flamandes. Le souvenir remonte à la dernière transgression marine de Dunkerque, un peu après l’empereur Claude, qui, comme vous le savez peut-être, la dernière fois qu’il mit le pied en Gaule, fit remarquer que dans nos régions, les traces de ses pas disparaissaient instantanément tant la terre était détrempée. Quelques siècles plus tard, nos terres seraient submergées par la mer jusqu’à Bruges. L’empereur avait vu juste.
J’étais venue dans son bureau pour la page culturelle du lendemain, j’attendais la fin du discours. Ce chef me faisait perdre pas mal de temps.
Il détestait les derniers empereurs au pouvoir, reprit-il. Il ne fallait en aucun cas glorifier l’antiquité.
— N’oubliez pas, conseilla-t-il en sautant du coq à l’âne, que je suis affublé d’un nom de famille impossible, De Man ! L’homme, le Type, l’Individu, quoi. D’accord, il y a eu un De Man célèbre, mais qui se souvient de lui ? Lius va mieux au grand patron que je suis.
Il avait l’air de se moquer de lui-même, et conclut enfin :
— Avec ce diminutif de Julius, je suis non seulement le grand patron, je suis l’Unique !
Il se fichait de son orgueil.
Curieux bonhomme, pensai-je
Ce fut la première série de phrases qui en disaient long sur son caractère. Il les prononçait, pleinement conscient qu’il se rendait odieux, mais que, simultanément, tous comprendraient qu’elles ne servaient qu’à rappeler et affirmer son pouvoir. –Je ne me trompe jamaisétait gentil et inoffensif.–Mon autorité est indiscutable, selon le cas, indiquait qu’il espérait qu’elle le soit, ou qu’il constatait qu’elle l’était.
— Celui qui admet ses défauts, me dirait-il plus tard, n’est pas obligé de s’en débarrasser. On vous les pardonne, car celui qui pardonne se sent meilleur. De l’orgueil, on ne guérit jamais. Tant mieux. L’orgueil est une force.
Pour discuter d’une page, d’un article ou d’un titre, Lius appelait par téléphone. L’automatisme électronique n’existait pas encore, nous avions chacun sur notre table un lourd appareil noir. Lius avait en mémoire les quarante-cinq numéros de nos téléphones et reconnaissait la voix qui répondait. Nous entendions un seul mot :Venir !
La première fois qu’il m’appela ainsi, je crus à une erreur et raccrochai.
— Pourquoi n’êtes-vous pas venue ? me demanda-t-il deux jours plus tard.
— Je n’ai pas compris votre appel, on me l’a expliqué ensuite.
Il ne changea pas pour autant sa façon de m’appeler.
S’il s’agissaitde mettre au point un travail, la discussion dans son bureau n’était pas désagréable.
Par contre, avec les rédacteurs qui l’avaient déçu, il assaisonnait ses entrevues d’injurieuses remarques. De préférence devant témoins.
Lius priait le rédacteur qu’il avait dans son bureaude resterun instant ici.Il prenait alors le téléphone et appelait un de nos collègues. Nous savionsd’avance qu’il venait de convoquerune victime et avait besoin d’un public. Le collègue entrait et s’asseyait – il y avait toujours quelques fauteuils vides devant le bureau du chef, à bonne distance du sien. Son fauteuil derrière le bureau du chef avait acquis un caractère de trône. Le chef vous regardait de haut.
Au malheureux qu’il venait de convoquer, il posait quelques questions qui d’emblée prouvaient ses erreurs, sa bêtise ou l’inutilité de son travail. Pourquoi avait-il jugé nécessaire d’écrire… ? Était-ce judicieux de dire… ?
La première fois que j’assistai à la scène, je fus horrifiée. Qu’on voulût dénigrer et faire souffrir ceux qu’on méprisait, me semblait totalement inutile. Satanique. Pourquoi ce chef ne laissait-il pas sa victime au calme dans son bonhomme de chemin ? Je ne comprenais pas la méchanceté gratuite. J’étais encore très jeune.
A l’étage supérieur, la grande rédaction était une immense salle de bureaux couverts d’un fouillis de papiers et de machines à écrire, les fils électriques descendant du plafond et trainant à terre. On m’avait prévenue que quand Lius passerait, il ne fallait pas se laisser impressionner s’il jugeait nécessaire de faire un commentaire, haut et fort.
Seul debout parmi les vagues de dos courbés, il restait cloué sur place à l’entrée de la salle, sans mot dire. Sa présence à leur étage était rarissime. Mais tous, un moment, paniquaient, s’examinant la conscience. On sentait qu’il était là. Les machines ne s’arrêtaient pas pour autant. Lius s’ébranlait, d’un pas lourd et lent. Carré et raide, il passait sans mot dire entre nos bureaux, les mains négligemment croisées dans le dos. Il balayait d’un regard flou mais fureteur nos machines, papiers, télex et documents à consulter, nos mains sur nos claviers, son éventuel intérêt faussement déguisé par l’indifférence fatiguée de son visage. On n’osait à peine lever les yeux. On l’entendait passer avec soulagement. La honte serait pour autrui. Car en effet, Lius s’arrêtait maintenant à côté de la victime pour laquelle il avait décidé de quitter son fauteuil. Bien qu’il s’agissait de visites éclairs, ses arrêts étaient fatidiques, et ressentis comme tels. Subitement, le silence devenait général. On voulait entendre ce qui s’abattrait sur le malheureux collègue. La salle attendait un grognement deLius. L’incompréhensible murmure était voulu, la victime devait lever les yeux vers lui, l’interrogeant du regard. Alors, subitement, une voix tonitruante arrêtait toutes les machines, plus personne n’affectait de travailler, et la cible du courroux s’aplatissait sur ses papiers. Impossible de disparaître. Le patron étalait ses erreurs au grand jour et le persécutait de questions cinglantes aussi inutiles que perfides. Ce déploiement de force annonçait la fin de la séance. Les collègues se remettaient au travail, certains d’entre eux, savourant le dépit de la victime. Je découvris que la collégialité était une notion assez relative, que nombreux étaient ceux qui se réjouissaient de la malchance d’autrui. Ils ne sont pas doués pour la joie de vivre, pensais-je. J’appris des tas de choses, la vie dans une grande boîte est un monde en miniature. Je redécouvris la frousse de l’école élémentaire, le soulagement del’échapper belle, le désarroi d’autrui… Passant en vitesse pour repêcher un photographe dans un café des alentours, j’avais entendu quelques collègues se tordre de rire. Il s’agissait dela dernière bonne