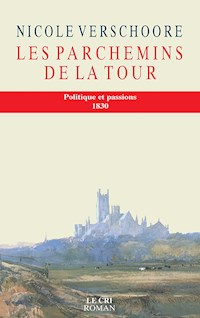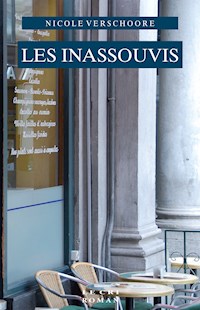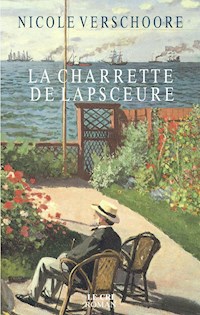
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La Passion et les Hommes
- Sprache: Französisch
Bruxelles, pôle d'attraction en 1900, le port d'Amsterdam, la guerre civile espagnole, l'Afrique du Sud... ne font qu'annoncer le mystère qui plane sur une famille belge. Le silence s'est fait sur l'extrême pauvreté de ses origines en Flandre agricole, après le typhus, la famine, le prolétariat des villes et le choléra du XIXe siècle. Silence aussi sur un désastre inexplicable dont le mot clé est une charrette qui part de Lapsceure... Mais voici la génération de la fin du siècle, l'émigration, le curé en Oklahoma qui sera prélat du pape, le début des luttes sociales, l'école militaire en 1910, quatre fils au front dans les tranchées, la Société des Nations, le Congo. Et à travers ses vies parallèles: le quotidien, la destinée, mais surtout la force de vivre qui dicte sa loi.
La Charrette de Lapsceure constitue le dernier volet de la trilogie
La Passion et les Hommes.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Nicole Verschoore, née à Gand en Belgique, est docteur en philosophie et lettres, anciennement boursière du Fonds national belge de Recherche scientifique, assistante à l'université de Gand. Journaliste, elle publie régulièrement dans la Revue générale et la revue électronique www.bon-a-tirer.com. Parlant six langues et amoureuse des grandes capitales européennes, elle se veut citoyenne du monde et passe le meilleur de son temps à revoir et à sauvegarder la vérité du vécu. Outre ses nouvelles
Vivre avant tout ! (2006), elle a publié aux éditions Le Cri les deux premiers volets de cette
Passion et les hommes :
Les Parchemins de la tour (2004) et
Le Mont Blandin (2005).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CHARRETTE DE LAPSCEURE
Du même auteur
chez le même éditeur
Les Parchemins de la tour, roman, 2004
Le Mont Blandin, roman, 2005
Vivre avant tout !, nouvelles, 2006
Chez un autre éditeur
Le Maître du bourg,Gallimard, 1994 (rééd. 2000)
Nicole Verschoore
La Charrette de Lapsceure
Roman
Catalogue sur simple demande.
www.lecri.be
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de laFédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6665-1
© Le Cri édition,
Av Léopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
En couverture : Claude Monet,
Terrasse à Sainte-Adresse(détail, 1867).
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
Kovsky était hongrois. Né à Vienne en septembre 1880, fils aîné d’un père violoniste de l’orchestre impérial, le gamin reçut son premier violon à l’âge de trois ans. Bientôt seul élu d’une tribu de frères et sœurs, il put suivre son père qui, pour parvenir à nourrir sa maisonnée, entre les répétitions d’orchestre et les concerts, donnait des cours particuliers dans la bonne société de la capitale autrichienne. Il était l’invité de marque des belles et grandes maisons, fort beau, la tignasse noire et luisante, les yeux charbon mystérieux et envoûteurs. Les mères avaient toujours l’un ou l’autre jeune désireux de toucher l’archet.
Le rite était partout pareil. La bonne ou le domestique ouvrait au visiteur, prenait son chapeau et ses gants, attendait que l’invité fasse glisser sa pelisse pour s’en charger et disparaître à la garde-robe sous le grand escalier. Entre-temps la maîtresse de maison apparaissait, descendant le même escalier, l’air parfois sec et distrait, parfois souriant. Parfois même sur le visage quelques traces de langoureuse attente. Elle introduisait le professeur artiste au salon où l’enfant attendait.
À l’âge de cinq ans, fiston Kovsky pouvait assister aux cours particuliers de son père. Il servait d’exemple, il soulageait son père. À huit ans, il jouait juste, à douze on le trouva remarquable.
Après quelques années et plusieurs centimètres de taille, l’exemple avait tant et si bien encouragé les élèves récalcitrants de son père — filles et garçons — qu’il fut sollicité pour égayer leurs fêtes. Il savait boire. Depuis son plus jeune âge il avait vidé les verres des tables non encore desservies. Pendant les adieux un peu longs du père professeur, il passait à l’office. Il y apprit qu’il était beau garçon. Les servantes le trouvaient gracieux. Leurs yeux faisaient office de miroirs. Les jeunes avaient des miroirs clairs, les vieilles, des miroirs sombres et enfumés. L’éphèbe attisait l’envie des goulues, plus gâtées par leurs rêves que par la réalité.
Les Kovsky ne s’appelaient pas encore Kovsky. Ils ne perdraient les deux premières syllabes de leur nom qu’au moment où fiston s’installa à Bruxelles. Il fallait qu’on puisse se souvenir de lui en toutes occasions. Un nom devait être facile à retenir. De plus, il avait compris qu’avec un Z en tête du patronyme il se trouverait partout à la queue des listes. Ce n’était pas son genre.
Lorsque Kovsky eût terminé le conservatoire de Vienne, il parvint à convaincre son père qu’un violoniste débutant devait passer par Bruxelles chez maître Eugène Isaye. D’autres petits Kovsky avaient pris sa relève dans les maisons que fréquentait son père. Qui plus est, dans une famille simple comme celle des Kovsky, les jeunes étaient lâchés sans amertume dès leurs premiers signes d’émancipation. Pour la mère ménagère cela faisait une bouche en moins à nourrir, une place vacante dans les chambrées, la lessive et le repassage allégés.
Gregor arriva gare du Nord à Bruxelles le 3 septembre 1899. Il avait presque vingt ans et portait, à part son violon, un manteau, un chapeau, deux paires de souliers, la seconde dans une petite valise pleine de musiques, de papiers et de quoi écrire, quelques bonnes chaussettes et un lainage. Le reste du nécessaire était coincé dans ses poches : les recommandations de ses professeurs pour son entrée au conservatoire.
Comme Isaye était plus absent que présent, Thomson devint son professeur. Pour vivre, l’élève adulte, comme son père, donna des cours particuliers. Bruxelles n’était pas moins favorable que Vienne. Adulte de taille et d’aspect, Gregor l’était à part entière. Il avait hérité l’œil vif de son père, la bouche cousue et les oreilles en éveil. Beau comme un ange, Gregor eut un succès fou. Un élément totalement exotique. Les bonnes familles de Bruxelles avaient la peau pâle, les yeux clairs et la chevelure diaphane.
Sans doute Grégor ne sut-il pas profiter de son éclat comme il aurait fallu. Les beaux garçons de l’époque se faisaient volontiers passer pour princes russes en voyage. Ils impressionnaient et conquéraient jeunes filles et femmes de tout âge. Qui des deux, les aînées levant les yeux de leur lecture ou les plus jeunes sortant de leurs écoles, rêvaient le plus ardemment de s’expatrier au bras d’un grand de ce monde ? Vivre au loin dans de vastes terres aux horizons illimités, parcourant à cheval des bois immenses et des vallées creuses, et s’arrêtant enfin essoufflées sur la crête de plateaux dénudés où hurlaient les vents déchaînés.
Gregor tira un mauvais lot. Il se maria à 31 ans et eut des fils, se fixa à Bruxelles et y mena une vie honorable et suffisamment honorée puisque ses enfants nés entre 1913 et 1918 survécurent à la première grande déflagration du siècle, à la famine et à la grippe espagnole. Ils purent faire des études qui mirent fin à la tradition familiale — vite oubliée d’ailleurs — dumusicien gagne-pain gagne-petit.
Les enfants et leur mère firent tout ce qui était en leur pouvoir pour oublier leur père.
Que s’était-il donc passé ? Avait-il été infidèle, léger, homme à femmes comme son père de brillante mémoire ? Même pas.
Il était autrichien, donc allemand. Après la guerre, en temps de paix et de ruines, des esprits échauffés par la haine et la revanche l’accusèrent d’espionnage. Il fut arrêté et jeté en prison. Il s’agissait d’une erreur judiciaire, la sentence fut révoquée, le prisonnier libéré. Mais la souillure avait jeté un doute et entaché sa réputation. Il perdit ses meilleurs élèves, et si déjà avant la guerre il avait été difficile d’obtenir la succession de Thomson au conservatoire, cette fois, pour lui, l’avenir se ferma à tout jamais. Ses fils et sa femme le savaient innocent, mais en vieillissant il ressemblait de plus en plus aux étrangers errants venus de l’Est, et la maisonnée le laissa méditer dans son coin, et jouer du violon. Le soir, l’instrument prenait de douloureux accents slaves et orientaux. Les proches du musicien, habitués à ses plaintes nostalgiques, les écoutaient un instant pour se rassurer eux-mêmes. Ils pouvaient partir tranquilles. Bruxelles et la vie les attendaient.
Nous retrouverons un des trois fils Kovsky à la fac de médecine, en 1931.
Albert Kovsky, celui qui jouait du violon dans le trio des oncles sur la photo de la chambre de couture.
Du côté Vermeir, l’ancêtre portait un nom célèbre sans s’en douter. Ses parents étaient de petites gens parmi d’innombrables autres dans un faubourg d’Amsterdam. Il ne leur vint pas un instant à l’esprit de regretter leide la deuxième syllabe de leur patronyme, ce plaisir distingué serait réservé aux générations qui les suivraient. Ils n’étaient pas prédestinés à le deviner, les hommes n’avaient pas eu le temps d’apprendre à écrire. Les femmes lisaient la Bible, cela suffisait. L’honorabilité du foyer était sauve, le travailleur pouvait se distraire au café.
Le fils de cet ancêtre, gosse du quartier portuaire d’Amsterdam peu inspiré par l’ordre établi, n’avait de cesse que d’atteindre l’âge de s’embarquer pour les Indes, embauché par une des compagnies aux noms prometteurs. En mer, il passa depetite mainàmain à tout faire, resta à terrelà-baset y réussit fort bien, de sorte qu’il revint richissime à vingt et un ans.
Il prit femme et déménagea à Bruxelles au moment où son aînée eut l’âge d’être policée dans une des grandes écoles pour demoiselles. Dans l’attente du prince russe.
Il dut y avoir un prince russe qui fit la cour à la mère Vermeir et à ses filles, à l’aînée et à celles qui suivirent. Une des filles, plus jeune et donc plus naïve que ses sœurs, ne connaissait pas encore le stratagème qui consiste à attiser les ardeurs d’un mâle en se mettant à l’abri de ses assauts. Elle tomba enceinte. Ce fut l’horreur, la malédiction. Elle fut envoyée en Italie. Ce qui s’y passa n’était pas clair, mais elle fut recueillie par des sœurs de la charité. À Naples, à gauche de la porte de l’hospice de l’Annonciation, une enclave en forme de niche avait été creusée dans le mur et aménagée avec un fond tournant et un petit volet qui se levait dès que le plateau s’activait. Les mères sans ressources ni famille pouvaient y déposer leur nouveau-né. Elles confiaient ainsi l’enfant à la Vierge et aux sœurs. Selon les Napolitains, il aurait une meilleure vie que leur mère.
À son retour d’Italie, la misère n’attendait pas la jeune Vermeir, mais après les accolades et salutations de mise lorsque quelqu’un revenait après une longue absence, l’attitude de ses parents lui apprit qu’elle n’était plus la sœur de ses sœurs ni la fille de sa mère. Elle se consola en continuant ses études. Il y avait moyen de le faire. Dans la capitale belge, une école pour filles venait de s’ouvrir sans bonnes sœurs ni couvent, où de véritables professeurs enseignaient aux filles ce qu’on enseignait aux garçons. C’était inespéré. Elle resterait vieille fille et se vouerait aux tâches de l’éducation.
Le sort en décida autrement, elle rencontra François Louis. Louis était un patronyme. Elle se maria. Madame Louis n’eut pas d’enfant.
Nous rencontrerons François bientôt, chez les ingénieurs en 1931. Sur la photo des musiciens, il est le premier chanteur debout. Il ne faisait pas partie des instrumentistes, il portait le costume bariolé des chanteurs.
Trente ans plus tard, la jeune épouse de François Louis, née Sidonie Vermeir, était devenue une dame respectable. Pas le genre de notre Mamou très moderne. Elle était petite de taille et aimait s’asseoir à ne rien faire. Mamou l’écoutait volontiers, mais s’occupait des enfants entre-temps. Les enfants étaient en réalité les petits-enfants de Mamou, tous déjà aux études. Dans la salle à manger, la table était extrêmement longue, on pouvait y travailler à plusieurs et étaler tous les bouquins dont on avait besoin. Madame Louis était sortie de l’école normale vingt-cinq ans après Mamou. Elle comprenait fort bien que Mamou fasse deux choses à la fois, l’écouter et se lever pour jeter des coups d’œil là où on la sollicitait.
La visiteuse n’avait pas l’autorité naturelle de notre grand-mère.
— J’ai tout appris de lui, affirmait Madame Louis veuve, lorsqu’elle sentait le besoin de parler de son mari. Car chez mes parents les Vermeir d’Amsterdam, rien ne comptait sauf la réussite en affaires et l’épopée de notre père aux Indes. On ne savait rien. Oui, à Bruxelles, nous menions grand train. Mais nous ne savions rien. Tout était fait pour l’apparence. Il y a très bien moyen de vivre ainsi, on brille, tout est joli, les gens ont l’air heureux. Mais ce n’était pas mon genre. J’ai été beaucoup mieux avec mon François. C’était un homme remarquable : bon et très intelligent. Il ne m’a jamais trompée. Je le laissais à ses affaires, mais j’étais toujours là quand il rentrait.
François l’avait gâtée. Ils avaient voyagé. François n’avait plus ni mère ni père ni frère, toute sa famille était décédée. Alors, il avait adopté la mère de sa femme.
—Un homme bon comme pas deux, se rappelait Madame Louis, la larme à l’œil.
François s’était occupé de la mère de son épouse ! Sans qu’elle l’eût demandé. Il en avait pris l’initiative. L’avait invitée, puis installée chez eux lorsque elle n’avait plus su où aller. Depuis les années de sa grande maison, sa mère avait beaucoup changé, et François avait senti en elle un fond meilleur. Il avait fait son éducation, mine de rien. Sa mère était devenue une personne presque bien. La pensée de François avait déteint sur elle, et elle avait remarqué sa noblesse de cœur. Il y avait eu moyen de parler avec elle.
— Elle semblait avoir oublié qu’elle ne m’avait jamais aimée, expliquait encore Madame Louis en changeant un peu de ton. Elle ne débordait pas d’affection, c’était une femme à qui quelque chose manquait : tout était dans la tête et dans les paroles. Elle avait perdu ses gestes mondains d’autrefois, et il n’en restait pas d’autres. Jamais de câlinerie, jamais la moindre caresse, ne fût-ce que pour frôler un beau tissu ou le dessin d’une nappe. Non, rien de ce côté-là, comme si elle n’avait en elle aucun sentiment.Ton contraire accompli, disait François, et c’était exact : moi, tout m’émouvait, je fondais à l’intérieur et je disais ce qui m’attendrissait. François aimait savoir ce que je ressentais. C’était un homme exquis. Elle non, elle ne s’intéressait pas à moi. Mais il y avait moyen de parler des choses et des gens. Elle a eu de belles dernières années. Ses autres filles ne venaient plus la voir.
Les indications de Madame Louis ne tombaient pas dans l’oreille d’un sourd. Ce qui se passait autour de la table basse de l’autre côté de la pièce ne méritait pourtant pas notre attention : un bavardage de femmes — nous pensionsde vieilles femmes. Mamou et son amie avaient la vie derrière elles. La nôtre serait toute différente. Bientôt pourtant, je me surpris à juger mes parents, mes oncles et tantes, mes amies… selon les critères de Madame Louis.
À force d’entendre ses épanchements nous comprenions aussi, sans que cela ne fût exprimé, que la famille Vermeir était déchue, et que par contre François Louis avait assuré à sa femme une vie fort aisée. Nous ne connaissions pas le terme defamille déchue, nous reconnaîtrions la chose plus tard.
Madame Louis s’appelait Sidonie, prénom si ridicule que nous préférions parler d’elle comme de Madame Louis. D’autant plus que les adultes appelaient son mari Monsieur Louis et non François. Mamou, de rares fois, l’interpellait :
— Mais Sido… !
— Oui, oui, Sido ma fille, je vois très bien ce que tu entends par là… Madame Louis parlait de François à tout bout de champ, pour des considérations parfaitement démodées :
—François ! un si brave homme !
—François ! Et si intelligent.
—Il était un génie en affaires bancaires.
—Il ne l’avait jamais quittée.
—Ils allaient en voyage ensemble.
—Il s’était occupé des études du fils de leurs voisins.
Nous ne pouvions pas comprendre qu’on pût aimer ainsi pendant toute une vie. Et continuer à être heureuse rien que d’y penser.
Après la photo de la chambre de couture, François, jeune ingénieur, avait accepté une place à Malines, dans les usines Vyncke qui fabriquaient les meubles en acajou de l’Orient-Express.
— Il pouvait aller chez Solvay, il pouvait avoir la plus belle place du monde. On n’est jamais trop bon, mais qu’il ait refusé une offre pareille ! Il l’a regretté plus tard.
— J’ai fait une erreur, concédait-il parfois.
— Immédiatement après la guerre, poursuivait Sidonie, ma mère nous avait fait venir en Angleterre, mon mari et moi. En 1945. Elle avait passé la guerre là-bas. Le duc d’Atholl chez qui elle résidait était un actionnaire de Solvay. Lorsqu’il apprit que François travaillait chez Vyncke, il voulut l’envoyer chez Solvay. Notre vie aurait été toute différente. Nous aurions vécu à Bruxelles. Ma mère a pleuré pour ce refus de François. Elle voyait bien qu’il était trop bien pour Malines. Naturellement, il s’est rattrapé. C’était un génie de la Bourse, et nous sommes devenus immensément riches.
— Dommage qu’ils n’aient pas d’héritiers en ligne directe, observaient les adultes lorsque Sidonie n’écoutait pas.
Les Vyncke, chez qui François Louis avait pris la direction de l’usine, étaient vaguement de la famille, nous ne savions pas comment parce que notre grand-père ne parlait jamais de sa famille, ni de ses frères et sœurs, ni de ses parents. Nous savions que les frères et sœurs avaient été très nombreux, et que notre grand-père avait dû quitter la maison paternelle très tôt. Se séparer de sa mère… Le lien de parenté avec les Vyncke avait été suggéré par Madame Louis et n’avait éveillé aucune réaction de notre côté. Pour quelle raison obscure connaissions-nous l’histoire de Kovsky, des Vermeir et de Monsieur Louis mieux que celle du père de notre grand-père ? De sa kyrielle de frères et sœurs ?
Notre passé débutait vaguement au mariage des grands-parents, en 1910. La guerre 14-18 était un épisode légendaire, fixé par grand-père lui-même dans un livre de « Souvenirs », que nous avions tous et toutes dû lire à un âge où nous préférions écouter. Son retour des camps allemands fut un temps fort, puis l’éducation des quatre enfants — notre mère, deux oncles et une tante —, les années vingt, les années trente, la réussite des études, et puis, juste avant la Deuxième Guerre : les mariages. L’ensemble manquait de surprises, et le texte était édité en tout petits caractères sur du papier jauni à peine meilleur que celui du journal qui traînait dans le corridor au lever du jour. Tout datait d’avant ma naissance, et j’avais l’impression queleurs vieilles histoiresne me regardaient pas.
Seule Mamou laissa passer des rais de lumière entre les rideaux du silence.
Au mur, dans le minuscule espace entre la porte qui ouvrait sur les toilettes et la fenêtre devant laquelle Mamou cousait à la machine, une photo ne pouvait qu’attirer l’attention des curieux. Elle avait été faite en noir et blanc comme toutes les photos à l’époque, mais aquarellée ensuite de violentes couleurs fort jolies et tout à fait inhabituelles.
— Authentiques, remarquait Mamou. Ils s’habillaient pour paraître excentriques. Je repassais leurs chemises et j’ai confectionné les couronnes.
On y voyait à gauche, en noir et blanc, nos oncles avant leur mariage, étudiants jouant le soir dans des cafés, l’un du piano et l’autre du violoncelle. Kovsky était le troisième, violon sous le menton. Les trois musiciens n’avaient pas été coloriés, ils étaient restés en noir et blanc. À leur droite, un deuxième trio se tenait debout. François Louis faisait partie du groupe de droite, déjà ingénieur mais méconnaissable. Avec deux autres, vêtus pareil, ils formaient un Triojazz et latino« Floret floribus ». Fleurir pour les fleurs. Trois gamins longs et maigres — ou étaient-ce des hommes ? — accoutrés comme des noirs au Carnaval de Rio, ou plutôt comme des blancs déguisés en chanteurs noirs.
— Ils avaient copié tout ce qu’il y avait d’exotique jusqu’aux Antilles, rapportait Mamou dans l’espoir que ses paroles se graveraient dans nos mémoires encore relativement inoccupées.
Tous trois debout face au public portaient des couronnes de grandes fleurs sur le haut du crâne, et les mêmes couronnes, plus grandes et plus touffues, à leur cou. Elles s’étalaient sur leurs épaules, couvraient une superbe chemise bariolée de dessins géométriques et retombaient jusque sous la ceinture d’un pantalon blanc comme en portaient jadis les joueurs de tennis. Ils étaient pieds nus et sautillaient en toutes directions pendant qu’ils chantaient et dansaient, on le voyait aux couronnes qui partaient en tous sens, comme font les jupes des danseuses quand le rythme est rapide.
— Ils chantaient du vif et du drôle, expliquait Mamou.
— Volage ? demandions-nous.
— Un mélange. Ils combinaient du faux jazz américain et de l’espagnol. Beaucoup d’espagnol. Un des trois était espagnol. Celui de droite.
Il n’y avait pas que les guirlandes de fleurs et le chemisier bariolé de dessins géométriques. Les manches étaient courtes, et leurs bras couverts de bracelets ! Comme des filles… Quant au col du chemisier, ils l’avaient laissé ouvert, sans la moindre cravate, et même déboutonné les premiers boutons pour bien montrer leur poitrine. Triomphant (de tant d’audace, pensions-nous), ils arboraient de larges sourires et secouaient des deux mains une sorte de noix de coco en bois qui devait contenir des graines pour rythmer leur chant.
Mamou nous décrivait la photo comme si nous connaissions comme elle le son que produisaient les chanteurs : elle les entendait de mémoire et les suivait du pied, battant déjà la mesure. Ce fut elle aussi qui un beau matin imita Joséphine Baker. Elle officiait à sa machine à coudre qu’elle ne devait partager avec personne et qu’elle quittait toujours comme à regret. Nous vénérions cette machine de Mamou, presque autant que Mamou elle-même. Nous l’écoutions coudre. Le ronronnement des roues et le picotement de l’aiguille racontaient l’histoire de son travail, ses ardeurs et ses arrêts. Nous nous tenions derrière elle. Elle nous entendait venir et nous parlait sans se retourner. Cette fois, sa pensée s’était envolée et Joséphine Baker avait fait intrusion dans la pièce. Se levant de derrière sa machine, dans un élan subit elle fit un bond et demanda, incrédule :
— Vous ne connaissez pas Joséphine Baker ? Toi non plus, Claude ?
L’aînée des cousines portait le nom d’une reine de France. Elle était la fille de l’oncle Frank, au piano sur la photo. Chez l’oncle médecin, il y avait un tourne-disque.
Claude ne connaissait pas Joséphine Baker.