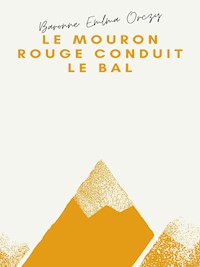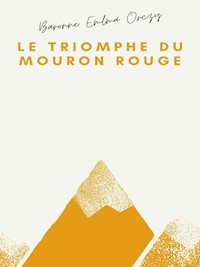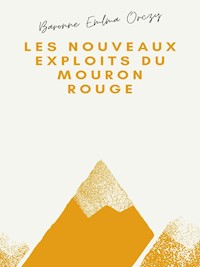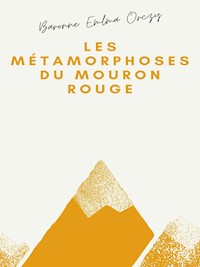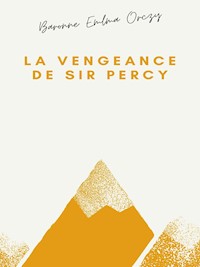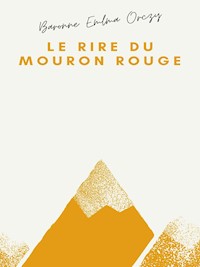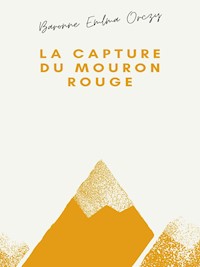
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quatrième épisode des aventures du Mouron rouge. Aux heures les plus sombres de la Terreur, après l'exécution du roi et de la reine, le Mouron Rouge élabore un plan audacieux pour délivrer le dauphin de la prison du Temple. Son pire ennemi, Chauvelin, bien décidé à se venger de ses échecs précédents, va profiter de la faiblesse d'un des membres de la ligue pour tendre un piège à sir Percy...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Capture du Mouron rouge
La Capture du Mouron rougePREMIÈRE PARTIE1. Une représentation sous la Terreur2. Deux points de vue qui diffèrent3. Où le hasard intervient4. Mademoiselle Lange5. La prison du Temple6. L’agent du comité7. Le fils de Louis XVI8. Un marché9. Idylle interrompue10. Espoirs et craintesDEUXIÈME PARTIE11. La ligue du Mouron Rouge12. Où l’amour et le devoir s’opposent13. L’horizon s’assombrit14. Rien n’est désespéré15. La Barrière de la Villette16. À la recherche de Jeanne Lange17. Chauvelin18. Le déménagement19. Il s’agit du dauphin20. L’enlèvement21. Retour à Paris22. L’appel23. La chance tourneTROISIÈME PARTIE24. À Richmond Park25. À l’affût des nouvelles26. L’ennemi27. À la Conciergerie28. Le lion en cage29. Pour le salut du dauphin30. « Le sort de Sir Percy est entre vos mains »31. Projets32. Dans le salon de l’impasse du Roule33. Frère et sœur34. La lettre35. Dernière résistance36. La partie se décide37. Capitulation38. Visite nocturne39. Le dernier message du Mouron Rouge40. À la section du faubourg du Nord41. Le lugubre voyage42. La dernière halte43. Dans la forêt44. Des pas dans la nuit45. La chapelle du Saint-Sépulcre46. Lever de lune47. La Terre promisePage de copyrightLa Capture du Mouron rouge
Baronne Emma Orczy
PREMIÈRE PARTIE
1. Une représentation sous la Terreur
En cette journée glaciale du 27 Nivôse, an II de la République, – ou, comme nous autres, gens de l’ancien style nous obstinons à dire, du 16 janvier 1794, – la salle du Théâtre national était remplie d’une nombreuse assistance, l’apparition d’une jeune actrice en renom dans le rôle de Célimène ayant attiré à cette reprise du Misanthrope tous les amateurs de spectacles.
Le Moniteur, qui relate au jour le jour avec impartialité les événements de l’époque, nous informe qu’à la même date l’Assemblée de la Convention vota une nouvelle loi autorisant ses espions à effectuer des visites domiciliaires et des arrestations sans avoir besoin d’en référer d’avance au Comité de sûreté générale ; l’Assemblée désirant agir avec rigueur et promptitude contre « les ennemis du bonheur public » promettait aux dénonciateurs, comme récompense, une somme de trente-cinq livres « par tête fournie à la guillotine ».
Quelques lignes plus bas, le Moniteur note également que, ce même jour, le Théâtre national fit salle pleine pour la reprise, avec nouveaux décors et costumes, de la célèbre comédie.
L’Assemblée, ayant voté la loi qui plaçait plusieurs milliers de personnes à la merci d’espions et de délateurs, leva la séance, et quelques-uns de ses membres, en quittant les Tuileries, traversèrent la Seine pour gagner le nouveau théâtre tout proche du Luxembourg où la troupe de la Comédie française s’était installée depuis quelques années.
La salle était déjà pleine lorsque les représentants du peuple se frayèrent un passage jusqu’aux sièges qui leur étaient réservés. À leur entrée le silence s’établit dans l’auditoire et, tandis qu’ils avançaient l’un après l’autre dans les étroits passages ménagés entre les fauteuils, ou gagnaient les loges du pourtour, les spectateurs tendaient le cou pour essayer de voir ces hommes dont le nom seul inspirait l’effroi.
Une étroite loge d’avant-scène était occupée par deux hommes qui y avaient pris place bien avant que la salle eût commencé à se remplir. La loge était très sombre, et si ses occupants n’avaient, par son étroite ouverture, qu’une vue incomplète de la scène, ils avaient en revanche l’avantage d’échapper à l’observation des spectateurs. Le plus jeune des deux était sans doute étranger à la capitale, car, au moment où les conventionnels firent leur entrée, il se tourna à plusieurs reprises vers son compagnon pour lui demander à voix basse des indications sur ces personnages pourtant si notoires.
– Dites-moi, Klagenstein, dit-il en appelant l’attention de l’autre sur un groupe qui venait de pénétrer dans la salle, savez-vous quel est cet homme en redingote verte, celui qui porte la main à sa figure ?
– Où donc ?
– En face, près de la porte… Il tient une feuille à la main. Tenez, le voilà qui regarde de notre côté : l’homme avec un menton proéminent, une figure de marmouset et des yeux de chacal. Ne le voyez-vous pas ?
L’autre se pencha sur le rebord de la loge et ses yeux fureteurs se promenèrent sur la salle pleine.
– Oh ! fit-il en découvrant le personnage que lui désignait son compagnon, c’est le citoyen Fouquier-Tinville.
– L’accusateur public ?
– Lui-même ; et celui qui s’assied à côté de lui est le citoyen Héron.
– Héron ? répéta le jeune homme d’un air interrogateur.
– Oui, l’un des principaux agents du Comité de sûreté générale.
– C’est-à-dire ?
Les deux spectateurs se renfoncèrent dans l’ombre de la loge. Instinctivement, pour prononcer le nom de l’accusateur public, ils avaient baissé la voix davantage encore.
En réponse à l’interrogation du jeune homme, son compagnon – homme d’âge moyen, grand, robuste, au visage marqué de la petite vérole – leva les épaules.
– C’est-à-dire, mon bon Saint-Just, que les deux hommes que vous voyez là, consultant paisiblement le programme de la soirée et prêts à goûter les vers de feu monsieur Molière, se valent autant par leur ruse que par leur cruauté.
– Vraiment ! fit Saint-Just. La réputation de Fouquier-Tinville m’est connue. Je sais son rôle au Tribunal révolutionnaire et le pouvoir dont il jouit ; mais l’autre ?
– L’autre ? Je puis vous affirmer, mon ami, que son pouvoir ne le cède en rien à celui de l’accusateur public.
– Est-ce possible ?
– Vous avez vécu si longtemps hors de France que seuls les traits essentiels de la tragédie qui se déroule ici vous sont connus et vous ignorez les acteurs qui tiennent les rôles principaux, sinon les plus en vue, dans cette arène sanglante. Héron est de ceux-là et son pouvoir vient encore d’augmenter aujourd’hui. Étiez-vous à l’Assemblée cet après-midi ?
– Non.
– Je m’y trouvais. J’ai entendu la lecture du nouveau décret que la Convention vient de voter. Les agents d’exécution du Comité de sûreté générale dont Héron est le chef ont, à dater de maintenant, toute latitude pour effectuer des visites domiciliaires et pleins pouvoirs pour agir contre « les ennemis du bonheur public ». Cette formule n’est-elle pas d’un vague admirable ? Nul n’est à l’abri de leurs soupçons. Qu’un homme dépense trop d’argent ou n’en dépense pas assez, qu’il rie aujourd’hui ou qu’il pleure demain, qu’il prenne le deuil d’un parent guillotiné ou qu’il se réjouisse de l’exécution d’un ennemi, en voilà assez pour le rendre suspect. Il est un mauvais exemple pour le peuple s’il est vêtu avec soin, il en est un autre s’il porte des vêtements sales et déchirés. Les agents de la Sûreté générale apprécieront eux-mêmes par quoi se reconnaît un ennemi du bonheur public et toutes les prisons s’ouvriront à leur ordre pour recevoir ceux qu’il leur plaira d’y envoyer. La loi leur donne en sus le droit d’interroger les prisonniers à part et sans témoins et, toute formalité supprimée, de les envoyer directement au Tribunal. Leur devoir est clair : « rabattre du gibier pour la guillotine ». Ils doivent fournir à l’accusateur public des dossiers à dresser, aux tribunaux des victimes à condamner, à la place de la Révolution des spectacles tragiques pour distraire le peuple, et chaque tête en tombant leur rapportera trente-cinq livres. Ah ! si Héron et ses semblables travaillent ferme, ils pourront se faire de jolis revenus. Voilà ce qu’on appelle le progrès, ami Saint-Just.
Ces propos, murmurés du bout des lèvres, étaient accompagnés d’un sourire singulier où se mêlaient le dédain et l’ironie.
– Mais c’est l’enfer déchaîné ! s’exclama Saint-Just. Les gens de cœur ne s’uniront-ils pas pour renverser un gouvernement capable de telles iniquités et sauver tant de vies innocentes menacées ?
Il avait parlé à voix contenue, mais ses joues étaient enflammées, ses yeux étincelaient ; il avait l’air très jeune et très ardent. Armand Saint-Just, frère de Lady Blakeney, avait quelque chose de la fine beauté de sa sœur, mais ses traits n’exprimaient pas la même fermeté, et ses yeux gris avaient le regard d’un rêveur plutôt que d’un homme d’action.
Klagenstein avait, sans doute, noté tout cela tandis qu’il considérait son jeune compagnon avec l’air souriant et ironique qui semblait lui être habituel.
– Il nous faut penser à l’avenir plutôt qu’au présent, mon cher, dit-il d’un ton net. Que sont quelques vies humaines auprès du but que nous nous proposons.
– Le retour à la monarchie, oui, je sais, murmura Saint-Just, mais en attendant…
– En attendant, trancha Klagenstein, chaque victime nouvelle de ce gouvernement inique marque un pas de plus vers la restauration de l’ordre. Seules ces atrocités répétées peuvent ouvrir les yeux des Français. Lorsque le peuple sera dégoûté de ces orgies sanglantes, il se retournera contre les monstres qui le mènent actuellement et restaurera la monarchie avec transports. Voilà notre seul espoir ; et croyez-moi, jeune homme, toute victime arrachée à l’échafaud par votre héros anglais, le célèbre Mouron Rouge, est comme une pierre apportée à l’édification de l’autel de la République.
– Je n’en crois rien, protesta Saint-Just.
Klagenstein, comme pour exprimer son dédain devant un tel manque de clairvoyance, haussa ses larges épaules. Il allait riposter, mais au même instant, les trois coups traditionnels retentirent, annonçant le lever du rideau.
L’agitation du public tomba comme par enchantement ; chacun se carra sur son siège, et l’attention de tout l’auditoire se tourna vers la scène.
2. Deux points de vue qui diffèrent
C’était la première fois qu’Armand Saint-Just revenait à Paris, depuis qu’il l’avait quitté en septembre 1792. Après avoir été, au début de la Révolution, comme tant d’autres, un adepte fervent des idées nouvelles, il s’était aperçu à la longue que ces grands principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui suscitaient chez lui tant d’enthousiasme, étaient exploités par certains pour couvrir l’injustice d’une tyrannie nouvelle. Puis étaient arrivés les jours d’émeute de 1792, la chute de la royauté, les horribles massacres dans les prisons. L’étincelle qu’avait allumée l’enthousiasme des républicains de la première heure était devenue un incendie qui menaçait de tout dévorer. Armand n’avait pas attendu ces derniers excès pour rompre avec son parti. Sa sœur, la célèbre actrice Marguerite Saint-Just, avait épousé un gentilhomme anglais et vivait outre-Manche. Se sentant à Paris impuissant et inutile, Armand s’était décidé à la rejoindre.
Son passage en Angleterre ne s’était pas opéré sans difficultés ni péripéties dramatiques et c’est grâce au Mouron Rouge, l’Anglais mystérieux auquel Klagenstein avait fait allusion, et à la poignée de braves qui le secondaient dans ses entreprises qu’il avait pu échapper à la vengeance des milieux révolutionnaires qui ne lui pardonnaient pas sa défection.
Parvenu sain et sauf près de Lady Blakeney, Armand Saint-Just ne demandait qu’à s’enrôler dans la valeureuse ligue qui avait arraché déjà tant de victimes à la fureur révolutionnaire et à laquelle il devait lui-même son salut. Longtemps, cependant, il s’était vu refuser cette faveur. Le Mouron Rouge ne voulait point sacrifier délibérément la vie du jeune Français, ni même l’exposer à d’inutiles dangers : les Saint-Just étaient très connus à Paris ; le souvenir d’une artiste du talent de Marguerite Saint-Just ne s’efface pas aisément ; son mariage, le revirement politique de son frère les désignaient l’un et l’autre au ressentiment de leurs anciens amis. Les deux jeunes gens s’étaient, en sus, fait un ennemi personnel de leur parent Antoine Saint-Just, jadis prétendant de Marguerite, que son insuccès auprès de sa belle cousine ne disposait certes pas à la bienveillance envers le frère et la sœur. Armand avait donc rongé son frein pendant plus d’un an, sans pouvoir fléchir la résolution de son chef. Enfin, au début de 1794, il avait pu persuader celui-ci de le comprendre dans sa prochaine expédition.
Le but de cette expédition, les membres de la ligue ne le connaissaient pas encore, mais ce qu’ils n’ignoraient point, c’est que des périls croissants les attendaient de l’autre côté de l’eau.
La situation dans les derniers mois avait quelque peu changé : au début, le mystère profond qui enveloppait la personne de leur chef avait été leur meilleure sauvegarde. Mais un coin du voile avait été soulevé. Chauvelin, ancien ambassadeur de la République à la cour d’Angleterre, savait pertinemment que Sir Percy Blakeney et le Mouron Rouge étaient une seule et même personne et Collot d’Herbois, qui avait tenu à sa merci l’audacieux ennemi des terroristes prisonnier à Boulogne pendant quelques heures, avait pu s’en convaincre également.
Cependant, c’est à peine si le Mouron Rouge, depuis lors, avait quitté le sol français. Le régime de la Terreur dominait partout, et, pour sauver tant d’innocents menacés, la petite bande se multipliait avec un enthousiasme jamais démenti.
Qu’on explique si on le veut par le goût du danger l’ardeur avec laquelle ces jeunes Anglais risquaient leur vie pour en sauver d’autres, il n’en faut pas moins admirer que tant de mois d’aventures périlleuses ne les eussent pas encore lassés. Un mot de leur chef, et tous ces jeunes gentilshommes quittaient le luxe de leurs demeures, les fêtes de Londres ou de Bath, certains même femmes et enfants, pour venir se ranger autour de lui. Armand, qu’animait une ardeur semblable, libre en outre de tout lien de famille, pouvait à bon droit réclamer de ne pas être laissé plus longtemps en arrière.
Il n’y avait guère plus de quinze mois qu’il avait quitté Paris et il retrouvait la physionomie de la grande ville tout à fait changée. Une impression de tristesse morne régnait partout, même dans les quartiers les plus animés. Armand ne voyait autour de lui que des figures sombres portant toutes une expression de crainte et d’étonnement, comme si la vie était devenue une énigme effrayante qu’il fallait à tout prix résoudre dans les brefs intervalles qui séparaient les passages répétés de la mort.
Ayant déposé son petit bagage dans le logement modeste qui lui avait été assigné, rue de la Croix-Blanche, sur la pente de Montmartre, Saint-Just était ressorti à la nuit pour faire une promenade solitaire à travers la ville où s’était écoulée toute sa jeunesse. Une heure durant il erra, triste et désemparé, guettant instinctivement l’apparition d’une figure de connaissance. À deux ou trois reprises, il crut entrevoir une silhouette familière, mais déjà, continuant son chemin, le passant qu’il avait cru reconnaître avait disparu dans l’ombre sans regarder à droite ni à gauche. Armand se sentait ce soir-là un étranger dans sa ville natale, dont l’aspect désolé lui glaçait le cœur.
Aussi n’est-il pas surprenant qu’en s’entendant interpeller soudain par une voix joviale, bien que contenue, il répondit avec empressement au salut qui lui était adressé.
– Comment ! Vous ici ? s’exclama-t-il d’un air charmé en faisant face au personnage grand et corpulent qui venait de lui mettre la main sur l’épaule au moment où il allait traverser la place du Palais-Royal.
Cette voix, cette figure ressuscitaient d’un seul coup dans son esprit les réceptions à la fois joyeuses et de bon ton qui groupaient autour de Marguerite Saint-Just les nombreux admirateurs que lui valaient son talent et sa beauté, dans le joli appartement de la rue Saint-Honoré que le frère et la sœur habitaient alors. À ces réunions le baron de Klagenstein, grand amateur de théâtre, se montrait parmi les plus assidus. Ayant passé plusieurs années à Versailles, où il faisait partie de l’entourage de l’ambassadeur Mercy-Argenteau, il était très répandu dans la société parisienne où l’on goûtait sa conversation facile, ses anecdotes amusantes, voire même ses paradoxes. Il discutait volontiers politique, et, au début de la Révolution, se posait résolument en défenseur du passé contre les partisans des idées nouvelles. Il avait eu d’interminables controverses avec les Saint-Just sur ces sujets de brûlante actualité et, plus tard, Armand avait dû reconnaître que, malgré ses exagérations, Klagenstein, somme toute, était dans le vrai. Il se demandait parfois ce qu’était devenu dans la tourmente cet Autrichien que tout désignait à la suspicion des « patriotes ». Sans doute était-il retourné dans son pays. Or, quelque temps auparavant, des émigrés récemment débarqués en Angleterre lui avaient appris que Klagenstein était toujours à Paris. On disait même qu’il avait pris part à une tentative du baron de Batz pour faire évader du Temple la famille royale. La tentative avait échoué, mais les conjurés avaient échappé à toutes les recherches.
Le plaisir qu’Armand éprouvait ce soir-là à retrouver une ancienne connaissance se doublait du fait qu’ils partageaient tous deux les mêmes convictions ; aussi n’eut-il point envie de se dérober lorsque Klagenstein lui dit le plaisir qu’il aurait à passer un moment avec lui pour parler du passé.
– Allons au théâtre, avait-il proposé. Il n’y a pas d’endroit plus sûr pour causer en paix. J’ai tâté de bien des coins et recoins de cette ville actuellement bourrée d’espions et j’en suis venu à la conclusion qu’une petite avant-scène aux Variétés ou à la Comédie est le meilleur abri pour un entretien particulier ; la voix des acteurs et le bourdonnement du public couvrent toutes les conversations individuelles.
Il n’est pas difficile de décider un jeune homme qui se sent perdu au milieu d’inconnus et qu’attend la froide solitude d’une chambre meublée, à passer une soirée au théâtre en compagnie d’un ami. Armand avait bien été prévenu par Blakeney du danger de renouer d’anciennes relations ; mais si une exception pouvait être faite, c’était assurément pour cet homme qui avait prouvé son dévouement à la cause royale. L’invitation fut donc acceptée et la première demi-heure s’écoula agréablement dans la petite loge sombre. Cependant, les paroles prononcées par Klagenstein avant le lever du rideau avaient causé chez Armand un vague malaise et comme un regret de s’être laissé entraîner à la Comédie. Il se tourna donc vers la scène et se mit à écouter les acteurs avec l’air de s’intéresser vivement à la querelle d’Alceste et de Philinte.
Klagenstein ne pouvait que l’imiter, mais, dès que le rideau se baissa, à la fin du premier acte, il se hâta de reprendre la conversation commencée :
– Votre cousin Antoine Saint-Just – vous le savez sans doute – marche la main dans la main avec Robespierre. Quand vous avez quitté la France, il y a dix-huit mois, vous pouviez le traiter de fruit sec et de cerveau brûlé. Actuellement, si vous voulez rester en France, vous aurez à compter avec sa puissance, – et une puissance redoutable…
– Je sais en effet qu’il hurle avec les loups, répondit Armand, il fut un temps où il courtisait ma sœur. Je rends grâces au Ciel qu’elle ait repoussé ses avances.
– Oui, il hurle avec les loups et ces loups sont nombreux. Lorsqu’ils se seront entre-dévorés – mais alors seulement – nous pourrons travailler à restaurer l’ordre ancien dans ce pays. Ce temps, hélas ! n’est pas encore venu. À ces fauves, il faut encore des victimes avant qu’ils se retournent contre eux-mêmes. Comme je vous le disais tout à l’heure, votre ami le Mouron Rouge fait fausse route en leur arrachant leur proie, si ses efforts ont pour but la fin de la Révolution.
Il attendit la réponse du jeune homme et, comme Saint-Just gardait le silence, il reprit lentement d’un ton presque de défi :
– S’il a vraiment pour but la fin de la Révolution.
Cette répétition impliquait un doute. Saint-Just ne put s’empêcher de répondre :
– Le Mouron Rouge n’a pas de buts politiques. L’œuvre qu’il accomplit est toute de justice et d’humanité.
– L’amour des aventures s’y mêle aussi, m’a-t-on dit, glissa Klagenstein avec un sourire.
– C’est un Anglais, dit Saint-Just, et, comme ceux de sa race, il n’aime pas faire étalage de ses sentiments. Quel que soit son mobile, voyez les résultats.
– Peuh ! quelques aristocrates volés à la guillotine.
– Des femmes, des enfants innocents qui auraient péri sans son dévouement.
– Plus innocentes, plus faibles sont les victimes, et plus haut leur sang crie vengeance contre leurs bourreaux. Si quelqu’un avait de l’influence sur cette tête chaude, conclut-il, ce serait le moment de l’exercer.
– Dans quel sens ? demanda Saint-Just réprimant son sourire à la pensée que quelqu’un pût avoir de l’influence sur Blakeney.
Ce fut au tour de Klagenstein de garder le silence. Un instant plus tard, il demanda à brûle-pourpoint :
– Il est actuellement à Paris, n’est-ce pas ?
– Qui donc ?
– Votre Mouron Rouge ?
– Je n’en sais rien.
– Ah ! Votre présence dans la capitale m’avait fait penser le contraire.
– Vous vous méprenez, Klagenstein, répliqua Saint-Just, je suis venu tout seul à Paris et pour mon plaisir.
– Voilà une chose dont je ne me serais pas douté, car vous n’aviez pas l’air précisément folâtre, dans la rue, tout à l’heure, et votre sursaut quand je vous ai accosté…
– Montrait simplement la surprise que me causait cette rencontre inattendue.
– Surprise !… Oui, vous avez pu être surpris de me voir circuler librement dans Paris, après avoir entendu parler de moi, sans doute, comme d’un dangereux conspirateur.
– Il m’est revenu, en effet, que vous aviez fait de vaillants efforts pour permettre aux malheureux prisonniers du Temple de s’échapper.
– C’est exact ; malheureusement ces efforts sont restés stériles et tous mes plans ont échoué. Cependant, vous me voyez ici sain et sauf ; je me promène dans les rues et cause avec mes amis lorsque j’en rencontre.
– Vous avez de la chance, observa Saint-Just.
– Dites plutôt de la sagesse, de la prudence, répliqua Klagenstein. J’ai eu soin de me faire des amis là où ils m’étaient le plus nécessaires… Les richesses d’iniquité… vous comprenez ?
Et il eut un petit rire satisfait.
– Oui, je comprends, dit Saint-Just, avec une nuance d’ironie, vous avez de l’or autrichien à votre disposition.
– Tant que j’en veux, dit l’autre avec complaisance. Une bonne quantité est déjà passée dans les mains sales de certains patriotes. C’est ainsi que j’assure ma sécurité. Je l’achète avec l’argent de l’empereur afin de pouvoir travailler à restaurer le roi de France.
Saint-Just resta un moment silencieux. Sa pensée allait vers l’autre conspirateur, – l’élégant gentilhomme qui dépensait sans compter ses propres ressources pour sauver les malheureux dont les mains se tendaient vers lui.
Sans se douter du parallèle qui s’établissait dans l’esprit de son compagnon, Klagenstein reprit d’un ton amical et confidentiel :
– Nous avançons pas à pas, mais nous avançons, mon ami. Si nous n’avons pas pu sauver la monarchie dans la personne du roi il nous reste encore le dauphin.
– Le dauphin, murmura Saint-Just involontairement.
– Oui, le dauphin, reprit lentement Klagenstein en hochant la tête comme en réponse à ses propres pensées, ou plutôt Louis XVII, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, et dont la vie est la plus précieuse du royaume.
– Précieuse, certes, appuya Saint-Just avec chaleur, et qui doit être sauvée à tout prix.
– Oui, dit Klagenstein, mais pas par votre ami le Mouron Rouge.
– Et pourquoi donc ?
Cette réplique échappée, Saint-Just la regretta aussitôt.
– Ah ! fit Klagenstein en souriant, vous ne savez guère dissimuler, ami Saint-Just. Ainsi donc, ajouta-t-il plus sérieusement, ce noble héros le Mouron Rouge médite d’arracher le jeune prisonnier à la surveillance de ses geôliers ?
– Je n’ai pas dit cela, répliqua Saint-Just d’un ton froid.
– Non, mais c’est moi qui le dis. Je n’ai jamais douté qu’à un moment ou à un autre, votre héros tournerait son attention vers le spectacle le plus émouvant de l’Europe ; l’enfant martyr du Temple. Le contraire m’eût fort étonné. Non, non, ne craignez pas d’avoir trahi des secrets. Quand le hasard vous a placé ce soir sur mon chemin, j’ai deviné tout de suite que vous étiez revenu ici sous la bannière de la petite fleur rouge, et enchaînant les hypothèses, je suis arrivé à cette certitude ; le Mouron rouge est actuellement à Paris pour délivrer le jeune roi de France.
– S’il en était ainsi, vous devriez non seulement vous en réjouir mais apporter votre concours à l’entreprise, dit Armand à qui son ardeur faisait perdre, de nouveau, toute prudence.
– Nenni, mon jeune ami ; l’entreprise dont nous parlons est si hasardeuse, elle est semée de telles difficultés qu’il faut la laisser à ceux qui connaissent à fond la situation. Le Mouron Rouge, malgré toute sa vaillance et toute son habileté, ne la peut mener à bien et une tentative de ce genre faite à la légère, non seulement échouerait, mais détruirait du même coup toutes les chances de succès de ceux qui, depuis longtemps, calculent, travaillent, dressent des plans et mettent tout en œuvre pour réussir.
Saint-Just ne répondit pas. Il était troublé, non pas tant par le sens de ce discours que par le changement de ton de son interlocuteur. La voix de celui-ci s’était faite pressante, persuasive, mais il y avait dans son accent quelque chose qui sonnait faux. Un autre, plus perspicace, se serait demandé si le désir qu’avait Klagenstein d’être le seul instrument de la délivrance du dauphin venait d’un véritable dévouement à la cause du fils de Marie-Antoinette ou s’il était causé par l’appât de la récompense destinée à celui qui ferait franchir au jeune Louis XVII la frontière autrichienne. Mais Armand sentit seulement son malaise s’accroître avec le désir de se retrouver seul.
3. Où le hasard intervient
Le rideau s’ouvre au deuxième acte pour laisser voir Alceste cherchant querelle à Célimène. Sans écouter l’apostrophe rageuse de l’amoureux misanthrope, Saint-Just se leva, cherchant une excuse pour prendre congé de son compagnon. L’eût-il fait deux minutes plus tôt que toute la suite de cette histoire eût été changée. Ces deux minutes décidèrent du reste de son existence. Le dos tourné à la scène, la main tendue, il allait exprimer à Klagenstein son regret de ne pouvoir assister à la fin du spectacle, lorsque, répondant, à Alceste, s’éleva la voix de Célimène :
C’est pour me quereller, donc, à ce que je vois,
Que vous avez voulu me ramener chez moi.
Les paroles d’excuses moururent sur les lèvres d’Armand et, sans achever son geste, il se tourna de nouveau vers la scène.
Qui n’a jamais subi le charme d’une jolie voix ? Celle-ci était d’une qualité particulièrement agréable : chaude, nuancée, son timbre clair et musical émut Armand au point de lui faire oublier les sentiments qui l’agitaient un instant auparavant.
Les répliques que Molière a mises dans la bouche de Célimène sont légères et sans profondeur, mais dites par cette voix charmante, chacune plongeait Armand dans une sorte de ravissement. Machinalement il se rassit et, s’accoudant au rebord de la loge, le menton appuyé dans la main, les yeux mi-clos, il s’abandonna tout entier au plaisir d’écouter.
Rien de ceci n’avait été perdu pour Klagenstein, qui, pour une raison ou pour une autre, ne tenait pas à voir son jeune compagnon lui fausser si tôt compagnie. Il attendit jusqu’à la fin du deuxième acte, puis, comme Armand se renversait sur son siège, le regard perdu dans un rêve, prêt à revivre par la pensée cette dernière demi-heure, il remarqua d’un ton indifférent :
– Mlle Lange est une actrice qui promet beaucoup, ne trouvez-vous pas ?
– Je n’ai fait attention qu’à sa voix, qui est délicieuse.
– C’est aussi une fort jolie personne, ajouta l’Autrichien avec un sourire. Durant le prochain acte, je vous engage, mon cher, à ouvrir les yeux aussi bien que les oreilles.
C’est ce que fit Armand. Vraiment tout en Mlle Lange était en harmonie avec sa voix. Elle était fine, gracieuse, avec une taille souple de très jeune fille dont les paniers bouffants de Célimène faisaient ressortir la sveltesse.
Était-elle vraiment belle ? Armand n’aurait su le dire, les traits de son visage n’avaient pas la régularité classique que d’aucuns jugent indispensable à la beauté ; sa bouche n’était pas petite, son nez n’avait pas une ligne impeccable, mais ses yeux bruns bordés de longs cils avaient un regard velouté, tour à tour spirituel et tendre, bien fait pour enchaîner les cœurs ; ses lèvres, d’un joli dessin, s’ouvraient pleines et fraîches sur des dents blanches et parfaitement rangées.
Mlle Lange était mieux que belle : elle était tout bonnement exquise.
À la fin du quatrième acte, Klagenstein laissa tomber négligemment :
– Vous vous souvenez que j’avais beaucoup de relations dans le monde du théâtre. J’ai l’honneur de connaître personnellement Mlle Lange, et s’il vous plaît de lui être présenté après la représentation…
Une voix murmura-t-elle : « Refuse ! » à l’oreille d’Armand Saint-Just ? Peut-être. Mais la voix mélodieuse de Mlle Lange parlait plus haut que les conseils de la prudence. Durant la fin du spectacle Armand ressentit un étrange frémissement, un désir passionné d’entendre ces lèvres fraîches prononcer son nom et de voir ces grands yeux bruns poser sur lui leur regard caressant.
4. Mademoiselle Lange
Il y avait foule au foyer, lorsque les deux hommes s’y rendirent, le spectacle terminé. Par la porte ouverte ils aperçurent Mlle Lange assise au milieu d’un groupe animé et tout entourée de gerbes et de bouquets offerts par des admirateurs.
Cette affluence ne faisait pas l’affaire de Klagenstein qui, arrachant son compagnon à la contemplation de la charmante artiste, le ramena vers la scène où des hommes de peine démontaient et rangeaient les décors à la lumière mouvante des chandelles. Pendant un moment tous deux se promenèrent de long en large, sans mot dire. Le bruit des conversations venant du foyer allait s’affaiblissant ; les uns après les autres, acteurs et actrices traversaient la scène pour gagner leurs loges respectives afin de dépouiller leurs costumes. Armand et Klagenstein surveillaient cette retraite avec une égale impatience. Enfin, Mlle Lange parut, lançant de joyeux bonsoirs à des visiteurs attardés. Elle portait encore le costume de Célimène à paniers volumineux complété par une perruque bouclée qui cachait sa chevelure, et ce costume raide et encombrant faisait un amusant contraste avec ses manières légères et dénuées d’affectation.
Elle avait dans les bras une grosse gerbe de narcisses parfumés que la lointaine Provence avait dû voir éclore, et Saint-Just pensa qu’il n’avait jamais contemplé plus riant tableau.
Ayant jeté par-dessus son épaule un dernier adieu, elle s’élança dans le passage, toujours souriante. En se trouvant soudain face à face avec Armand, elle s’arrêta court et poussa un petit cri effarouché. Mais déjà Klagenstein s’avançait la figure souriante et la main tendue :
– Vous étiez tellement assiégée tout à l’heure, mademoiselle, dit-il, que je n’ai pas osé me joindre à la foule de vos admirateurs. Mais j’avais un très vif désir de vous présenter en personne mes chaleureuses félicitations.
– Ah ! s’écria Mlle Lange de sa voix de cristal, de quel ciel tombez-vous donc, mon cher Klag…
– Chut !… murmura-t-il en posant un doigt sur ses lèvres, pas de noms ici, je vous prie, belle dame.
– Peuh ! lança-t-elle d’un ton léger, bien que le tremblement de sa voix démentît ses paroles, vous n’avez rien à craindre ici. Il est entendu que les comités ne font pas circuler leurs espions derrière le rideau d’un théâtre. Si acteurs et actrices étaient envoyés à la guillotine, ce serait la fin des spectacles ; et les bons citoyens qui nous gouvernent ne sauraient plus où passer leurs soirées.
Cependant, en dépit de ses paroles légères et de son air enjoué, il était facile de voir que la jeune fille n’échappait pas aux craintes et aux préoccupations communes.
– Ne restons pas ici, continua-t-elle, car on va souffler les lumières ; venez dans ma loge, où nous pourrons causer tranquillement.
Elle leur montra le chemin en s’élançant la première sur un étroit escalier de bois qui prenait au fond de la scène.
Armand, pendant ce dialogue, s’était tenu discrètement à l’écart, un peu embarrassé de son personnage, hésitant sur ce qu’il devait faire ; mais, sur un signe péremptoire de Klagenstein, il suivit la charmante créature qui montait légèrement les marches branlantes en fredonnant une ariette. Elle ouvrit la porte de sa loge et laissa tomber sa gerbe de fleurs sur une table encombrée de pots, de flacons et de mouchoirs de dentelle, puis elle se retourna vers ses visiteurs, un rayon de gaieté dansant dans ses yeux bruns.
– Fermez la porte, cher ami, dit-elle à Klagenstein, et asseyez-vous où vous voudrez, pourvu que ce ne soit pas sur un pot de rouge ou une boîte de poudre.
Se tournant alors vers Armand, elle dit avec une interrogation dans la voix :
– Monsieur… ?
– Saint-Just, pour vous servir, mademoiselle, répondit celui-ci en s’inclinant.
– Saint-Just ? répéta-t-elle, avec un regard surpris, vous n’êtes cependant pas…
– Je suis un parent éloigné du célèbre citoyen Antoine Saint-Just.
– Mon ami Armand Saint-Just, intervint Klagenstein, est fraîchement débarqué d’Angleterre, et n’en a point avisé, je gage, son cousin le proconsul.
– Vous habitez l’Angleterre ? s’écria Mlle Lange. Oh ! parlez-moi de ce pays que j’aimerais tant connaître ! Voyons, Klagenstein, prenez donc un siège, poursuivit-elle avec une certaine volubilité, tandis qu’une teinte plus chaude envahissait son visage devant le regard d’évidente admiration que Saint-Just attachait sur elle.
Elle débarrassa prestement un fauteuil d’un flot de batiste et de dentelles pour l’offrir à son visiteur, puis, s’asseyant elle-même sur le canapé, du regard et du geste elle invita Saint-Just à prendre place auprès d’elle. Elle reprit alors ses narcisses et, s’adossant aux coussins du siège, plongea son visage dans les corolles parfumées.
– Oui, monsieur, parlez-moi de l’Angleterre, répéta-t-elle avec l’expression d’une enfant gâtée qui réclame une histoire.
Vaguement gêné par la présence de Klagenstein, Armand ne savait que dire, ce qui paraissait amuser beaucoup Mlle Lange.
– J’aime beaucoup l’Angleterre, commença-t-il un peu gauchement. Ma sœur a épousé un Anglais et je suis allé me fixer près d’elle après son mariage.
– Dans la société des émigrés ? interrogea Mlle Lange. Comme Armand hésitait, Klagenstein se hâta de dire :
– Inutile de faire de mystère, mon cher ; Mlle Lange compte elle-même de nombreuses relations dans l’aristocratie.
– Mais, bien entendu, dit celle-ci, j’ai des amis partout. Les artistes, à mon avis, ne doivent pas s’occuper de politique, et je ne vous demanderai pas, monsieur, quelles sont vos convictions.
– Mon ami n’est pas un partisan de Robespierre, intervint encore Klagenstein, bien au contraire ; et toute l’admiration qu’il refuse aux « patriotes » de son pays, il la reporte sur un de leurs ennemis, ce fameux héros d’outre-Manche que toute l’Angleterre adore sans le connaître : le Mouron Rouge !
La jeune fille laissa tomber ses fleurs.
– Oh ! le Mouron Rouge ! s’exclama-t-elle en fixant sur Saint-Just de grands yeux ardents. Le connaîtriez-vous, par hasard, monsieur ?
Le front d’Armand se rembrunit. Le plaisir qu’il goûtait à se trouver près de cette charmante créature, à retenir son attention et à éveiller peut-être sa sympathie, était gâté par le discours et les indiscrétions de son compagnon. Pour lui, le nom de son chef était sacré et ne devait pas être prononcé légèrement. Eût-il été seul avec Mlle Lange qu’il n’en eût pas été de même, mais la présence de Klagenstein fit qu’il répondit avec brièveté :
– Oui, mademoiselle, je le connais.
– Vous l’avez vu ? Vous lui avez parlé ? demanda-t-elle vivement.
– Oui, mademoiselle.
– Oh ! alors, racontez-moi tout ce que vous savez sur lui. Vous ne pouvez vous imaginer comme cela m’intéresse ! En France, nous sommes très nombreux à l’admirer. Quelle vaillance ! quelle habileté ! Et comme j’aime ce mystère qui l’entoure et fait de lui un personnage presque fabuleux !
Devant cette explosion d’enthousiasme, Armand sourit, s’abandonnant de nouveau au charme qui émanait de la gracieuse et vibrante artiste.
– Comment est-il ? répétait-elle avec insistance.
– Cela, je ne puis vous le dire, mademoiselle.
– Comment ? fit-elle avec un petit sourire provocant, vous ne pouvez pas me le dire ?… Et si je vous l’ordonnais !
– Au risque d’encourir votre courroux, mademoiselle, je resterais silencieux.
Tout étonnée, Mlle Lange regarda le jeune homme dont l’air grave et résolu contrastait avec les manières timides et un peu gauches qu’il avait quelques instants auparavant. Se retournant vers son autre visiteur, elle s’exclama :
– Hélas ! ne suis-je pas fort à plaindre ? Depuis de longs mois, je brûle d’apprendre quelque chose sur ce mystérieux Mouron Rouge ; le hasard met sur ma route quelqu’un qui le connaît, et ce quelqu’un est assez peu courtois pour refuser de satisfaire ma curiosité !
– Le citoyen Saint-Just ne vous dira rien en ce moment, mademoiselle, dit Klagenstein en riant de bon cœur. La présence d’un tiers l’oblige à la discrétion. Mais peut-être un jour sera-t-il heureux de vous faire partager son enthousiasme, heureux de voir briller vos beaux yeux au récit des exploits de son héros.
Pour toute réponse, Mlle Lange se pencha pour respirer le parfum de ses narcisses, et Saint-Just, à travers les fleurs, devina plus qu’il ne vit deux yeux bruns fixés sur lui avec un regard étonné.
Ce sujet abandonné, quelques propos furent échangés sur le spectacle de la soirée, les acteurs, les nouveaux décors, après quoi les deux hommes se levèrent pour prendre congé.
Le cœur battant, Saint-Just s’inclina pour baiser la petite main de l’actrice.
– Reviendrez-vous me voir, monsieur ? demanda-t-elle.
– Si vous m’y invitez, bien volontiers, mademoiselle.
– Combien de temps restez-vous à Paris ?
– Je puis repartir pour l’Angleterre d’un moment à l’autre.
– Alors venez demain. Je serai chez moi vers quatre heures. J’habite l’impasse du Roule, qui donne dans le faubourg Saint-Honoré, au n°6, la maison avec un balcon.
– J’irai, mademoiselle, avec plaisir.
Cette phrase en elle-même était banale, mais le regard qui l’accompagnait exprimait clairement la joie et la gratitude.
5. La prison du Temple
Il était près de onze heures lorsque les deux compagnons se retrouvèrent à la porte du théâtre. Fouettés par la bise âpre de cette nuit de janvier, ils s’enveloppèrent étroitement dans leurs manteaux et descendirent vers la Seine d’un pas rapide.
Armand avait hâte de se retrouver seul pour revivre cette soirée inoubliable, rêver à celle qui en avait fait le charme, à sa voix exquise et à son regard caressant.
L’émotion joyeuse qui le faisait vibrer n’allait pas sans quelques remords. Armand sentait que, pendant ces dernières heures, il avait agi à l’encontre des instructions de son chef. Tout d’abord il avait renoué un peu inconsidérément une ancienne connaissance. Il venait d’en faire une autre qui l’attirait dans un chemin dangereux ; mais ce chemin était tellement fleuri de narcisses odorants, que leur enivrant parfum eut vite fait d’assoupir sa conscience.
Au pont Neuf, les deux hommes se séparèrent après un bref adieu. Klagenstein poursuivit son chemin le long des quais, passa près de la vieille église Saint-Jacques-la-Boucherie et s’engagea dans la rue Saint-Martin. Sa large figure grêlée exprimait la satisfaction du joueur qui vient de marquer un point sur un adversaire dangereux.
– Ainsi donc, mon beau Mouron Rouge, murmura-t-il entre ses dents, vous voudriez vous jeter au travers de mes plans. C’est ce que nous verrons.
La longue rue était seulement éclairée de loin en loin par la devanture allumée d’un cabaret où quelques citoyens attardés achevaient une partie de cartes. Comme Klagenstein prenait la rue du Temple, une pâle lune d’hiver émergea placide et sereine au-dessus des toits, contemplant la grande ville endormie. Le sol était dur, blanchi par la gelée. À droite, le cimetière des Innocents s’étendait paisible sous le clair de lune ; le givre recouvrait les tertres de gazon et la pierre lisse des tombes. Çà et là une croix brisée dressait ses bras inégaux comme pour faire un appel suprême à la charité humaine et porter un muet témoignage contre la folie de la destruction. Un silence solennel régnait dans le champ des morts ; seul, le vent du nord en secouant les branches des cyprès faisait tomber de leurs aiguilles sombres des perles de cristal semblables à des larmes gelées.
Sans s’attarder à philosopher sur ce spectacle, Klagenstein poursuivit sa route et bientôt il se trouva devant les hautes murailles de la prison du Temple.
Les abords en étaient déserts, mais à l’intérieur un roulement de tambour proclamait la présence vigilante de la garde nationale. Parvenu à la porte principale, Klagenstein glissa un mot à l’oreille de la sentinelle, puis saisissant la chaîne qui pendait le long du vantail la tira énergiquement.
Le son d’une cloche retentit qui se prolongea, répercuté par les murailles de pierre ; un petit judas grillé s’ouvrit et un colloque s’engagea entre un personnage invisible et le visiteur nocturne. Enfin la lourde porte tourna lentement sur ses gonds et livra passage à l’Autrichien pour se refermer aussitôt après.
Celui-ci se trouva sous un passage voûté qui s’ouvrait sur une vaste cour en hémicycle plantée d’arbres. La loge du concierge était immédiatement sur la gauche ; là, nouveau colloque, après quoi, un individu à la carmagnole élimée qui se trouvait à l’intérieur de la loge reçut du concierge l’ordre bref de conduire le citoyen à l’appartement du citoyen Héron.
L’homme prit une lanterne et partit en avant, traînant la savate et faisant sonner d’une manière sinistre le gros trousseau de clefs qu’il tenait à la main.