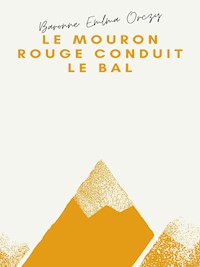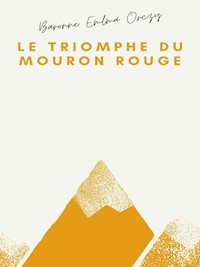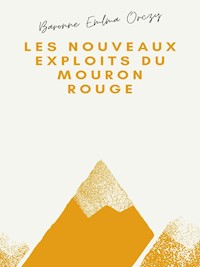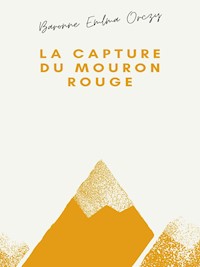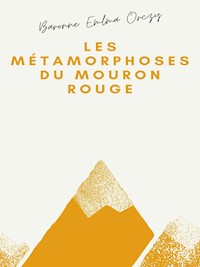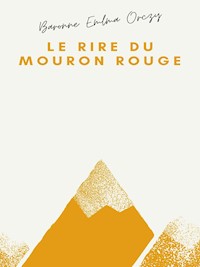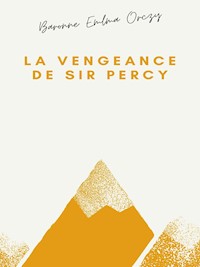
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce cinquième volet des aventures du Mouron rouge nous entraîne dans la campagne du Dauphiné, où d'autres vies sont menacées. C'est là que nous allons découvrir son implacable ennemi, Chauvelin, dans un rôle inattendu...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Vengeance de Sir Percy
La Vengeance de Sir Percy1. L’auberge des Amandiers2. Conciliabule dans une mansarde3. L’anniversaire de Fleurette4. Une visite5. Le vagabond6. Le château de Frontenac7. La perquisition8. La cachette9. Chez Sidonie Tronchet10. Fleurette se confie à François11. Retour dans la nuit12. L’arrestation de François13. Fleurette prend une décision14. Chez M. Duflos15. Le départ de Fleurette16. L’arrivée à Sisteron17. Les aventures du lieutenant Godet18. Rencontre inattendue19. Le père et la fille20. La vengeance de Godet21. Le témoignage d’Adèle22. Premières manœuvres de Chauvelin23. Voyage interrompu24. Sauver Fleurette !25. En prison26. Inquiétudes et soupçons27. Passe d’armes28. La ligue fait parler d’elle29. Chauvelin se débat contre le sort30. Le messager31. Dans la prison32. Le rendez-vous33. Veillée d’armes34. Le tribunal35. Les témoignages36. Face à face37. Déception des patriotes38. Réunion39. ÉpiloguePage de copyrightLa Vengeance de Sir Percy
Baronne Emma Orczy
1. L’auberge des Amandiers
À l’endroit même où l’Hôtel Moderne dresse aujourd’hui sa prétentieuse façade, s’élevait alors une simple maisonnette au toit de tuiles rouges et aux murs blanchis à la chaux. Elle appartenait à un certain Baptiste Portal, vieux paysan dauphinois, qui rafraîchissait passants et voyageurs avec le petit vin suret du pays, ou les réconfortait à l’occasion avec un petit verre d’eau-de-vie. En dehors de cela, Baptiste Portal occupait ses loisirs à vitupérer contre la nouvelle auberge de la Poste qui, disait-il, ruinait son commerce. Lui, Baptiste Portal, ne voyait pas l’utilité de cette auberge, pas plus que celle des chaises de poste. Avant toutes ces nouveautés, les voyageurs se contentaient d’un bon cheval pour patauger le long des chemins boueux, ou de la vieille diligence qui soulevait derrière elle de si beaux nuages de poussière. À quoi bon changer ? Est-ce que le vin des Amandiers n’était pas meilleur que l’espèce de vinaigre que l’on servait à cette fameuse auberge de la Poste ?
La maison Portal s’appelait Les Amandiers à cause de deux arbustes anémiques aux branches tordues qui se couvraient de fleurs pâles au printemps, et de poussière en été. Devant la maison, contre le mur blanchi à la chaux, il y avait un banc de bois sur lequel les clients privilégiés de Baptiste venaient s’installer, les soirs de beau temps, pour joindre leurs critiques à celles du vieux bonhomme sur ces gens du gouvernement de Paris et toutes leurs idées nouvelles.
De cet endroit sur la hauteur, on avait une vue superbe sur la vallée du Buech, puis, au-delà de Laragne, sur les sommets du Pelvoux, tandis que sur la droite se dressait la vieille citadelle de Sisteron avec ses tours et ses fortifications et l’imposante église Notre-Dame. Mais vues grandioses, rivières sinueuses, pics neigeux et forteresses médiévales n’intéressaient pas, à beaucoup près, les clients de Baptiste Portal autant que le prix des amandes et la hausse constante du coût de la vie.
Cet après-midi du mois de mai 1794, comme le mistral arrivant des hauteurs neigeuses du Pelvoux soufflait sans merci à travers la vallée, le froid et la poussière avaient fait rentrer les clients du brave Portal à l’intérieur de l’auberge. La pièce, basse de plafond, ornée de guirlandes d’oignons qui pendaient des poutres en compagnie d’ail, de basilic et autres plantes potagères, et parfumée par l’arôme du pot-au-feu mijotant dans la cuisine, offrait cette atmosphère intime, tiède et odorante qu’apprécie particulièrement tout natif du Dauphiné.
Rien n’aurait marqué ce jour-là plutôt qu’un autre dans la mémoire des clients de Portal si un détachement de soldats, commandé par un officier subalterne, n’était arrivé aux Amandiers en fin d’après-midi.
Ce détachement venait d’Orange avec la mission de rassembler les jeunes gens désignés pour l’armée, et l’aubergiste Portal avait été requis de lui fournir le vivre et le couvert.
Bien sûr, les soldats, en tant que soldats, n’étaient guère en odeur de sainteté auprès des bonnes gens de Sisteron qui fréquentaient Les Amandiers, surtout s’ils venaient chercher les jeunes gens du pays pour en faire de la chair à canon et prolonger cette funeste guerre contre les Anglais, qui était cause du renchérissement de la vie et enlevait tant de bras aux travaux des champs. Mais d’autre part, les soldats, en tant que compagnie, étaient plutôt les bienvenus. Ils apportaient des nouvelles du monde extérieur – mauvaises pour la plupart, il est vrai, mais des nouvelles tout de même. Et si on frémissait d’horreur au récit de ce qui se passait à Paris, à Lyon, et même dans la proche ville d’Orange, il y avait aussi d’amusantes histoires à entendre sur la vie des camps, des plaisanteries, des chansons, bref quelque chose de vivant qui venait animer ce coin perdu du Dauphiné.
Les soldats, comme de juste, occupaient les meilleures places. Ils étaient là une vingtaine, assis coude à coude sur les bancs de chaque côté de l’officier. Celui-ci, autant qu’on en pouvait juger, devait être un lieutenant, car à présent, on ne pouvait distinguer un gradé de ses hommes que par les épaulettes. Ah ! il n’y avait rien de comparable entre ces officiers de la République et les beaux militaires qui commandaient jadis les armées du roi.
En tout cas, ce lieutenant n’était vraiment pas fier. Installé au milieu de ses hommes, il plaisantait et buvait avec eux. Et voilà qu’il invitait maintenant l’ami Portal à boire « à la santé de la République et du citoyen Robespierre, du grand, de l’incorruptible Robespierre ! »
Baptiste n’avait pas osé refuser, parce que les soldats sont des soldats, et que le lieutenant avait pris la peine d’expliquer que si la guillotine ne chômait pas, c’était parce que les Français n’étaient pas tous de bons républicains.
– Nous avons coupé la tête à Louis Capet ainsi qu’à la veuve Capet, avait-il ajouté d’un ton significatif. Cependant il y a encore dans le pays de mauvais patriotes qui souhaitent le retour des tyrans.
Comme tous les vieux paysans du Dauphiné, Baptiste avait appris dans son enfance à adorer Dieu et à révérer le roi. Le régicide lui paraissait un crime impardonnable. En outre, Baptiste était choqué d’entendre nommer « Louis Capet » et « veuve Capet » le feu roi Louis XVI et son auguste épouse. Mais il garda ses réflexions pour lui et termina son vin en silence. Ce qu’il pensait ne regardait personne.
Puis la conversation dériva, et il fut question des aristos et de leur entêtement à se cramponner à la terre qui, de droit, appartient au peuple. Ni Baptiste, ni ses clients ne pouvaient tenir tête au lieutenant sur de tels sujets. N’osant pas discuter, ils se contentaient de branler la tête et de soupirer quand les soldats lançaient de grosses plaisanteries contre de nobles familles estimées de tout le monde dans la région.
Les Frontenac, de Laragne, par exemple. Eh bien ! voilà qu’aux yeux du lieutenant les Frontenac étaient de mauvais patriotes, des tyrans et des traîtres. Le citoyen Portal les connaissait-il ?
Certes oui, Portal les connaissait ; et d’autant mieux qu’il était natif lui-même de Laragne ; mais il ne pouvait imaginer que les Frontenac fussent des traîtres. Comment M. le comte, qui s’y connaissait mieux que personne à dix lieues à la ronde sur la question du bétail et de la production des amandes, pouvait-il être un mauvais patriote ? Et Mme la comtesse qui était la bonté même ? Et mademoiselle, si frêle et si maladive, la pauvrette ?
Là-dessus, le lieutenant admonesta sévèrement Baptiste pour avoir dit « M. le comte » et « Mme la comtesse ». Sacrebleu ! Il n’y avait plus d’aristocrates ni de privilégiés.
– Nous sommes tous maintenant des citoyens de la République et des égaux, conclut-il avec emphase.
Le silence respectueux qui suivit cette déclaration calma un peu le patriotisme agressif du lieutenant Godet. Il voulut bien alors confier à son hôte qu’il était chargé, entre autres missions, de perquisitionner chez quelques ci-devant de la région, et que si la moindre chose compromettante était découverte chez eux, leur compte serait bon. Ce n’était pas pour rien que la Convention avait édicté la loi des Suspects.
Nouveaux hochements de tête et regards interrogateurs.
– Les Comités révolutionnaires ont l’ordre d’arrêter toutes les personnes suspectes, poursuivit Godet, plein de son sujet. Et sont suspects tous ceux qui, par leurs actes ou par leurs écrits, ou par… euh… toute autre chose… euh… éveillent la suspicion.
Cette explication, bien que peu lumineuse, n’en produisit pas moins un effet de malaise, et les clients du père Portal considérèrent leur verre en silence. Au bout de la salle, à côté de la petite fenêtre basse, deux bûcherons prêtaient une oreille attentive. Ils n’osaient se mêler à la conversation, car ils étaient étrangers au pays ; sans doute, des vagabonds désireux de gagner quelques sous en travaillant pour l’un ou pour l’autre. L’un deux était petit et mince, mais vigoureux d’aspect. L’autre, beaucoup plus âgé, avait les épaules voûtées et des cheveux gris dont de longues mèches retombaient sur son front. Il était secoué constamment par une toux déchirante qu’il s’efforçait de dominer à cause de la compagnie.
– Mais, citoyen lieutenant, risqua le brave Portal, à quoi voit-on que quelqu’un est suspect ?
– Si tu es un bon patriote, répondit le lieutenant, tu dois pouvoir reconnaître un suspect n’importe où. Ton devoir alors est de le saisir au collet et de le traîner devant le Comité le plus proche qui le fera aussitôt jeter en prison. Or, mettez-vous bien dans la tête que tous les ci-devant sont suspects.
La façon dont il prononça ces derniers mots fit frissonner tout le monde.
À l’autre bout de la salle, le vieux bûcheron fut pris d’un terrible accès de toux.
– Ah ! c’est la petite Fleurette qui pleurerait s’il arrivait jamais quelque chose à made… aux citoyens du château, dit le vieux Portal en hochant tristement la tête.
– Qui ça, Fleurette ? demanda le lieutenant.
– La fille d’Armand, de Laragne. Vous le connaissez peut-être, le citoyen Armand ?… Mais quoi !…
Ahuri, Baptiste fixait l’officier qui avait éclaté de rire.
– La fille du citoyen Armand, dis-tu ? demanda-t-il quand son accès de gaieté se fut calmé.
– Mais oui, et il n’y a pas de plus jolie fille dans toute la région. Pourquoi le citoyen Armand n’aurait-il pas de fille ?
– Est-ce que les tigres ont des enfants ? rétorqua le lieutenant.
Cette phrase incompréhensible jeta un nouveau froid, et la conversation languit après cela. Même les histoires de la vie militaire que les soldats s’étaient mis à conter avec entrain ne provoquèrent pas beaucoup de rires.
D’ailleurs il se faisait tard. Informé qu’il y avait derrière la maison une assez vaste remise avec quantité de bonne paille, le lieutenant décida que ses hommes s’en contenteraient, et il leur donna l’ordre d’y aller dormir. Lui-même s’était mis à bâiller en disant qu’il espérait bien que le père Portal avait un bon lit à lui offrir. Les clients habituels des Amandiers vidèrent leurs gobelets, payèrent leur écot et sortirent l’un après l’autre dans la nuit.
Le vent était tombé. Plus un nuage. Le ciel bleu sombre était piqueté d’étoiles. La lune ne se montrait pas encore et l’atmosphère était imprégnée de parfums. Une belle nuit en vérité, dans la paix et la douceur de la nature.
La nature se montrait douce et bienfaisante, tandis que les hommes, eux, étaient méchants et cruels. La loi des Suspects ! chaque citoyen convié à espionner et dénoncer son voisin ! Jamais pays civilisé n’avait édicté une loi pareille.
Cette révolution n’était-elle pas la plus belle de toutes celles qui avaient secoué le monde et n’ouvrait-elle point dignement une nouvelle ère de Liberté et de Fraternité ?
2. Conciliabule dans une mansarde
Les soldats étaient maintenant dans la remise et le lieutenant dans sa chambre. Lui, l’officier commandant le détachement, avait droit à dormir dans un lit, qui était en l’occurrence le lit du vieux Portal. Quant au vieux Portal et à sa femme, ils pouvaient s’estimer très honorés de lui avoir cédé leur chambre. Où coucheraient-ils eux-mêmes, le lieutenant Godet s’en souciait fort peu.
Le reste de la compagnie s’était dispersé, chacun regagnant sa demeure. Les deux bûcherons – bûcherons ou charbonniers, ils avaient l’air surtout de vagabonds – avaient été les derniers à quitter l’auberge. Ils s’en allaient d’un pas traînant, car l’un était vieux et l’autre boitait, et tournèrent bientôt dans une ruelle étroite qui menait à la rivière. Cette ruelle était bordée de maisons aux toits débordants entre lesquelles le soleil pénétrait rarement. Des volets vermoulus grinçaient sur leurs gonds rouillés ; une odeur de soupe aux choux et d’eau croupissante flottait entre les murs.
Les deux hommes entrèrent dans une de ces masures et gagnèrent à tâtons un escalier obscur qu’ils montèrent en silence. Arrivé en haut, l’un d’eux ouvrit d’un coup de pied une porte qui gémit sous le choc, et entra, suivi de son compagnon, dans une mansarde au plafond incliné, noirci par les ans. Au milieu de la pièce se dressait une table de bois entourée de trois chaises branlantes et sur laquelle deux chandelles allumées coulaient dans leurs bougeoirs d’étain. Un homme jeune, vêtu d’un manteau de voyage usé, chaussé de lourdes bottes et coiffé d’un tricorne défraîchi, était assis sur une des chaises. Son attitude, les bras allongés sur la table, la tête reposant sur ses bras, montrait qu’il était certainement en train de dormir quand la porte s’était ouverte si brusquement. Le bruit lui fit lever la tête. Alors il s’étira, bâilla, et finalement s’exclama en anglais : Ah ! at last !
L’un des vagabonds, celui qui toussait si fort à l’auberge et qui venait de se redresser, déployant une stature d’athlète, partit d’un rire léger.
– Tony, fainéant que vous êtes, lança-t-il, j’aurais bien envie de vous jeter en bas de l’escalier ! Qu’en dites-vous, Ffoulkes ? Pensez que pendant que nous trimions tous les deux, cet animal de Tony dormait comme une souche !
– C’est cela, jetons-le dehors, approuva son compagnon, qui ne boitait plus et auquel on venait de donner le nom de Ffoulkes.
– Que pouvais-je faire d’autre ? protesta Tony. Vous m’aviez dit d’attendre : j’attendais. J’aurais beaucoup mieux aimé aller avec vous.
– Je ne le crois pas, dit Ffoulkes d’un air de doute, car il vous aurait fallu être aussi sale que Blakeney et moi. Regardez-le : avez-vous jamais vu quelqu’un de si dégoûtant ?
– Parbleu ! s’exclama Blakeney en regardant ses mains longues enduites de poussière de charbon, je ne sais pas vraiment si j’ai jamais été aussi crasseux de mon existence ! Vite, de l’eau et du savon ! commanda-t-il avec un geste impérieux. De l’eau et du savon, ou je meurs !
Tony haussa les épaules.
– Voilà le savon, dit-il. (Et, fouillant dans la vaste poche de son manteau, il en tira un morceau minuscule qu’il jeta sur la table.) Mais, pour ce qui est de l’eau, il n’y en a pas une goutte. On en trouve seulement dans la cuisine que notre respectable logeuse a bouclée pour la nuit. Il ne faut rien gaspiller, affirme-t-elle, pas même l’eau.
– À la bonne heure ! Des gens économes que ces Dauphinois, commenta Blakeney en hochant gravement la tête. N’avez-vous pas essayé des espèces sonnantes ?
– Si fait. Mais mad… pardon, la citoyenne Marteaux m’a regardé de travers et traité d’aristo. Elle m’a même menacé de je ne sais quel comité. Impossible de discuter avec elle car elle empestait l’ail.
– Et quand il y a de l’ail dans l’air, Tony, vous n’êtes plus qu’un fieffé poltron.
– C’est vrai, admit Tony, et c’est pourquoi vous me faites si peur tous les deux en ce moment.
Tous se mirent à rire et puisque se laver était hors de question, Sir Percy Blakeney et Sir Andrew Ffoulkes s’assirent chacun sur une chaise branlante. Leur accès de gaieté terminé, ils passèrent sans plus tarder aux affaires sérieuses.
– Quelles sont les dernières nouvelles ? demanda Lord Tony.
– Ceci, répondit Sir Percy : ces suppôts de Satan envoient des détachements de soldats par tout le pays pour dépister et arrêter les traîtres. Nous savons assez ce que cela veut dire.
– Opèrent-ils déjà par ici ? s’enquit Lord Tony.
– Nous venons d’entrer en contact avec un de ces détachements, répondit Ffoulkes.
– Eh ! oui, dit Blakeney, Ffoulkes et moi venons de passer deux heures en compagnie de soldats débraillés, dans une salle de cabaret où l’odeur d’ail qui parfumait l’atmosphère vous aurait fait fuir. Ma parole ! mes cheveux en sont encore tout imprégnés.
– Est-ce que vous avez quelque chose en vue ? demanda Tony qui connaissait assez son chef pour deviner qu’il avait l’esprit préoccupé en dépit de son ton plaisant.
– Oui, répondit Blakeney. Le détachement qui est logé aux Amandiers paraît s’intéresser d’une façon regrettable à une famille de Frontenac qui m’avait été signalée, et au sujet de laquelle je me suis informé il y a quelques jours, tandis que je voiturais du fumier chez un fermier de Laragne. Sale invention que le fumier, par parenthèse ! Cette famille comprend le père, la mère et une fille infirme. Je me suis arrangé pour rencontrer le comte de Frontenac, un optimiste incorrigible qui se refuse à croire qu’on puisse lui vouloir du mal. Je m’étais présenté comme un agent royaliste au courant des arrestations projetées ; mais il m’a été impossible de le convaincre. J’ai déjà rencontré ce genre d’homme. Un réveil terrible l’attend demain.
Sir Percy garda le silence un instant. Un pli s’était creusé entre ses sourcils. Son intelligence pénétrante et constamment en éveil était déjà au travail, imaginant les circonstances du drame qui allait peut-être se dérouler dans un avenir immédiat : la perquisition, l’arrestation, le jugement sommaire et le massacre de trois innocents sans défense.
– Si sot et si obstiné qu’il soit, je ne puis m’empêcher d’être peiné pour le comte, dit-il au bout d’un moment. Mais c’est la mère et la fille qu’il faut à tout prix soustraire à ces sauvages. Je les ai aperçues. La jeune infirme, petite et chétive, fait pitié ! Je ne puis supporter la pensée que…
Il s’interrompit brusquement. Inutile d’en dire davantage. Ils se comprenaient à demi-mot, ces hommes qui, si souvent, avaient bravé la mort ensemble, dans cette valeureuse Ligue du Mouron Rouge dont le but, en ces temps tragiques, était de secourir les innocents et les faibles. Les deux qui se trouvaient là, près du chef, dans cette mansarde obscure et misérable, étaient ses lieutenants les plus chers. Les autres n’étaient pas loin, éparpillés dans les environs, déguisés, occupés à quelque travail mercenaire afin d’entrer en contact avec les gens du pays ; se cachant dans des cabanes ou dans les bois, épiant, observant, tous aux ordres de Blakeney et prêts à répondre à son appel.
– Tenez, dit Sir Percy après avoir réfléchi un moment, voici, je crois, comment il vaut mieux opérer. La première chose à faire est d’aller trouver Hastings et Stowmaries afin qu’ils avertissent les autres et leur disent que notre centre de ralliement sera la ferme abandonnée des Quatre-Chênes, à un quart de lieue à droite de la route, avant d’arriver à Laragne. Trois de nos camarades s’y rendront et attendront là les instructions que je leur enverrai ultérieurement par Ffoulkes. Ffoulkes va partir tout de suite avec moi, car il faut que je sois de bonne heure à Laragne de façon à commencer demain matin le travail que le sieur Martineau m’a donné à faire dans son bois, à côté du ruisseau. Tony, je compte sur vous pour monter la garde autour des Amandiers, dès la première heure, demain matin, afin d’être au courant des faits et gestes du détachement, et vous viendrez me prévenir dès qu’il se mettra en marche. Ffoulkes me servira d’agent de liaison.
– Alors, dit Ffoulkes, vous pensez que nous pourrions rencontrer des difficultés du côté des Frontenac ?
– Pas du côté des femmes, j’en suis persuadé, répondit Blakeney ; nous les ferons disparaître en temps voulu, et, si le Ciel nous favorise, peut-être aurons-nous aussi la possibilité de sauver quelques objets de valeur. Mais c’est le comte qui m’inquiète avec son extraordinaire incompréhension de la situation. Je suis persuadé qu’il ne bougera pas avant que les soldats ébranlent sa porte. En tout cas, il faut que je trouve le moyen d’aller au château demain dans la matinée. Après quoi je vous retrouverai les uns et les autres aux Quatre-Chênes, vers midi.
Il se leva. Grand et bien découplé, il avait debout une extraordinaire dignité, en dépit de ses misérables vêtements de tâcheron ; dignité qu’affirmaient un port de tête plein de noblesse, de larges épaules et de longs membres vigoureux, mais qui s’exprimait surtout dans l’éclair impérieux du regard sous les paupières lourdes et dans la voix calme et mesurée – cette voix toujours écoutée, toujours obéie.
– Dois-je partir tout de suite avec vous, Blakeney ? demanda Ffoulkes, tandis que Sir Percy, toujours debout, continuait à réfléchir.
– Oui, dit celui-ci. Et au fait, Ffoulkes, une fois à Laragne, et vous aussi, Tony, quand vous serez aux Amandiers, tâchez donc d’apprendre quelque chose sur cette Fleurette dont a parlé le vieil aubergiste. Il a dit que cette fille pleurerait s’il arrivait malheur aux Frontenac, vous vous rappelez ?
– Parfaitement. Il a dit aussi qu’on ne pourrait trouver plus jolie fille dans tout le Dauphiné, ajouta Ffoulkes avec un sourire.
– Son père s’appelle Armand, rappela Blakeney.
– Et le lieutenant l’a traité de tigre, ce qui m’a beaucoup intrigué.
– Cette Fleurette m’a tout l’air d’une aimable jeune personne, commenta Tony d’un air intéressé.
– Aimable ou non, cette jeune personne, amie de la famille Frontenac, pourrait nous être utile. Recueillez donc tout ce qu’il vous sera possible d’apprendre à son sujet.
Sir Percy Blakeney fut le dernier à quitter la pièce. Lord Anthony Dewhurst et Sir Andrew Ffoulkes s’étaient déjà engagés à tâtons dans l’escalier branlant, mais Blakeney demeura un instant sur place, immobile. En cet instant ce n’était plus Sir Percy Blakeney le favori de la société de Londres, mais l’homme audacieux prêt une fois de plus à jeter sa vie dans la balance pour sauver des innocents de la mort.
Cet amour chevaleresque des aventures lui faisait oublier tout le reste : les conforts, les agréments et les joies de l’existence ; tout, sauf la femme exquise qui, le cœur rongé d’angoisse, attendait dans la lointaine Angleterre les rares nouvelles qui lui parvenaient de l’époux bien-aimé, la femme dont le courage dépassait peut-être leur héroïsme à tous.
Sir Percy Blakeney poussa un soupir. Finalement il souffla les chandelles et sortit.
3. L’anniversaire de Fleurette
La maison où Fleurette naquit et où elle vécut les dix-huit premières années de sa vie peut se voir encore sur le bord de la route de Sisteron, tout près de Laragne, simple village niché dans la vallée du Buech. Pour en approcher il faut d’abord suivre le sentier escarpé qui conduit du vieux pont de pierre à la berge, puis remonter une autre pente, et l’on se trouve alors devant la porte de la maison, tout près du petit ruisseau turbulent qui fait tourner le moulin et dont le gazouillis berça l’enfance et la jeunesse de Fleurette.
À présent, la maison tombe en ruine ; les portes et les fenêtres tiennent à peine sur leurs gonds, l’escalier est vermoulu, les murs craquelés, et la petite niche au-dessus de la porte est privée depuis longtemps de la curieuse statuette peinturlurée de saint Antoine de Padoue portant dans ses bras le Divin Enfant. Cependant la vigne vierge grimpe toujours le long des vieux murs ; et dans les branches tordues d’un noyer centenaire, un couple de merles construit parfois son nid.
Mais au moment de la naissance de Fleurette il y avait près de la porte d’entrée un amandier que le printemps couvrait de neige rose. Les portes, les volets étaient peints d’un vert brillant, et les murs, passés à la chaux chaque année, resplendissaient de blancheur. La vigne vierge, à l’automne, devenait cramoisie, et le rosier grimpant n’était qu’une fleur au mois de juin. En mai, le rossignol chantait dans les branches du noyer ; et plus tard, quand Fleurette eut grandi, elle prit l’habitude de fleurir la statue de saint Antoine de Padoue.
Tout cela, bien entendu, était antérieur à la Révolution qui, en quelques mois, avait renversé la royauté, bouleversé les institutions et déchaîné par toute la France ce vent de folie sanguinaire. Fleurette avait juste dix-huit ans lorsque survinrent les dramatiques événements qui allaient menacer sa jeune vie et lui enseigner combien l’homme peut être méchant et cruel, et aussi à quels sommets d’héroïsme et de dévouement il est capable de s’élever.
L’anniversaire de Fleurette tombait au mois de mai, et c’était pour elle un des meilleurs jours de l’année. D’abord elle savait que Pèpe serait sûrement là – Pèpe était le nom qu’elle avait donné à son père dès qu’elle avait commencé à parler. Fleurette n’avait plus de mère, et son père et elle s’adoraient. Comme de juste, Pèpe était venu passer trois jours avec elle au moment de son anniversaire, et il lui avait apporté comme cadeau un ravissant châle de laine, si doux et si duveteux que, mis contre la joue, il faisait à Fleurette l’effet d’une caresse de papillon.
La vieille Louise, qui avait dirigé la maison et pris soin de Fleurette depuis que la mère de celle-ci était morte, avait cuisiné un repas délicieux, ce qui n’allait pas sans peine en ces jours où la nourriture était rare et chère et où les riches, seuls, pouvaient se procurer du sucre, du beurre et des œufs. Mais qu’importe ? quand il s’agissait d’un dîner, la vieille Louise faisait montre d’un véritable génie, et M. Colombe, l’épicier de la Grand-Rue, et le boucher M. Duflos lui avaient accordé tout ce qu’elle demandait – un appétissant morceau de veau, trois œufs, une motte de beurre, et cela sans ajouter à la note un sou de plus. Il restait encore une demi-douzaine de bouteilles de cet excellent vin rouge que Pèpe avait acheté aux jours heureux d’autrefois. Il avait débouché lui-même une de ces bouteilles, et Fleurette après avoir pris deux doigts de ce vieux vin s’était sentie pleine d’allégresse. À cette joie il y avait peut-être une autre raison que nous verrons sous peu.
La dernière partie du repas s’était néanmoins teintée de tristesse, car l’heure approchait du départ de Pèpe, et ce départ, paraît-il, ne pouvait être retardé. Toutes les supplications de Fleurette pour le faire remettre au lendemain avaient été vaines. Dieu seul savait quand Fleurette reverrait son père dont les absences, depuis quelque temps, se faisaient de plus en plus fréquentes et prolongées.
Mais quoi ! le jour de ses dix-huit ans, une jeune fille ne va pas s’attrister à l’avance. La journée avait été parfaite en tous points. Pas un nuage. Comparés au bleu lumineux du ciel, les myosotis qui couvraient la berge du ruisseau paraissaient presque pâles. Les pivoines, derrière la maison, étaient en pleine floraison, et le rosier grimpant était couvert de boutons prêts à s’épanouir.
Maintenant, le dîner avait pris fin. À la cuisine, Louise lavait la vaisselle et Fleurette s’occupait à replacer soigneusement dans leur écrin de cuir les couverts d’argent qu’on avait sortis pour l’occasion. Elle les rangeait sans bruit car Pèpe, la tête appuyée au dossier de la chaise, avait fermé les yeux et paraissait dormir.
Il semblait bien pâle et las, ce pauvre père chéri ; des rides se dessinaient autour de ses lèvres minces, et, depuis peu, les cheveux gris se multipliaient sur ses tempes. Oh ! comme Fleurette aurait souhaité pouvoir le garder toujours près d’elle à Lou Mas ! C’était la seule demeure qu’elle eût jamais connue, ce cher Lou Mas, si joli, si embaumé. Elle entourerait si bien son père de soins affectueux qu’elle finirait par effacer toutes ces rides causées par les soucis. Et qu’est-ce qui pouvait mieux ramener le sourire sur ses lèvres que le vieux mas au toit rouge et aux volets verts, avec sa vue sur le ruisseau du moulin dont les rives, les trois quarts de l’année, étaient couvertes d’une profusion de fleurs : violettes, myosotis et narcisses, au printemps, et ensuite reines-des-prés jusqu’aux gelées d’automne ?
Quant à cette pièce, Fleurette n’imaginait pas qu’il pût en exister de plus agréable et de plus intime. On y voyait un beau buffet de noyer poli comme un miroir, des sièges recouverts d’étoffe cramoisie, et le fauteuil de Pèpe orné d’une bande de tapisserie que Fleurette avait exécutée pour sa fête, quand elle avait douze ans. Et ce beau lustre avec ses pendeloques de cristal, et ces vases bleus aux anses dorées qui garnissaient la cheminée, et les rideaux de perse fleurie, et la nappe à carreaux blancs et bleus qui couvrait la table ? Comme Fleurette aimait ces choses familières ! Si seulement Pèpe retrouvait son sourire, elle se croirait au paradis.
Soudain quelque chose vint altérer cette atmosphère de sérénité. Fleurette ayant replié et drapé son nouveau châle sur ses épaules, s’exclama innocemment :
– Que ce châle est donc joli, Pèpe, et que la laine est fine et douce ! Je suis sûre qu’il vient d’Angleterre.
C’est alors que tout se gâta. D’abord – simple accident – Pèpe brisa le pied du verre qu’il portait à ses lèvres et le vin précieux se répandit sur la belle nappe. Là-dessus, sans raison apparente, car une nappe est vite lessivée et le dommage n’était pas bien grand, il repoussa brusquement son assiette, et sa figure pâle aux traits tirés parut vieillie de dix ans. Fleurette aurait voulu l’entourer de ses bras et lui demander ce qui le tourmentait. Certes, à dix-huit ans, elle était en âge de tout comprendre, et si Pèpe l’aimait autant qu’elle le croyait il trouverait en elle son meilleur réconfort.
Mais quelque chose dans l’expression de son père arrêta Fleurette dans son élan. Elle se remit à sa besogne tout doucement, sans faire plus de bruit qu’une souris, et pendant un bon moment le silence régna dans la jolie salle à manger de Lou Mas, un silence empreint d’une étrange tristesse.
4. Une visite
Pèpe fut le premier à entendre des pas au-dehors. Il tressaillit comme s’il était tiré brusquement d’un rêve.
– Voilà M. Colombe, dit Fleurette.
Pèpe la reprit aussitôt d’un air sévère, ce qui lui arrivait rarement.
– Le citoyen Colombe, rectifia-t-il brièvement.
Fleurette haussa ses jolies épaules.
– Oh ! vraiment…, s’exclama-t-elle.
– Il faut que tu t’y habitues, Fleurette, insista son père avec une gravité inaccoutumée.
Pour toute réponse elle se contenta de poser un baiser sur son front, puis se tourna vers le buffet pour y ranger l’argenterie, mais aussi pour dissimuler la rougeur qui avait envahi ses joues quand elle s’était rendu compte par le bruit des pas que ce n’était pas un, mais deux visiteurs, qui s’avançaient dans le sentier menant à Lou Mas.
Un coup vigoureux fut frappé à la porte.
– Est-ce qu’on peut entrer ? lança une voix joviale et sonore.
Fleurette courut ouvrir la porte en disant :
– Mais oui, mais oui !
Puis ajouta aussitôt d’un air apparemment fort surpris :
– Tiens ! vous voilà aussi, François !
Le brave Colombe était entré dans la salle et abordait Pèpe en disant : « Oui, nous sommes venus pour boire à la santé de Fleurette », mais François, lui, s’attardait sur le paillasson où il essuyait longuement ses bottes comme si son existence dépendait de leur propreté. Il tenait à la main un énorme bouquet de pivoines qu’il tournait et retournait machinalement, mais ses yeux ne quittaient pas Fleurette, et sur sa bonne figure ouverte se lisait une expression de timide adoration.
Il respira profondément et murmura d’une voix enrouée d’émotion :
– Bonjour, mademoiselle Fleurette.
Et Fleurette, essuyant sa petite main brûlante contre son tablier, répondit tout bas :
– Bonjour, François.
François avait tout de même fini de se frotter les pieds et Fleurette put refermer la porte ; après quoi elle tendit la main pour prendre les fleurs que, dans son trouble, il oubliait de lui offrir.
– Ces belles pivoines sont pour moi, François ? demanda-t-elle.
– Si vous voulez bien les accepter, mademoiselle Fleurette, répondit-il.
Elle avait dix-huit ans, et lui, tout juste vingt. Ni l’un ni l’autre n’avaient quitté plus de quelques heures ce petit coin perdu du Dauphiné où ils avaient vu le jour, elle dans la petite maison aux volets verts, lui au-dessus de la boutique de la Grand-Rue où son père, Hector Colombe, vendait de la chandelle et du sucre, du vinaigre et des lentilles, depuis le jour où il avait été d’âge à aider son propre père dans le même commerce. Enfants, ils avaient fait ensemble des pâtés de sable au bord du ruisseau, et François se faisait un devoir de protéger Fleurette contre les redoutables ennemis qui l’effrayaient parfois, tels que le chien du boucher, les oies de madame Amélie, ou Achille, l’innocent, avec son regard étrange. Ils étaient assis tous deux – non pas côte à côte, vous pensez bien, les petits garçons étaient placés à droite et les filles à gauche – dans la petite salle de classe où M. le curé enseignait, avec le catéchisme, l’alphabet et « 2 et 2 font 4 ». Ils s’étaient agenouillés tous deux pleins de ferveur et d’émotion, dans la vieille église de Laragne, le jour de leur première communion, Fleurette en robe blanche et François vêtu d’un bel habit de drap à boutons de cuivre et chaussé de souliers à boucles.
Et quand François avait été d’âge à faire à cheval les courses que lui confiait son père autour de Laragne, Fleurette montait souvent en croupe derrière lui en s’accrochant aux basques de son habit pour ne pas perdre l’équilibre. Ils s’en allaient ainsi le long des routes sinueuses, au pas tranquille de la vieille jument qui semblait se douter que ses cavaliers n’étaient pas pressés d’arriver.
À présent, François avait vingt ans, et Fleurette dix-huit ; ses cheveux étaient blonds comme le blé mûr, ses yeux bleus comme le ciel d’un matin d’été et sa bouche aussi fraîche qu’une cerise. Étonnez-vous après cela que le pauvre François se sentît les pieds lourds comme du plomb et le cou trop serré dans sa cravate ! Étonnez-vous qu’en obéissant à Fleurette qui lui demandait de verser l’eau de la carafe dans un vase pour y placer les pivoines, il aspergeât copieusement le parquet ; surtout si vous considérez que ses gros doigts malhabiles rencontraient les doigts menus de Fleurette autour du col de la carafe ! Le brave Hector fit mine de se fâcher contre le maladroit.
– Voyez-moi ce grand dadais ! s’exclama-t-il de la voix rude qu’il prenait pour mettre en fuite les gamins du village lorsqu’ils regardaient de trop près les pommes de sa devanture. Tirez-lui donc les oreilles, mademoiselle Fleurette !
Cette proposition leur parut si drôle à tous les deux qu’ils en rirent de bon cœur, après quoi ils se mirent à quatre pattes pour éponger le carrelage en se taquinant gaiement. Hector se retourna vers son hôte et frappa la table de son poing vigoureux.
– Eh bien ! ça y est ! jeta-t-il d’une voix sourde. Ils vont me le prendre et l’emmener pour en faire de la chair à canon… Ah ! les gredins !
Le père de Fleurette leva les yeux d’un air interrogateur.
– Emmener François, dites-vous ? fit-il simplement. Puis, avec un haussement d’épaules il ajouta :
– Il a bien vingt ans, n’est-ce pas ?
– Est-ce une raison pour qu’on me l’enlève, alors que j’ai besoin de lui pour m’aider au magasin ? riposta Hector auquel cet argument semblait sans réplique.
– À quoi bon tenir un commerce, mon bon Hector, si la France est envahie et que l’étranger vienne se joindre à tous les traîtres qui veulent sa perte ?
– Mais est-ce qu’ils ne la mènent pas eux-mêmes à sa perte, tous ces démons de Paris qui ne rêvent que guerre et massacre ? gronda Hector Colombe sans prendre garde au geste d’avertissement qui lui était adressé.
Adèle, une jeune fille du village qui donnait un coup de main à la vieille Louise dans les grandes occasions, arrivait de la cuisine avec une pile d’assiettes et de plats qu’elle se mit à ranger sur le dressoir. Hector haussa ses larges épaules. Qui donc se souciait d’Adèle, une fille qui gagnait cinq sous par jour à frotter les planchers ? un petit laideron aux pieds plats et aux bras rouges… peuh !
Mais le père de Fleurette leva un doigt.
– Les murs ont des oreilles, murmura-t-il.
– Oui, je sais, je sais, grogna Hector. C’est la mode à présent de s’espionner les uns les autres. Une jolie mode, ma foi ! que nous ont apportée vos amis de Paris.
L’autre ne répondit point. Sans doute savait-il l’inutilité de toute discussion avec le brave épicier quand celui-ci était de mauvaise humeur.
Ayant terminé ses rangements, Adèle quitta la pièce sans faire plus de bruit qu’une souris – ressemblant elle-même à une souris avec ses petits yeux vifs, et son nez pointu. Dans un coin de la salle, près de la fenêtre, encore occupés des pivoines qui sans doute ne voulaient pas se laisser arranger dans le vase, Fleurette et François causaient tout bas.
– Je vais partir, mademoiselle Fleurette, disait-il.
– Partir ! pour où ? bientôt ?
– On a besoin de moi à l’armée.
– Pourquoi faire ? demanda-t-elle naïvement.
– Pour combattre les Anglais.
– Vous n’allez pas aller vous battre, bien sûr…
– Mais si, mademoiselle Fleurette. Il le faut.
– Oh ! mais qu’est-ce que je… qu’est-ce que M. Colombe va faire sans vous ? Il faut que vous restiez ici pour l’aider au magasin.
Et à la pensée du pauvre M. Colombe privé des services de son fils, elle sentit quelque chose s’étrangler dans sa gorge.
– Mon père est furieux, dit François d’une voix enrouée, car lui aussi avait la gorge serrée. Mais il n’y a rien à faire. Il faut que je parte.
– Quand ? demanda Fleurette, si bas que seule l’oreille d’un amoureux pouvait saisir le sens du mot murmuré.
– Je dois rejoindre demain à Serres les autres recrues, répondit François.
– Déjà demain ? Et moi qui étais si heureuse aujourd’hui !
C’était le cri d’un jeune cœur qu’accablait soudain son premier chagrin. Fleurette ne s’efforçait plus de contenir ses larmes, tandis que François ne savait au juste s’il allait pleurer, lui aussi, parce qu’il allait la quitter, ou danser de joie parce que c’était son départ qui faisait pleurer Fleurette.
– Mon souhait le plus cher est de voir s’unir ces deux enfants, dit à voix basse le digne épicier.
Il se moucha bruyamment avant d’ajouter :
– Mais, avec ce départ…
Son interlocuteur, lui, prenait la chose avec plus de philosophie.
– Il faut attendre de meilleurs jours, Colombe, dit-il. D’ailleurs, Fleurette est trop jeune pour se marier.
5. Le vagabond
La séparation n’unit pas toujours la douceur à la tristesse, comme voudrait nous le faire croire un grand poète. Fleurette, en tout cas, n’y voyait qu’amertume en ce jour de ses dix-huit ans qui n’aurait dû lui apporter que de la joie.
C’était déjà dur pour elle de voir partir son père, mais elle y était accoutumée, car depuis des mois celui-ci faisait des absences de plus en plus fréquentes, et elle savait que, dès qu’il le pourrait, il reviendrait à Lou Mas pour une de ces visites-surprises qui la rendaient si joyeuse. Mais l’adieu à François, c’était tout autre chose. François partait pour l’armée. François allait se battre contre les Anglais. Dieu seul savait quand il reviendrait… Et s’il ne revenait pas ?…
Jamais, au grand jamais la pauvre Fleurette n’avait ressenti une telle tristesse.
Et maintenant, les adieux avaient été échangés. Son père, accompagné de M. Colombe et de François, s’était éloigné dans la direction du village où il devait prendre son cheval et partir pour Paris.
Fleurette demeura sur le pont à les regarder, ombrageant d’une main ses yeux tout brûlants des larmes qu’elle venait de verser. Les trois hommes n’étaient plus que des points sur la route ; Louise était retournée à la cuisine avec Adèle et Fleurette restait seule sur le pont. Des larmes continuaient à couler sur ses joues pendant qu’elle s’efforçait de voir encore Pèpe avant qu’il disparût avec ses compagnons au tournant de la route. Ou bien était-ce François qu’elle tâchait d’apercevoir une dernière fois ?
Le soleil dorait les cimes neigeuses du Pelvoux ; sur le bleu vif du ciel de minuscules nuages paraissaient flamber. Le ruban sinueux du Buech était comme un long miroir qui reflétait toute une gamme de couleurs, mêlant le bleu à l’or et au violet, tandis qu’au-dessus de la route flottait une poussière blonde et lumineuse comme de la poudre de topaze. Soudain, du côté de Sisteron, un nuage de poussière plus dense s’éleva et se rapprocha peu à peu. À présent, Fleurette apercevait distinctement dix ou douze hommes qui venaient vers Laragne. Ils étaient coiffés de bonnets rouges. À leur tête s’avançait un homme à cheval qui portait un tricorne décoré d’une cocarde tricolore, et le soleil faisait étinceler l’acier du mors et les boucles en cuivre du harnachement de sa monture.
Fleurette entendait maintenant le son assourdi des sabots sur la route poussiéreuse et le pas lourd des hommes, et, sans savoir pourquoi, elle demeurait sur place, comme fascinée, à regarder la petite troupe qui approchait.