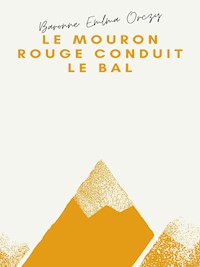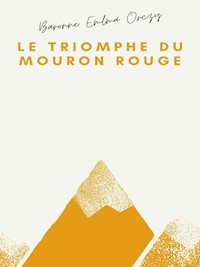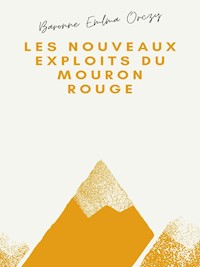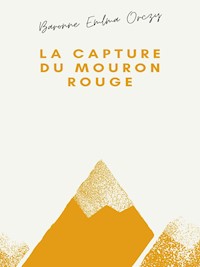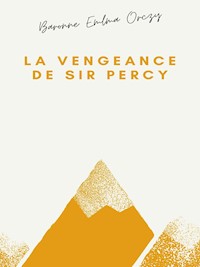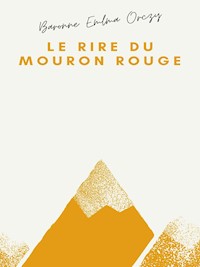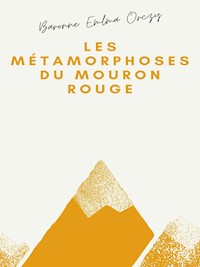
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Maitre Bastien de Croissy était, avant la révolution, un homme renommé au barreau de Paris qui s'occupait des affaires juridiques des aristocrates. Sa femme Louise et son jeune fils Jean-Pierre vivent à présent, dans des conditions plus précaires. Soudain, Jean-Pierre tombe très malade et Mme de Croissy pense que l'air de la montagne de sa province natale, permettrait à son fils de retrouver la santé. Cependant, pour voyager, il faut un «sauf-conduit» ou laisser-passer que le médecin peut facilement signer pour l'enfant, mais non pour les parents qui ne peuvent quitter Paris pour plus de sept jours. Ne connaissant personne de confiance pour garder leur fils unique sur place, Bastien dresse un plan, en désespoir de cause, qui devrait sauver la vie de son fils...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Métamorphoses du Mouron rouge
Les Métamorphoses du Mouron rouge1. La taverne des Trois Singes2. L’enfant malade3. À la recherche du beau chevalier4. Les lettres5. Pressentiments6. L’attentat7. À la Section de la Montagne8. L’homme aux béquilles9. Le billet10. Départ nocturne11. La charrette de la mère Ruffin12. Le conducteur taciturne13. La traversée14. Nouvelles d’Angleterre15. L’arrestation16. Chez le député Chabot17. Le conciliabule18. Voyage en diligence19. L’obligeant inconnu20. Réunion des deux amies21. Regard en arrière22. Le marin23. L’épée de Damoclès24. Les lettres retrouvées25. Le loup et l’agneau26. Le traître27. Les fausses lettres28. Le vagabond29. Au Bout du Monde30. Chabot part sans son escorte31. Les fiancés se retrouvent32. ÉpiloguePage de copyrightLes Métamorphoses du Mouron rouge
Baronne Emma Orczy
1. La taverne des Trois Singes
À l’angle de la rue de la Monnaie et de l’étroit passage des Fèves s’élevait au temps de la Révolution une vaste maison dont l’aspect évoquait un passé de grandeur et de luxe. Pour la décorer, l’or avait été dépensé sans compter. Les balcons de la façade s’ornaient de balustrades finement sculptées, tandis que des personnages allégoriques aux nobles attitudes encadraient les hautes fenêtres à petits carreaux et surmontaient la grande porte cochère. Cet hôtel avait été la résidence d’un riche banquier autrichien, qui s’était empressé de quitter Paris dès que s’étaient fait sentir rue de la Monnaie les premiers souffles de la tourmente révolutionnaire.
L’opulente demeure était restée inhabitée pendant deux ans au bout desquels le gouvernement en avait pris possession, la confisquant comme « bien d’étranger ». Paris étant à court de logements, on avait partagé par des cloisons les salons de réception du banquier pour en faire de petites pièces que louaient des familles modestes, de petits commerçants et des hommes d’affaires. Chose curieuse, les deux années pendant lesquelles la maison avait été abandonnée avaient suffi à lui donner un air de vétusté, et il semblait que privée de ses habitants, dépouillée de ses meubles, de ses tentures et de ses tableaux, elle fût maintenant hantée par je ne sais quels fantômes qu’on croyait entendre chuchoter, et dont on s’imaginait voir les formes vaporeuses glisser à travers les grandes salles désertes, les antichambres et le monumental escalier de pierre. Bien que, par la suite, le rez-de-chaussée fût entièrement occupé par des bureaux d’hommes d’affaires et que plusieurs familles se fussent installées dans les étages supérieurs, une atmosphère de désolation et de ruine continuait à envelopper le vaste hôtel qui conservait entre ses murs une odeur de pierre humide et de moisissure.
À l’intérieur, cependant, la vie suivait son cours. Dans un petit logement, un enfant venait au monde ; dans tel autre, un mariage apportait un peu d’animation joyeuse ; des vieilles femmes se racontaient les nouvelles, des jeunes gens courtisaient des jeunes filles ; mais tout cela sans bruit, à voix contenue, presque furtivement, par crainte, semblait-il, de réveiller les échos endormis.
À vrai dire, cette atmosphère de silence et d’inquiétude n’était pas particulière à l’hôtel de la rue de la Monnaie. En France, pour beaucoup, les temps étaient durs, très durs même, et à de pareilles époques les gens, instinctivement, recherchent le silence et s’efforcent de passer inaperçus. À Paris surtout, la vie était difficile : les denrées les plus communes, les plus nécessaires – lait, sucre, savon – étaient devenues chères et rares, parfois introuvables. Quant aux choses de luxe, si courantes naguère, personne ne pouvait plus se les offrir, à part ces hommes qui avaient excité les passions populaires par leurs discours incendiaires et par les belles promesses de bonheur et d’égalité au moyen desquelles ils éblouissaient de pauvres ignorants. Trois années de bouleversement politique et social avaient procuré à la France plus de misère que de bonheur. Les riches, pour la plupart, avaient été dépouillés de leurs biens ou s’étaient réfugiés à l’étranger, et les pauvres étaient dans le besoin encore plus qu’auparavant. La vue d’un roi détrôné et d’aristocrates en fuite pouvait satisfaire les esprits assoiffés de justice et d’égalité, mais ne calmait pas la faim, ne réchauffait pas les corps mal vêtus. La seule égalité apportée par cette révolution était celle de la misère, de la crainte, du soupçon. Voilà ce que les gens se chuchotaient les uns aux autres, mais ils ne le disaient pas tout haut. Personne n’osait parler ouvertement, de crainte qu’un espion ne fût à l’écoute, prêt à jouer le rôle de dénonciateur.
Ainsi des femmes et des enfants pâtissaient, et des hommes souffraient de ne pouvoir alléger les peines et les privations de leur famille. Certains avaient eu la chance de pouvoir s’échapper de cet enfer et, abandonnant leur malheureuse patrie, ils avaient été chercher dans d’autres pays, sinon le bonheur, du moins la sécurité et la paix. Mais innombrables étaient ceux que retenaient en France des liens impossibles à dénouer – famille, intérêts, profession – et ceux-là supportaient des privations de plus en plus grandes, alors que les auteurs responsables de cette misère générale vivaient largement, avaient une table bien servie et s’asseyaient le soir dans les meilleurs fauteuils de la Comédie française. On festoyait chez Danton, dans sa maison d’Arcis-sur-Aube ; Camille Desmoulins et Saint-Just portaient des jabots de dentelle de Malines sur leurs habits de drap fin, et François Chabot habitait une belle maison rue d’Anjou. Les privations, le dénuement, c’était bon pour le menu peuple qui y était habitué et pour les aristos qui avaient ignoré jusqu’alors ce que c’est que de manquer du nécessaire ; mais eux, les maîtres du jour, qui avaient déployé l’étendard de l’Égalité et de la Fraternité, qui avaient arraché le peuple français à la tyrannie de la royauté et de la noblesse, eux, les libérateurs de la nation, ils avaient droit au luxe et à l’abondance, surtout s’ils se l’offraient aux dépens de ceux qui en avaient joui dans le passé.
En cette année 1792, Maître Sébastien de Croissy louait dans l’hôtel de la rue de la Monnaie deux petites pièces qu’il avait converties en bureaux pour exercer sa profession. C’était un homme d’âge moyen dont les cheveux commençaient à grisonner ; son visage était beau, mais les soucis avaient creusé prématurément des sillons sur son front et aux commissures de ses lèvres, et son regard était empreint de mélancolie.
Quelques années plus tôt, Maître Sébastien de Croissy comptait parmi les membres les plus appréciés du barreau de Paris. Des hommes éminents, appartenant au monde des arts, de la littérature et de la politique venaient le consulter dans sa belle étude de la place Vendôme, et il avait pour clients jusqu’à des membres de la famille royale. Riche, bien né, de belle prestance, le jeune avocat avait été accueilli partout avec faveur, et son mariage avec Louise de Vendeleur, fille unique du général de Vendeleur, avait été un événement mondain. Le duc d’Ayen le traitait en ami, et la duchesse avait voulu être la marraine du petit Jean-Pierre que Louise avait mis au monde quelques mois avant la réunion des États Généraux. Puis la Révolution était venue, et avait privé de ses ressources cet homme jusqu’alors favorisé par la fortune. Beaucoup de ses meilleurs clients avaient émigré, et ceux qui restaient, appauvris et peu soucieux d’attirer sur eux l’attention, n’étaient pas tentés de se lancer dans des procès coûteux. D’autre part, il avait vu le revenu de son patrimoine fondre et se réduire à rien, tant pour les impôts écrasants qui frappaient son domaine du Dauphiné que par la malhonnêteté de ses fermiers qui, assurés de l’impunité, avaient cessé de payer leurs redevances.
En conséquence, Maître de Croissy avait dû renoncer à sa belle installation de la place Vendôme pour prendre un modeste logis rue Quincampoix qui abritait non seulement lui-même, sa femme et son fils, mais aussi son secrétaire et une amie de Louise. Il traitait ce qu’il pouvait en fait d’affaires rue de la Monnaie, dans les deux petites pièces occupées naguère par le majordome du banquier autrichien. Il s’y rendait à pied chaque matin, quelque temps qu’il fît, et donnait des consultations juridiques à de petits bourgeois que les impôts faisaient renâcler ou à des commerçants besogneux menacés de faillite. Ce n’était plus « Maître de Croissy », mais « le citoyen Croissy » réduit à se féliciter de ce que des hommes comme Chabot ou Bazire l’eussent favorisé de leur clientèle, et que le grand Danton lui-même lui confiât parfois quelques affaires. Alors que trois secrétaires suffisaient à peine à le seconder trois ans auparavant, il ne gardait auprès de lui que le fidèle Maurice Reversac qui s’était obstinément refusé à le quitter lors du départ de ses collègues.
– Vous ne voulez pas me mettre sur le pavé, maître, j’en suis sûr ? avait dit le jeune homme d’un ton suppliant.
– Bien sûr que non, Maurice ; mais vous trouveriez aisément une autre situation, avait affirmé Sébastien de Croissy. (Non sans raison, car Maurice était jeune, travailleur, très instruit en jurisprudence, et il pouvait certainement se faire une position indépendante.) Et je n’ai plus les moyens de vous assurer les appointements auxquels vous avez droit.
– Donnez-moi seulement le vivre et le couvert, maître, avait insisté Reversac. Je ne veux rien de plus. J’ai mis de côté quelques louis, mes vêtements dureront bien encore deux ou trois ans, et d’ici là…
– Oui, d’ici là…, répéta Maître de Croissy en soupirant.
Pour ce loyal serviteur du roi, attaché aux traditions et au passé glorieux de la France, une des pires épreuves était de voir l’état de désordre dans lequel s’enfonçait peu à peu sa patrie. Tout d’abord il avait pensé que cette période de chaos, d’oppression, de cruauté ne pouvait pas durer, et que le peuple de France retrouverait bientôt son bon sens. Mais petit à petit il avait perdu ses illusions. Depuis cette conversation avec Maurice Reversac, la situation avait encore empiré. Le roi, déchu, était maintenant emprisonné au Temple avec sa famille, les massacres de Septembre venaient de faire frémir Paris d’effroi, et des Français parlaient de faire passer Louis XVI en jugement comme un vulgaire criminel. Comment ne pas désespérer d’un pays où soufflait un tel vent de folie ?
La vie continuait cependant, simple et laborieuse dans le logis de la rue Quincampoix. Chaque matin, les deux hommes se rendaient au bureau de la rue de la Monnaie. Parti le premier, Maurice Reversac commençait le travail de la journée par le balayage et le rangement du modeste local. Le soir, Sébastien et son clerc revenaient ensemble à la rue Quincampoix. Ce logement, si resserré fût-il, représentait pour tous deux le foyer, et ils y trouvaient l’un et l’autre la mesure de bonheur intime dont leur cœur avait besoin. Pour Sébastien de Croissy, c’était l’amour de sa femme et de son fils. Pour Maurice Reversac, le bonheur consistait à vivre sous le même toit que Josette, à la voir chaque jour, à l’emmener chaque soir de beau temps faire une promenade le long de la Seine ou sous les marronniers du Palais-Royal.
Vers le milieu de l’étroit passage des Fèves, il y avait alors une taverne fréquentée surtout par des travailleurs des ateliers nationaux. Elle portait l’enseigne Aux Trois Singes et l’on y accédait par une porte étroite en contrebas de la rue. La nourriture et la boisson n’y étaient pas plus chères qu’ailleurs, et l’aubergiste, un nommé Furet, avait le grand mérite d’être dur d’oreille et de bégayer, à quoi s’ajoutait le fait qu’il ne savait ni lire ni écrire. Ces circonstances faisaient de Furet l’aubergiste idéal dans un endroit où des travailleurs au ventre creux se laissaient aller à des récriminations contre le présent état de choses, voire à indiquer d’un geste narquois la devise Liberté, Égalité, Fraternité qui s’étalait, par ordre du gouvernement, sur les murs de tous les lieux publics. Surdité et difficulté d’élocution rendaient Furet aussi incapable d’espionner que de dénoncer ses clients. Ceux-ci pouvaient donc se détendre quand ils s’asseyaient à une table Aux Trois Singes pour manger un ragoût de haricots arrosé d’un vin aigrelet. C’était un soulagement pour eux de pouvoir s’entretenir de leurs durs travaux, de leurs maigres salaires et de la cherté de la vie, avec la certitude que Furet n’entendait pas ce qu’ils disaient et ne répéterait pas le peu qu’il pourrait saisir.
À l’intérieur des Trois Singes, il y avait deux tables à l’écart des autres. À proprement parler, ce n’étaient pas des tables, mais deux tonneaux vides, posés debout dans deux recoins de la salle, à droite et à gauche de la porte d’entrée. Il y avait dans chaque recoin deux tabourets à trois pieds, et les clients qui s’installaient à cette place de choix étaient supposés commander une bouteille du meilleur vin de Furet. C’était là une de ces lois non écrites qu’aucun client des Trois Singes n’aurait eu l’idée de transgresser, Furet étant d’humeur assez difficile.
Par une chaude soirée de la fin de l’été 1792, deux hommes étaient installés dans un de ces recoins privilégiés des Trois Singes et s’entretenaient depuis un long moment à voix basse. Une bouteille du meilleur vin de Furet était placée entre eux sur le tonneau, mais bien que les deux interlocuteurs fussent là depuis près d’une heure, la bouteille était encore à moitié pleine. Ils étaient trop absorbés par leur conversation pour songer à vider leurs verres.
L’un d’eux était petit, solidement bâti, très brun, l’air décidé. Il parlait bien français, mais avec un accent guttural qui trahissait son origine allemande.
L’autre était Sébastien de Croissy, qui écoutait d’un air grave et soucieux ce que l’homme brun lui disait à voix basse en frappant parfois le tonneau teinté de vin avec la paume de sa main charnue pour appuyer ses arguments.
– Voyons, cher maître, représentait-il avec insistance, vous avez certainement à cœur, autant que M. le baron, le renversement de cet abominable gouvernement. Nous avions cru pouvoir compter sur votre dévouement à la cause royale.
– Ce n’est point le manque de dévouement qui me fait hésiter, protesta Maître de Croissy avec chaleur.
– Quoi donc, alors ?
– La prudence ! La peur qu’une fausse manœuvre de notre part ne contribue à aggraver les dangers qui menacent le roi et sa famille.
L’autre haussa les épaules.
– Ces dangers ne sont déjà que trop grands. La vie du roi est en péril. Il faut agir, et agir vite. Le baron estime indispensable qu’on s’assure ici le concours de quelques membres de l’Assemblée. Des conventionnels, vous en connaissez, je crois ?
– J’en connais quelques-uns, admit Sébastien.
– Vénaux ?
– Oui.
– Avides ?
– Assurément.
– Ambitieux ?
– Capables de trahir leur cause par ambition.
– Alors ?
Sébastien de Croissy ne répondit pas tout de suite.
C’était le matin même qu’il avait reçu un billet non signé le priant de se rendre à la taverne des Trois Singes pour un entretien particulier. Le sujet de cet entretien, précisait le billet, concernait le bien de la France et le salut du roi. Sébastien n’était pas peureux, et la façon dont était rédigé le message lui avait inspiré confiance. Ayant donné sa liberté plus tôt que de coutume à Maurice Reversac, il avait fermé l’étude et s’était rendu à l’heure dite au mystérieux rendez-vous.
L’étranger s’était présenté à lui comme l’envoyé du baron de Batz, gentilhomme breton ardemment dévoué à la cause royale et résidant actuellement à Vienne où le frère de l’infortunée Marie-Antoinette, l’empereur François II, lui avait donné sa confiance et promis son appui. Une longue conversation avait suivi au cours de laquelle Sébastien de Croissy avait gardé d’abord une attitude réservée. Autour d’eux régnait un bourdonnement de conversations sur lequel se détachaient un bruit de verres entrechoqués et le son mat des dominos auxquels jouaient quelques-uns des buveurs. Pas d’oreilles à l’écoute dans ce coin sombre et protégé où deux hommes traitaient à voix basse des destinées de la France, l’un, représentant d’une puissance étrangère, l’autre, ardent royaliste, tous deux poursuivant le même but : sauver la famille royale et renverser un gouvernement d’assassins qui s’apprêtaient à ajouter le régicide à leurs autres crimes.
– Cher maître, reprit l’Autrichien d’un ton persuasif, je n’ai pas besoin de vous dire de quel milieu sortent ces gens et par quoi on peut les gagner. Notre empereur n’entend pas laisser son auguste sœur à la merci de ces bandits. Il a donné sa confiance à M. le baron et lui a ouvert un vaste crédit pour l’aider à mener à bien son entreprise. En conséquence, M. le baron envisage de donner jusqu’à vingt mille livres à chacun des dix ou douze hommes dont on pourrait acheter le concours.
– Dix ou douze hommes, dites-vous ! s’exclama Sébastien de Croissy, ajoutant d’un air découragé : Où les trouver ?
– Nous nous en remettons à vous pour cela, cher maître.
– Moi ? Mais je n’ai aucune influence.
– C’est possible, mais vous êtes en rapport avec des hommes influents, insista l’étranger qui poursuivit d’un ton significatif : Nous sommes au courant.
– Je m’en doutais.
– Nous savons que par votre profession vous avez des relations d’affaires avec des membres de la Convention qu’il nous semble possible de gagner.
– Lesquels ?
– Eh bien, Chabot par exemple ; le capucin défroqué.
– Dieu du ciel ! s’exclama Sébastien de Croissy. Se servir d’un tel instrument ?
– La fin justifie les moyens, mon cher, répliqua l’autre. Puis il ajouta :
– Et le beau-frère de Chabot, Bazire ?
– Ces deux hommes vendraient leur âme s’ils en avaient une.
– Vous connaissez aussi l’ami de Danton, Fabre d’Églantine.
– Vous êtes bien informé.
– Et que diriez-vous de Danton lui-même ?
L’Autrichien se penchait au-dessus de la table, vibrant d’ardeur contenue, sûr à présent que Sébastien de Croissy commençait à être ébranlé. Celui-ci, en effet, était en train de céder devant l’enthousiasme de l’envoyé du baron de Batz et sa confiance dans le succès final. Quelle merveilleuse perspective se déroulait en ce moment dans son esprit ! La France délivrée de la tyrannie, le roi retrouvant pouvoir et prestige, le pays heureux et prospère, uni de nouveau autour de son monarque ! Ainsi songeait Maître de Croissy en prêtant une oreille de plus en plus complaisante aux plans élaborés par le baron de Batz. Lui-même suggéra de nouveaux noms : noms de royalistes éprouvés qui les seconderaient dans leur entreprise, noms de républicains qui n’hésiteraient pas à trahir leur parti si on y mettait le prix.
– Il me semblerait sage, reprit Sébastien de Croissy, de promettre à ces hommes le versement d’une première somme dès que tous les membres de la famille royale auraient été mis en sûreté hors de France. Après quoi il leur serait versé une autre somme, plus forte que la première, le jour où Sa Majesté serait remise en possession de son trône.
L’animation, l’ardeur que mettait Maître de Croissy à exposer ses vues, montrait qu’il était à présent pleinement gagné. L’avocat était un de ces Français pour qui la royauté de droit divin était chose sacrée. Tout ce qu’il avait souffert ces dernières années, pertes d’argent et de prestige, privations, n’était rien en comparaison de la douleur qu’il ressentait à la vue des humiliations imposées au roi. Sauver Louis XVI ! Le ramener triomphant sur le trône de ses ancêtres ! Ce but avait de quoi remplir d’enthousiasme l’âme de Sébastien de Croissy.
Il écoutait maintenant d’une oreille distraite l’aperçu que l’Autrichien donnait par avance du châtiment réservé aux ennemis du roi. Ces tristes personnages pouvaient s’engraisser avec l’or autrichien ou recevoir la punition de leur infamie, peu lui importait pourvu que le but magnifique fût atteint.
Le conciliabule dura encore un moment, des points de détail furent précisés, et l’émissaire autrichien dit en conclusion :
– Vous voyez, cher maître, l’idée maîtresse de notre plan : obtenir de ces coquins par des lettres autant de preuves écrites de leur vénalité, par lesquelles nous pourrons les tenir, et qui, s’ils tentaient de relever la tête, nous permettraient de proclamer leur turpitude et de ruiner leur influence.
Il était tard quand cette conversation prit fin. Dans le logis de la rue Quincampoix, Louise de Croissy attendait impatiemment le retour de son mari. À ses questions répétées, Maurice Reversac n’avait pu répondre qu’une chose : Maître de Croissy s’était rendu, à la fin de l’après-midi, à un rendez-vous d’affaires demandé par un client qui désirait garder l’anonymat. Quand enfin Sébastien rentra, il paraissait fatigué, mais son visage avait une expression ardente que Louise ne lui avait pas vue depuis longtemps. Jamais, depuis les premiers jours sombres de la Révolution, elle n’avait vu une telle flamme briller dans ses yeux, elle n’avait entendu ses lèvres prononcer des paroles aussi confiantes, optimistes même. Il ne lui dit rien de son entrevue avec l’envoyé du baron de Batz, et parla seulement de l’avenir qui lui semblait s’éclaircir.
– Dieu, dit-il, ne permettrait pas plus longtemps le triomphe du mal ; l’état présent de la France ne pouvait durer, et de meilleurs jours se préparaient.
Louise était toute disposée à partager ses espoirs, mais elle ne le questionna pas pour savoir d’où lui venait cette confiance nouvelle dans l’avenir. De nature docile, un peu passive, elle était toujours disposée à accueillir les choses comme Sébastien les lui présentait, sans se perdre en « pourquoi » ni « comment ». Elle avait une admiration sans bornes pour l’intelligence de son mari et une parfaite confiance dans son jugement. Ce soir, elle le voyait à nouveau rempli d’espoir, et cela lui suffisait.
Ce n’est qu’au fidèle Maurice Reversac que Sébastien parla de son entrevue avec l’Autrichien, mais le jeune homme dut faire effort pour paraître s’intéresser aux aventureux projets du gentilhomme breton, et il lui fut impossible de partager l’optimisme de son patron quant au résultat final de l’entreprise. Garçon laborieux et instruit, Maurice n’avait pas une intelligence brillante, mais l’attachement profond qu’il avait pour Maître de Croissy et sa famille lui donnait une sorte d’intuition, presque la prescience des événements bons ou mauvais que le destin tenait pour eux en réserve. Tandis qu’il écoutait les détails que lui donnait Maître de Croissy avec animation, il sentait naître en lui l’étrange pressentiment que quelque chose ferait obstacle à ce beau projet, et que, d’une façon ou d’une autre, il conduirait à un désastre.
Le lendemain, comme le secrétaire assis devant sa table copiait les lettres que l’avocat lui avait dictées – lettres semblables à des tentacules lancés pour essayer de saisir des hommes sans conscience – l’envie le prit de se jeter aux pieds de Sébastien de Croissy pour le supplier de ne point s’aventurer dans une entreprise aussi hasardeuse conçue à l’étranger.
Mais il dut résister à la tentation. Maître de Croissy n’était pas homme à se laisser influencer par les pressentiments de son secrétaire, si grande que fût la confiance qu’il avait en lui. Les lettres furent donc écrites – une dizaine en tout, dans lesquelles Maître Croissy, du barreau de Paris, demandait à divers membres influents de la Convention de lui accorder un entretien privé sur des sujets concernant de façon urgente les affaires de l’État.
2. L’enfant malade
Une année s’était écoulée depuis lors, et Sébastien de Croissy avait vu s’effondrer l’un après l’autre ses espoirs les plus chers. Il n’y avait pas eu d’éclaircie dans les nuages qui planaient au-dessus du beau pays de France. Au contraire, les nuées s’étaient amoncelées plus sombres, plus menaçantes que jamais. On était arrivé à l’automne de l’année 1793. Quelques mois auparavant, le roi, condamné à mort par la Convention, avait payé de sa vie les erreurs, les faiblesses, les incompréhensions du passé. Marie-Antoinette, séparée de ses enfants et de tous ceux qui lui étaient dévoués, chargée de viles et mensongères accusations, attendait à la Conciergerie son jugement et une mort certaine.
Les prisons étaient pleines, depuis que la loi des Suspects avait favorisé les dénonciations et multiplié les arrestations. Des milliers de prisonniers et de prisonnières de tout âge et de tout rang attendaient avec plus ou moins d’anxiété et plus ou moins d’illusions d’être appelés devant le Tribunal révolutionnaire. Cependant, les maîtres de l’heure, Danton et Robespierre, commençaient à se dresser l’un contre l’autre, prêts à se combattre, tandis que le pays, déchiré par la guerre civile, devait faire face à l’invasion étrangère. La famine et les épidémies faisaient de nombreuses victimes. La terre n’avait plus assez de bras pour la cultiver, et les villes manquaient de tout ce que la campagne ne pouvait plus produire. Les armées alliées victorieuses avaient débordé les frontières et foulaient le sol sacré de la France. La Lorraine, la Champagne, les Flandres étaient dévastées par le passage des troupes, les Prussiens traversaient le Rhin, les Espagnols franchissaient les défilés des Pyrénées pendant que la torche de la guerre civile se rallumait en Vendée.
Le cri de Danton : « Aux armes ! la patrie est en danger ! » avait résonné d’un bout à l’autre du pays, éveillant des échos dans les villages endormis, à travers les plaines et les coteaux, et trois cent mille soldats de la Liberté marchaient vers la frontière, mal nourris, mal vêtus, mal chaussés, afin de repousser l’ennemi hors de France.
Ceux qui restaient à l’arrière, les femmes, les vieux, les faibles, avaient eux aussi leur rôle à remplir pour la défense de la patrie. Dans les ateliers nationaux les femmes cousaient des chemises et des uniformes pour l’armée, tricotaient des chaussettes, salaient de la viande, et s’occupaient de leurs enfants et de leur ménage quand elles le pouvaient… La patrie avant tout !
C’est alors que le petit Jean-Pierre tomba malade, et ce fut le point de départ de la tragédie. Ce fils que Louise et Sébastien avaient tant souhaité, qu’ils avaient accueilli avec tant de joie, ils avaient bien craint de ne pas le conserver tant il était frêle. Cependant, à force de soins il s’était développé et fortifié jusqu’à cet affreux automne de 1793 où la nourriture, pour les Parisiens, était devenue rare et médiocre, et le lait à peu près introuvable.
Appelé auprès du petit malade, le bon vieux Dr Leroux affirma que l’enfant n’avait rien de grave, mais qu’il lui fallait d’urgence un changement d’air. Paris était un mauvais endroit pour un petit être si délicat. Il lui fallait l’air pur de la campagne et une bonne nourriture.
Un changement d’air ? Bonté du ciel ; comment faire ?
Louise demanda au médecin :
– Pouvez-vous m’obtenir un laissez-passer, citoyen Leroux ? Nous avons encore une maison sur le bord de l’Isère, pas bien loin de Grenoble. Je pourrais y emmener mon fils.
– Oui ; je crois qu’étant donné les circonstances, je puis vous faire délivrer un laissez-passer pour l’enfant.
– Et un autre pour moi, docteur.
– Un autre pour vous, oui ; mais temporaire seulement.
– Temporaire ! que voulez-vous dire ?
– Un laissez-passer d’une durée de dix ou douze jours qui vous permettra de conduire l’enfant, de l’installer et de revenir aussitôt à Paris.
– Mais, docteur, je ne veux pas revenir à Paris.
– Je crains que vous n’y soyez obligée, citoyenne. Personne ne peut actuellement rester absent de son domicile plus de quinze jours. Vous n’êtes pas sans connaître ce règlement.
– Je ne veux pas, je ne puis pas me séparer de Jean-Pierre ! protesta la jeune femme.
– Pourquoi pas ? Je vous le répète, l’enfant n’est pas gravement malade, et il n’a besoin que de soleil et de grand air.
Louise sentait l’impatience la gagner. Comme les hommes, les meilleurs même, sont lents à comprendre certaines choses !
– Mais il n’y a personne à qui je puisse le confier, déclara-t-elle.
– Oh ! il y a bien là-bas quelque bonne paysanne qui… Cette fois, Louise s’emporta.
– Et vous vous figurez, s’écria-t-elle, que je confierais mon fils à des mains étrangères ?
– N’avez-vous point de parente en Dauphiné ? Une mère, une sœur ?
– Ma mère est morte. Je n’ai pas de sœur. Et je tiens à soigner mon enfant moi-même.
Le médecin hocha la tête. Il avait du cœur, mais il voyait journellement des situations analogues aussi pénibles, et lui-même ne pouvait rien pour y remédier.
– Je crains que vous ne soyez obligée…, commença-t-il.
– Docteur Leroux, interrompit Louise d’un ton ferme, il faut que vous me fassiez un papier certifiant que Jean-Pierre est trop malade pour être séparé de sa mère.
– Cela ne servirait à rien, citoyenne.
– Faites-en l’essai, je vous en prie !
– J’ai déjà tenté la chose pour d’autres, à plusieurs reprises, et toujours sans succès. Vous avez sûrement entendu parler de ces nouveaux arrêtés de la Commune. Personne n’ose aller contre.
– Alors, dois-je voir mourir mon fils, faute d’une feuille de papier ?
Le vieux médecin haussa les épaules. Il était surmené, et d’autres malades l’attendaient. Il prit congé sans répondre. À quoi bon s’attarder puisqu’il ne pouvait rien pour cette jeune femme ? Louise s’aperçut à peine de son départ. Elle était demeurée sur place, immobile, l’image du désespoir. Les joues pâles de son fils étaient moins décolorées que les siennes.
Josette était restée auprès du petit lit pendant la visite du médecin. Jean-Pierre lui avait saisi un doigt avec sa menotte, et elle n’avait pas voulu se dégager, aussi n’avait-elle rien perdu de la scène. Ses yeux bleus que faisait briller l’émotion restaient fixés sur Louise.
Louise et Josette avaient toujours vécu ensemble depuis le jour où Mme de Vendeleur, sentant ses jours comptés, avait confié sa fille, âgée seulement de quelques mois, à Virginie Gravier, la mère de Josette. Les deux enfants avaient grandi ensemble comme des sœurs, partageant leurs joies et leurs chagrins d’enfants. La vieille ferme dauphinoise résonnait de leurs rires et de leurs pas légers. Elles s’amusaient à monter sur les chèvres, et elles avaient à elles leurs poules, leurs lapins, leurs canards à qui elles distribuaient soir et matin du fourrage et du grain.
Devenues plus grandes, elles allèrent ensemble en pension au couvent de la Visitation de Grenoble pour connaître tout ce qu’il était d’usage d’enseigner aux jeunes demoiselles du temps, c’est-à-dire : coudre, broder, bien tourner une lettre, savoir par cœur quelques beaux vers et posséder quelques notions d’histoire et de géographie. Il n’y avait pas eu de différence entre l’éducation de Louise de Vendeleur, la fille du général aide de camp de Sa Majesté, et celle de Joséphine Gravier, la fille de son fermier. Ainsi l’avait voulu le père de Louise, en reconnaissance des soins dévoués donnés par Virginie Gravier à la fillette privée de mère.
Peu de temps après sa sortie du couvent, Louise avait épousé Sébastien de Croissy. La pauvre Josette sentit son cœur se briser lorsqu’il lui fallut se séparer de sa compagne de toujours. Vinrent ensuite les jours sombres de 1789 qui lui apportèrent épreuves sur épreuves. Lors d’une échauffourée à Grenoble, son père fut mortellement blessé, et Virginie mourut de chagrin peu de mois après. Quand Louise apprit ces malheurs, elle pria sa compagne d’enfance de venir vivre auprès d’elle. Josette vint donc à Paris où elle se remit à entourer Louise de soins et d’affection comme elle l’avait fait dans le passé. Dans des jours de plus en plus troublés, de plus en plus tragiques, elle fut son aide et son réconfort. Grâce à son caractère énergique, elle était devenue le soutien moral de toute la famille. La patrie en danger réclamait d’elle plusieurs heures de travail par jour. Elle aussi devait coudre des chemises et des uniformes pour les soldats de la Liberté ; mais ses soirées étaient libres ainsi que le début de ses matinées, et elle les consacrait à Louise et à Jean-Pierre pour qui elle avait une vive tendresse.
Dans l’appartement de la rue Quincampoix, Josette avait une toute petite chambre, mais pour elle, cette pièce exiguë était un paradis. C’est là que dans ses heures de liberté elle faisait jouer Jean-Pierre, tout en lavant et en repassant ses petits vêtements, et c’est là qu’elle voyait briller les grands yeux noirs de l’enfant, si pareils à ceux de Louise, lorsqu’elle lui racontait des contes de fées, des légendes ou des récits de chevalerie. Jean-Pierre était encore bien petit, mais, doué d’une intelligence précoce, il était capable de s’intéresser aux prouesses des croisés, de Bayard et de Jeanne d’Arc. C’était peut-être, parce qu’il se sentait petit et faible et pressentait avec le sûr instinct des enfants qu’il n’aurait jamais la force voulue pour imiter ces exploits, qu’il aimait tellement entendre Josette les lui conter avec tous les détails que lui suggérait sa riche imagination.
Quand Jean-Pierre, qui avait toujours été fragile, tomba dans un état de faiblesse inquiétant, Josette perdit toute sa joie – joie intérieure, faut-il préciser, car extérieurement elle conservait la même gaieté, allait et venait en chantant, dorlotait le petit malade, réconfortait Louise et soutenait le courage de Sébastien qui l’appelait « l’ange du foyer ». Chaque fois qu’elle avait un moment libre, elle le passait à côté du petit lit de Jean-Pierre ; et quand personne n’écoutait, elle redisait à voix basse les contes que l’enfant aimait tant. Si l’ombre d’un sourire paraissait sur ses lèvres pâles, Josette était heureuse, bien qu’en même temps elle sentît les larmes lui monter aux yeux !
Dès que le vieux médecin fut parti, Josette dégagea sa main que tenait toujours l’enfant et entoura Louise de ses bras.
– Ne perdons pas courage, ma chérie, dit-elle. Il doit y avoir un moyen de sortir de cette impasse.
– Un moyen ? répéta Louise. Ah ! si je pouvais le trouver.
– Nous tâcherons de le trouver ensemble.
– Tu en vois un, toi, Josette ?
– Pas exactement, Louise ; mais il me semble que des choses comme celles-là doivent pouvoir s’arranger d’une façon ou d’une autre. Tous ces règlements, tous ces décrets changent constamment suivant le bon plaisir de ces messieurs de la Commune. Peut-être permettra-t-on demain ce qu’on interdit aujourd’hui. Et puis, tant de choses étranges se passent à présent ! Si vous entendiez comme moi les conversations à l’atelier – des conversations à voix basse, bien entendu. Il y est question de fuites, d’évasions ; tantôt ce sont des aristocrates qui disparaissent subitement alors qu’on allait les arrêter, tantôt c’est un prêtre non jureur, caché sous un déguisement, qui dit la messe dans des caves et parcourt les rues de Paris pour voir et réconforter ses paroissiens sans que jamais les gendarmes puissent mettre la main sur lui. Hier encore, ma voisine de travail me chuchotait qu’un étranger, un Anglais, croit-on, a déjà fait sortir de Paris plusieurs personnes qui se savaient à la veille d’être mises en prison, et l’une d’elles a pu informer, par je ne sais quel moyen, une de ses anciennes domestiques, amie de ma voisine, qu’elle se trouvait maintenant en sûreté en Angleterre. Cet Anglais est un homme étonnant, si habile, si courageux, si mystérieux ! Personne ne le connaît, on ignore son vrai nom, on sait seulement qu’il se fait appeler le Mouron Rouge. Ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est qu’il réussit tout ce qu’il entreprend. C’est incroyable ! Ah ! Louise, si seulement nous savions où le trouver.
La voix de Josette vibrait, ses yeux brillaient. Mais Louise, accablée par ses soucis, jeta une douche d’eau froide sur l’enthousiasme de son amie.
– C’est incroyable, dis-tu ? eh bien, moi, je n’y crois pas, déclara-t-elle. Ce n’est pas le moment de plaisanter en me racontant des choses qui n’existent que dans ton imagination.
Josette hocha la tête.
– Pourquoi dire cela, Louise ? L’aide que d’autres ont trouvée, peut-être la trouverons-nous aussi. Cet Anglais a fait des merveilles pour d’autres ; s’il vous connaissait, il en ferait aussi pour vous. Je tâcherai d’en apprendre davantage sur lui par ma voisine d’atelier.
Louise regardait le visage animé de son amie, et elle se sentit étrangement émue. Bouleversée par la visite du médecin, elle était comme un naufragé qui essaie de se raccrocher à n’importe quoi. Les yeux de Josette rayonnaient d’espoir, et Louise avait tant besoin d’espoir ! Elle enviait à son amie sa foi et son enthousiasme, mais les jugeait dénués de fondement.
– Je souhaiterais, dit-elle, être comme toi, Josette, et croire aux contes de fées.
– Il ne s’agit pas de contes de fées, Louise. Les prouesses de ce Mouron Rouge sont bien réelles.
– Soit ! Mais il nous ignore. Il ne peut rien pour Jean-Pierre.
– Il pourrait vous emmener tous deux hors de Paris.
– Mais, ma pauvre petite, je te le répète, il ne nous connaît pas, nous ne le connaissons pas, nous ignorons où il est, et chercher ce mystérieux personnage – si tant est qu’il existe – à travers les rues de Paris, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin.
– Je ne veux quand même pas renoncer à tout espoir, répondit Josette. Il se produit parfois d’heureux hasards, Louise, il ne faut pas se décourager si vite.
Louise ne répondit pas. Elle restait immobile sur son siège, perdue dans ses pensées, priant Dieu, peut-être, de la soutenir dans cette épreuve. Josette traversa la pièce d’un pas léger pour aller se pencher sur le petit lit de Jean-Pierre. Tandis qu’elle le rebordait et l’embrassait, l’enfant murmura son nom et ajouta :
– Raconte-moi une histoire, veux-tu ? Une belle histoire.
– Plus tard, mon joli, je te dirai comment un beau chevalier a sauvé des petits enfants et leur maman. Un jour, Dieu t’enverra aussi un beau chevalier, Jean-Pierre.
Et Josette sortit rapidement de la pièce.
3. À la recherche du beau chevalier
Josette saisit sa cape, la jeta sur ses épaules et, tout en ramenant le capuchon sur ses boucles blondes, descendit l’escalier en courant et sortit. D’avoir parlé du Mouron Rouge avait excité son énergie et lui donnait envie d’agir, de tenter quelque chose. Elle vibrait encore au souvenir des récits que lui avait faits à voix basse sa compagne d’atelier tout en cousant pour les soldats des armées de la République. Josette devait faire encore deux heures de travail à l’atelier. À la tombée du jour, elle serait libre et, comme le temps était beau, Maurice Reversac irait sans doute la chercher à la sortie, et ferait une promenade avec elle avant de la ramener rue Quincampoix, à temps pour préparer le souper familial.
Quand elle quitta l’atelier, elle faillit passer près de Maurice sans le voir, tant elle était absorbée par les pensées qui s’agitaient dans son esprit. Maurice, qui l’attendait dans la rue, l’appela et fut rempli de bonheur à la vue de l’air joyeux que prit Josette en l’apercevant.
– Maurice, s’écria-t-elle, comme je suis contente que vous soyez venu ! Maurice étant jeune et éperdument amoureux, ne songea pas à lui demander pourquoi elle était si contente. Elle semblait heureuse de le voir, et cela lui suffisait. Il la prit par le bras et la mena par un dédale de petites rues vers les quais. Ils s’assirent au bord de la Seine, sous des arbres à demi dépouillés par l’automne et dont les feuilles jaunies et craquantes jonchaient le sol. Tandis que les dernières lueurs du couchant se fondaient dans le crépuscule, les moineaux nichés dans les branches menaient un joyeux tapage qui semblait un hymne d’allégresse tout à fait en accord avec l’état d’esprit de Maurice. Celui-ci ne s’apercevait pas que Josette était perdue dans ses pensées. Il voyait seulement que ses yeux brillaient plus qu’à l’ordinaire et que ses lèvres étaient légèrement entrouvertes. De ces lèvres fraîches, ah ! comme il eût aimé recevoir un baiser !
L’air était doux pour la saison. C’était une belle soirée d’automne où flottait comme un parfum de fruit mûr. Et les moineaux tapageurs continuaient à se chamailler là-haut dans les grands arbres avant de se mettre la tête sous l’aile pour dormir. Il y avait peu de passants, et ce coin désert paraissait singulièrement paisible, loin, très loin de la Révolution, séparé de ses horreurs par un monde de rêve et d’espoir.
D’ailleurs, les renversements sociaux, les révolutions et les cataclysmes comptent-ils beaucoup pour un amoureux quand il est absorbé dans la contemplation de sa bien-aimée ? Assis à côté de Josette, Maurice Reversac admirait son charmant profil, son petit nez gentiment retroussé, le velouté de sa joue si pareil à celui d’une pêche mûre. Josette demeurait immobile et muette, aussi Maurice s’enhardit-il jusqu’à s’emparer doucement de sa main. Elle ne fit pas de résistance, et Maurice crut défaillir de joie en sentant dans sa grande main cette main mignonne, douce, tiède et palpitante comme un de ces moineaux blottis au-dessus d’eux dans les arbres.
– Josette, dit tout bas Maurice au bout d’un instant, c’est vrai que vous êtes contente de me voir ?… Ne me l’avez-vous pas dit tout à l’heure ?
Elle ne tourna pas les yeux vers lui, mais peu importait à Maurice, car il continuait à voir dans les dernières lueurs du jour l’adorable profil et les longs cils qui ressemblaient à une frange d’or bruni. Le capuchon avait glissé de sa tête, et la brise se jouait dans les bouclettes blondes.
– Que vous êtes jolie, Josette ! reprit Maurice en soupirant. À côté de vous je ne suis qu’un lourdaud, un maladroit. Pourtant, je crois que je saurais vous rendre heureuse. Heureuse comme les oiseaux qui n’ont pas de soucis. J’aimerais que comme eux vous chantiez du matin jusqu’au soir et que vous ne sachiez plus ce que c’est que l’inquiétude ou la tristesse. Encouragé par le silence de Josette, il se rapprocha un peu d’elle.
– J’ai vu, murmura-t-il près de son oreille, un logis qui vous conviendrait. Il n’a que trois pièces, mais le soleil matinal y entre par de hautes fenêtres, et il y a devant la maison un grand acacia dans lequel les oiseaux chanteraient dès l’aube, au printemps, pour charmer votre réveil…
Jamais jusqu’alors Maurice n’avait trouvé assez d’audace pour parler à Josette de ses sentiments. C’était le temps où les hommes vraiment épris étaient timides, le temps où la jeune fille qu’ils aimaient était à leurs yeux un être quasi sacré dont il ne fallait pas troubler l’âme limpide par une parole imprudente ou prématurée. Et Maurice avait été élevé par une mère tendre dans ces principes rigides. La Révolution avait, il est vrai, bouleversé et ruiné bien des principes et endurci les fibres du cœur des hommes aussi bien que la sensibilité des femmes, mais la délicatesse des hommes bien élevés ne s’était pas laissée ébranler, et jamais encore Maurice n’avait osé ouvrir son cœur à la femme qu’il souhaitait avoir un jour pour épouse.
Le silence de Josette l’avait enhardi, et aussi le fait qu’elle lui avait abandonné sa main. Il osa passer son bras autour des épaules de Josette et il commençait à l’attirer vers lui avec le sentiment qu’il était sur le point de franchir le seuil du paradis, quand elle tourna la tête vers lui et le regarda droit dans les yeux. Elle avait l’air étonné et fronçait légèrement les sourcils.
– Maurice, demanda-t-elle, est-ce que par hasard vous me feriez la cour ? Puis comme lui-même, devenu muet, avait l’air interdit et peiné, elle eut un petit rire, dégagea doucement sa main et lui tapota amicalement la joue.
– Mon pauvre Maurice, fit-elle, je regrette de ne pas avoir écouté plus tôt, mais je pensais à autre chose.
Quand un homme se croit aux portes du paradis et les voit déjà s’entrouvrir devant lui, quand il a savouré ce bonheur un instant, puis qu’en une seconde il est précipité du ciel sur la terre, quoi d’étonnant à ce qu’il soit comme assommé et incapable de proférer une parole ? Maurice demeura donc déconcerté et sans voix à côté de la charmante fille qui, avec un rire frais et le cœur léger, venait de lui assener un tel coup.
Le pire, c’est qu’elle ne semblait pas avoir conscience de sa cruauté, car elle parlait maintenant des « autres choses » qui occupaient son esprit, sans accorder une pensée aux paroles de Maurice et au sentiment qui les avait inspirées.
– Mon bon Maurice, poursuivit-elle, écoutez-moi au lieu de dire des bêtises.
Des bêtises ! Parler ainsi !
– Maurice, il faut que vous m’aidiez à trouver le Mouron Rouge.
Les beaux yeux qu’elle fixait sur lui étaient brillants d’enthousiasme – d’un enthousiasme qui n’avait rien à voir avec lui, Maurice. Il ne comprenait pas de quoi il s’agissait. Tout ce qu’il savait, c’est qu’elle avait traité ses prières, ses instances, de « bêtises », et, qu’avec un sourire singulier sur les lèvres, elle lui tournait et retournait une pointe acérée dans le cœur.
Et, mon Dieu, que cela faisait mal !
Mais en même temps elle sollicitait son aide, aussi s’efforça-t-il de comprendre ce qu’elle voulait de lui.
– Voyez-vous, mon bon Maurice, reprit-elle, Jean-Pierre est très malade. Il n’est pas exactement en danger, mais le médecin dit qu’il lui faut respirer l’air pur de la campagne, faute de quoi il ira s’affaiblissant, et rien ne pourra le sauver. Mais comme il est impossible de quitter Paris…
– Quand un médecin prescrit un changement d’air pour un malade, il peut obtenir pour lui le sauf-conduit nécessaire, observa Maurice du ton dont il aurait donné une consultation juridique.
– Ne soyez pas stupide, Maurice, riposta Josette avec impatience. Nous savons tous que le Dr Leroux peut obtenir un sauf-conduit pour Jean-Pierre ; mais il ne peut en obtenir ni pour Mme de Croissy, ni pour moi, et peut-on envoyer Jean-Pierre tout seul à la campagne, sans l’une de nous pour le soigner ?
– Que peut-on faire ?
– Tâchez de prêter attention à ce que je dis, Maurice, lui lança-t-elle. Vous n’avez pas l’air de m’écouter.
– Mais si, protesta-t-il. Je vous jure que si.
– Vraiment ?
– Vraiment, Josette, je vous écoute avec mes deux oreilles et toute mon intelligence.
– Alors, c’est bien. Vous avez entendu parler du Mouron Rouge, n’est-ce pas ?
– Comme tout le monde, vaguement.
– Comment cela, vaguement ?
– Mon Dieu, personne n’est sûr qu’il existe réellement, et…
– Et moi, coupa la bouillante Josette, je sais qu’il existe. Écoutez, Maurice : j’ai pour voisine à l’atelier une fille très gentille, Agnès Minet, qui a été longtemps en service chez une certaine Mme