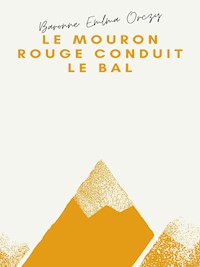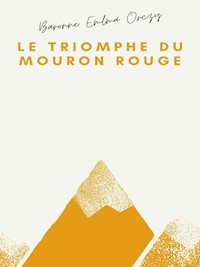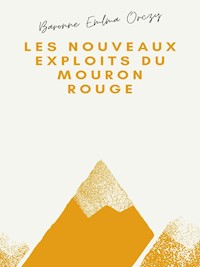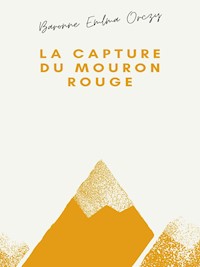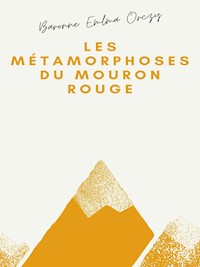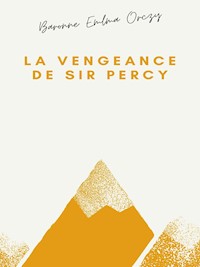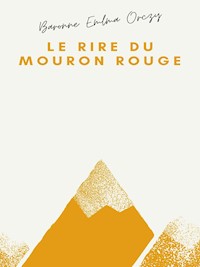
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le septième volet des aventures du Mouron rouge, ce gentilhomme anglais en lutte contre la police de Robespierre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Rire du Mouron rouge
Le Rire du Mouron rougePROLOGUE. Nantes, 1789IIIIIIIVVVIPREMIÈRE PARTIE. Bath, 17931. La lande2. L’Auberge Basse3. La salle de bal4. Le père5. Le nid6. Le Mouron Rouge7. Marguerite8. La route de Portishead9. Les côtes de FranceDEUXIÈME PARTIE. Nantes, décembre 17931. Le repaire du tigre2. Le Bouffay3. Les oiseleurs4. Le piège5. Le message d’espoir6. Le Rat Mort7. La bagarre dans la taverne8. Les chevaliers anglais9. Le proconsul10. Lord TonyPage de copyrightLe Rire du Mouron rouge
Baronne Emma Orczy
PROLOGUE. Nantes, 1789
I
– Tyran ! Tyran ! Ah ! les tyrans !
C’était Pierre Adet qui avait parlé, d’une voix à peine plus forte qu’un chuchotement. Son visage exprimait une passion intense et ses mains crispées semblaient vouloir étrangler un ennemi imaginaire ; ces quelques mots simplement murmurés contenaient tant de haine, tant de force, une détermination si impérative, qu’un silence total s’abattit sur tous les garçons du village de Vertou, assis avec lui dans la salle basse de l’auberge Les Trois Vertus.
Même l’homme à la redingote déchirée et au pantalon usé jusqu’à la corde, qui, juché sur une table, venait de haranguer l’assistance sur les Droits de l’Homme, s’était arrêté au beau milieu de sa péroraison et regardait Pierre d’un œil inquiet, redoutant cette sombre flamme de haine passionnée, que ses propres paroles avaient contribué à attiser.
Le silence n’avait duré que quelques instants ; le moment d’après Pierre fut debout, et un cri, semblable à celui d’un bœuf égorgé, sortit de ses entrailles.
– Au nom de Dieu ! hurla-t-il, cessons ces vaines palabres. N’avons-nous pas assez discuté pour satisfaire nos consciences angoissées ? L’heure a sonné de frapper ces damnés aristocrates, qui ont fait de nous ce que nous sommes : des ignorants, misérables, écrasés, de pauvres diables vidés de tout sens, juste assez bons pour user nos doigts jusqu’à l’os et nos corps jusqu’à l’épuisement, pour qu’eux puissent se vautrer dans leurs plaisirs et leur luxe. Frappez ! répéta-t-il, tandis que ses yeux lançaient des flammes et que sa respiration devenait haletante. Frappez ! comme les hommes et les femmes ont frappé ce fameux jour de juillet à Paris. Pour eux, la Bastille représentait la tyrannie – et ils l’ont abattue comme on décapiterait le tyran, et le despote, intimidé et tremblant, a cédé, il a eu peur de la juste fureur du peuple ! Ce qui est arrivé à Paris doit arriver à Nantes ! Le château du duc de Kernogan est notre Bastille ! Attaquons-le ce soir, et si cet arrogant aristocrate se défend, nous raserons sa demeure. Le jour, l’heure, tout nous est propice. Toutes nos dispositions sont prises, les voisins sont prêts. Frappons !
En disant ces mots, il laissa retomber son poing sur la table avec une telle violence que les gobelets et les bouteilles s’entrechoquèrent. Son enthousiasme avait galvanisé tous ses auditeurs ; sa haine et son désir de vengeance avaient obtenu plus en cinq minutes que toutes les belles paroles des agitateurs, envoyés de Paris pour inculquer les idées révolutionnaires à ces paysans à l’esprit borné.
– Qui donnera le signal ? demanda d’une voix calme un homme d’un certain âge.
– Moi ! rugit Pierre.
Il marcha vers la porte et tous se levèrent, prêts à le suivre, entraînés dans cette folle aventure par la volonté d’un seul homme. Ils suivaient Pierre comme un troupeau de moutons ; c’était vraiment une vision extraordinaire !
Et tout cela avait été provoqué par la mort de deux pigeons… Ce fait, en apparence insignifiant, avait été l’étincelle qui avait mis le feu à toutes ces passions qui couvaient depuis un demi-siècle. Voici ce qui s’était passé :
Antoine Melun, le charron, qui devait épouser Louise Adet, la sœur de Pierre, avait piégé un couple de pigeons dans les bois du duc de Kernogan. Il ne voulait pas ces pigeons, il l’avait fait uniquement pour affirmer ses droits d’homme libre. Il était pauvre, certes, mais pas plus que des centaines d’autres paysans des environs. Mais il payait tant d’impôts et de taxes que le très maigre profit qu’il tirait de son misérable lopin de terre prenait toujours le chemin de l’agent du fisc, alors que M. le duc de Kernogan ne contribuait pas d’un sol aux charges de l’État. Il ne restait donc au charron pour subsister que ce que voulaient bien lui laisser de blé et de seigle, après s’être gavés, les pigeons de M. le duc.
Antoine Melun n’avait nullement l’intention de manger les pigeons, il voulait seulement faire savoir au duc que ni Dieu, ni la nature n’ont décidé que les animaux et les oiseaux d’un bois seraient la propriété exclusive d’un homme, plutôt que d’un autre. Le régisseur en chef de Kernogan le surprit, rentrant chez lui avec son butin.
Antoine fut arrêté pour braconnage et vol et passa en jugement à Nantes, sous la présidence de M. le duc de Kernogan. Et c’est précisément pendant que l’homme à la redingote usée discourait sur les Droits de l’Homme et du Citoyen devant un groupe de villageois réunis dans la salle de l’auberge de Vertou, que quelqu’un apporta la nouvelle qu’Antoine Melun avait été condamné à être emprisonné sa vie durant.
Cette nouvelle agit comme un soufflet sur le feu, et la haine de Pierre Adet pour les aristocrates devint un véritable brasier. Tous les hommes, mus par un même sentiment de révolte devant cette infortune, se rallièrent autour de leur chef. Ce rôle revenait tout naturellement à Pierre, sa haine pour le duc étant plus directe et active que la leur. Il avait également plus d’instruction que les autres. Son père, le meunier Jean Adet, l’avait envoyé à l’école à Nantes et, à son retour de la ville, le curé de Vertou s’était intéressé à ce garçon éveillé et lui avait appris le peu de philosophie et de littérature qu’il savait lui-même. Plus tard, Pierre découvrit les écrits de Jean-Jacques Rousseau et apprit par cœur le Contrat Social. Il lisait également les articles de Marat dans l’Ami du Peuple, et avec son ami Antoine Melun ils conclurent que ni Dieu, ni la nature n’avaient eu l’intention de laisser mourir de faim les uns, tandis que les autres profitaient de tous les biens de ce monde.
Pierre Adet gardait toutes ces idées pour lui, sans en parler ni à son père, ni à sa sœur, ni à M. le curé ; mais ses ruminations allaient bon train et, quand le prix du pain avait monté à quatre sous, il avait murmuré des imprécations contre le duc de Kernogan. Ces imprécations étaient devenues des menaces ouvertes, dès que des prix de famine avaient atteint tout le district, et aux premiers signes de la famine elle-même, qui s’était fait sentir à Vertou, la haine de Pierre contre le duc avait tourné en une furie sans bornes contre toute la noblesse de France.
Il gardait toujours le silence vis-à-vis des siens. Seul son père était au courant. Le vieux meunier voyait de sombres nuages traverser le front de son fils et surprenait les imprécations qui échappaient à Pierre, pendant qu’il travaillait pour le seigneur qu’il abhorrait. Mais Jean Adet était un sage et il connaissait l’impuissance des mots venant d’un vieil homme qui essayerait d’éteindre l’esprit de rébellion chez les jeunes. C’était comme si une faible main avait voulu arrêter le cours d’un torrent.
Il veillait toutefois. Soir après soir, une fois le travail des champs terminé, Pierre se rendait à l’auberge et, pendant des heures, lui et les autres hommes de Vertou discouraient sur l’arrogance des aristocrates, leur injustice, les péchés de M. le duc et de sa famille, la conduite honteuse du roi, l’immoralité de la reine. Des hommes mal vêtus vinrent de Nantes et même de Paris pour haranguer ces villageois et leur en raconter encore sur les innombrables torts des aristocrates envers le peuple, et leur farcir la tête avec des plans destinés à en finir une bonne fois avec tous ces hommes et ces femmes qui s’engraissaient de la sueur du peuple et qui tiraient leur luxe de la faim et de la peine des paysans comme eux.
Pierre absorbait ces discours par tous ses pores : il en faisait sa raison de vivre. Sa haine et sa passion se nourrissaient de ces paroles et toute sa personne était consumée par un désir effréné de vengeance et par l’espoir de triompher un jour de ceux qu’on lui avait appris à craindre.
Aussi, dans cette étroite et sombre salle d’auberge, les hommes de Vertou, l’esprit enfiévré, s’étaient réunis en conseil et les clameurs et les cris s’étaient changés en murmures et en chuchotements derrière les portes barricadées et les fenêtres closes. Les hommes échangeaient des signes impérieux lorsqu’ils se rencontraient dans les rues du village et se lançaient des coups d’œil énigmatiques pendant leur travail ; des villages voisins arrivaient, au milieu de la nuit, des hommes qui repartaient comme ils étaient venus. Les espions de M. le duc ne voyaient rien, ne devinaient rien. M. le curé en vit plus et le vieux Jean Adet devina beaucoup de choses, mais tous deux restèrent muets, car ils savaient bien que toutes leurs paroles seraient vaines. Alors survint la catastrophe.
II
Pierre poussa la porte de l’auberge et sortit. Un violent coup de vent le frappa au visage. La nuit était noire comme de l’encre. Au loin, les lumières de la ville dansaient dans la tempête.
Sans hésiter, Pierre avança dans la nuit. Sa petite troupe le suivait en silence. Dégrisés par l’air frais, les vapeurs du cidre et la chaleur de la salle basse n’obscurcissaient plus leur vue et n’enflammaient plus leurs esprits.
Ils savaient où Pierre se dirigeait. Durant tout l’été, dans la salle malodorante de l’auberge, derrière les portes et fenêtres bien closes, tout avait été minutieusement préparé et ils n’avaient plus qu’à suivre celui qu’ils avaient alors unanimement élu comme chef. Ils le suivaient, les mains enfouies dans les poches de leurs misérables vêtements, têtes baissées pour lutter contre la fureur du vent.
Pierre allait tout droit vers le moulin, où il vivait avec son père et où justement, à cette heure, Louise pleurait de toutes les larmes de son cœur l’injuste condamnation de son fiancé, Antoine Melun.
Derrière le moulin se trouvait la maison d’habitation et, un peu plus loin, se dressaient de petits bâtiments de ferme. Jean Adet, le meunier, possédait un lopin de terre, et si les impôts n’avaient pas toujours englouti tout l’argent provenant de la vente du seigle et du foin, la famille Adet aurait pu vivre à l’aise.
Une pente abrupte montait vers une petite hauteur, d’où l’on pouvait embrasser d’un vaste coup d’œil les villages des environs.
Pierre contourna le moulin et, sans se soucier si les autres le suivaient toujours, il marcha vers la droite en longeant un sentier bordé de peupliers qui menait vers le sommet de la colline, autour de laquelle se groupaient les bâtiments délabrés de la ferme.
La tempête cinglait violemment les troncs hauts et rigides des arbres, qu’elle courbait profondément, et chaque petite branche dénudée gémissait et soupirait comme si elle souffrait. Glacés jusqu’à la moelle dans leurs misérables vêtements, les hommes suivaient dans une sombre détermination, les dents serrées, le cœur dévoré de haine et de fureur.
Ils atteignirent ainsi le haut de la petite montée. Une vaste grange et un groupe de meules de paille se dressaient dans l’obscurité, toutes noires contre le ciel sombre de cette nuit d’orage. Pierre se tourna vers la grange ; ceux qui se trouvaient en avant du groupe le virent s’enfoncer dans cette masse qui prenait dans la nuit un aspect inquiétant.
Soudain, des étincelles jaillirent dans toutes les directions et, l’instant d’après, les hommes distinguèrent la silhouette de Pierre, debout au milieu de la grange, une torche allumée à la main. Ils savaient ce qu’il allait faire maintenant, car tout avait été si longuement préparé que même ces esprits dépourvus de toute imagination prévoyaient ce qui allait se passer. Et pourtant, au moment où l’heure suprême allait sonner, et où Pierre, brandissant la torche, allait donner le signal qui mettrait le feu à la révolte qui grondait dans le pays, leurs cœurs semblaient devoir s’arrêter. Ils retenaient leur souffle et leurs mains calleuses se portaient à leur gorge, comme pour en arracher cette affreuse sensation oppressante qui ressemblait tant à la peur.
Mais Pierre, lui, n’avait aucune hésitation et, quand il sortit de la grange, tous purent voir que ses mains ne tremblaient pas et que son pas était assuré. Des rafales de vent agitaient parfois sa torche qui lançait des étincelles, lui brûlant les mains, et, tandis que les autres, saisis de crainte, s’écartaient, Pierre avançait vers la meule de paille la plus proche.
Une nouvelle fois il brandit sa torche en l’air et un éclair de triomphe brilla dans ses yeux. Il tourna son regard vers l’obscurité, qui se dressait impénétrable hors du cercle de lumière, semblant vouloir arracher à la nuit noire tous ses secrets, tout l’enthousiasme et l’agitation, les passions et la haine qu’il aurait voulu enflammer, comme il allait embraser la meule de paille. Soudain il abaissa la flamme vers la première meule :
– Êtes-vous prêts, mes amis ? cria-t-il.
– Oui ! Oui ! répondirent-ils sans entrain, à voix basse.
La torche toucha la paille sèche, qui se mit aussitôt à crépiter ; le vent avivait l’incendie et des gerbes de flammes grimpaient le long de la meule. Un nouveau coup de vent amena gaiement le feu jusqu’au sommet. Mais Pierre n’attendit pas que le premier brasier fût complètement consumé ; déjà il atteignait la seconde meule et y mettait également le feu ; puis ce fut le tour de la troisième, et ainsi de suite. En l’espace de quelques instants, toute la colline parut embrasée.
Des cris, des jurons, des rires forcés fusèrent de toutes parts, mêlés à des serments de vengeance. La mémoire, telle une sorcière, parcourait invisible l’obscurité et venait toucher chaque cerveau enfiévré de son bâton malfaisant. Chaque homme, se souvenant d’un outrage, d’une injustice, brandissait un poing menaçant dans la direction du château de Kernogan, dont les lumières luisaient faiblement au-delà de la Loire. Partout retentissaient des cris : « Mort aux tyrans ! Les aristos à la lanterne ! Plus de famine ! Plus d’injustice ! Égalité ! Liberté ! À mort les aristos ! »
– En avant ! hurla Pierre.
Et lançant sa torche à terre, il courut de nouveau vers la grange, suivi de tous les autres. À l’intérieur se trouvaient les pauvres armes que les malheureux paysans, démunis de tout, avaient réunies ; des faux, des bâtons, des haches et des scies, enfin tout ce qui pouvait servir à détruire le château de Kernogan et à terroriser le duc et sa famille. Au-dehors, la tempête alternativement attisait le feu ou menaçait de l’éteindre. Par moments la lumière était telle que l’on pouvait distinguer le moindre brin d’herbe, la forme d’une pierre ou l’eau d’une flaque, étincelante comme une opale ; tandis qu’à d’autres moments, une obscurité aussi noire que l’encre envahissait tout, estompant les contours des maisons et recouvrant d’un épais manteau hommes et choses.
Pierre, sans prendre garde ni à la lumière ni à l’obscurité, insensible au froid ou à la chaleur, procédait avec calme et méthode à la distribution de ce primitif attirail de guerre à ces hommes qui étaient maintenant plus que prêts pour faire le mal. En remettant à chacun son arme il savait trouver le mot juste, reçu par une oreille avide, des mots qui savaient attiser le désir de vengeance là où il sommeillait, ou le ranimer chez ceux qui l’avaient étouffé !
– Souvenez-vous ! Souvenez-vous, mes amis ! criait-il avec exaltation ; rappelez-vous chaque coup, chaque injustice, chaque malheur ! Souvenez-vous de votre misère et de sa richesse, de vos croûtes de pain sec et de ses repas succulents, de vos hardes et de ses vêtements de soie et de velours ; rappelez-vous vos enfants affamés, vos mères souffrantes, vos femmes écrasées de soucis et vos filles accablées par le travail. N’oubliez rien de tout cela ce soir, mes amis, et exigez à la grille du château de Kernogan, de son arrogant propriétaire œil pour œil et dent pour dent !
D’assourdissants cris de triomphe saluèrent cette péroraison, les hommes brandirent haches, bâtons, faux et faucilles, et leurs mains tendues vers Pierre s’unirent dans un nouveau serment de fraternité vengeresse.
III
Soudain, en jouant vigoureusement des coudes et des mains, Jean Adet, le meunier, apparut, se frayant un chemin jusqu’à son fils.
– Malheureux, cria-t-il, que te proposes-tu de faire ? Où allez-vous tous ?
– À Kernogan ! hurlèrent-ils en réponse.
– En avant, Pierre ! Nous te suivons ! crièrent quelques-uns avec impatience.
Mais Jean Adet qui, malgré son âge, était encore très vigoureux, avait saisi Pierre par le bras et l’entraînait vers un coin éloigné de la grange.
– Pierre, dit-il sur un ton d’autorité, je t’interdis au nom de l’obéissance et du respect que tu me dois, ainsi qu’à ta mère, de faire un pas de plus dans cette folle aventure. J’étais sur la route, rentrant à la maison, quand l’incendie et les cris insensés de ces malheureux garçons m’ont prévenu qu’une catastrophe se préparait ! Pierre, mon fils, je t’ordonne de déposer cette arme.
Pierre, qui pourtant adorait son père et s’était toujours montré un fils respectueux, se dégagea brutalement de l’étreinte du vieillard.
– Père, s’écria-t-il, ce n’est pas l’heure d’intervenir. Nous sommes tous des hommes et savons ce que nous faisons. Ce que nous voulons accomplir cette nuit a été mûrement réfléchi depuis des semaines et des mois. Je t’en conjure, père, laisse-moi, je ne suis plus un enfant et j’ai du travail à faire.
– Plus un enfant ? s’exclama le vieil homme, en se tournant d’un air suppliant vers les garçons qui, maussades et silencieux, avaient assisté à cette petite scène. Plus un enfant ? Mais vous êtes tous encore des enfants, mes gars. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne connaissez pas les conséquences terribles que votre folle escapade aura pour nous tous, pour le village, oui ! et toute la contrée. Croyez-vous vraiment que le château de Kernogan va se livrer à quelques malheureux bougres sans armes, comme vous ? Mais même à quatre cents, vous n’arriverez pas jusqu’à la cour du château. M. le duc a eu vent depuis quelque temps de vos réunions bruyantes à l’auberge et il a auprès de lui, depuis des semaines, une garde armée, stationnée dans la cour du château ; une compagnie d’artillerie et deux canons montés sur l’enceinte. Mes pauvres garçons, vous allez droit au désastre ! Je vous en supplie, rentrez chez vous ! Oubliez l’aventure de cette nuit ! Seuls de grands malheurs pour vous et les vôtres peuvent résulter de tout cela.
Ils avaient écouté en silence les paroles vibrantes de Jean Adet. Son autorité paternelle commandait le respect, même aux plus violents. Mais tous sentaient qu’ils avaient été trop loin pour reculer maintenant ; la saveur anticipée de la vengeance avait été trop douce pour y renoncer si facilement. La forte personnalité de Pierre, son éloquence chaleureuse, sa force persuasive avaient plus de poids sur leurs esprits que les sages conseils du vieux meunier. Pas un mot ne fut proféré, mais d’un geste instinctif, chaque homme serra son arme encore plus fortement et tous se tournèrent vers leur chef pour attendre ses ordres.
Pierre avait également écouté sans mot dire le discours de son père, s’efforçant de cacher l’anxiété qui dévorait son cœur, de peur que ses camarades ne se laissent influencer et que leur ardeur n’en soit refroidie. Mais quand Jean Adet eut cessé de parler et que Pierre vit chaque homme étreindre son arme, un cri de triomphe s’échappa de ses lèvres.
– Tout cela est inutile, père ! cria-t-il, nous sommes décidés. Une armée d’anges descendus du ciel ne pourrait arrêter notre marche vers la victoire et la vengeance !
– Pierre !… supplia le vieillard.
– C’est trop tard, répondit Pierre fermement ; en avant, mes gaillards !
– Oui ! En avant ! En avant ! s’exclamèrent quelques-uns, nous avons déjà perdu trop de temps comme ça.
– Mais, malheureux garçons, insista le père, qu’allez-vous faire ? Vous n’êtes qu’une poignée, où allez-vous ainsi ?
– Tout droit à la croisée des chemins, père, répondit Pierre. L’incendie des meules, pour lequel je te demande humblement pardon, est le signal convenu qui amènera tous les hommes à notre rendez-vous, ceux de Goulaine et des Sorinières, ceux de Doulon et de Tourne-Bride. Ne crains rien ! Nous serons plus de quatre cents et une compagnie de mercenaires ne saurait nous faire peur. N’est-ce pas, les gars ?
– Non ! Non ! hurlèrent les hommes. Et ils ajoutèrent à voix basse :
– Il y a eu trop de parlotes déjà et nous avons perdu un temps précieux. Le père voulut insister encore, mais personne n’écoutait plus le vieux meunier. Un mouvement général vers la descente de la colline s’était amorcé, et Pierre, tournant le dos à son père, prit la tête de la colonne. Au sommet, le feu brûlait déjà plus doucement ; de temps en temps, une petite flamme sortait encore de la braise mourante et s’agitait dans la nuit. Une sombre lueur rouge éclairait les bâtiments de la ferme et le moulin, ainsi que la masse d’hommes qui se mouvait lentement le long du sentier, tandis que d’épais nuages de fumée s’agitaient dans la tempête. Pierre marchait la tête haute. Il ne pensait plus à son père et il ne se retourna même pas pour voir si les autres les suivaient. Il en était sûr ; comme les meules de paille, ces hommes étaient devenus la proie d’un feu dévorant. Les flammes de leur propre passion les mordaient au cœur et ne les abandonneraient plus jusqu’à leur assouvissement dans la victoire ou dans la défaite.
IV
Le duc de Kernogan venait à peine de terminer son dîner lorsque le régisseur en chef, Jacques Labrunière, entra et lui apprit qu’une foule en délire, composée de paysans de Goulaine et de Vertou, ainsi que des villages environnants, s’était rassemblée à la croisée des chemins, où il s’était tenu des discours révolutionnaires et qu’elle était actuellement en marche vers le château, hurlant, chantant et brandissant des armes hétéroclites, principalement des faux et des haches.
– La garde est à sa place, je pense ? fut la seule réponse du duc en apprenant cette nouvelle, qui n’était pas imprévue pour lui.
– Tout est parfaitement en ordre pour la sauvegarde de monseigneur, de mademoiselle, ainsi que du château, répliqua d’un ton calme le régisseur.
En entendant prononcer le mot « mademoiselle », le duc, qui était confortablement installé dans un des grands fauteuils au milieu du hall imposant de Kernogan, pâlit et se leva brusquement, une expression d’angoisse dans les yeux.
– Ma fille ! s’écria-t-il d’un ton précipité. Oh ! mon Dieu ! Labrunière, j’avais complètement oublié…
– Quoi, monsieur le duc ? s’écria le régisseur affolé.
– Mlle de Kernogan doit être sur le chemin du retour ; elle a passé la journée chez Mme la marquise d’Herbignac et devait être rentrée vers huit heures… Si jamais ces diables rencontrent sa voiture sur la route…
– Monsieur le duc a tort de s’inquiéter, interrompit Labrunière avec précipitation ; je vais ordonner qu’une demi-douzaine d’hommes partent immédiatement à cheval pour se porter à la rencontre de mademoiselle et l’escorter jusqu’au château.
– Oui, oui, mon brave, que le nécessaire soit fait à l’instant même ! murmura le duc d’une voix défaillante. (L’idée que sa fille pouvait courir de graves dangers l’avait anéanti.) Je ne vivrai pas jusqu’à son retour. Faites vite ! vite !
Labrunière sortit en courant pour prendre les mesures nécessaires, laissant le duc le visage enfoui entre ses mains tremblantes, dans un état de prostration complète.
Il connaissait parfaitement la haine de ces paysans envers lui et sa famille.
C’est pour cette raison que le duc avait mis sur pied, à ses frais, une compagnie d’artillerie stationnée dans l’enceinte du château. Avec l’arrogant mépris des aristocrates pour les paysans qu’il n’avait pas encore appris à craindre, il s’était refusé à prendre d’autres mesures, telles qu’interdire les réunions au village par exemple, ne voulant pas donner à la populace la satisfaction de leur montrer la moindre inquiétude.
Mais de savoir justement sa fille Yvonne sur les routes ce soir, exposée à cette même foule apparemment prête à agir, lui faisait envisager maintenant les choses d’une tout autre manière. Des insultes, des outrages, pire peut-être, pouvaient atteindre l’unique enfant de cet aristocrate. Sachant qu’elle ne pouvait attendre ni pitié, ni le moindre esprit chevaleresque de la part de ces gens, le duc, au milieu de son château inviolable, ressentait pour sa fille les craintes les plus violentes qu’un homme puisse éprouver.
Quelques instants après, Labrunière revint et s’efforça de rassurer son maître.
– Monseigneur, j’ai donné l’ordre de seller les six meilleurs chevaux ; les hommes prendront le raccourci à travers champs vers la Gramoire, pour intercepter la voiture de mademoiselle avant quelle atteigne la croisée des chemins. Je suis sûr qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer, ajouta-t-il avec empressement…
– Que Dieu vous entende, Labrunière ! murmura le duc. Savez-vous de combien d’hommes se compose la foule ?
– Pas exactement, monseigneur. Camille, mon assistant, qui m’a apporté les nouvelles, rentrait à cheval à travers les herbages il y a une heure environ. Il aperçut un grand incendie du côté du moulin d’Adet, le ciel était entièrement embrasé par une lueur sinistre ; il a poussé sa monture vers le sommet de la colline, derrière la ferme du meunier. Il a entendu des cris, mais personne ne paraissait vouloir éteindre le feu. Il est alors descendu de cheval et s’est faufilé entre les bâtiments pour éviter d’être aperçu. Protégé par l’obscurité, il a vu le vieux meunier et son fils en train de distribuer des faux, des bâtons et des haches à une foule de garçons qu’ils excitaient au combat. Il a surpris également Pierre Adet qui disait que l’incendie était un signal convenu, que lui et ses camarades devaient rencontrer les hommes des villages voisins à la croisée des chemins et que quatre cents d’entre eux marcheraient sur Kernogan pour piller le château.
– Bah ! s’écria le duc, d’un ton plein de mépris et d’exécration, une poignée d’imbéciles qui donneront beaucoup de travail demain au bourreau. Quant à cet Adet et à son fils, ils me paieront tout cela, je peux le leur garantir… Si seulement ma fille était rentrée ! ajouta-t-il avec un soupir déchirant.
V
En effet, si le duc de Kernogan avait eu le don de double vue, son angoisse eût été mille fois plus grande. Au moment même où le régisseur faisait de son mieux pour rassurer son maître au sujet de la sécurité de Mlle de Kernogan, sa voiture se dirigeait bon train venant du château d’Herbignac, précisément vers cette croisée des chemins, rendez-vous de quelques centaines de paysans exaltés et qui projetaient de faire tout le mal que leurs esprits obtus pouvaient imaginer.
La tempête soufflait toujours avec autant de violence et maintenant une forte pluie s’était mise à tomber. L’enthousiasme des pauvres diables avait considérablement diminué. Soixante étaient venus de Goulaine, quarante des Sorinières et trois douzaines de Doulon. Ils s’étaient ralliés en grande hâte lorsqu’ils avaient aperçu le signal convenu, armés de piques et de pelles. Leurs villages étant plus près de là que celui de Vertou, ils étaient arrivés très excités et pleins d’entrain au rendez-vous avant les autres, au moment même où ceux-ci écoutaient encore les vaines exhortations de Jean Adet. Mais l’attente sous la pluie torrentielle avait rafraîchi leur ardeur en même temps que leurs vêtements s’étaient imbibés d’eau, et le retard de leurs compagnons commençait à les inquiéter.
Malgré cela, cette troupe restait très dangereuse, et la prudence aurait dû dicter à Mlle de Kernogan de donner l’ordre à son vieux cocher de faire demi-tour et de retourner à Herbignac, plutôt que de continuer. En effet, un de ses piqueurs, envoyé en éclaireur, était revenu disant qu’une foule armée était rassemblée au dit lieu et qu’il serait très imprudent d’avancer.
Déjà, depuis un moment, on pouvait percevoir une clameur dominant le bruit de la voiture et des chevaux. Le cocher avait arrêté l’équipage en attendant le retour du piqueur envoyé en avant. Au récit de ce dernier, qui ajouta qu’il avait entendu des imprécations et des menaces contre Sa Seigneurie et que l’incendie aperçu de loin avait été sans doute le signal de la révolte, la prudence commandait le retour.
À ce moment, mademoiselle sortit la tête de la portière pour demander ce qui se passait. En apprenant les nouvelles et voyant que ses gens conseillaient la retraite, elle se moqua de leur couardise.
– Jean-Marie, appela-t-elle en s’adressant dédaigneusement au vieux serviteur au service de son père depuis cinquante ans, ne me dites pas que vous craignez vraiment cette populace !
– N… non, mademoiselle, ne vous en déplaise, rétorqua le vieillard, piqué dans son amour-propre par cette raillerie, mais j’ai la responsabilité de votre sécurité et nos paysans ont un bien mauvais esprit depuis quelque temps.
– Continuez ! C’est un ordre, et vous devez obéir, répondit Mlle de Kernogan d’un ton péremptoire, qu’un petit rire joyeux adoucissait. Si mon père apprenait qu’il y a des émeutes sur la route, il mourrait d’inquiétude de ne pas me voir revenir. Fouettez les chevaux, mon brave. Personne n’osera attaquer la voiture.
– Mais, mademoiselle…, voulut protester le cocher.
– Ah ça ! l’interrompit-elle impatiemment. Va-t-on me désobéir ? Si vous ne respectez pas mes ordres, Jean-Marie, vous n’avez plus qu’à vous joindre à cette bande !
Le vieux serviteur ne put qu’obéir à cette sévère réprimande. Il essaya de pénétrer du regard le rideau aveuglant de pluie qui cinglait son visage et agaçait les chevaux. Mais l’éblouissement des lanternes de la voiture l’empêchait de voir loin dans l’obscurité. Il eut quand même la sensation qu’une masse humaine avançait vers l’équipage et que les cris et bruits venant de cette foule excitée s’étaient considérablement rapprochés depuis un moment. Sans doute les rebelles avaient-ils aperçu les lumières et ils avançaient maintenant vers la voiture. Jean-Marie ne pouvait que trop deviner quelles étaient leurs intentions.
Mais il avait des ordres et l’idée d’y manquer ne l’effleurait même pas. Il fit donc ce qu’on lui commandait et d’un coup de fouet il mit au galop ses chevaux, d’admirables bêtes très nerveuses, qui obéissaient au moindre signe. Mlle de Kernogan se laissa retomber sur les coussins, satisfaite d’avoir été obéie et nullement inquiète.
Quelques minutes après, à peine, elle ressentit une brusque secousse ; la voiture venait de faire un bond terrible. Les chevaux s’étaient cabrés, puis avaient bronché ; des clameurs assourdissantes s’élevaient de toutes parts, des hommes hurlaient et juraient. Au choc de leurs armes contre la voiture se mêlaient le sifflement du fouet, le piétinement des chevaux et le bruit sourd des corps tombant dans la boue. Les lanternes de la voiture avaient été arrachées et brisées, mais malgré l’obscurité, Yvonne de Kernogan avait l’impression de voir des visages grimaçants et défigurés par la haine se presser contre les portières. En dépit de cet indescriptible désordre, la voiture continuait d’avancer. Jean-Marie était comme rivé à son poste, ainsi que le postillon et les quatre piqueurs. Jouant du fouet et avec des paroles encourageantes, ils pressaient les chevaux d’avancer dans la foule, renversant et piétinant les hommes, sans égard pour les vies humaines, sourds à tous les blasphèmes et à toutes les malédictions lancés contre eux et les occupants de la voiture, dont la populace ignorait encore l’identité.
Mais l’instant d’après, la voiture s’arrêta net et un cri sauvage couvrit les gémissements des blessés :
– Kernogan ! Kernogan !
– Ah ! suppôts du diable, cria le cocher. Vous regretterez tout cela et pleurerez des larmes de sang le reste de votre vie, c’est moi qui vous le dis. Mademoiselle est dans la voiture. Quand M. le duc apprendra ce qui s’est passé, il y aura du travail pour le bourreau…
– Mademoiselle est dans la voiture ! interrompit une voix rauque, sur un ton brutal, allons voir ça…
– Oui ! Oui ! allons tous la voir, hurla la foule, en ajoutant une bordée d’injures.
À l’intérieur de la voiture, Yvonne de Kernogan osait à peine respirer. Elle était assise toute droite, serrant sa pèlerine autour de ses épaules. Ses yeux agrandis, non par la peur, mais par la surexcitation, fixaient l’obscurité au-delà de la vitre. Elle ne voyait rien, mais sentait la présence de cette foule hostile qui avait réussi à maîtriser le cocher et était décidée à lui faire du mal.
Mais elle appartenait à une race qui n’avait jamais compté la lâcheté parmi ses nombreux défauts. Durant ces courts instants où elle savait que sa vie ne tenait qu’à un fil, elle n’avait ni crié, ni perdu connaissance. Soudain la portière fut violemment ouverte et elle put distinguer vaguement des formes humaines qui s’agitaient. Elle demeura sans bouger, mais quand elle se sentit brusquement saisie au poignet elle dit calmement, avec un léger frémissement dans la voix :
– Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Un rire brutal fut la réponse.
– Qui nous sommes, ma charmante dame ? s’écria celui qui lui avait saisi le poignet et se trouvait maintenant à moitié hissé dans la voiture, nous sommes ceux qui trimons toute notre vie, sans jamais manger à notre faim, tandis que des gens comme vous voyagent dans de belles voitures et mangent plus qu’ils n’en peuvent. Ce que nous voulons ? Mais simplement le spectacle d’une si charmante dame comme vous, renversée dans la boue comme le sont nos mères et nos femmes, quand il leur arrive de se trouver sur le passage de votre voiture. N’est-ce pas cela, mes amis ?
– Oui-da ! répondirent-ils avec convoitise. Dans la boue, la demoiselle ! Sors-la, Adet ! Laisse-nous voir de quoi elle aura l’air, la figure dans la boue ! Vite, sortons-la !
Mais l’homme qui avait été ainsi apostrophé n’obéit pas immédiatement. Tenant toujours le poignet de la jeune fille, il l’attira contre lui et soudain lui jeta un de ses bras rude et barbouillé de poussière autour de la taille ; soulevant de l’autre son capuchon, il lui maintint son fin visage à hauteur du sien.
Yvonne de Kernogan n’était certes pas une lâche, mais au contact atroce de cet homme, elle fut saisie d’une peur si intense qu’elle faillit perdre connaissance. Malheureusement, elle n’eut pas cette chance et devait garder de cette scène un souvenir qui hanterait toute sa vie. Elle ne pouvait distinguer le visage de l’homme, mais sentait son haleine brûlante sur ses joues et l’odeur âcre de ses vêtements trempés monter vers elle. Elle pouvait entendre ses chuchotements rauques, car pendant l’espace de quelques secondes il la tint serrée contre lui, dans une étreinte qui lui sembla plus terrifiante que celle de la mort.
– Juste pour vous punir, ma gente dame, murmura-t-il avec un tel accent qu’elle fut secouée d’un frisson d’horreur, pour vous punir de ce que vous êtes, fière, méprisante, de la race des tyrans, un tyran en herbe vous-même, pour chaque malheur que nos femmes ont dû supporter et pour tout le luxe dont vous avez joui, je vous embrasserai sur les lèvres, sur les joues, je couvrirai votre visage et votre col blanc de baisers qui seront comme autant de marques indélébiles. Ces baisers, qui vous viennent de quelqu’un qui vous déteste et vous exècre, vous brûleront pour le reste de votre vie comme un souvenir infâme. Celui qui vous tient à sa merci n’est qu’un pauvre paysan, que vous considérez comme la lie de la terre.
D’horreur Yvonne avait fermé les yeux et on l’entendait à peine respirer, mais à travers sa demi-pâmoison, elle put malgré tout percevoir ces mots cruels et subir la souillure atroce, car cet être, qu’elle haïssait et craignait comme le diable, possédé par l’esprit du mal, couvrait maintenant son visage et sa gorge de baisers ardents.
Son souvenir s’arrêta là ; heureusement pour elle, un profond évanouissement suivit cette épreuve abominable. Quand elle reprit connaissance, elle était revenue au château et reposait entre les bras de son père. Un murmure confus parvenait jusqu’à ses oreilles. Petit à petit elle put comprendre ce qui se disait. Jean-Marie, le postillon et les piqueurs étaient en train de faire au duc, qui les harcelait de questions, le récit de ce qui s’était passé. Ces hommes ignoraient naturellement tout du drame poignant qui s’était joué à l’intérieur de la voiture. Tout ce qu’ils savaient était qu’une foule brutale, composée d’une centaine d’hommes, avait entouré l’équipage, agitant des bâtons et des faux ; qu’ils avaient fait des efforts désespérés pour briser ce groupe menaçant et continuer la route à tout prix, mais que quelques-uns de ces diables, plus audacieux que les autres, avaient saisi les chevaux et maîtrisé les fidèles serviteurs. Croyant tout perdu, ceux-ci n’avaient eu comme principal souci que de protéger mademoiselle. Jean-Marie avait voulu descendre de son siège et tirer les pistolets de ses bottes pour repousser les assaillants, quand heureusement ils avaient perçu au loin au bruit de galop malgré l’effroyable tumulte de la canaille en délire. Jean-Marie avait pensé immédiatement que ce devait être une compagnie de soldats de Sa Seigneurie, venue à leur rencontre. Cela lui avait donné des forces nouvelles et l’inspiration de commander au postillon Carmail de tirer en l’air ou même dans la foule, peu importait. Ce coup de feu avait eu un effet magique sur les chevaux déjà affolés. Ils s’étaient cabrés et, d’un bond formidable, avaient fendu la foule, mais heureusement que le cocher les avait parfaitement en main. Les cavaliers qui s’approchaient à toute allure leur avaient lancé des cris d’encouragement qu’ils avaient pu distinguer au-dessus de l’indescriptible mêlée générale. Fouettant ses chevaux, le cocher n’avait rien vu d’autre que la tête de ses bêtes, mais les autres serviteurs déclarèrent que la panique avait été incroyable et que des hommes avaient été écrasés, tandis que d’autres disparaissaient dans la nuit.
Ce qui était arrivé après, aucun de ces hommes ne le savait. D’un train endiablé l’équipage avait volé jusqu’au château sans se retourner.
VI
Si M. le duc avait eu la haute main sur la justice et la distribution des peines, sans aucun doute le bourreau de Nantes aurait eu fort à faire. De nombreuses arrestations avaient eu lieu le lendemain, la moitié de la population mâle de la contrée était compromise dans cette jacquerie manquée et la prison de la ville ne suffisait pas pour contenir tout ce monde.
Une cour de justice, présidée par le duc et composée d’une demi-douzaine d’hommes plus ou moins directement sous ses ordres, prononça contre les révoltés des jugements sommaires qui devaient être exécutés, aussitôt que les mesures nécessaires auraient été prises pour cette mise à mort collective. Nantes était devenue une ville remplie de lamentations : les paysannes, mères, filles et épouses des condamnés, venues de leurs villages, en appelant à la clémence de M. le duc, assiégeaient la cour de justice improvisée, s’accrochant aux grilles de la prison, portant leurs clameurs devant la résidence du duc et à l’archevêché. La foule des malheureuses, que les laquais étaient impuissants à contenir et à maîtriser, pénétra de force dans ces palais, sollicitant le droit d’en appeler directement à M. de Kernogan qui tenait entre ses mains la vie de leurs hommes.
La municipalité de Nantes se tenait à l’écart de cette conjoncture tragique et les conseillers et hauts fonctionnaires de la ville s’enfermèrent avec leur famille dans leurs maisons, pour n’être pas témoins des scènes poignantes qui se déroulaient sans cesse à la cour de justice et autour de la prison. Le maire lui-même était impuissant à remédier à cet état de choses, mais on apprit plus tard qu’il avait envoyé un courrier secret à Paris, auprès de M. de Mirabeau, qui était un de ses amis personnels, avec un rapport détaillé sur cette jacquerie et lui rendant compte des représailles horribles que le duc de Kernogan se proposait de faire. Il avait ajouté une requête pressante pour que, émanant des plus hautes autorités, viennent des ordres pour atténuer autant que possible les rigueurs de M. le duc.
Le pauvre roi Louis XVI, terrorisé maintenant par l’Assemblée nationale et ébloui par l’éloquence de M. de Mirabeau, n’était que trop disposé à faire des concessions à l’esprit démocratique du jour, et souhaitait que la noblesse fût également prête à faire de même. Il envoya donc une lettre personnelle au duc, lui ordonnant de montrer de la compréhension et de la pitié pour ces jeunes paysans égarés, dont la loyauté et la fidélité, insistait le roi, pourraient être sûrement regagnées par un geste de clémence.
À l’ordre du roi, il ne pouvait être désobéi et le même trait de plume qui devait envoyer une cinquantaine de paysans à la mort, leur accorda la liberté et le pardon magnanime du duc. Mais la seule exception à cette amnistie générale fut pour Pierre Adet. Les serviteurs du duc avaient témoigné l’avoir vu ouvrir la portière et se tenir un bon moment à moitié hissé dans la voiture, probablement pour terroriser mademoiselle. Celle-ci refusait soit de confirmer, soit de rejeter cette déclaration. On avait trouvé Yvonne de Kernogan, sans connaissance, dans le fond de la voiture en arrivant au château et depuis elle était très malade. Des médecins, appelés en hâte de Paris, avaient constaté un violent choc nerveux et on supposait qu’elle avait perdu tout souvenir des événements terribles de cette nuit.
Mais dans sa soif de vengeance, le duc de Kernogan était très satisfait de constater que c’était apparemment la présence de Pierre Adet dans l’intérieur de la calèche qui avait occasionné la mystérieuse maladie de sa fille, ainsi que cette déchirante expression de terreur qui, depuis, ne quittait plus son regard. De ce fait, M. le duc était resté implacable en ce qui concernait cet homme et eu égard aux sentiments d’un père outragé, aussi bien le maire de Nantes que les hauts fonctionnaires de la ville avaient approuvé à l’unanimité la condamnation d’Adet.
Cependant l’exécution de Pierre, le fils de Jean Adet, le meunier de Vertou, n’avait pu avoir lieu pour la simple raison qu’il avait disparu et que les plus minutieuses recherches à travers toute la campagne, dans un rayon considérable, n’avaient donné aucun résultat. L’un des piqueurs, qui accompagnait mademoiselle cette nuit fatale, avait déclaré que, lorsque le cocher, à l’approche de la colonne de renfort, avait finalement réussi à dégager la voiture, il avait cru voir Pierre Adet tomber à la renverse du marchepied et être écrasé par les roues arrière. Mais on n’avait pas retrouvé son corps parmi tous ceux qui gisaient morts sur la route et que les hommes et les femmes du village étaient venus reconnaître, pour les ensevelir et les pleurer.