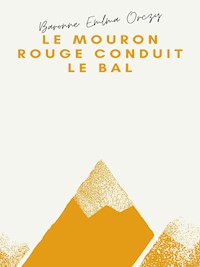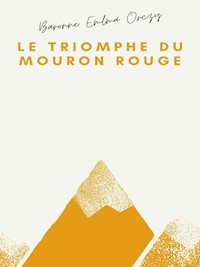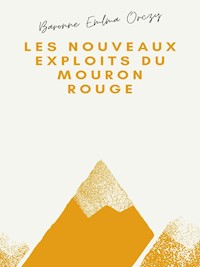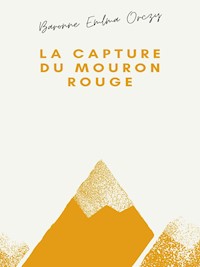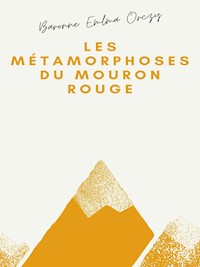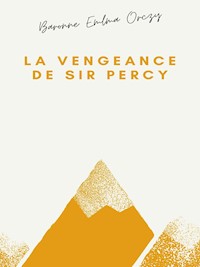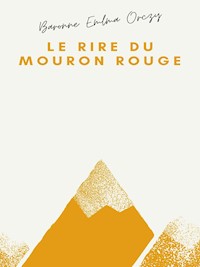Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En pleine Révolution Française, un gentilhomme anglais se dresse contre les excès de la Terreur, lutte contre la police de Robespierre pour sauver d'innocentes victimes promises à la guillotine. Il signe chacun de ses exploits avec un billet et un sceau figurant la fleur du Mouron rouge. Rien ne manque à ce parfait pourfendeur de l'injustice et du crime: il est mystérieux, endiablé, bondissant, enflammé, galant, amoureux, invincible... et il a un ennemi à la hauteur de ses qualités: l'horrible Chauvelin, chef de la police secrète de Robespierre. Mélanges de suspense, d'intrigues, de passions et de coups de théâtre, les romans de cette saga n'ont pas pris une ride: lorsque vous aurez commencé Le Mouron rouge, vous ne le lacherez pas avant de l'avoir terminé...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Mouron rouge
Le Mouron rouge1. La barrière de Neuilly2. Douvres : au Repos du Pêcheur3. Les réfugiés4. La ligue : le Mouron Rouge5. Marguerite6. Un élégant de 927. Le verger secret8. L’agent accrédité9. L’attentat10. À l’opéra11. Le bal de Lord Grenville12. Le billet13. L’un ou l’autre14. Une heure précise15. Doute16. Richmond17. Bon voyage !18. L’emblème mystérieux19. Le Mouron Rouge20. L’ami21. Arrêt22. Calais23. Espoir24. Le guet-apens25. L’aigle et le renard26. Le juif27. Sur la piste28. La hutte du père Blanchard29. Prise30. Le yacht31. SauvésPage de copyrightLe Mouron rouge
Baronne Emma Orczy
1. La barrière de Neuilly
Une foule grouillante, bruissante et houleuse d’êtres qui n’ont d’humain que le nom, car à les voir et les entendre, ils ne paraissent que des créatures féroces, animées par de grossières passions et par des appétits de vengeance et de haine. L’heure : quelques minutes avant le coucher du soleil ; et le lieu : la barrière de Neuilly, non loin de l’endroit où plus tard un tyran orgueilleux éleva un monument immortel à la gloire de la nation et à sa propre vanité.
Pendant presque tout le jour, la guillotine avait été occupée à sa hideuse tâche : tout ce dont la France avait été fière dans les siècles passés, en fait de noms anciens et de race noble, avait payé tribut à la liberté et à la fraternité. Le massacre n’avait cessé qu’à cette heure tardive de la journée, car il y avait maintenant pour le peuple d’autres spectacles plus intéressants à voir, un peu avant la fermeture définitive des portes.
La foule quitta en hâte la place de Grève, et se dirigea vers les différentes barrières afin d’assister à ce spectacle captivant.
On pouvait le voir tous les jours, car ces aristos étaient si bêtes. Ils étaient naturellement traîtres au peuple, tous, hommes, femmes et enfants, descendants des grands hommes qui, depuis les croisades, avaient fait la gloire de la France et constitué sa vieille noblesse. Leurs ancêtres avaient opprimé le peuple et l’avaient écrasé sous les talons rouges de leurs élégants souliers à boucles, et aujourd’hui le peuple était devenu le souverain de la France et écrasait ses anciens maîtres, non pas sous ses talons, car à cette époque la plupart des gens du peuple allaient pieds nus, mais sous un poids plus effectif : le couteau de la guillotine.
Et chaque jour, chaque heure, l’affreux instrument de torture réclamait ses nombreuses victimes, hommes âgés, jeunes femmes, petits enfants, jusqu’au jour où il devait exiger après la tête d’un roi celle d’une reine jeune et belle.
Mais cela allait de soi : le peuple ne gouvernait-il pas la France ? Tout aristocrate était un traître, tous ses ancêtres l’avaient été avant lui : pendant deux cents ans, le peuple avait sué, avait peiné, était mort de faim, pour entretenir une cour débauchée dans une extravagante prodigalité ; et maintenant les descendants de ceux qui avaient aidé à rendre cette cour si brillante avaient à se cacher pour échapper à la mort, à s’enfuir s’ils voulaient éviter la vengeance tardive du peuple.
Oui, ils cherchaient à se cacher, ils cherchaient à s’enfuir ; de là le plaisir ! Chaque après-midi avant la fermeture des portes, lorsque les voitures des maraîchers s’en allaient en processions par les diverses barrières, il y avait quelques fous d’aristos qui tentaient de s’échapper des griffes du Tribunal révolutionnaire. Sous différents déguisements, sous divers prétextes, ils essayaient de se glisser à travers les portes si bien gardées par les soldats-citoyens de la République. Hommes en femmes, femmes en hommes, enfants en haillons : il y en avait de toutes sortes : ci-devant comtes, marquis et même ducs, qui voulaient s’enfuir de France, atteindre l’Angleterre ou quelque autre pays maudit, et là, chercher à exciter l’étranger contre la glorieuse Révolution, ou à lever une armée pour délivrer les malheureux prisonniers du Temple, qui naguère s’appelaient la famille royale de France.
Mais ils étaient presque toujours pincés aux barrières. Le sergent Bibot surtout, à la barrière de Neuilly, avait un flair extraordinaire pour reconnaître un aristo sous le plus parfait déguisement. C’est alors que le jeu commençait. Bibot regardait sa proie comme un chat regarde une souris, il jouait avec elle pendant un bon quart d’heure quelquefois, faisait semblant d’être trompé par l’apparence, par la perruque et les autres arrangements d’acteurs qui cachaient l’identité d’un noble comte ou d’une marquise.
Oh ! ce Bibot, quel rude farceur ! Et l’on ne perdait point son temps en flânant autour de cette barrière de Neuilly pour le voir attraper un aristo au moment même où celui-ci cherchait à fuir la vengeance du peuple.
Parfois, Bibot laissait sa proie franchir la porte, lui permettant de croire pendant deux minutes que réellement elle s’était évadée de Paris, et que même elle pourrait atteindre en sûreté la côte anglaise : il laissait le pauvre malheureux marcher dix mètres vers la campagne et, alors, il envoyait après lui deux hommes pour le ramener démasqué.
Oh ! c’était très drôle, car une fois sur deux, le fugitif se trouvait être une femme, quelque fière marquise, à l’air terriblement comique, quand elle finissait par se trouver dans les griffes de Bibot, sûre de ce qui l’attendait le lendemain : un procès sommaire et ensuite la douce étreinte de madame Guillotine.
Il n’y avait rien d’étonnant à ce que, par cette belle soirée, autour de la porte de Bibot, la foule fût impatiente et excitée. La soif du sang croît lorsqu’on cherche à l’apaiser, jamais on ne l’étanche : pendant la journée, la foule avait vu tomber cent têtes sous le couteau, elle voulait s’assurer que le lendemain elle en verrait tomber cent autres.
Bibot était assis contre la grille de la barrière, sur un tonneau vide renversé : il avait sous ses ordres un petit détachement de citoyens-soldats. Dans ces derniers temps la besogne avait été dure, les maudits aristos commençaient à être terrifiés et cherchaient de leur mieux à se glisser hors de Paris : hommes, femmes et enfants dont les ancêtres, même dans les temps reculés, avaient servi ces traîtres de Bourbons, étaient tous des traîtres eux-mêmes et n’étaient qu’une juste pâture pour le couperet.
Tous les jours Bibot avait eu le plaisir de démasquer quelques royalistes fugitifs et de les renvoyer au Tribunal révolutionnaire, à la merci de ce bon patriote, le citoyen Fouquier-Tinville.
Robespierre et Danton l’avaient tous deux félicité de son zèle, et Bibot était fier d’avoir, sur sa propre initiative, envoyé à la guillotine cinquante aristos au moins.
Aujourd’hui tous les sergents qui commandaient aux différentes portes avaient reçu des ordres spéciaux. Récemment, un grand nombre de ci-devant avaient réussi à se sauver de France et à gagner l’Angleterre. Il courait des bruits curieux à propos de ces disparitions : elles étaient devenues très fréquentes et extraordinairement audacieuses ; l’opinion publique en était étrangement surexcitée. Le sergent Grospierre avait été condamné à mort pour avoir, à la porte Nord, laissé filer sous ses yeux toute une famille de ci-devant.
On assurait que ces évasions étaient organisées par une bande d’Anglais, dont la témérité était sans égale et qui, par pure manie de se mêler de ce qui ne les regardait pas, occupaient leurs loisirs à enlever à madame Guillotine ses victimes légales.
Ces bruits s’étaient bientôt accrus d’une façon extravagante. Personne ne doutait que cette bande d’Anglais n’existât ; elle semblait se trouver sous la direction d’un homme dont l’audace et le courage étaient presque fabuleux. D’étranges histoires circulaient : comment lui et les aristos qu’il sauvait devenaient soudainement invisibles en arrivant aux barrières, et comment ils s’échappaient des portes par un moyen surnaturel.
Personne n’avait vu ces mystérieux Anglais ; quant à leur chef, on n’en parlait jamais qu’avec un frisson superstitieux.
Pendant la journée, le citoyen Fouquier-Tinville recevait de quelque source inconnue un bout de papier ; quelquefois il le trouvait dans la poche de son manteau ; d’autres fois, quelqu’un le lui tendait dans la foule, quand il se rendait à la séance du Tribunal révolutionnaire. Le papier contenait toujours l’avis succinct que la bande d’Anglais intrigants était à l’œuvre et toujours il était signé d’une marque rouge : une petite fleur en forme d’étoile, celle que l’on appelle le mouron rouge.
Quelques heures après la réception de cet impertinent avis, les citoyens du Tribunal révolutionnaire apprenaient qu’un certain nombre de royalistes et d’aristocrates avaient réussi à gagner la côte et allaient chercher leur salut en Angleterre. Les gardes avaient été doublées aux portes, les sergents qui y commandaient avaient été menacés de mort, tandis que de généreuses récompenses avaient été promises à celui qui ferait prisonniers ces audacieux et insolents Anglais. On avait promis cinq mille francs à celui qui mettrait la main sur le mystérieux et insaisissable Mouron Rouge.
Chacun pensait que Bibot aurait ce bonheur. Bibot laissait cette idée prendre racine dans l’esprit de tous. Aussi chaque jour venait-on le voir à la barrière de Neuilly, dans l’espoir d’être là quand il arrêterait quelque aristo fugitif, qui peut-être serait accompagné de l’Anglais mystérieux.
– Bah ! dit-il à son fidèle caporal, le citoyen Grospierre était un sot ! Si j’avais été moi, à la barrière de Clichy, la semaine dernière… Le citoyen Bibot cracha par terre pour exprimer son mépris de la stupidité de son collègue.
– Comment est-ce arrivé, citoyen ? demanda le caporal.
– Grospierre était à la porte faisant bonne garde, commença Bibot avec emphase, pendant que la foule s’écrasait autour de lui pour écouter avidement son récit. Tous, nous avons entendu parler de ce mêle-tout d’Anglais, ce maudit Mouron Rouge. Il ne passera pas cette porte, morbleu, à moins qu’il ne soit le diable ! Mais Grospierre était un sot. Les voitures franchissaient la grille, il y en avait une chargée de tonneaux et conduite par un vieil homme, avec un gamin à côté de lui. Grospierre était saoul, mais il se croyait très malin ; il regarda dans les tonneaux, dans la plupart du moins, vit qu’ils étaient vides et laissa passer le chariot.
Un murmure de colère et de réprobation parcourut le groupe de malheureux déguenillés qui entouraient le citoyen Bibot.
– Une demi-heure plus tard, continua le sergent, arrive un capitaine de la garde accompagné d’une douzaine d’hommes. « Est-ce qu’une voiture a passé ? demanda-t-il hors d’haleine à Grospierre. – Oui, répond Grospierre, il y a moins d’une demi-heure. – Et vous les avez laissés passer ! s’écrie le capitaine avec fureur ; vous expierez cela sur la guillotine, citoyen-sergent ; cette voiture cachait le ci-devant duc de Chalis et toute sa famille ! – Quoi ? éclate Grospierre ébahi. – Oui, et le conducteur n’était personne d’autre que ce maudit Anglais, le Mouron Rouge.
Un cri d’exécration accueillit ce récit. Le citoyen Grospierre avait payé sa bévue sur la guillotine, mais quel sot ! oh ! quel sot !
Bibot riait tant de son histoire qu’il lui fallut quelques secondes avant de continuer.
– « Poursuivez-les, mes braves ! s’écrie le capitaine, pensez à la récompense ! poursuivez-les ! ils ne peuvent être bien loin ! » Et là-dessus il s’élance par la porte suivi de ses douze soldats.
– Mais il était trop tard ! hurla la foule excitée.
– Jamais ils ne les rattrapèrent.
– Au diable, Grospierre ! Quelle folie !
– Il a mérité son sort.
– Quelle drôle d’idée de ne pas examiner ces tonneaux avec soin !
Ces saillies parurent amuser extrêmement le citoyen Bibot qui rit jusqu’à en avoir mal aux côtes et à pleurer à grosses larmes.
– Non, non, dit-il enfin, ces aristos n’étaient pas dans les tonneaux ; le conducteur n’était pas le Mouron Rouge !
– Quoi !
– Non ! Le capitaine de la garde était ce maudit Anglais déguisé et tous ses soldats des aristos !
La foule se tut cette fois : l’histoire sentait certainement le surnaturel et quoique la République eût aboli Dieu, elle n’avait pas complètement réussi à tuer la crainte du surnaturel dans le cœur du peuple. Certes, il fallait que cet Anglais fût le diable en personne.
Le soleil descendait très bas à l’ouest. Bibot se préparait à pousser les grilles.
– En avant les voitures, dit-il.
Une douzaine de chariots couverts s’allongeaient en file, prêts à quitter la ville, pour aller chercher dans la campagne voisine les légumes pour le marché du lendemain.
Bibot les connaissait presque tous, car ils passaient par sa porte deux fois par jour. Il parla à quelques-uns de ceux qui les conduisaient, la plupart étaient des femmes, et se donnait beaucoup de peine pour examiner l’intérieur des voitures.
– On ne sait jamais, disait-il, je n’ai pas envie d’être attrapé comme cette bête de Grospierre.
Les femmes qui conduisaient les chariots passaient habituellement leur journée sur la place de Grève, devant la plate-forme de la guillotine, à tricoter et à bavarder, tout en regardant la rangée de charrettes qui arrivaient chargées des victimes que le régime de la Terreur réclamait chaque jour. C’était très drôle de voir les aristos arriver à la réception de madame Guillotine, aussi les places les plus rapprochées de la plate-forme étaient-elles très recherchées.
Pendant la journée, Bibot avait été de service sur la place. Il reconnut la plupart des vieilles furies, les tricoteuses, comme on les appelait, qui étaient assises là et ne cessaient le mouvement de leurs aiguilles pendant que les têtes tombaient sous le couteau, sans se soucier d’être éclaboussées du sang de ces maudits aristos.
– Hé ! la mère ! dit Bibot à l’une de ces horribles mégères, qu’est-ce que vous avez là ?
Il l’avait déjà vue dans la journée avec son tricot et son fouet à côté d’elle. Maintenant elle avait attaché au manche de son fouet une rangée de boucles de cheveux de toutes nuances, depuis l’or jusqu’à l’argent, du blond au noir, et les caressait de ses énormes doigts osseux en plaisantant avec Bibot.
– Je me suis liée d’amitié avec l’amoureux de madame Guillotine, dit-elle avec un rire grossier, il m’a coupé ça sur les têtes, tandis qu’elles roulaient. Il m’en a promis d’autres demain, mais je ne sais pas si je serai à ma place ordinaire.
– Ah ! pourquoi ça, la mère ? demanda Bibot, qui, bien que soldat endurci, ne pouvait s’empêcher de frissonner à l’aspect répugnant de cette mégère, avec son horrible trophée.
– Mon petit-fils a la petite vérole, dit-elle en indiquant du doigt l’intérieur de la voiture, il y en a qui prétendent que c’est la peste ! Si c’est vrai, on ne me laissera pas entrer dans Paris demain.
En entendant les mots « petite vérole » Bibot fit rapidement quelques pas en arrière, et, quand la vieille sorcière parla de peste, il battit en retraite aussi vite qu’il put.
– Ah ! malédiction ! gronda-t-il, tandis que toute la foule s’écartait en hâte de la voiture, la laissant toute seule au milieu de la place.
La vieille mégère ricana.
– Le diable t’emporte, citoyen, tu es un poltron. Bah ! Un homme qui a peur de la maladie !
– Dites donc, la peste !
Chacun était épouvanté et silencieux, rempli d’horreur pour l’affreuse maladie, la seule chose qui avait encore le pouvoir d’exciter la terreur et le dégoût chez ces sauvages et bestiales créatures.
– Fiche-moi le camp, toi, avec ta portée de pestiférés ! hurla Bibot d’une voix rauque.
Et après une autre plaisanterie grossière, la vieille furie fouetta en riant son vieux bidet efflanqué et lança sa voiture hors de la porte.
Cet incident avait gâté l’après-midi ; le peuple était terrifié par les deux épouvantables fléaux, qui étaient les avant-coureurs d’une mort terrible dans un complet abandon.
Tous traînaillaient autour de la barrière, silencieux et maussades, ils se regardaient avec défiance, chacun évitant instinctivement les autres, de peur que la peste ne fût embusquée au milieu d’eux.
Tout à coup, de même que dans le cas de Grospierre, un capitaine de la garde apparut. Mais Bibot le connaissait et il n’était pas à craindre qu’on eût affaire à quelque Anglais déguisé.
– Une voiture ! cria-t-il hors d’haleine, même avant d’être arrivé à la barrière.
– Quelle voiture ? demanda Bibot brusquement.
– Conduite par une vieille sorcière, une voiture couverte ?
– Il y en avait une douzaine.
– Une vieille furie qui disait que son petit-fils avait la peste ?
– Oui.
– Vous ne les avez pas laissés passer ?
– Morbleu ! dit Bibot dont les joues pourpres étaient soudainement devenues exsangues de peur.
– La voiture contenait la ci-devant comtesse de Tournay et ses deux enfants, tous traîtres et condamnés à mort.
– Et leur conducteur ? gronda Bibot, en frissonnant.
– Sacré tonnerre ! mais on craint que ce ne soit ce maudit Anglais lui-même, le Mouron Rouge !
2. Douvres : au Repos du Pêcheur
Dans la cuisine, Sally était très occupée ; les casseroles et les poêles à frire s’allongeaient en rangs serrés sur le fourneau, l’énorme marmite ronflait sur un coin, la rôtissoire tournait avec une lenteur majestueuse en présentant alternativement à la flamme les différentes faces d’un respectable quartier de bœuf.
Les deux petites aides de cuisine s’agitaient au milieu de tout cela, empressées, rouges, essoufflées, leurs manches de toile bien relevées, montrant des bras potelés ; elles éclataient de rire à quelque drôlerie comprise d’elles seules, chaque fois que Miss Sally tournait un instant le dos.
La vieille Jemima, aussi lourde d’esprit qu’épaisse d’aspect, n’arrêtait pas de grogner en sourdine, tout en remuant méthodiquement la marmite sur le feu.
– Eh bien ! Sally ! cria de la salle à manger voisine une voix joyeuse, sinon mélodieuse.
– Dieu me bénisse ! s’exclama Sally, avec un rire de bonne humeur, que leur faut-il encore, je me le demande !
– De la bière pour sûr, grogna Jemima, vous n’allez pas croire que Jimmy Pitkin en ait assez avec un pot ?
– Monsieur Harry, on dirait que vous avez une soif extraordinaire aujourd’hui, murmura Martha, une des petites aides de cuisine ; et ses petits yeux noirs et brillants clignaient en rencontrant ceux de sa camarade, ce qui les faisait partir toutes deux de fous rires étouffés.
Sally parut agacée un instant et, tout en songeant, essuya ses mains sur ses hanches arrondies ; ses paumes étaient tentées évidemment de se mettre en contact avec les joues roses de Martha, mais sa bonne humeur naturelle reprit le dessus et, avec une moue et un haussement d’épaules, elle fixa son attention sur les pommes de terre frites.
– Eh bien ! Sally ! Eh ! Sally !
Et un chœur de pots d’étain secoués avec impatience sur le chêne des tables de la salle accompagnait les bruyants appels à la séduisante fille de l’hôtelier.
– Sally ! cria une voix dominant les autres, et cette bière ? cela va-t-il durer toute la nuit ?
– Je trouve que le père pourrait bien leur porter la bière, murmura Sally, tandis que Jemima, lourdement et sans autre commentaire, prenait sur le rayon une paire de cruches couronnées d’écume et commençait à remplir un certain nombre de pots d’étain avec cette bière de ménage pour laquelle le Repos du Pêcheur était célèbre depuis l’époque du roi Charles, il sait pourtant combien il y en a à faire ici.
– Votre père est bien trop occupé à parler politique avec M. Hempseed pour s’embarrasser de vous et de la cuisine, bougonna Jemima à mi-voix.
Sally s’était précipitée vers le petit miroir qui pendait au mur dans un coin de la cuisine, vivement elle arrangeait ses cheveux et remettait son bonnet tuyauté sous l’angle le plus seyant à ses boucles brunes ; puis elle prit par leurs anses les pots d’étain, trois dans chacune de ses vigoureuses mains hâlées, et moitié riant, moitié grognant et rougissant, les porta dans la salle.
Dans cette pièce on ne pouvait vraiment pas s’apercevoir de la bousculade et de l’activité qui régnaient à côté, parmi les quatre femmes, dans la cuisine brûlante.
La salle du Repos du Pêcheur (une curiosité actuellement, au début du vingtième siècle) n’avait pas encore acquis à la fin du dix-huitième siècle, cette notoriété et cette importance qu’un siècle de plus et la manie archéologique de notre époque lui ont conférées depuis.
Cependant, déjà en ce temps-là, c’était un vieux coin ; les poutres et les chevrons noircis par l’âge en témoignaient, ainsi que les sièges à panneaux, hauts de dossiers, entourant les longues tables de chêne ciré, sur lesquelles les traces d’innombrables gobelets d’étain de toutes dimensions avaient formé des dessins fantastiques.
Dans la fenêtre en vitrail, une bordure de pots de géraniums rouges et de dauphinelles bleues donnait une note de couleur gaie dans le sombre cadre de chêne.
Il était clair pour l’observateur le plus superficiel que M. Jellyband, propriétaire du Repos du Pêcheur à Douvres, était heureux dans ses affaires. Les étains sur les beaux vieux dressoirs et le cuivre couronnant l’âtre énorme étincelaient comme de l’or et de l’argent, le pavage de carreaux rouges resplendissait autant que l’écarlate des géraniums qui fleurissaient la fenêtre, et tout cela montrait que les serviteurs étaient nombreux et actifs, que la clientèle était fidèle et comportait ce raffinement d’ordre et d’élégance.
Lorsque Sally apparut, souriant sous son air sévère et montrant une rangée d’étincelantes dents blanches, elle fut accueillie par un chœur d’acclamations et d’applaudissements.
– Voilà Sally ! Eh bien ! Sally ! Vive la jolie Sally !
– Je croyais que vous étiez devenues sourdes dans votre cuisine, marmotta Jimmy Pitkin, passant le revers de sa main sur ses lèvres sèches.
– C’est bien ! c’est bien ! cria Sally, tout en posant sur les tables les pichets fraîchement remplis. Dieu ! que vous êtes pressés ! C’est-y que votre grand-mère est à la mort et que vous voulez voir la pauvre âme avant qu’elle ne s’en aille ? Je n’ai jamais vu une pareille bousculade !
Une fanfare de rires joyeux reçut cette plaisanterie qui fut longtemps pour la compagnie la source de nombreux quolibets.
Sally paraissait maintenant moins impatiente de retourner à ses pots et à ses casseroles. Un jeune blond, les cheveux bouclés, les yeux bleus, le regard ardent, occupait presque toute son attention et tout son temps, pendant que de grosses plaisanteries sur la grand-mère fictive de Jimmy Pitkin passaient de bouche en bouche, coupées de lourdes bouffées d’acre fumée de tabac.
Devant l’âtre, les jambes écartées, une longue pipe en terre entre les dents, se tenait notre hôte lui-même, le digne M. Jellyband, propriétaire du Repos du Pêcheur, comme son père l’avait été, de même que son grand-père et son arrière-grand-père. Large de carrure, jovial d’aspect, le crâne quelque peu dégarni, Jellyband était certainement la fidèle incarnation du John Bull campagnard à cette époque… époque où les préjugés d’insulaires étaient à leur apogée, où un Anglais fût-il lord, fermier ou paysan, considérait toute l’Europe comme un antre d’immoralité et le reste du monde comme un pays inexploré peuplé de sauvages et de cannibales.
Notre digne hôte, ferme et solidement planté sur ses jambes, fumait sa longue bouffarde, indifférent à tout chez lui et méprisant tout au-dehors. Il portait le typique gilet rouge à boutons de cuivre, la culotte de velours, les bas de laine grise et les élégants souliers à boucles, ce qui caractérisait en ce temps tout aubergiste qui se respectait en Grande-Bretagne ; et tandis que Sally, jolie et orpheline, aurait eu besoin de quatre paires de mains solides pour faire tout l’ouvrage qui retombait sur ses épaules arrondies, Jellyband discutait les affaires des nations avec ses hôtes privilégiés.
Certes, elle avait l’air extrêmement gaie et confortable, cette salle à manger, éclairée par deux lampes reluisantes suspendues aux poutres du plafond. À travers les épais nuages de fumée de tabac qui s’accrochaient à tous les coins de la pièce, les physionomies des clients de M. Jellyband apparaissaient rouges et plaisantes à regarder ; ils semblaient être en bons termes entre eux, ainsi qu’avec leur hôte et avec tout le monde ; de tous les côtés de la salle de bruyants éclats de rire accompagnaient les causeries agréables, et pas très intellectuelles, tandis que les fous rires étouffés de Sally témoignaient de l’excellent usage que M. Harry Waite faisait du peu de temps qu’elle paraissait consentir à lui accorder.
Ceux qui patronnaient l’établissement de Jellyband appartenaient presque tous à la classe des pêcheurs, mais les pêcheurs sont connus pour avoir toujours soif, et le sel qu’ils respirent quand ils sont en mer n’est pas pour rien dans la sécheresse de leurs gosiers lorsqu’ils sont à terre. Mais le Repos du Pêcheur était quelque chose de plus qu’un rendez-vous à l’usage de ce pauvre monde. Les diligences de Douvres à Londres partaient tous les jours de l’hôtellerie ; les voyageurs qui avaient traversé la Manche et ceux qui entreprenaient le « grand tour » faisaient tous connaissance avec M. Jellyband, ses vins français et sa bière de ménage.
C’était vers la fin de septembre 1792 et le temps qui avait été beau et chaud tout le mois avait soudainement changé ; pendant deux jours des torrents d’eau avaient inondé le sud de l’Angleterre, faisant leur possible pour anéantir les chances que les pommes, les poires et les prunes tardives avaient de devenir de bons et de respectables fruits. En ce moment même la pluie battant le vitrail et dégringolant le long de la cheminée faisait gaiement crépiter le bois dans le feu.
– Bon Dieu ! avez-vous jamais vu un mois de septembre aussi humide, monsieur Jellyband ? demanda M. Hempseed.
Monsieur Hempseed était assis sur l’un des sièges dans l’âtre, car c’était une autorité et un important personnage que ce M. Hempseed, et pas seulement au Repos du Pêcheur, où M. Jellyband s’adressait particulièrement à lui lorsqu’il voulait faire ressortir la valeur de ses arguments politiques, mais aussi dans tout le voisinage, où son instruction et particulièrement sa connaissance des Écritures étaient tenues en haute considération et en profond respect. Une main enfoncée dans une des larges poches de sa culotte de velours que surmontait une blouse brodée avec recherche et assez usée, l’autre main tenant sa pipe en terre, M. Hempseed regardait avec découragement à travers la chambre les petits ruisseaux qui coulaient le long des carreaux de la fenêtre.
– Non, répliqua Jellyband sentencieusement, je ne crois pas l’avoir jamais vu, monsieur Hempseed, et voilà près de soixante ans que je suis dans le pays.
– Oh ! vous ne vous souvenez pas des trois premières années de ces soixante ans-là, monsieur Jellyband, interrompit M. Hempseed. Un bambin ne fait guère attention au temps, du moins en ce monde-ci, et moi, voilà près de soixante-quinze ans que j’y vis.
La supériorité de ces sages réflexions était si incontestable que sur le moment Jellyband ne se trouva pas prêt à répondre avec son abondante argumentation habituelle.
– Ça ressemble plutôt à avril qu’à septembre, vous ne trouvez pas ? continua M. Hempseed, plaintivement, tandis qu’une averse faisait crépiter le feu.
– Ah ! pour sûr ! convint notre digne hôte, mais que pouvez-vous attendre, que je dis, monsieur Hempseed, avec le gouvernement que nous avons ?
M. Hempseed branla la tête avec une prudence infinie tempérée par une méfiance profondément enracinée du climat et du gouvernement britanniques.
– Je n’attends rien, monsieur Jellyband ; du pauvre monde comme nous ne comptons pas grand-chose à Londres ; je le sais bien et ce n’est pas souvent que je m’en plains, mais quand il nous arrive une humidité pareille en septembre et que tous mes fruits pourrissent et meurent comme des premiers-nés d’Égypte, sans profit pour personne, si ce n’est pour un tas de Juifs, de colporteurs et d’autre engeance semblable avec leurs oranges et tous leurs fruits de mécréants… que personne n’achèterait si les pommes et les poires d’Angleterre étaient bien poussées. Comme dit l’Écriture…
– C’est très vrai, monsieur Hempseed, rétorqua Jellyband, et que pouvez-vous attendre de mieux ? Ce sont tous ces diables de Français de l’autre côté de la Manche en train de tuer leur roi et leur noblesse, et M. Pitt, M. Fox et M. Burke, qui se battent et se chamaillent pour savoir si nous, Anglais, nous devons laisser continuer ce manège de païens. Laissez-les se tuer, dit M. Pitt. Arrêtez-les, dit M. Burke.
– Et laissez-les s’entre-tuer et qu’ils se fassent damner sans nous, dit M. Hempseed avec emphase, car il n’avait que peu de sympathie pour les arguments politiques de son ami Jellyband, pour lesquels il avait toujours à descendre des régions élevées où il planait, et qui ne lui donnaient pas beaucoup d’occasions de faire montre de ces perles de sagesse qui lui avaient gagné une si grande réputation dans le voisinage et tant de pots de bière gratuits au Repos du Pêcheur.
– Laissez-les se tuer, répéta-t-il, mais ne nous laissez pas avoir une pareille pluie en septembre, car c’est contre la loi et contre les Écritures qui disent…
– Mon Dieu ! monsieur Harry, que vous m’avez fait tressauter !
C’était malheureux pour Sally et pour son entretien galant que cette remarque arrivât au moment précis où M. Hempseed rassemblait son souffle dans l’intention de se soulager d’une de ces fameuses citations bibliques qui l’avaient rendu célèbre ; cela amena sur la jolie tête de Sally le flot de la colère paternelle.
– Eh bien ! Sally, eh bien ! dit-il, cherchant à donner un air sévère à sa joyeuse figure, cesse tes bêtises avec ce jeune freluquet, et fais avancer l’ouvrage.
– L’ouvrage va bien, père.
Mais le ton de M. Jellyband était péremptoire. Il avait d’autres vues pour sa séduisante fille, son enfant unique, qui serait un jour, quand Dieu le voudrait, la propriétaire du Repos du Pêcheur, que de la marier à l’un de ces jeunes garçons qui ne gagnaient avec leur filet qu’une existence précaire.
– As-tu entendu, ma fille ? dit-il avec ce ton tranquille auquel personne dans l’auberge n’osait désobéir, soigne le dîner de lord Tony, car, s’il n’est pas le meilleur que nous puissions faire et si lord Tony n’est pas content, méfie-toi de ce qui t’attend ; c’est bon, file.
Sally obéit sans entrain.
– Vous attendez quelqu’un de particulier ce soir, monsieur Jellyband ? demanda Jimmy Pitkin, faisant un effort loyal pour distraire l’attention de son hôte des circonstances qui avaient accompagné le départ de Sally.
– Oui ! des amis de lord Tony lui-même. Des ducs et des duchesses de l’autre côté de l’eau, que le jeune lord et son ami Sir Andrew Ffoulkes et d’autres gentilshommes ont aidé à arracher des griffes de ces diables d’égorgeurs.
Mais c’en était trop pour la philosophie combative de M. Hempseed.
– Bon Dieu, dit-il, pourquoi font-ils ça, je n’aime pas qu’on se mêle des affaires des autres. Comme dit l’Écriture…
– C’est possible, monsieur Hempseed, interrompit Jellyband avec une ironie mordante, comme vous êtes un ami personnel de M. Pitt et que vous dites avec M. Fox : Laissez-les s’égorger !
– Faites excuse, monsieur Jellyband, protesta faiblement Hempseed, je ne crois pas que j’aie jamais dit ça.
Mais M. Jellyband avait enfin réussi à enfourcher son dada favori et n’avait pas la moindre intention d’en descendre si vite.
– Ou bien, c’est peut-être que vous vous êtes comme ça lié d’amitié avec quelques-uns de ces gaillards de Français dont on raconte qu’ils ont passé l’eau pour nous réconcilier avec leurs façons d’assassins.
– Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur Jellyband, tout ce que je sais…
– Tout ce que je sais moi, déclara notre hôte, c’est qu’il y avait mon ami Peppercorn, celui à qui appartient le Sanglier bleu et qui était bien le plus fidèle et le plus loyal Anglais qu’il y eût dans le pays. Et maintenant, voyez-le ! Il s’est lié avec quelques-uns de ces mangeurs de grenouilles et trinque avec eux comme s’ils étaient des Anglais, au lieu d’être une bande de mécréants, de païens, d’espions. Bref, qu’est-ce qui est arrivé ? Maintenant Peppercorn a la tête en feu, parle de révolutions, de liberté, et crie contre les aristocrates, juste comme M. Hempseed fait ici.
– Faites excuse, monsieur Jellyband. Je ne crois pas que j’aie jamais dit… Jellyband en avait appelé à la compagnie en général, qui écoutait, frappée d’horreur et bouche bée, le récit des crimes de M. Peppercorn. À l’une des tables, deux clients, qui, à en juger par leur costume, devaient être des gentlemen, avaient laissé le jeu de dominos qu’ils venaient d’entamer et, amusés, écoutaient depuis un moment les divagations politiques de M. Jellyband. L’un d’eux, avec un demi-sourire sarcastique, se tourna vers le centre de la chambre, où M. Jellyband se tenait debout.
– Vous avez l’air de trouver, mon honnête ami, dit-il avec calme, que ces Français, des espions, je crois que vous les appelez, sont de bien malins compagnons pour avoir fait, comme qui dirait, du hachis avec les opinions de votre ami M. Peppercorn. Comment croyez-vous qu’ils s’y soient pris ?
– Mon Dieu, monsieur, je suppose qu’ils lui ont conté leurs balivernes accoutumées, les Français qu’on m’a dit, ont la langue bien pendue, et M. Hempseed, ici présent, vous dira comment il se fait qu’ils vous retournent les gens avec le petit doigt.
– Vraiment, monsieur Hempseed ?
– Non, monsieur ? répliqua Hempseed furieux. Je ne puis vous donner les renseignements que vous demandez.
– Ma foi, espérons, mon digne hôte, que ces malins espions ne réussiront pas à retourner vos opinions de très fidèle sujet du roi.
C’en était trop pour l’aimable sérénité de M. Jellyband. Il partit d’un bruyant éclat de rire auquel bientôt firent écho tous ceux qui étaient ses débiteurs.
– Hahaha ! Hohoho ! Héhéhé ! Il rit sur tous les tons, notre digne hôte, il rit jusqu’à en avoir mal aux côtes et à en pleurer à grosses larmes. Écoutez-moi ça ! L’avez-vous entendu dire qu’ils allaient retourner mes opinions ? Eh ! Dieu vous protège, monsieur, mais vous dites de drôles de choses.
– Eh bien ! monsieur Jellyband, dit sentencieusement M. Hempseed, vous savez ce que dit l’Écriture : Que celui qui est debout prenne garde à lui, de crainte de tomber.
– Mais écoutez-le, monsieur Hempseed, répliqua M. Jellyband qui se tenait toujours les côtes de rire. L’Écriture ne me connaissait pas. Quoi, je ne voudrais même pas boire un verre de bière avec un de ces assassins de Français et il n’y a rien qui me ferait changer d’avis. J’ai entendu dire que pas un de ces mangeurs de grenouilles ne savait parler l’anglais du roi. Alors pour sûr que si quelqu’un d’eux cherchait à me parler son jargon de mécréant, je le remettrais de suite à sa place, et un homme prévenu en vaut deux, comme on dit.
– Eh bien ! mon brave ami, acquiesça gaiement l’étranger, je vois que vous êtes beaucoup trop fin et qu’à vous tout seul vous valez bien vingt Français. À votre santé, mon digne hôte, si vous voulez me faire l’honneur de finir cette bouteille avec moi, dit-il en levant son verre.
– C’est bien de la politesse, monsieur, et ce n’est pas de refus, répondit Jellyband en essuyant les abondantes larmes que le rire avait amenées à ses yeux.
L’étranger remplit de vin deux gobelets et après en avoir offert un à notre hôte, prit lui-même l’autre.
– Bon Anglais comme nous le sommes tous, fit-il, tandis que le même sourire ironique flottait sur ses lèvres minces, fidèles sujets de Sa Majesté, comme nous le sommes aussi, nous devons malgré tout reconnaître que cette boisson, tout au moins, est une bonne chose qui nous vient de France.
– Ah ! pour ça, personne ne dira le contraire.
– Au meilleur aubergiste d’Angleterre, à notre digne hôte, M. Jellyband, fit l’étranger d’une voix sonore.
– Hip, hip, hurrah ! acclama toute la compagnie présente.
Puis des battements de mains retentissants et des heurts de pichets résonnèrent sur la table, accompagnés de rires sans motifs précis, et d’exclamations sourdes de Jellyband.
– Pensez donc, moi, me laisser monter la tête par un mécréant d’étranger ! Quoi ! Dieu vous protège, monsieur, mais vous dites de drôles de choses.
L’étranger approuva cordialement cette constatation évidente. Il était absurde de supposer que n’importe qui pût renverser les opinions solidement enracinées de M. Jellyband au sujet de la nullité complète des habitants de tout le continent européen.
3. Les réfugiés
En Angleterre, à cette époque, les esprits étaient très montés contre les Français. Des contrebandiers, aussi bien que d’honnêtes négociants faisant le commerce entre la France et la côte anglaise, apportaient des bribes de nouvelles. Ce qu’on apprenait par eux faisait bouillir le sang de tout brave Anglais, et lui donnait grand désir de marcher sur les égorgeurs qui avaient emprisonné leur roi et sa famille, fait subir à la reine et à ses enfants les traitements les plus odieux, et allaient maintenant jusqu’à demander ouvertement le sang de tous les Bourbons et de leurs partisans.
L’assassinat de la princesse de Lamballe, la jeune et charmante amie de Marie-Antoinette, avait rempli les consciences anglaises d’une horreur inexprimable ; le supplice quotidien de nombre de royalistes de marque, dont l’unique crime était leur nom aristocratique, semblait crier vengeance à toute l’Europe civilisée.
Malgré tout, personne n’osait intervenir. Burke avait épuisé toute son éloquence pour chercher à entraîner le gouvernement britannique à combattre la révolution française, mais Pitt, avec sa prudence caractéristique, n’avait pas admis que son pays fût prêt à s’engager dans une nouvelle guerre, coûteuse et difficile. C’était à l’Autriche de prendre l’initiative, l’Autriche dont la plus jolie des filles était alors une reine détrônée, emprisonnée, insultée journellement par les hurlements de la populace ; ce n’était pas le moment, ajoutait Fox, pour l’Angleterre entière de prendre les armes, parce que la moitié des Français avait décidé d’assassiner l’autre.
Quant à Jellyband et à son ami John Bull, bien qu’ils regardassent tous les étrangers avec un mépris écrasant, ils étaient royalistes et antirévolutionnaires jusqu’aux moelles, et, à l’heure actuelle, ils étaient furieux contre Pitt à cause de sa prudence et de sa modération, bien que tout naturellement ils n’eussent pas la moindre idée des raisons diplomatiques qui guidaient la conduite du grand homme.
Mais voici que Sally rentrait en courant très surexcitée et affairée. Les joyeux compagnons dans la salle n’avaient rien entendu du bruit à l’extérieur, mais elle avait aperçu s’arrêtant devant la porte du Repos du Pêcheur un cheval et un cavalier ruisselants d’eau, et tandis que le palefrenier accourait prendre les rênes, la gentille Miss Sally s’était précipitée vers la porte d’entrée pour souhaiter la bienvenue au visiteur.
– Je crois avoir vu dans la cour le cheval de Lord Antony, dit-elle en traversant la salle en toute hâte.
Mais déjà du dehors on avait repoussé le battant et, un moment plus tard, un bras recouvert de drap gris et trempé de pluie entourait la taille de la jolie Sally, tandis qu’une voix chaude résonnait au milieu des lambris de chêne.
– Vivent vos yeux noirs qui voient si clair, ma petite Sally, s’écria l’homme qui venait d’entrer.
De son côté le digne M. Jellyband arrivait affairé, alerte, faisant l’empressé, comme il convenait pour recevoir l’un des hôtes favoris de son auberge.
– Ma parole, Sally, ajouta Lord Antony, en posant un baiser sur les joues en fleur de Miss Sally, vous devenez de plus en plus jolie, chaque fois que je vous vois, et mon brave Jellyband doit avoir une rude besogne pour écarter la main des galants de votre taille si mince. – Vous disiez, monsieur Waite ?
M. Waite, partagé entre le respect qu’il devait à milord et l’aversion qu’il avait pour ce genre de plaisanteries, répondit simplement par un grognement indécis.
Lord Antony Dewhurst, l’un des fils du duc d’Exeter, était un jeune Anglais typique de son temps, grand, bien planté, large d’épaules, d’une physionomie joyeuse. Partout où il allait, son rire clair sonnait. Bon sportsman, gai compagnon, homme du monde poli et courtois, n’ayant pas trop de cervelle pour gâter son humeur, il était un favori universel, aussi bien dans les salons de Londres que dans les salles des hôtelleries de village.
Au Repos du Pêcheur chacun le connaissait ; il aimait à faire voile pour la France, et jamais il ne manquait de passer une nuit sous le toit du digne M. Jellyband soit à l’aller soit au retour.
Il fit un signe de tête à Waite, à Pitkin et aux autres, lorsque enfin il lâcha la taille de Sally, et il traversa la pièce pour aller se réchauffer et se sécher dans l’âtre ; en même temps il lança un regard rapide et quelque peu soupçonneux aux deux étrangers qui tranquillement avaient repris leur jeu de dominos, et, pendant quelques secondes, une expression de profonde gravité, d’anxiété même, assombrit sa physionomie jeune et joviale.
Mais ce ne fut qu’un éclair ; l’instant d’après il s’était tourné vers M. Hempseed, qui respectueusement portait la main à son front.
– Eh bien ! monsieur Hempseed, et les fruits ?
– Ça va mal, milord, ça va mal, mais que pouvez-vous attendre sous un gouvernement qui favorise ces sacripants de Français qui voudraient tuer leur roi et toute leur noblesse ?
– Ventre-saint-gris ! ils le feraient, mon bon Hempseed, du moins pour ceux qui ont la mauvaise chance de se laisser prendre. Mais nous avons quelques amis qui arrivent ici ce soir qui, eux au moins, ont échappé à leurs griffes.
Lorsque le jeune homme dit ces mots, il parut jeter un regard défiant sur les deux étrangers tranquilles dans le coin.
– Grâce à vous, milord, et à vos amis, m’a-t-on raconté, dit M. Jellyband. Mais aussitôt Lord Antony secoua le bras de notre hôte pour l’avertir :
« Chut ! » fit-il d’un ton péremptoire, et, instinctivement, de nouveau il regarda les étrangers.
– Oh ! mon Dieu, n’ayez pas peur, c’est parfait, je n’aurais rien dit si nous n’avions pas été entre amis. Ce monsieur-là est un sujet du roi George, aussi loyal et aussi fidèle que vous êtes vous-même, milord, sauf révérence. Il n’est arrivé à Douvres que dernièrement et il installe un commerce par ici.
– Un commerce ? Alors, ma parole, ce doit être comme entrepreneur des pompes funèbres, car je n’ai jamais vu une figure plus lamentable.
– Non, milord, je crois que ce monsieur est un veuf, ce qui expliquerait bien son aspect mélancolique ; mais néanmoins je garantis que c’est un ami, et vous devez reconnaître, milord, que personne ne peut mieux juger les figures que le propriétaire d’une auberge de village.
– Alors, ça va bien, si nous sommes entre amis, continua Lord Antony, qui ne paraissait pas enclin à discuter ce sujet avec son hôte. Mais, dites-moi, vous n’avez personne d’autre qui habite ici, n’est-ce pas ?
– Personne, milord, et pas d’arrivants non plus, du moins…
– Du moins ?
– Oh ! personne à qui Votre Seigneurie mettrait objection, je le sais.
– Qui est-ce ?
– Eh bien ! milord, Sir Percy Blakeney et sa dame seront ici dans quelques minutes, mais ils ne resteront pas.
– Lady Blakeney ? demanda Lord Antony quelque peu étonné.
– Oui, milord, le capitaine du bateau de Sir Percy vient de venir. Il dit que le frère de Sa Seigneurie traversera le détroit pour la France aujourd’hui, à bord du Day Dream, qui est le voilier de plaisance de Sir Percy et Sir Percy et milady viendront ici pour ne nous quitter qu’à la dernière minute. Cela ne vous ennuie pas, milord ?
– Non, non, mon ami, pas du tout, rien ne m’ennuierait, sauf ce souper, s’il n’était pas le meilleur que Miss Sally puisse cuire et le meilleur qui ait jamais été servi sur la table du Repos du Pêcheur.
– Quant à cela, soyez sans crainte, milord, s’exclama Sally qui tout le temps avait été très occupée à mettre le couvert.
Et elle paraissait très gaie et très engageante, cette table, garnie au centre d’un grand bouquet de dahlias de diverses couleurs et, tout autour, de gobelets d’étain bien reluisants et de porcelaine bleue.
– Pour combien de personnes, milord ?
– Cinq places, ma jolie Sally, mais préparez le dîner pour dix au moins, mes amis seront fatigués et affamés aussi, j’espère. Quant à moi, je vous assure que ce soir j’avalerais bien la moitié d’un bœuf.
– Les voilà, je crois, dit Sally agitée.
On pouvait entendre distinctement un bruit de sabots de chevaux et de roues qui approchaient rapidement.
Il y eut dans la salle une émotion générale. Chacun voulait voir les élégants amis de Lord Antony, qui arrivaient de l’autre côté de l’eau. Miss Sally lança un ou deux regards rapides à la petite glace qui pendait au mur, et le digne M. Jellyband sortit en hâte pour être le premier à souhaiter la bienvenue à ses hôtes de distinction. Il n’y eut que les deux étrangers dans le coin qui ne participèrent pas à l’agitation environnante. Ils finissaient tranquillement leur partie de dominos et ne regardaient même pas vers la porte.
– Tout droit, comtesse, la porte à votre droite, disait dehors une voix agréable.
– Oui, les voilà bien arrivés, s’écria Lord Antony, enchanté. Allons, Sally, voyez à nous servir la soupe le plus tôt possible.
La porte fut repoussée, grande ouverte, et, précédé de Jellyband qui se perdait dans ses révérences, un groupe de quatre personnes, deux dames et deux hommes, entra dans la salle.
– Soyez les bienvenus dans la vieille Angleterre, fit avec effusion Lord Antony, avançant rapidement vers les arrivants, les deux mains tendues.
– Lord Antony Dewhurst, je suppose, dit en anglais une des deux dames avec un accent étranger prononcé.
– Pour vous servir, madame.
Il baisa cérémonieusement la main des deux femmes, puis, se tournant vers les hommes, il les reçut cordialement.
Sally était déjà en train d’aider les Françaises à ôter leurs manteaux de voyage, et toutes deux se tournèrent en frissonnant vers l’âtre où la flamme brillait gaiement.
Un mouvement se produisait dans l’ensemble de la compagnie présente. Sally s’était précipitée dans sa cuisine ; Jellyband, toujours distribuant des saluts à profusion, arrangeait quelques sièges autour du feu. Monsieur Hempseed touchait son front du doigt et laissait libre la place qu’il occupait dans l’âtre. Chacun examinait les étrangers avec curiosité, tout en y mettant quelque discrétion.
– Ah, messieurs, que puis-je vous dire ? s’exclama la plus âgée des deux femmes, en présentant à la chaleur du brasier ses mains fines et aristocratiques et en regardant avec une gratitude indicible d’abord Lord Antony, puis l’un des deux jeunes gens qui l’avaient accompagnée et qui était occupé à se débarrasser d’un lourd manteau à collets.
– Oh ! comtesse, tout simplement que vous êtes heureuse d’être en Angleterre, répondit Lord Antony, et que vous n’avez pas trop souffert de ce pénible voyage.
– Certainement, nous sommes heureuses d’être en Angleterre ; déjà nous avons oublié tout ce que nous avons souffert – et ses yeux se remplissaient de larmes.
Sa voix était basse et bien timbrée et sur son visage régulier, surmonté d’abondants cheveux blancs coiffés très haut sur le front, à la mode du temps, on pouvait voir la trace de bien des souffrances, supportées avec beaucoup de dignité calme et de noblesse.
– J’espère que mon ami, Sir Andrew Ffoulkes, s’est montré agréable compagnon de voyage ?
– Sir Andrew a été l’amabilité même. Comment pourrons-nous jamais, mes enfants et moi, montrer la reconnaissance que nous vous devons à tous, messieurs ?
Sa compagne, une ravissante jeune fille, presque une enfant, dont l’air de fatigue et de tristesse était poignant, avait gardé le silence jusque-là, mais ses grands yeux bruns et humides d’émotion avaient cessé de contempler la flamme et cherchaient à rencontrer ceux de Sir Andrew Ffoulkes, qui s’était rapproché de l’âtre en même temps que d’elle. Lorsque ses regards croisèrent ceux du jeune homme, elle les trouva fixés avec une admiration non déguisée sur le joli visage qui était devant lui et cela amena à ses joues pâles une légère rougeur.
– C’est donc cela, l’Angleterre ? dit-elle en regardant avec une curiosité juvénile l’âtre ouvert, les poutres de chêne, les rustres vêtus de blouses brodées et à la physionomie joyeuse et colorée.
– Ce n’en est qu’une bien petite partie, mademoiselle, répliqua Sir Andrew en souriant, mais elle est tout entière à votre service.
La jeune fille rougit à nouveau, mais cette fois un léger sourire, joyeux et doux, illumina ses traits charmants. Elle se tut et Sir Andrew fit de même, mais ils se comprenaient, car la jeunesse a une façon de s’entendre qui est la même dans toutes les langues depuis le commencement du monde.
– Eh bien ! et le souper, interrompit la voix joviale de Lord Antony, le souper, honnête Jellyband ? Où donc est votre jolie fille et son pot-au-feu ? Morbleu, mon bonhomme ! pendant que vous regardez ces dames bouche bée, elles vont défaillir d’inanition.
– Un instant, un instant, milord, s’écria Jellyband en ouvrant toute grande la porte qui conduisait à la cuisine et en appelant vigoureusement.
– Sally ! Eh là ! Sally, es-tu prête, ma fille ?
Sally était prête, et la minute suivante elle apparut portant une énorme soupière d’où s’élevait un nuage de vapeur qui répandait une odeur savoureuse.
– Ventre-saint-gris ! Enfin, voilà le souper, fit Lord Antony avec joie, et, galamment, il offrit son bras à la comtesse en ajoutant avec cérémonie :
– Voulez-vous me faire l’honneur, madame ? et il la conduisit à table.
Il y eut un remue-ménage général dans la salle. M. Hempseed et la plupart des pêcheurs et des autres assistants s’étaient retirés pour laisser la place aux gens de qualité et pour finir leur pipe ailleurs. Il n’y eut que les deux étrangers qui ne bougèrent point ; sans s’occuper de rien ils finissaient leur jeu de dominos et sirotaient leur vin ; à une autre table, Harry Waite, qui était en train de perdre rapidement patience, surveillait les mouvements de Sally autour de la table.
Elle paraissait une jolie fleur de la campagne anglaise, et il n’y avait rien d’extraordinaire à ce que ce jeune Français, facilement émotionnable, ne pût la quitter des yeux.
Le vicomte de Tournay était un garçon imberbe, de dix-neuf ans à peine, sur qui les tragédies terribles qui se jouaient dans son propre pays n’avaient fait que peu d’impression. Il était vêtu avec élégance et même avec recherche ; une fois débarqué en Angleterre, il était évidemment disposé à oublier les horreurs de la Révolution dans les plaisirs de la vie anglaise.
– Pardi, si c’est là l’Angleterre, elle me plaît, dit-il, en continuant à regarder Sally avec une satisfaction marquée.
Il est impossible de rapporter l’exclamation qui jaillit des dents serrées de Harry Waite. Ce ne fut que le respect de la qualité des hôtes, surtout de celle de Lord Antony, qui le retint de montrer son mécontentement.
– Eh bien ! oui, c’est là l’Angleterre ; mais surtout, je vous prie, jeune débauché, interrompit Lord Antony en riant, n’apportez pas vos mœurs étrangères et libertines dans ce pays austère.
Lord Antony s’était déjà assis au haut de la table, la comtesse à sa droite. Jellyband s’agitait autour d’eux, remplissait les verres et remuait les chaises. Sa fille attendait, prête à servir la soupe. Les amis de Harry Waite avaient enfin réussi à l’emmener hors de la chambre, car il perdait de plus en plus son sang-froid, en voyant l’admiration évidente du vicomte pour Sally.
– Suzanne ! commanda la sévère comtesse.
Suzanne rougit encore, l’heure et le lieu avaient disparu pour elle ; assise auprès du feu, elle avait laissé les yeux du bel Anglais s’arrêter sur sa gracieuse figure et presque inconsciemment avait abandonné sa main dans celles du jeune homme. La voix de sa mère la ramena une fois de plus à la réalité, et avec un « Oui, maman ! » soumis, elle prit place à table.