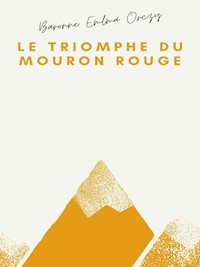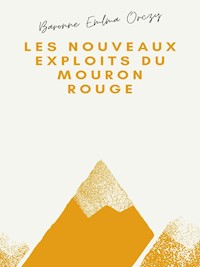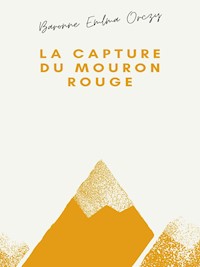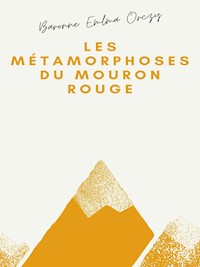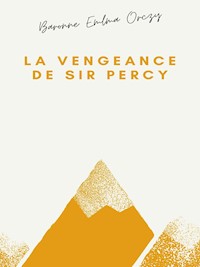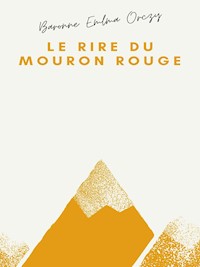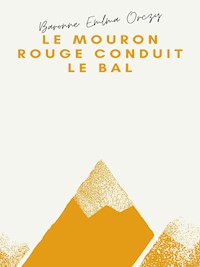
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. L'abbé Edgeworth de Firmont l'assiste dans ces tragiques circonstances. Mais le Mouron Rouge, toujours prévoyant, escamote ce dernier juste après l'exécution, devinant que la Convention est prête à lui faire subir le même sort qu'au Roi. C'est l'histoire de ce sauvetage, doublé de celui d'une famille d'aristocrates compromis dans cette aventure, qui vous est contée ici. L'entreprise est d'autant plus périlleuse qu'un traître apparaît dans la bande du Mouron Rouge...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Mouron rouge conduit le bal
Le Mouron rouge conduit le balPREMIÈRE PARTIE. L’ABBÉDEUXIÈME PARTIE. Le médecinTROISIÈME PARTIE. MademoiselleQUATRIÈME PARTIE. Le traîtreCINQUIÈME PARTIE. Le chefPage de copyrightLe Mouron rouge conduit le bal
Baronne Emma Orczy
PREMIÈRE PARTIE. L’ABBÉ
1 Le procès du roi
Depuis le 14 janvier, les scrutins avaient commencé. On allait savoir si Louis Capet était reconnu coupable d’avoir conspiré contre la liberté. Louis Capet – c’est-à-dire Louis XVI, le descendant d’une longue lignée de souverains – avait été traîné à la barre de la Convention par ses sujets pour répondre de ce crime, et sa vie était en jeu.
Il ne pouvait même y avoir de doute. Ce n’était pas au bannissement, comme beaucoup de députés, surtout les girondins, l’avaient laissé entendre, mais à la peine de mort qu’on allait le condamner.
On avait posé cinquante-sept questions à l’accusé et il avait répondu négativement. Un de ses trois défenseurs, Desèze, avait montré que le procès du roi, irresponsable suivant la Constitution, était illégal, mais rien ne le sauverait.
Une fois déjà, un siècle et demi auparavant, un roi, Charles Ier d’Angleterre, avait été traduit devant son Parlement, et cela s’était terminé par un régicide. La foule, une foule inquiète et silencieuse, se pressait aux alentours de l’Assemblée, attendant les nouvelles tandis que l’avocat Barère résumait les débats dans un discours interminable. Puis on ramena le roi à la prison du Temple où il vivait maintenant, séparé de sa femme, de sa sœur et de ses enfants.
Le 16 janvier, le vote commença. Il dura vingt-quatre heures. La Convention avait décidé que, quelle que soit la sentence, il ne serait pas fait appel au peuple. Les modérés auraient bien voulu conserver cette échappatoire, mais les extrémistes crièrent que ce serait fomenter la guerre civile et, une fois de plus, les autres s’étaient laissé intimider.
Sept cent vingt et un députés étaient présents. On les appelait un à un ; ils montaient à la tribune et prononçaient la peine qu’ils voulaient voir appliquer.
Pendant longtemps, le bannissement et la mort se partagèrent à peu près également les votes. Cette étrange scène avait pour témoins les spectateurs fort élégamment vêtus des galeries qui mangeaient des bonbons et bavardaient. Il y eut un moment d’intense curiosité lorsque Philippe d’Orléans – on l’appelait maintenant Philippe-Égalité – vota la mort de son cousin en son âme et conscience, bien entendu.
Enfin on compta les votes ; la peine de mort avait réuni trois cent soixante-sept voix contre trois cent trente-quatre, et le président Vergniaud, qui avait dit la veille encore : « Je ne voterai pas la mort », et qui l’avait votée, proclama le verdict.
2 La sentence
À peine le président avait-il terminé que les avocats du roi déposèrent une protestation. Ils demandaient un sursis et l’appel au peuple. Celui-ci avait déjà été rejeté ; il restait le sursis, mais les députés étaient recrus de fatigue et remirent leur décision au lendemain.
Les extrémistes disaient « non », Philippe-Égalité disait « non », peu de députés avaient le courage de dire « oui » et, finalement, on rejeta aussi le sursis.
Le Conseil exécutif vint lire le décret de mort au condamné dans sa prison. Louis XVI l’écouta tranquillement, puis il demanda un délai pour se préparer à la mort et un confesseur dont il donna le nom. Le ministre de la Justice, Garat, accepta de transmettre cette dernière demande, et lorsqu’il revint il dit « qu’il était libre à Louis d’appeler tel ministre du culte qu’il jugeait à propos ».
Pendant ce temps, la nouvelle se répandait dans Paris et le frappait de stupeur. Seuls les extrémistes se réjouissaient, agitaient leurs cocardes tricolores et criaient : « Vive la liberté ! » Le député qui s’était élevé le premier contre un sursis, Le Peletier, alla souper au Palais-Royal chez un restaurateur à la mode : Février. Il allait payer sa note lorsqu’il fut attaqué par un homme qui lui plongea un poignard dans la poitrine en criant : « Régicide ! voilà pour toi ! » Dans la confusion qui suivit, le meurtrier s’échappa. Lorsqu’on apprit la chose, la plupart des députés qui avaient voté la mort s’enfermèrent chez eux.
Cependant, les cafés et les restaurants ne désemplissaient pas. On parlait du procès et on parlait de la guerre peut-être imminente avec l’Angleterre. L’ambassadeur de France à Londres, Chauvelin, n’était pas encore revenu, mais on s’attendait à le voir rappelé d’un instant à l’autre ; les Anglais qui résidaient en France se préparaient à quitter le pays.
Cependant, il en restait encore un certain nombre, journalistes, hommes d’affaires ou simples curieux, et ils venaient dîner chez Février où se rencontraient aussi Saint-Just, Robespierre, Desmoulins, Vergniaud et d’autres hommes en vue. Ce soir-là, une douzaine d’étrangers se trouvaient réunis autour d’une table ronde. Le dîner était maigre, car les provisions commençaient à manquer et les menus s’en ressentaient. Cependant, la bonne humeur assaisonnait la pauvre chère, et les convives, des Anglais surtout, se résignaient sans trop de grimaces à mal manger.
– Que diriez-vous d’un rôti de bœuf à la moutarde ? disait un homme qui s’efforçait de venir à bout d’un morceau de salé aux haricots.
– Qu’il passerait bien, répondit son voisin, bien que, pour le moment, j’ai plutôt envie d’un ragoût de mouton à la mode Lancashire : c’est le triomphe de ma femme.
– Chez moi, interrompit un de leurs compatriotes à l’accent caractéristique, c’est aujourd’hui le jour du hachis, avec un grand verre de whisky écossais par-dessus, je vous jure…
Deux hommes dînaient ensemble à une petite table voisine ; l’un d’eux s’écria :
– Ces Anglais ! Ils ne parlent que de nourriture !
Sans commenter cette remarque, l’autre dit :
– Vous savez l’anglais, monsieur ?
– Oui ; vous ne le savez pas ?
– Je n’ai jamais pris de leçons, fut la réponse énigmatique.
Ces deux hommes étaient très différents : l’un était plutôt petit et large d’épaules, il avait le visage rubicond, les lèvres sensuelles et des yeux à fleur de tête. Ses mains s’agitaient constamment, roulaient des boulettes de mie de pain ou tambourinaient sur la table. L’autre était très grand ; il parlait sur un ton légèrement pédant, un ton de professeur, ses mains fines ne faisaient pas de gestes. Les deux convives étaient vêtus simplement d’habits noirs et de culottes de drap.
À ce moment, il y eut un grand remue-ménage ; on demandait les chapeaux, les manteaux, on se disait bonsoir… Robespierre, Vergniaud, Saint-Just, quittèrent la salle et, lorsqu’ils eurent disparu, le plus petit des deux dîneurs se renversa sur le dossier de sa chaise avec un soupir et murmura :
– L’air est meilleur à respirer maintenant que cette sale engeance a vidé les lieux.
– Pourtant, dit doucement le professeur, je vous ai rencontré pour la première fois au club des jacobins, monsieur le baron de Batz.
– J’y étais allé par curiosité. Et si je vous ai accosté ce soir-là, c’est bien parce que je vous ai trouvé différent de ces énergumènes.
– Différent ?
– Oui, vous êtes un homme cultivé et votre linge est élégant.
– Vous me flattez.
– Non, vous m’avez parlé de poésie, de la rhétorique anglaise et de l’art italien ; j’ai donc pensé en vous quittant qu’il me fallait vous rencontrer de nouveau. Aussi, je me suis félicité de vous voir apparaître ici cette nuit et je suis heureux que vous ayez accepté de vous asseoir à ma table.
La salle s’était presque entièrement vidée. À part nos deux interlocuteurs, il ne restait plus que trois joueurs de dominos et un quatrième quidam, le nez dans son journal.
Le baron de Batz se pencha vers le professeur :
– Je vais vous montrer toute mon estime maintenant, murmura-t-il.
– Vraiment ?
– Je vous demande votre aide.
– Pour quoi ?
– Pour sauver le roi.
– C’est une entreprise difficile, monsieur.
– Difficile, mais non impossible. J’ai cinq cents amis qui seront postés demain entre le Temple et la place de la Révolution. À mon signal, ils se précipiteront sur la voiture, emmèneront le roi dans une maison du quartier dont tous les habitants sont à ma solde. Vous ne dites rien ? À quoi pensez-vous ?
– Au général Santerre et aux huit mille soldats de l’escorte. Sont-ils eux aussi à votre solde ?
– Huit mille, répliqua Jean de Batz. Bah !
– Vous doutez du chiffre ?
– Non. Je sais tout cela. Je sais aussi qu’il y aura des canons et des canonniers, la mèche allumée à la main, mais il faut tenir compte de l’effet de surprise. Une panique soudaine peut se produire parmi ces hommes. Je peux vous dire que j’ai déjà vu des choses de ce genre-là.
– Il y a tout de même des tâches qui sont au-dessus des forces humaines.
– Alors, vous ne voulez pas m’aider ?
– Vous ne m’avez pas encore dit ce que je peux faire, et que puis-je faire ? Vous allez exposer inutilement la vie de vos adhérents et celle du pauvre prêtre qui sera dans la voiture du roi, l’abbé Edgeworth de Firmont, que j’ai connu autrefois à la Sorbonne. Vous ne sauverez pas le roi de la guillotine.
– La guillotine, hurla le baron de Batz, comment osez-vous parler dans la même phrase de notre souverain et de la guillotine ? Non, Louis XVI ne montera pas les marches de l’échafaud, nous l’arracherons aux griffes des assassins !
– Puis-je avoir mon manteau ? répondit le professeur.
Et avec un salut poli, il se retira.
3 La ligue du Mouron Rouge
Une heure ou deux plus tard, cinq hommes étaient réunis au second étage d’un immeuble de la rue du Bac : quatre d’entre eux étaient assis sur des chaises plus ou moins branlantes et le cinquième, debout devant la fenêtre, regardait à travers la pénombre le tableau qu’offrait la triste petite rue. Cet homme, d’une taille au-dessus de la moyenne, portait encore l’habit noir bien coupé qu’il avait pour dîner avec le baron de Batz chez Février, et qui lui donnait l’apparence d’un professeur.
De vrai, ce qu’on voyait par la fenêtre n’était guère réjouissant, mais cette atmosphère mélancolique ne semblait pas affecter ces hommes. Au contraire, leurs visages étaient ardents, animés, et la silhouette de l’homme en noir, avec ses larges épaules et ses hanches étroites, n’était pas celle d’un homme déprimé. Au bout d’un moment, d’ailleurs, il se détourna de son poste d’observation et alla s’asseoir dans un coin sur le bord d’un lit à roulettes tout à fait cassé.
– Bien, commença-t-il en s’adressant à tous. Vous avez entendu ce que ce fou a dit ?
– Presque tout, répondit quelqu’un.
– Il a le dessein insensé de jeter cinq cents écervelés à l’assaut de la voiture qui va emmener le roi à l’échafaud. Cinq cents cerveaux brûlés, menés par un candidat à Bedlam[1], vont essayer d’atteindre cette voiture que huit mille hommes armés vont escorter. Ce serait ridicule si ce n’était tragique.
– On se demande, dit un des assistants, qui peuvent être ces cinq cents malheureux.
– De jeunes royalistes, tous bien connus des Comités. En fait, j’ai appris que la plupart d’entre eux, si ce n’est tous, recevront la visite de la police au petit jour et n’auront pas la possibilité de quitter leur domicile jusqu’à ce que l’exécution du roi ait eu lieu.
– Ciel ! dit l’aîné des quatre jeunes gens, comment avez-vous su cela ?
– Très simplement, mon cher, très facilement. La foule s’est écoulée aussitôt qu’on a eu proclamé le verdict. Il était trois heures du matin. Tout le monde était très excité et personne ne s’occupait de son voisin. Le président et les autres juges se sont retirés dans la salle qui leur est réservée. Vous voyez celle que je veux dire. Elle n’a pas de porte, seulement une arcade, et il y a toujours foule dans les corridors ; je me suis approché de l’entrée le plus possible et j’ai entendu Vergniaud donner l’ordre de mettre sous la surveillance de la police jusqu’à midi toute personne connue pour ses opinions royalistes ou même seulement modérées.
– Percy, vous êtes merveilleux ! s’écria le jeune homme avec ferveur.
– Tony, vous êtes un idiot ! répondit l’autre en riant.
– Donc, nous devons penser que le plan de notre ami le baron a fait long feu ?
– N’avez-vous pas pensé, Blakeney, que nous…
– Dieu me défend, interrompit Sir Percy avec emphase, de risquer vos précieuses vies dans une entreprise que mon bon sens me montre irréalisable. À quoi pourrait aboutir ce projet à la don Quichotte ? Pourrait-on enfoncer un cordon de troupes profond de dix rangs ? Et même, si nous supposons que les cinq cents hommes de Batz arrivent à atteindre la voiture, que pourront-ils espérer après ? Vont-ils se battre avec toute la garnison qui compte cent trente mille hommes ? Croit-on que tout le peuple de Paris va se soulever comme un homme et prendre parti pour le roi ? Folie que tout cela ! Et le premier résultat du corps à corps dans les rues serait le meurtre du roi par une main inconnue. N’ai-je pas raison ?
Tous en convinrent. Leur chef n’avait pas l’habitude de faire de longs discours. Qu’il en ait fait un à ce propos prouvait combien il était troublé par l’événement. Voulait-il se justifier devant ses fidèles de rester inactif ? Je ne le pense pas. Il était habitué à leur obéissance aveugle : c’était là ce qui faisait la force infrangible de la ligue du Mouron Rouge, et trois des hommes présents : Lord Anthony Dewhurst, Sir Andrew Ffoulkes et Lord Hastings, étaient ses plus chers amis.
Le chef avait parlé clairement et longuement de tout ce qui pouvait se passer le lendemain si on essayait de sauver le roi, mais il n’avait certainement pas encore fait part de tout ce qu’il avait à dire : les membres de la ligue savaient que leur chef ne leur aurait pas donné cet imperceptible signal au moment de quitter le restaurant s’il n’avait voulu que leur faire constater leur impuissance.
Sir Percy parla de nouveau :
– Mettons de côté le roi : son sort nous emplit d’horreur, mais nous ne pouvons rien y changer. Songeons à ce prêtre infortuné qui perdra sûrement sa tête sur l’échafaud si notre ligue n’intervient pas.
– L’abbé Edgeworth ?
– Oui. Il est d’origine irlandaise et, de son nom Fairymount, les Français ont fait Firmont. Qu’il vienne de nos îles ne peut qu’augmenter l’intérêt que nous lui portons… Calmez-vous ! Ce n’est pas la question ! L’abbé est un brave homme qui passe sa vie à secourir les malheureux, c’est donc une sorte de frère pour nous ; allons-nous l’abandonner à ces bêtes féroces ?
Tous secouèrent la tête avec énergie en signe de dénégation, et Ffoulkes ajouta :
– Si vous le voulez, Percy, nous ne l’abandonnerons pas.
– Bien. Il nous faudra occuper notre poste à sept heures sur la place de la Révolution, à l’angle de la rue Égalité, l’ancienne rue Royale. C’est là que nous serons le plus près de la guillotine. Lorsque la tête du roi sera tombée, il y aura un grand mouvement de foule : on se précipitera pour chercher ces horribles reliques que le bourreau vendra au plus haut prix. D’y penser, on a un haut-le-cœur, mais c’est là notre chance : entre nous cinq, nous aurons vite fait de nous emparer du pauvre prêtre et de le mettre en sûreté.
– Où pensez-vous l’emmener ? demanda Lord Tony.
– À Choisy. Vous vous souvenez des Levet ?
– Bien sûr. J’aime le vieux Levet. C’est un homme qui sait prendre des risques.
– Moi aussi je l’aime, dit Sir Andrew, et je suis bien fâché de ce qui est arrivé à sa pauvre femme. La petite n’a pas d’importance, mais je me méfie de son amoureux.
– Lequel ? dit Blakeney avec un sourire. La jolie petite Blanche en a plusieurs.
– Ffoulkes veut parler du médecin, interrompit alors le plus jeune des quatre hommes, Lord Saint-John Devinne qui était resté silencieux et maussade jusqu’à maintenant, sans prendre part à la conversation de ses amis.
C’était un grand jeune homme, de belle figure, le type classique de l’Anglais bien né, et on aurait pu le dire vraiment beau sans quelque chose de têtu et de faible à la fois qui se faisait jour dans ses yeux gris et dans la courbe efféminée de ses lèvres.
– Pradel n’est pas un mauvais homme, répondit Sir Andrew Ffoulkes. Peut-être aime-t-il un peu trop pérorer sur la Liberté, l’Égalité et tout le reste…
– Je ne peux pas supporter cet animal, murmura Devinne d’un air hargneux ; il dit sans cesse, et démontre, et prêche, que les manants mal lavés sont des gens très bien en réalité si seulement ils arrivaient à s’en apercevoir, et que l’avenir leur appartient.
Il ajouta, plein de mépris :
– Liberté, Égalité ? Quelles bêtises !
– Bien, dit à son tour Sir Percy de sa voix calme, ne peut-on dire quelque chose en leur faveur ? Les pauvres diables ont eu de mauvais temps en France ; maintenant ils menacent et ils tuent. Pradel est un intellectuel, il parle, mais il ne tuera jamais.
Devinne murmura :
– J’en suis moins sûr que vous.
Tandis que Lord Tony éclatait de rire :
– Je vais vous dire ce qui ne va pas avec votre ami Pradel !
– Qu’est-ce que c’est ? demanda Sir Andrew.
– Il est amoureux.
– Oui, de Blanche Levet.
– Non. De Cécile de la Rodière.
La nouvelle fut accueillie avec incrédulité.
– Quelle blague ! dit Sir Andrew.
– Ce n’est pas vrai ? demanda Hastings.
Blakeney cependant la confirma :
– J’ai peur que ce ne soit vrai.
Tandis que Devinne interrompait avec fureur :
– Il n’oserait pas !
– Il n’y a rien d’audacieux à être amoureux, mon cher garçon, fit remarquer Sir Percy.
– Alors, pourquoi dites-vous que vous avez peur que ce ne soit vrai ?
– Parce que ce genre de chose amène inévitablement des complications.
– Vous voyez la tête de la marquise et de son fils François, s’ils s’aperçoivent un jour que le médecin du village est amoureux de Mlle de la Rodière ?
– Je vois cela très bien, dit Saint-John Devinne. Il arriverait la bonne vieille histoire dont j’ose dire qu’on peut l’approuver : celle d’une solide correction administrée à M. Pradel des mains du marquis et…
Il s’arrêta, et une vive rougeur envahit sa jolie figure. Comme il levait les yeux, il avait rencontré le regard de son chef fixé sur lui avec une expression qu’il était difficile de définir. Il y avait là de la gaieté, de la pitié, de la raillerie, et tout cela réduisit le jeune homme au silence.
On se tut pendant quelques instants. Il semblait que l’attitude de Lord Saint-John, et sa courte discussion avec le chef de la ligue, eussent jeté un froid. Blakeney consulta sa montre et dit tranquillement :
– Il est temps de revenir à nos affaires.
Aussitôt, tous redevinrent attentifs. Le mot « affaires » avait pour eux un sens si riche : enthousiasme, aventure, le piment de leur existence. Seul, Devinne, renfrogné, ne regarda pas une fois du côté de son chef.
– Écoutez-moi, camarades, reprit Blakeney d’un ton ferme : si vous n’apprenez rien de moi d’ici demain matin, nous nous retrouverons où je l’ai dit, à sept heures précises. Après, vous n’avez qu’à vous tenir aussi près de moi que possible, et si nous sommes séparés par la foule, nous nous retrouverons à Choisy. Donnez-vous l’apparence d’une bande de coquins. Ce ne sera pas difficile.
Après un arrêt, il conclut :
– Si, contrairement aux prévisions, l’abbé Edgeworth ne devait pas accompagner le roi, je vous enverrais un mot avant cinq heures du matin. Souvenez-vous que mes ordres pour cette nuit sont de ne pas vous faire arrêter, cela aurait des inconvénients pour nous tous.
Les jeunes gens sourirent. Il ajouta :
– C’est tout. Bonne nuit ! Dieu vous bénisse !
Et il partit.
Les autres prêtèrent l’oreille attentivement pour chercher à entendre ses pas dans l’escalier de pierre, mais ils n’entendirent rien. Ils allèrent à la fenêtre et, à travers le brouillard, ils virent la haute silhouette de leur chef traverser la rue et disparaître dans la nuit.
D’un seul cœur, trois Anglais chevaleresques murmurèrent avec ferveur :
– Dieu le protège !
Devinne ne dit rien et, au bout de quelques minutes, sortit. Lord Tony dit aux autres :
– Vous avez confiance en Devinne ?
Et il ajouta avec emphase :
– Moi, non !
Lord Hastings secoua la tête :
– Je me demande ce qu’il a.
– Je peux vous le dire, reprit Lord Tony. Il aime Mlle de la Rodière. Il l’avait rencontrée à Paris il y a cinq ans avant toutes ces histoires. La mère de la jeune fille et son frère n’ont pas voulu d’un mariage avec un étranger, pas plus qu’ils ne voudraient d’un mariage avec un médecin de campagne. Devinne ne peut pas voir en Pradel un rival sérieux, et cependant il le hait et passe sa bile sur lui. Son attitude à l’égard de Percy est impardonnable, c’est pourquoi je n’ai pas confiance en lui.
Là-dessus, Sir Andrew murmura tout bas :
– S’il y a un traître parmi nous, que Dieu nous aide !
4 Le 21 janvier
Ce matin-là, les rues de Paris étaient silencieuses. On entendit seulement quelques cris de « Grâce ! Grâce ! » lorsque, à la porte du Temple, le roi sortit accompagné de l’abbé Edgeworth et monta dans la voiture qui l’attendait. Tout le reste du chemin, la foule resta silencieuse. Personne n’osa pousser un cri de pitié parce qu’on avait trop peur d’être dénoncé par ses voisins. Toutes les fenêtres étaient fermées, pas un visage ne s’y montra pour regarder dans la rue. Entre la prison et la place de la Révolution, on avait disposé huit mille hommes, l’arme au bras. Personne n’aurait pu réussir à franchir cette barrière et, à chaque coin de rue, on voyait la gueule dressée des canons et les canonniers, immobiles, tenaient leurs mèches allumées. On n’entendait pas rouler d’autres voitures que celle où le roi Louis XVI écoutait l’abbé Edgeworth lire les prières des agonisants.
À l’angle du boulevard Bonne-Nouvelle et de la rue de la Lune, debout sur un mamelon, se tenait un homme trapu enveloppé dans un manteau sombre. C’était le baron de Batz. Il attendait là depuis trois heures et essayait de se réchauffer en frappant du pied le sol gelé. Deux heures auparavant, deux hommes jeunes étaient venus par la rue de la Lune rejoindre le guetteur solitaire. Après une conversation à voix basse, ils étaient tous restés silencieux à leur poste et, du monticule sur lequel ils étaient juchés, ils examinaient avec une anxiété croissante la foule qui les environnait. Il n’y avait pas trace des cinq cents complices qui devaient aider le baron à exécuter son plan insensé pour sauver le roi. Batz ignorait que ses amis avaient été éveillés à l’aube par des coups frappés à leur porte. Deux gendarmes entraient alors dans l’appartement et s’y installaient pour les surveiller et leur interdire de quitter leur maison jusqu’à midi. Batz et les deux amis qui l’avaient rejoint avaient passé la nuit à discuter dans une taverne du Boulevard et avaient échappé ainsi à cette visite domiciliaire. À mesure que le temps passait, ils maudissaient la traîtrise et la lâcheté des autres conspirateurs. De la direction du Temple vint bientôt le roulement sinistre des tambours et un bruit de roues.
Il y avait du brouillard, mais bientôt pourtant, Batz et ses amis aperçurent l’avant-garde de l’escorte. D’abord venait la gendarmerie montée qui barrait la rue dans toute sa largeur, puis, ce furent les grenadiers de la Garde nationale, enfin l’artillerie suivie par les tambours et par la voiture aux stores baissés. Autour de celle-ci et derrière elle, il y avait d’autres troupes, d’autres canons, d’autres tambours. Heureusement pour le baron de Batz et pour ses compagnons, leurs cinq cents complices avaient manqué le rendez-vous et n’étaient pas là pour tenter de se mesurer avec cette imposante escorte.
Batz cria :
– À nous ! À nous ! Sauvons le roi ! en agitant son chapeau, mais les trois hommes furent vite submergés par la foule qui se précipitait vers la place de la Révolution et ces cris n’eurent pas d’écho.
La voiture s’arrêta en face de la guillotine qui était dressée sur la place. Derrière le cordon de troupe, la multitude s’écrasait. Certes, ç’avait été un spectacle passionnant de voir un roi jouer sa tête dans un procès, mais lui voir perdre cette tête était infiniment plus extraordinaire.
La portière s’ouvrit. Le général Santerre commanda un roulement de tambour tandis que le roi montait les degrés de l’échafaud. L’abbé Edgeworth était aux côtés du roi et priait toujours.
Louis XVI adressa quelques mots au peuple, mais un nouveau roulement de tambour couvrit sa voix. Le couteau tomba. On cria :
– Vive la République !
On hissa des bonnets rouges sur les baïonnettes, et on se pressa autour de l’échafaud tandis qu’un aide du bourreau montrait la tête du roi. On teignit des mouchoirs dans le sang, et le bourreau, pour quelques pièces d’argent, vendit des mèches des cheveux du martyr. La foule hurlait, chantait, s’agitait avec frénésie et, au milieu de tout ce tumulte, l’abbé Edgeworth restait à genoux à l’endroit même où il avait été séparé du roi, sans se soucier des cris menaçants qui s’élevaient autour de lui.
– À la lanterne !
– À moi, le calotin !
– Non, à moi !
– À moi ! À moi !
Alors seulement, l’idée que certains excités demandaient son sang traversa l’esprit de l’abbé. Il pensa qu’on allait le traîner à la guillotine et le tuer comme on avait tué le roi. Il ne fut pas effrayé, il continua ses prières jusqu’à ce qu’un groupe d’hommes qui criaient plus fort que les autres le relevât et l’emportât en hurlant.
La foule, qui pensait surtout à se procurer des reliques, envahit la plateforme de la guillotine, oublia le prêtre. L’abbé, à demi inconscient, se sentit envelopper d’un manteau qui amortit les clameurs hideuses de la populace et, bientôt, il n’entendit plus rien. Il s’évanouit.
Au bout d’une demi-heure, la frénésie populaire s’apaisa, les troupes se retirèrent et peu à peu la foule se dispersa, chacun retourna à ses affaires, acheta, vendit, déjeuna comme si le 21 janvier 1793 était un jour comme un autre au lieu d’être un des plus étonnants de l’histoire de France.
À la Convention, les membres du gouvernement se frottaient les mains : « C’est fait ! » Un roi venait de mourir comme un vulgaire criminel pour avoir conspiré contre la liberté.
Ce ne fut pas avant le soir que la Convention, réunie en comité, décida que le prêtre qui avait reçu la dernière confession de Louis Capet devait être mis en lieu sûr. Qui pouvait savoir ce que Louis Capet avait confié à cet homme ? De toute façon, le Comité décida qu’il valait mieux le faire mourir et donna l’ordre à la police de procéder à son arrestation.
Seulement, d’une manière ou d’une autre, pendant l’effervescence qui avait suivi la mort du roi, l’abbé Edgeworth avait disparu.
5 La famille Levet
En 1793, la famille Levet comptait quatre membres. Le père ; Charles, n’avait pas plus de cinquante ans, mais on l’avait depuis longtemps surnommé « le vieux Levet » pour le distinguer de son fils aîné « le jeune Levet ». Donc, le vieux Levet était, de son métier, botaniste ; son travail consistait à parcourir les prés, les montagnes et les bords des rivières pour recueillir les plantes médicinales que demandaient les apothicaires. Ce genre de vie, solitaire la plupart du temps, l’avait rendu silencieux et réfléchi. Il vivait dans la nature et en connaissait toutes les humeurs, aucune d’elles ne l’eût effrayé : gelées, neiges, tempêtes étaient ses amies ; au lieu de les craindre, il vivait en communion avec elles. En plus de la nature, il avait deux amours : sa femme et son fils aîné. Le jeune Levet, qui était lieutenant de la Garde nationale, avait été tué en défendant les Tuileries le 10 août 1792. Après cela, le vieux Levet n’avait plus jamais été le même. Avant, il était laconique ; maintenant, il était taciturne et morose. Sa femme n’avait pu surmonter cette épreuve, elle avait eu un coup de sang qui l’avait laissée paralysée et elle restait depuis plus morte que vive, incapable de parler, incapable de bouger avec, dans ses grands yeux sombres, le reflet de l’angoisse que les événements de la capitale entretenaient dans son âme affaiblie. Elle et son mari, comme leur fils aîné, étaient de fervents royalistes, et la pauvre Henriette Levet avait manqué mourir lorsqu’elle avait entendu parler du procès de Louis XVI.
Le second fils des Levet, leur fils unique maintenant, était prêtre de Saint-Sulpice. Comme son père, Augustin était peu loquace, sauf lorsqu’il remplissait les devoirs de son état. Il passait le temps dont il pouvait disposer auprès de sa mère, lui lisant des livres de piété et les Vies des Saints avec une voix morne, inexpressive, qui ne semblait pas apporter beaucoup de réconfort à la pauvre malade.
Blanche, la jeune fille, faisait de son mieux, au contraire, pour apporter dans la maison sinon la gaieté, ce qui était impossible, du moins l’animation et le divertissement. Elle n’avait pas encore vingt ans, était jolie, et les jeunes gens tournaient autour d’elle comme des guêpes autour d’un pot de miel. Les constantes admonestations de son frère, qui aurait voulu la voir prendre la vie au sérieux, glissaient sur sa nature de vif-argent. Afin de ne pas heurter les convictions de sa famille et des amis qui fréquentaient la maison de son père, elle affichait des opinions royalistes et savait fort bien exprimer son amour pour le roi et son horreur devant le sort qui le menaçait, mais tout cela était superficiel ; les opinions politiques de Blanche ne l’empêchaient pas d’accepter les hommages d’un jeune homme bien connu pour sa ferveur républicaine, Louis Maurin, un jeune notaire qui aimait beaucoup Blanche et craignait tout autant le père de sa bien-aimée. Le vieux Levet n’avait pas formellement défendu l’entrée de sa maison à Louis Maurin, mais il n’encourageait pas ses visites ; cependant, lorsqu’il osait se présenter, Louis était très discret et le sourire de Blanche lui permettait de supporter les coups d’œil furieux du père de famille chaque fois que la politique venait sur le tapis.
En réalité, Blanche ne considérait Maurin que comme un amoureux, ainsi considérait-elle tout être qui portait des culottes et lui offrait l’hommage de son admiration. Tous les jeunes hommes de Choisy étaient dans ce cas, tous, sauf le médecin Simon Pradel, un Provençal cultivé et de belle mine dont la popularité dans le pays était immense, car avec la fortune que lui avait léguée un oncle qu’il n’avait jamais vu, il avait fondé un hôpital pour les enfants malades. Il venait souvent chez les Levet pour soigner Mme Levet dont les grands yeux lui souhaitaient une bienvenue muette, et il était le seul homme avec qui le vieux Levet acceptât de causer, ce qui veut dire qu’il écoutait avec sympathie ce que le jeune docteur lui disait.
Blanche, elle, faisait plus qu’écouter, et ses sourires, ses regards, indiquaient à Pradel que ses visites étaient bien accueillies, quoiqu’elle ne fît rien de plus que s’amuser avec celui-là aussi. Assez étrangement, le jeune homme semblait insensible aux avances de l’enfant gâtée et il ne lui montrait pas plus d’empressement qu’à Marie Bachelier, la bonne à tout faire.
À Choisy, on disait même que Pradel était un misanthrope, et surtout un misogyne, mais certains racontaient qu’ils avaient vu le Dr Pradel errer le soir aux alentours du château de la Rodière dans l’espoir, ajoutait-on, d’apercevoir Mlle Cécile de la Rodière. Ces bavardages étaient revenus aux oreilles de la jolie Blanche Levet, et le dépit avait changé son cœur. Ce qui n’avait été d’abord qu’une franche sympathie s’était changé en une passion.
6 Des nouvelles
Le 21 janvier avait été un jour de terreur et de désespoir pour les habitants de la maison Levet. Le vieux Levet était sorti le matin de très bonne heure. Avec la neige sur le sol et un épais brouillard sur les champs et la rivière, il ne lui était pas possible de cueillir ses herbes comme de coutume ; ce qu’il voulait, c’était d’abord être seul et ensuite aller en ville pour savoir les nouvelles. Il savait qu’il lui faudrait apprendre les nouvelles à sa femme, il savait que s’il ne disait rien, elle devinerait, et quand elle serait au courant, elle mourrait.
C’est ainsi que le vieillard, car en ce moment il était vraiment vieux, parcourait les rues de Choisy en s’efforçant de se préparer au coup terrible qui allait le frapper. Il avait d’abord erré sans but, mais à dix heures du matin il s’arrêta. Quelque chose lui disait que le crime affreux était consommé. Il y eut un roulement lointain qu’on aurait pu prendre pour un coup de tonnerre, mais Levet était sûr, au fond de son cœur, que c’était le roulement de tambour qui annonçait au monde que la tête du roi de France venait de tomber sous le couteau de la guillotine. Il ressentit à la fois une douleur aiguë presque physique et une haine violente contre les gens qui l’entouraient. Il descendit rapidement la rue qui menait à la rivière et s’arrêta à l’entrée du pont. Il y avait là une pierre d’angle où il s’assit, et il attendit. Il s’était levé ce matin-là de très bonne heure et, lorsqu’il avait ouvert la porte d’entrée de sa maison, il avait vu sur le seuil un bout de papier lesté d’une pierre. Il l’avait pris et lu, car il savait très bien qui lui envoyait ce message. Il en avait déjà reçu plusieurs auparavant ; ils lui donnaient des instructions pour coopérer à un sauvetage. Il avait toujours été prêt à donner son aide et à obéir à ces instructions qui lui venaient d’un homme dont il savait vaguement qu’il professait dans une université, mais qu’il respectait plus que tous ceux qu’il avait rencontrés jusqu’ici.
Le message d’aujourd’hui donnait des instructions très simples. Il disait : Attendezà la tête de pont, de midi au crépuscule. Il n’était que dix heures, mais peu importait au vieil homme. Y avait-il encore des heures pour lui alors que cet horrible forfait avait souillé la France ? Il était engourdi de froid et recru de fatigue, mais il n’en était pas conscient. Il était assis là, il attendait en surveillant de ses yeux mornes les allées et venues qui animaient le pont. L’horloge d’une église lointaine avait sonné quatre heures lorsque deux silhouettes se détachèrent de la foule et vinrent tout droit au coin où se tenait le vieux Levet. Deux hommes, l’un grand, l’autre petit, et tous les deux enveloppés d’épais manteaux. Levet s’éveilla de sa torpeur. Le plus grand des deux hommes l’aida à se mettre debout et lui dit :
– Voici l’abbé Edgeworth, Charles. Il a assisté Sa Majesté jusqu’au bout.
– Allons tout de suite à la maison, répondit simplement Levet. Il fait froid ici, et M. l’abbé sera le bienvenu.
Sans un mot de plus, les trois hommes traversèrent la ville. C’était bien de Levet de ne pas faire de commentaire, de ne pas poser une question. Il marchait vite devant les deux autres sans regarder à droite et à gauche. Le prêtre paraissait à bout de forces, son ami le tenait par le bras pour l’aider à marcher. À cent mètres de la maison, Levet s’arrêta ; il attendit que les autres le rejoignissent et leur dit :
– Ma femme est très malade. Elle ne sait rien encore. Peut-être devine-t-elle ? Il faut que je la prépare. Voulez-vous attendre ici ?
Il était tout à fait nuit et le brouillard était très dense. La silhouette cassée de Levet fut vite hors de vue.