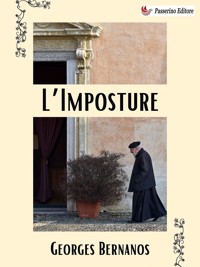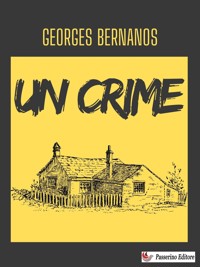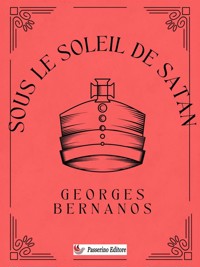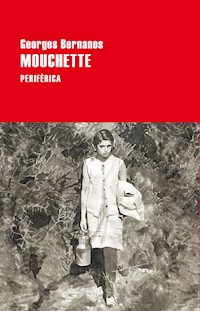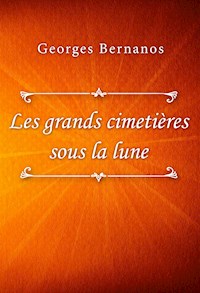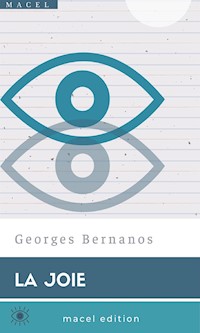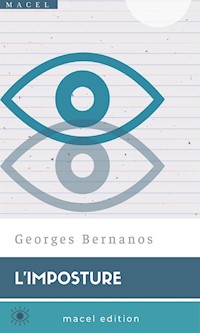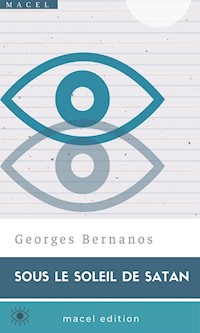1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La France contre les robots est un essai de Georges Bernanos publié en 1947. Il s'agit d'un recueil de différents textes formant une violente critique de la société industrielle. Bernanos y estime que le machinisme limite la liberté des hommes, et perturbe jusqu'à leur mode de pensée. Pour lui, la civilisation française est incompatible avec une certaine idolâtrie anglo-saxonne pour le monde de la technique.
Il y conteste l'idée selon laquelle la libre entreprise conduirait automatiquement au bonheur de l'humanité, car, selon lui, « il y aura toujours plus à gagner à satisfaire les vices de l'homme que ses besoins ».
Il y prédit aussi une révolte des élans généreux de la jeunesse contre une société trop matérialiste où ceux-ci ne peuvent s'exprimer.
Extrait
| I
| Si le monde de demain ressemble à celui d’hier, l’attitude de la France sera révolutionnaire. Lorsqu’on s’en tient à certains aspects de la situation actuelle, cette affirmation peut paraître très audacieuse. Dans le moment même où j’écris ces lignes, les puissants rivaux qui se disputent, sur le cadavre des petites nations, le futur empire économique universel, croient déjà pouvoir abandonner, vis-à-vis de nous, cette ancienne politique expectative, qui a d’ailleurs toujours été celle des régimes conservateurs en face des révolutions commençantes. On dirait qu’une France libérée de l’ennemi les inquiète beaucoup moins que la France prisonnière, mystérieuse, incommunicable, sans regard et sans voix. Ils s’efforcent, ils se hâtent de nous faire rentrer dans le jeu — c’est-à-dire dans le jeu politique traditionnel dont ils connaissent toutes les ressources, et où ils se croient sûrs de l’emporter tôt ou tard, calculant les atouts qui leur restent et ceux que nous avons perdus. Il est très possible que cette manœuvre retarde un assez long temps les événements que j’annonce. Il est très possible que nous rentrions dans une nouvelle période d’apaisement, de recueillement, de travail, en faveur de laquelle sera remis à contribution le ridicule vocabulaire, à la fois cynique et sentimental, de Vichy. Il y a beaucoup de manières, en effet, d’accepter le risque de la grandeur, il n’y en a malheureusement qu’une de le refuser. Mais qu’importe ! Les événements que j’annonce peuvent être retardés sans dommage. Nous devons même prévoir avec beaucoup de calme un nouveau déplacement de cette masse informe, de ce poids mort, que fut la Révolution prétendue nationale de Vichy. Les forces révolutionnaires n’en continueront pas moins à s’accumuler, comme les gaz dans le cylindre, sous une pression considérable. Leur détente, au moment de la déflagration, sera énorme...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
NOTE DE L’ÉDITEUR
PRÉFACE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
GEORGES BERNANOS
LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS
ROMAN
Robert Laffont
1947
Raanan Éditeur
Livre 558| édition 1
NOTE DE L’ÉDITEUR
Cet ouvrage, dont le texte vient de parvenir en France, fut écrit à la fin de 1944 et donné par l’auteur au Comité de la France Libre du Brésil qui en a publié l’édition originale.
À Auguste Rendu, Président du Comité France Libre à Rio de Janeiro, à Madame Rendu et aux Membres du Comité
Marcel Layolle
Jean Hauser
André Faure
René Bouguié
Yves Mainguy
Léon Reuché
René Wurmser
Maurice Cellier
Pierre Aubaud
Louis Hutier
Arthus Germain
en témoignage de ma fidélité fraternelle à leur souvenir et à leur exemple.
G. BERNANOS.
PRÉFACE
Mon cher ami, c’est à vous et à votre chère et vaillante femme que je veux dédier ces pages, les dernières que j’écrirai au Brésil, après sept années d’exil. Je dis sept années parce que — mieux vaut peut-être le rappeler tout de suite — c’est en 1938 que j’ai quitté mon pays ; je dis sept années d’exil, car, après Munich, fussé-je resté en France, j’y aurais été aussi un exilé.
Voilà longtemps que nous nous connaissons, RENDU, et c’est pourtantaujourd’hui la première fois qu’il m’arrive de dire publiquement ce que je pense de vous. Dans les quatre volumes du Chemin de la Croix-des-Âmes, votre nom n’est pas cité une fois. Je n’avais jamais pensé jusqu’ici à cette anomalie, et il est probable que vous n’y aviez pas pensé davantage. Lorsque deux bons ouvriers travaillent côte à côte, chacun d’eux ne pense qu’à sa propre besogne, parce qu’il sait que celle du voisin sera faite aussi consciencieusement que la sienne. Eh bien, Rendu, voilà le témoignage que je veux vous rendre d’abord. Je sais ce que c’est que le travail, le vrai, pas le travail d’amateur. Vous êtes un bon ouvrier, Rendu. Et votre chère femme est aussi une bonne ouvrière ; vous faites, à vous deux, comme aurait dit Péguy, un rude ménage ouvrier. Voilà précisément ce qui n’est pas du goût de tout le monde. On vous aurait pardonné de donner à notre pays de la camelote, de l’article de bazar, et vous lui avez fourni, au contraire, ce que les bravesgens de chez nous appellent du bon, du solide, fait avec de vrais outils, de forts et loyaux outils, et qui pesaient le poids qu’il faut. Évidemment, lorsqu’un malheureux atteint de cette curieuse espèce d’anémie morale qui porte le nom de pétainisme, de cette bizarre décoloration de la conscience — la maladie des consciences pâles — vient vous déranger dans votre travail, s’approche trop près de l’établi, et que Mme Rendu lui laisse malicieusement tomber l’outil sur les pieds, le pauvre diable s’en va furieux. Tant pis pour le pauvre diable ! Tant pis pour les décolorés ! Nous trouvons que leur décoloration chronique a déjà coûté très cher à la France. C’est pour eux, pour leur santé, qu’elle est allée jadis à Munich. Elle aurait pu d’ailleurs s’épargner le voyage, car, deux ans plus tard, les décolorés étaient plus décolorés que jamais, la honte de l’armistice ne leur a même pas rendu de couleurs. La France s’occupera d’eux plus tard. Certes, nous ne doutonspas que notre pays reprenne un jour sa place traditionnelle à la tête de la civilisation — ou de ce qu’il en restera, de ce que les conférences en auront laissé ; mais elle a encore beaucoup de chemin à faire, et, lorsqu’on part pour une longue étape, on ne s’embarrasse pas de traînards et de mal fichus.
Cher ami, en m’adressant à vous, je pense à tous ceux qui ont fait, dans cette Amérique du Sud que je vais quitter, le même travail que vous. Je les salue de tout mon cœur. Vous étiez pour la plupart des hommes tranquilles et laborieux, attachés à leur métier, à leur négoce, à leur famille, et généralement peu soucieux de politique. La nouvelle de l’armistice vous a tous frappés de stupeur avant de vous enflammer de colère. Vous n’avez pas discuté l’armistice, vous avez refusé d’entrer dans les prétendues raisons de l’armistice. Vos adversaires en profitent pour vous accuserd’intransigeance, et même de fanatisme. Ils ont ainsi dupé un certain nombre de naïfs qui, dans le but de rassurer leur propre conscience, ne demandaient pas mieux que de vous croire aveuglés par la passion. Car vos pires ennemis, les pires ennemis de votre œuvre, n’étaient pas ceux qui mettaient en doute votre désintéressement, votre sincérité, c’étaient ceux qui feignaient de rendre hommage à « vos illusions généreuses ». Les « illusions généreuses » ! Tout le monde sait ce que ces deux mots signifient aujourd’hui, traduits en patois yankee. On ne pouvait pas dire plus clairement que nous étions des imbéciles. Eh bien, Rendu, lorsque vous et vos amis refusiez d’entrer dans les raisons de l’armistice, ce n’était nullement parce que vous redoutiez d’être convaincus. Vous refusiez d’entrer dans ces raisons parce qu’elles ne valaient rien. Ce que vous opposiez au déshonneur, c’était d’abord, et avant tout, le bons sens — un jugement droit. Mais ce mot de droit n’en suggère-t-il pas un autre ?On ne saurait être à la fois droit et tordu. Qui dit droit, n’est-ce pas, dit aussi inflexible. Vous étiez le bon sens inflexible. Alors que la plupart des valeurs brillantes révélaient brusquement leur impuissance et leur malfaisance, nous menaçant ainsi d’une faillite spirituelle mille fois plus désastreuse que la faillite militaire, la France s’est repliée sur vous, sur le bon sens populaire, comme un homme pressé de toutes parts s’adosse à un mur pour faire face. Vous opposiez le Bon Sens au Réalisme. S’il n’y avait que des salauds dans le monde, le Réalisme serait aussi le Bon Sens, car le Réalisme est précisément le bon sens des salauds. Lorsque, au temps de Munich, Jean Cocteau criait : « Vive la Paix Honteuse ! », il prouvait une fois de plus que le Réalisme n’est qu’une exploitation, une déformation du réel, un idéalisme à rebours. Car il n’y a pas de paix honteuse, il n’y a pas de véritable paix dans la honte. Une paix injuste peut,momentanément du moins, produire des fruits utiles, au lieu qu’une paix honteuse restera toujours par définition une paix stérile. Le bon sens et l’honneur sont d’accord sur ce point, quoi de plus naturel ? L’honneur n’est-il pas un peu au bon sens ce que la Sainteté est à la Vertu, l’honneur n’est-il pas le bon sens au degré le plus éminent ? Le bon sens et l’honneur ensemble, voilà sur quoi s’est toujours fondée la grandeur française, voilà le principe de toute union nationale. Les imbéciles de Vichy ont cru très malin d’opposer le bon sens à l’honneur, mais l’honneur et le bon sens ont fini par se rejoindre pour former ce mélange détonant qui a explosé sous leurs derrières. Ils s’en frottent encore les fesses.
Cher ami, à l’heure où j’écris ces lignes, notre Gouvernement vient de vous honorer, honorant dans votre personne tous ceux qui, à travers cette immense Amérique latine, ont tenu bon comme vous. La décoration quevous avez reçue a un immense avantage sur les autres : c’est que, instituée depuis peu de temps, elle n’a pas encore beaucoup servi. Mais vous, Rendu, si l’on veut bien me permettre de risquer cette espèce de calembour, vous avez beaucoup servi, vous avez bien servi, vous avez bien servi la France. Je dis la France, celle d’hier et celle de demain, la France immortelle. Car cette France d’aujourd’hui à laquelle nous appartenons premièrement par la chair, puisque nous y sommes nés, que nous n’avons pas encore achevé d’y mourir, elle est la France, certes, mais une France où se trouvent étroitement mêlés le bon et le mauvais, le périssable et l’impérissable. De la France d’aujourd’hui, vous vous êtes efforcé de servir la part impérissable. Ce service ne va pas sans déceptions. Vous aviez accepté ces déceptions par avance. La France périssable, celle des combinaisons politiques et des partis, destinée à disparaître en même temps que les générations qui la constituent, vous aurait demandé beaucoup moins de sacrifices, pour de considérables profits, n’importe ! Les événements vous ont donné raison, ils ont donné raison à vous et à l’honneur. Cela devrait clore le débat. Malheureusement ce n’est ni à vous, ni à l’honneur que se sont ralliés vos anciens adversaires ; ils ne se sont ralliés qu’au succès, afin d’en tirer parti. Nous les voyons déjà exploiter cyniquement vos idées et vos formules. Ils en déforment le sens, ils en faussent l’esprit. Oh ! certes, nous souhaitons autant que personne l’union des Français ; je ne voudrais pas la retarder d’un jour, d’une heure. Mais, il y a quelque chose de plus précieux que l’union, ce sont les principes au nom desquels on s’unit.
Cher Rendu, ni vous, ni vos amis, n’avez jamais refusé d’accueillir ceux qui, reconnaissant leurs erreurs et la nécessité de les réparer, sont venus à vous franchement. Mais vous devez continuer à repousser l’insolente prétention des traîtres, des lâches ou des imbéciles qui n’ont jamais réclamé l’union que pour essayer de la confisquer à leur profit, afin de vous en exclure. Car ils ne vous demandent pas d’oublier ou d’excuser leurs fautes. Ils exigeraient bien plutôt que vous justifiiez ces fautes à vos dépens, aux dépens de la vérité. Voilà précisément ce que vous ne pourriez faire sans trahir la mission que vous avez reçue. L’esprit de l’armistice est inséparable de l’esprit de collaboration, le drame de l’armistice et celui de la collaboration ne font qu’un seul et même drame, celui de la conscience nationale, obscurcie par les équivoques. La loyauté inflexible d’hommes tels que vous a dissipé ces équivoques. Il ne faut pas qu’elles se retrouvent un jour, sous une forme ou sous une autre, dans la conscience des futurs petits Français.
Georges BERNANOS.
5 Janvier 1945