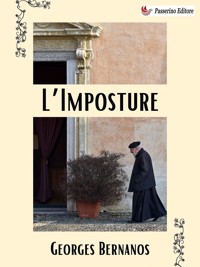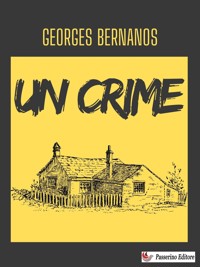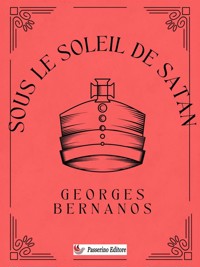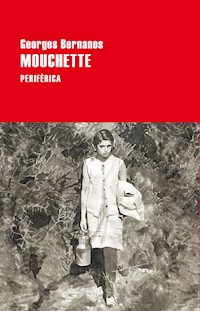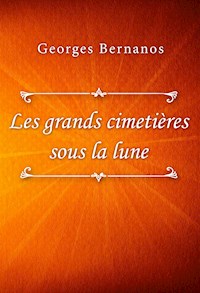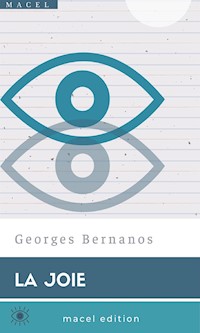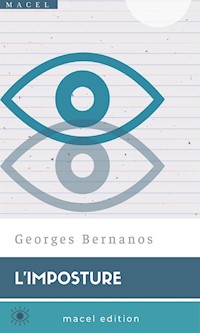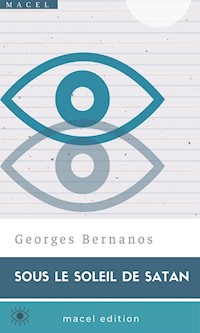2,44 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Macelmac
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Bernanos Georges – Les grands Cimetières sous la Lune : C’est lors de son exil que Bernanos rédige
Les Grands Cimetières sous la lune, un violent pamphlet anti-franquiste qui aura en France un grand retentissement lors de sa publication, en 1938. Bernanos séjourne à Majorque lorsque la guerre civile éclate. D’abord favorable au camp nationaliste pendant les trois premiers mois qui suivent le soulèvement l’écrivain est rapidement horrifié par la répression franquiste et désespéré par la complicité du clergé local. (Wikipédia)
En janvier 1937, il évoque l’arrestation par les franquistes de «pauvres types simplement suspects de peu d’enthousiasme pour le mouvement […] Les autres camions amenaient le bétail. Les malheureux descendaient ayant à leur droite le mur expiatoire criblé de sang, et à leur gauche les cadavres flamboyants. L’ignoble évêque de Majorque laisse faire tout ça. »
Dans
Les Grands Cimetières sous la lune, qui paraît d’abord dans une revue dominicaine, il ironise sur le « cardinal Goma » (Isidro Gomá y Tomás, archevêque de Tolède, qui identifiait le combat des franquistes à une véritable croisade catholique, dans une « guerre d’amour ou de haine envers la religion »). Le prélat est dépeint prêt à bénir la légalité, pour peu qu’elle soit devenue militaire, ou vantant l’esprit dans lequel, à ses dires, les républicains envoyés au mur accueillent les secours du « saint ministère ».
Alors qu’il réside encore à Palma de Majorque, il apprend que sa tête est mise à prix par Franco. Son pamphlet offre « un témoignage de combat » qui prend rapidement une actualité extraordinaire pour se révéler une prophétie des grandes catastrophes du siècle. Ce livre qui, comme
L’Espoir d’André Malraux, est un témoignage important sur la guerre d’Espagne, lui vaudra l’hostilité d’une grande partie de la droite nationaliste, en particulier de son ancienne famille politique, l’Action française, avec laquelle il avait rompu définitivement en 1932.
Bernanos affiche encore son admiration pour Édouard Drumont : « Le vieil écrivain de
La France juive fut moins obsédé par les juifs que par la puissance de l’Argent, dont le juif était à ses yeux le symbole ou pour ainsi dire l’incarnation ». Mais, on peut lire chez Bernanos, dès 1938, les prémices d’une profonde évolution : « Aucun de ceux qui m’ont fait l’honneur de me lire ne peut me croire associé à la hideuse propagande antisémite qui se déchaîne aujourd’hui dans la presse dite nationale, sur l’ordre de l’étranger »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Georges Bernanos
table des matières
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
Georges Bernanos
LES GRANDS CIMETIÈRES SOUS LA LUNE
1938
bibliothèque macel edition
Si je me sentais du goût pour la besogne que j’entreprends aujourd’hui, le courage me manquerait probablement de la poursuivre, parce que je n’y croirais pas. Je ne crois qu’à ce qui me coûte. Je n’ai rien fait de passable en ce monde qui ne m’ait d’abord paru inutile, inutile jusqu’au ridicule, inutile jusqu’au dégoût. Le démon de mon cœur s’appelle – À quoi bon ?
J’ai cru jadis au mépris. C’est un sentiment très scolaire et qui tourne vite à l’éloquence, comme le sang d’un hydropique tourne en eau. La lecture prématurée de Barrès m’avait donné là-dessus quelque illusion. Malheureusement le mépris de Barrès – ou du moins l’organe qui le sécrète – paraît souffrir d’une perpétuelle rétention. Pour atteindre à l’amertume, un méprisant doit pousser très loin la sonde. Ainsi le lecteur, à son insu, participe moins au sentiment lui-même qu’à la douleur de la miction. Paix au Barrès de Leurs figures ! Celui que nous aimons est entré dans la mort avec un regard d’enfant fier, et son pauvre sourire crispé de fille pauvre et noble qui ne trouvera jamais de mari.
Au seuil de ce livre, pourquoi le nom de Barrès ? Pourquoi à la première page du Soleil de Satan celui du gentil Toulet ? C’est qu’en cet instant, comme en cet autre soir de septembre « plein d’une lumière immobile » j’hésite à franchir le premier pas, le premier pas vers vous, ô visages voilés ! Car le premier pas franchi, je sais que je ne m’arrêterai plus, que j’irai, vaille que vaille, jusqu’au bout de ma tâche, à travers des jours et des jours si pareils entre eux que je ne les compte pas, qu’ils sont comme retranchés de ma vie. Et ils le sont en effet.
Je ne suis pas un écrivain. La seule vue d’une feuille de papier blanc me harasse l’âme. L’espèce de recueillement physique qu’impose un tel travail m’est si odieux que je l’évite autant que je puis. J’écris dans les cafés au risque de passer pour un ivrogne, et peut-être le serais-je en effet si les puissantes Républiques ne frappaient de droits, impitoyablement, les alcools consolateurs. À leur défaut, j’avale à longueur d’année ces cafés-crème douceâtres, avec une mouche dedans. J’écris sur les tables de cafés parce que je ne saurais me passer longtemps du visage et de la voix humaine dont je crois avoir essayé de parler noblement. Libre aux malins, dans leur langage, de prétendre que « j’observe ». Je n’observe rien du tout. L’observation ne mène pas à grand-chose. M. Bourget a observé les gens du monde toute sa vie, et il n’en est pas moins resté fidèle à la première image que s’en était formée le petit répétiteur affamé de chic anglais. Ses ducs sentencieux ressemblent à des notaires, et, quand il les veut naturels, il les fait bêtes comme des lévriers.
J’écris dans les salles de cafés ainsi que j’écrivais jadis dans les wagons de chemins de fer, pour ne pas être dupe de créatures imaginaires, pour retrouver, d’un regard jeté sur l’inconnu qui passe, la juste mesure de la joie ou de la douleur. Non, je ne suis pas écrivain. Si je l’étais, je n’eusse pas attendu la quarantaine pour publier mon premier livre, car enfin vous penserez peut-être avec moi qu’à vingt ans j’aurais pu, comme un autre, écrire les romans de M. Pierre Frondaie. Je ne repousse d’ailleurs pas ce nom d’écrivain par une sorte de snobisme à rebours. J’honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent, après Dieu, de ne pas mourir de faim. J’endure même humblement le ridicule de n’avoir encore que barbouillé d’encre cette face de l’injustice dont l’incessant outrage est le sel de ma vie. Toute vocation est un appel – vocatus – et tout appel veut être transmis. Ceux que j’appelle ne sont évidemment pas nombreux, ils ne changeront rien aux affaires de ce monde. Mais c’est pour eux, c’est pour eux que je suis né.
***
Compagnons inconnus, vieux frères, nous arriverons ensemble, un jour, aux portes du royaume de Dieu. Troupe fourbue, troupe harassée, blanche de la poussière de nos routes, chers visages durs dont je n’ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le bien et le mal, rempli leur tâche, assumé la vie et la mort, ô regards qui ne se sont jamais rendus ! Ainsi vous retrouverai-je, vieux frères. Tels que mon enfance vous a rêvés. Car j’étais parti à votre rencontre, j’accourais vers vous. Au premier détour, j’aurais vu rougir les feux de vos éternels bivouacs. Mon enfance n’appartenait qu’à vous. Peut-être, un certain jour, un jour que je sais, ai-je été digne de prendre la tête de votre troupe inflexible. Dieu veuille que je ne revoie jamais les chemins où j’ai perdu vos traces, à l’heure où l’adolescence étend ses ombres, où le suc de la mort, le long des veines, vient se mêler au sang du cœur ! Chemins du pays d’Artois, à l’extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grandes chevauchées des nuages, rumeurs du ciel, eaux mortes… J’arrivais, je poussais la grille, j’approchais du feu mes bottes rougies par l’averse. L’aube venait bien avant que fussent rentrés dans le silence de l’âme, dans ses profonds repaires, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, Mouchette et Donissan, Cénabre, Chantal, et vous, vous seul de mes créatures dont j’ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n’ai pas osé donner de nom – cher curé d’un Ambricourt imaginaire. Étiez-vous alors mes maîtres ? Aujourd’hui même, l’êtes-vous ? Oh ! je sais bien ce qu’a de vain ce retour vers le passé. Certes, ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l’heure venue, c’est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu’à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la Maison du Père. Après tout, j’aurais le droit de parler en son nom. Mais justement, on ne parle pas au nom de l’enfance, il faudrait parler son langage. Et c’est ce langage oublié ; ce langage que je cherche de livre en livre, imbécile ! comme si un tel langage pouvait s’écrire, s’était jamais écrit. N’importe ! Il m’arrive parfois d’en retrouver quelque accent… et c’est cela qui vous fait prêter l’oreille, compagnons dispersés à travers le monde, qui par hasard ou par ennui avez ouvert un jour mes livres. Singulière idée que d’écrire pour ceux qui dédaignent l’écriture ! Amère ironie de prétendre persuader convaincre alors que ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n’appartient qu’aux enfants, aux héros et aux martyrs.
Palma de Majorque,
janvier 1937.
I
PREMIÈRE PARTIE
« J’ai juré de vous émouvoir, d’amitié ou de colère, qu’importe ! » C’est ainsi que je parlais jadis, au temps de la Grande Peur, il y a sept longues années. À présent je ne me soucie plus beaucoup d’émouvoir, du moins de colère. La colère des imbéciles m’a toujours rempli de tristesse, mais aujourd’hui elle m’épouvanterait plutôt. Le monde entier retentit de cette colère. Que voulez-vous ? Ils ne demandaient pas mieux que de ne rien comprendre, et même ils se mettaient à plusieurs pour ça, car la dernière chose dont l’homme soit capable est d’être bête ou méchant tout seul, condition mystérieuse réservée sans doute au damné. Ne comprenant rien ils se rassemblaient d’eux-mêmes, non pas selon leurs affinités particulières, trop faibles, mais d’après la modeste fonction qu’ils tenaient de la naissance ou du hasard et qui absorbait tout entière leur petite vie. Car les classes moyennes sont presque seules à fournir le véritable imbécile, la supérieure s’arrogeant le monopole d’un genre de sottise parfaitement inutilisable, d’une sottise de luxe, et l’inférieure ne réussissant que de grossières et parfois admirables ébauches d’animalité.
C’est une folle imprudence d’avoir déraciné les imbéciles, vérité qu’entrevoyait M. Maurice Barrès. Telle colonie d’imbéciles solidement fixée à son terroir natal, ainsi qu’un banc de moules au rocher, peut passer pour inoffensive et même fournir à l’État, à l’industrie un matériel précieux. L’imbécile est d’abord un être d’habitude et de parti pris. Arraché à son milieu il garde, entre ses deux valves étroitement closes, l’eau du lagon qui l’a nourri. Mais la vie moderne ne transporte pas seulement des imbéciles d’un lieu à l’autre, elle les brasse avec une sorte de fureur. La gigantesque machine, tournant à pleine puissance, les engouffre par milliers, les sème à travers le monde, au gré de ses énormes caprices. Aucune autre société que la nôtre n’a fait une si prodigieuse consommation de ces malheureux. Ainsi que Napoléon les « Marie-Louise » de la campagne de France, elle les dévore alors que leur coquille est encore molle, elle ne les laisse même pas mûrir. Elle sait parfaitement que, avec l’âge et le degré d’expérience dont il est capable, l’imbécile se fait une sagesse imbécile qui le rendrait coriace.
Je regrette de m’exprimer si naturellement par images. Je souhaiterais de tout cœur faire ces réflexions si simples en un langage simple comme elles. Il est vrai qu’elles ne seraient pas comprises. Pour commencer d’entrevoir une vérité dont chaque jour nous apporte l’évidence, il faut un effort dont peu d’hommes sont aujourd’hui capables. Avouez donc que la simplicité vous rebute, qu’elle vous fait honte. Ce que vous appelez de ce nom est justement son contraire. Vous êtes faciles, et non simples. Les consciences faciles sont aussi les plus compliquées. Pourquoi n’en serait-il pas de même des intelligences ? Au cours des siècles, les Maîtres, les Maîtres de notre espèce, nos Maîtres ont défriché les grandes avenues de l’esprit qui vont d’une certitude à une autre, les routes royales. Que vous importent les routes royales si la démarche de votre pensée est oblique ? Parfois le hasard vous fait tomber dedans, vous ne les reconnaissez plus. Ainsi notre cœur se serrait d’angoisse lorsqu’une nuit, sortant du labyrinthe des tranchées, nous sentions tout à coup, sous nos semelles, le sol encore ferme d’un des chemins de jadis, à peine visible sous la moisissure d’herbes, le chemin plein de silence, le chemin mort qui avait autrefois retenti du pas des hommes.
C’est vrai que la colère des imbéciles remplit le monde. Vous pouvez rire si vous voulez, elle n’épargnera rien, ni personne, elle est incapable de pardon. Évidemment les doctrinaires de droite ou de gauche, dont c’est le métier, continueront de classer les imbéciles, en dénombreront les espèces et les genres, définiront chaque groupe selon les passions, les intérêts des individus qui le composent, leur idéologie particulière. Pour de telles gens cela n’est qu’un jeu. Mais ces classifications répondent si peu à la réalité que l’usage en réduit impitoyablement le nombre. Il est clair que la multiplication des partis flatte d’abord la vanité des imbéciles. Elle leur donne l’illusion de choisir. N’importe quel commis de magasin vous dira que le public appâté par les étalages d’une exposition saisonnière, une fois rassasié de marchandages et après avoir mis le personnel sur les dents, défile au même comptoir. Nous avons vu naître et mourir un grand nombre de partis, car chaque journal d’opinion ne dispose guère d’un autre moyen pour retenir sa clientèle. Néanmoins la méfiance naturelle aux imbéciles rend précaire cette méthode d’émiettement, le troupeau inquiet se reforme sans cesse. Dès que les circonstances, et notamment les nécessités électorales, semblent imposer un système d’alliances, les malheureux oublient instantanément les distinctions qu’ils n’avaient d’ailleurs jamais faites qu’à grand-peine. Ils se divisent d’eux-mêmes en deux groupes, la difficile opération mentale qu’on leur propose étant ainsi réduite à l’extrême, puisqu’il ne s’agit plus que de penser contre l’adversaire, ce qui permet d’utiliser son programme marqué simplement du signe de la négation. C’est pourquoi nous les avons vus n’accepter qu’à regret des désignations aussi complexes que celles, par exemple, de royalistes ou de républicains. Clérical ou anticlérical plaît mieux, les deux mots ne signifient rien d’autre que « pour » ou « contre » les curés. Il convient d’ajouter que le préfixe « ami » n’appartient en propre à personne, car si l’homme de gauche est anticlérical, l’homme de droite est anti-maçon, anti-dreyfusard.
Les entrepreneurs de presse qui ont employé ces slogans jusqu’à leur totale usure voudront sans doute me faire dire que je ne distingue pas entre les idéologies, qu’elles m’inspirent un égal dégoût. Hélas ! je sais pourtant mieux que personne ce qu’un garçon de vingt ans peut donner de lui, de la substance de son âme, à ces grossières créations de l’esprit partisan qui ressemblent à une véritable opinion comme certaines poches marines à un animal – une ventouse pour sucer, une autre pour évacuer la bouche et l’anus – qui, même chez certains polypes, ne font qu’un. Mais à qui la jeunesse ne prodigue-t-elle pas son âme ! Elle la jette parfois à pleines mains, dans les bordels. Comme ces mouches chatoyantes, vêtues d’azur et d’or, peintes avec plus de soin que les enluminures de missel, les premières amours s’abattent autour des charniers.
Que voulez-vous ? Je ne crois même pas au relatif bienfait des coalitions d’ignorance et de parti pris. L’indispensable condition à remplir pour entrer réellement dans l’action est de se connaître soi-même, d’avoir pris la juste mesure de soi. Or tous ces gens-là ne se rassemblent que pour mettre en commun les quelques raisons qu’ils possèdent de se juger meilleurs que les autres. Dès lors, qu’importe la cause qu’ils prétendent servir ? Dieu sait, par exemple, ce que coûte au reste du monde le maigre cheptel bigot entretenu à grands frais par une littérature spéciale, répandue à des millions d’exemplaires sur toute la surface du globe, et dont on voudra bien reconnaître qu’elle est faite pour décourager les incroyants de bonne volonté. Je ne veux aucun mal aux bigots, je voudrais simplement que vous ne me rebattiez pas les oreilles de leur prétendue naïveté. Le premier prêtre venu, s’il est sincère, vous dira que nulle espèce n’est plus éloignée que la leur de l’esprit d’enfance, de sa clairvoyance surnaturelle, de sa générosité. Ce sont des combinards de la dévotion, et les gras chanoines littéraires qui entonnent à ces larves le miel butiné sur les bouquets spirituels ne sont pas non plus des ingénus.
La colère des imbéciles remplit le monde. Il est tout de même facile de comprendre que la Providence qui les fit naturellement sédentaires avait ses raisons pour cela. Or vos trains rapides, vos automobiles, vos avions les transportent avec la rapidité de l’éclair. Chaque petite ville de France avait ses deux ou trois clans d’imbéciles dont les célèbres « Riz et Pruneaux » de Tartarin sur les Alpes nous fournissent un parfait exemple. Votre profonde erreur est de croire que la bêtise est inoffensive, qu’il est au moins des formes inoffensives de la bêtise. La bêtise n’a pas plus de force vive qu’une caronade de 36, mais, une fois en mouvement, elle défonce tout. Quoi ! nul de vous pourtant n’ignore de quoi est capable la haine patiente et vigilante des médiocres, et vous en semez la graine aux quatre vents ! Car si les mécaniques vous permettent d’échanger vos imbéciles non seulement de ville en ville, de province en province, mais de nation à nation, ou même de continent à continent, les démocraties empruntent encore à ces malheureux la matière de leurs prétendues opinions publiques. Ainsi par les soins d’une Presse immense, travaillant jour et nuit sur quelques thèmes sommaires, la rivalité des « Pruneaux et des Riz » prend une sorte de caractère universel dont M. Alphonse Daudet ne s’était certainement pas avisé.
Mais qui lit aujourd’hui Tartarin sur les Alpes ? Mieux vaut rappeler que le gentil poète provençal qu’éleva tant de fois au-dessus de lui-même la consommation de la douleur, le génie de la sympathie, rassemble au fond d’un hôtel de montagne une douzaine d’imbéciles. Le glacier est là tout proche, suspendu dans l’immense azur. Personne n’y songe. Après quelques jours de fausse cordialité, de méfiance et d’ennui, les pauvres diables trouvent le moyen de satisfaire à la fois leur instinct grégaire et la sourde rancune qui les travaille. Leur parti des Constipés exige, au dessert, les pruneaux. Celui des Dévoyants tient naturellement pour le riz. Dès lors, les querelles particulières s’apaisent, l’accord se fait entre les membres de chacun des groupes rivaux. On peut très bien imaginer, dans la coulisse, l’amateur ingénieux et pervers, sans doute marchand de riz ou de pruneaux, suggérant à ces misérables une mystique appropriée à l’état de leurs intestins. Mais le personnage est inutile. La bêtise n’invente rien, elle fait admirablement servir à ses fins, à ses fins de bêtise, tout ce que le hasard lui apporte, et par un phénomène, hélas ! beaucoup plus mystérieux encore, vous la verrez se mettre d’elle-même à la mesure des hommes, des circonstances ou des doctrines, qui provoquent sa monstrueuse faculté d’abêtissement. Napoléon se vantait à Sainte-Hélène d’avoir tiré parti des imbéciles. Ce sont les imbéciles qui finalement ont tiré parti de Napoléon. Non pas seulement, comme vous pourriez le croire, parce qu’ils sont devenus bonapartistes. Car la religion du Grand Homme, accordée peu à peu au goût des démocraties, a fait ce patriotisme niais qui agit encore si puissamment sur leurs glandes, patriotisme que n’ont jamais connu les aïeux, et dont la cordiale insolence, à fonds de haine, de doute et d’envie, s’exprime, bien qu’avec une inégale fortune, dans les chansons de Déroulède et dans les poèmes de guerre de M. Paul Claudel.
Ça vous embête de m’écouter parler si longtemps des imbéciles ? Eh bien, il m’en coûte, à moi, d’en parler ! Mais il faut d’abord que je vous persuade d’une chose : c’est que vous n’aurez pas raison des imbéciles par le fer ou par le feu. Car je répète qu’ils n’ont inventé ni le fer, ni le feu, ni les gaz, mais ils utilisent parfaitement tout ce qui les dispense du seul effort dont ils sont réellement incapables, celui de penser par eux-mêmes. Ils aimeront mieux tuer que penser, voilà le malheur ! Et justement vous les fournissez de mécaniques ! La mécanique est faite pour eux. En attendant la machine à penser qu’ils attendent, qu’ils exigent, qui va venir, ils se contenteront très bien de la machine à tuer, elle leur va même comme un gant. Nous avons industrialisé la guerre pour la mettre à leur portée. Elle est à leur portée, en effet.
Sinon je vous mets au défi de m’expliquer comment, par quel miracle, il est devenu si facile de faire avec n’importe quel boutiquier, clerc d’agent de change, avocat ou curé, un soldat ? Ici comme en Allemagne, en Angleterre comme au Japon. C’est très simple : vous tendez votre tablier, et il tombe un héros dedans. Je ne blasphémerai pas les morts. Mais le monde a connu un temps où la vocation militaire était la plus honorée après celle du prêtre, et ne lui cédait qu’à peine en dignité, c’est tout de même étrange que votre civilisation capitaliste, qui ne passe pas pour encourager l’esprit de sacrifice, dispose, en pleine primauté de l’économique, d’autant d’hommes de guerre que ses usines peuvent fournir d’uniformes…
Des hommes de guerre comme on n’en a sûrement jamais vu. Vous les prenez, au bureau, à l’atelier, bien tranquilles. Vous leur donnez un billet pour l’Enfer avec le timbre du bureau de recrutement, et des godillots neufs, généralement perméables. Le dernier encouragement, le suprême salut de la patrie, leur vient sous les espèces du hargneux coup d’œil de l’adjudant rengagé affecté au magasin d’habillement et qui les traite de cons. Là-dessus ils se hâtent vers la gare un peu saouls, mais anxieux à l’idée de manquer le train pour l’Enfer, exactement comme s’ils allaient dîner en famille, un dimanche, à Bois-Colombes ou à Viroflay. Ils descendront cette fois à la station Enfer, voilà tout. Un an, deux ans, quatre ans, le temps qu’il faudra, jusqu’à l’expiration du billet circulaire délivré par le gouvernement, ils parcourront ce pays sous une pluie de fonte d’acier, attentifs à ne pas manger sans permission le chocolat des vivres de réserve, ou soucieux de faucher à un copain le paquet de pansement qui leur manque. Le jour de l’attaque, avec une balle dans le ventre, ils trottent comme des perdreaux jusqu’au poste de secours, se couchent tout suants sur le brancard et se réveillent à l’hôpital d’où ils sortent un peu plus tard aussi docilement qu’ils y sont entrés, avec une bourrade paternelle de M. le Major, un bon vieux… Puis ils retournent vers l’Enfer, dans un wagon sans vitres, ruminant de gare en gare le vin aigre et le camembert ou épelant à la lueur du quinquet la feuille de route couverte de signes mystérieux et pas du tout sûrs d’être en règle. Le jour de la Victoire… Eh bien, le jour de la victoire, ils espèrent rentrer chez eux !
À la vérité, ils n’y rentrent point pour la raison fameuse que « l’Armistice n’est pas la Paix », et qu’il faut leur laisser le temps de s’en rendre compte. Le délai d’un an a paru convenable. Huit jours eussent suffi. Huit jours eussent suffi pour prouver aux soldats de la grande guerre qu’une victoire est une chose à regarder de loin, comme la fille du colonel ou la tombe de l’Empereur, aux Invalides ; qu’un vainqueur, s’il veut vivre pénard, n’a qu’à rendre ses galons de vainqueur. Ils sont donc retournés à l’usine, au bureau, toujours bien tranquilles. Quelques-uns ont même eu la chance de trouver dans leur pantalon d’avant-guerre une douzaine de tickets de leur gargote, de la gargote de jadis, à vingt sous le repas. Mais le nouveau gargotier n’en a pas voulu.
***
Vous me direz que ces gens-là étaient des saints. Non, je vous assure, ce n’étaient pas des saints. C’étaient des résignés. Il y a dans tout homme une énorme capacité de résignation, l’homme est naturellement résigné. C’est d’ailleurs pourquoi il dure. Car vous pensez bien qu’autrement l’animal logicien n’aurait pu supporter d’être le jouet des choses. Voilà des millénaires que le dernier d’entre eux se serait brisé la tête contre les murs de sa caverne, en reniant son âme. Les saints ne se résignent pas, du moins au sens où l’entend le monde. S’ils souffrent en silence les injustices dont s’émeuvent les médiocres, c’est pour mieux retourner contre l’Injustice, contre son visage d’airain, toutes les forces de leur grande âme. Les colères, filles du désespoir, rampent et se tordent comme des vers. La prière est, en somme, la seule révolte qui se tienne debout.
L’homme est naturellement résigné. L’homme moderne plus que les autres en raison de l’extrême solitude où le laisse une société qui ne connaît plus guère entre les êtres que les rapports d’argent. Mais nous aurions tort de croire que cette résignation en fait un animal inoffensif. Elle concentre en lui des poisons qui le rendent disponible le moment venu pour toute espèce de violence. Le peuple des démocraties n’est qu’une foule, une foule perpétuellement tenue en haleine par l’Orateur invisible, les voix venues de tous les coins de la terre, les voix qui la prennent aux entrailles, d’autant plus puissantes sur ses nerfs qu’elles s’appliquent à parler le langage même de ses désirs, de ses haines, de ses terreurs. Il est vrai que les démocraties parlementaires, plus excitées, manquent de tempérament. Les dictatoriales, elles, ont le feu au ventre. Les démocraties impériales sont des démocraties en rut.
***
La colère des imbéciles remplit le monde. Dans leur colère, l’idée de rédemption les travaille, car elle fait le fond de toute espérance humaine. C’est le même instinct qui a jeté l’Europe sur l’Asie au temps des Croisades. Mais en ce temps-là l’Europe était chrétienne, les imbéciles appartenaient à la chrétienté. Or un chrétien peut être ceci ou cela, une brute, un idiot, ou un fou, il ne peut pas être tout à fait un imbécile. Je parle des chrétiens nés chrétiens, des chrétiens d’état, des chrétiens de chrétienté. Bref, des chrétiens nés en pleine terre chrétienne, et qui grandissent libres, consomment l’une après l’autre, sous le soleil ou l’averse, toutes les saisons de leur vie. Dieu me garde de les comparer à ces cornichons sans sève que les curés font pousser dans des petits pots, à l’abri des courants d’air !
Pour un chrétien de chrétienté, l’Évangile n’est pas seulement une anthologie dont on lit un morceau chaque dimanche dans son livre de messe, et à laquelle il est permis de préférer le Jardin des âmes pieuses du P. Prudent, ou les Petites Fleurs dévotes du chanoine Boudin. L’Évangile informe les lois, les mœurs, les peines et jusqu’aux plaisirs, car l’humble espoir de l’homme, ainsi que le fruit des entrailles, y est béni. Vous pouvez faire là-dessus les plaisanteries que vous voudrez. Je ne sais pas grand-chose d’utile, mais je sais ce que c’est que l’espérance du Royaume de Dieu, et ça n’est pas rien, parole d’honneur ! Vous ne me croyez pas ? Tant pis ! Peut-être cette espérance reviendra-t-elle visiter son peuple ? Peut-être la respirerons-nous tous, un jour, tous ensemble, un matin des jours, avec le miel de l’aube. Vous ne vous en souciez pas ? Qu’importe ! Ceux qui refuseront alors de l’accueillir dans leur cœur la reconnaîtront du moins à ce signe : les hommes qui détournent aujourd’hui les yeux sur votre passage, ou ricanent lorsque vous leur avez tourné le dos, viendront droit vers vous, avec un regard d’homme. À ce signe, je le répète, vous saurez que votre temps n’est plus.
***
Les imbéciles sont travaillés par l’idée de rédemption. Évidemment si vous interrogez le premier venu d’entre eux, il vous répondra qu’une telle imagination n’a jamais effleuré sa pensée, ou même qu’il ne sait pas très exactement ce que vous voulez dire. Car un imbécile ne dispose d’aucun instrument mental lui permettant de rentrer en lui-même, il n’explore que la surface de son être. Mais quoi ! parce qu’un nègre, avec sa misérable houe, ne fait qu’égratigner le sol, juste assez pour qu’y pousse un peu de mil, la terre n’en n’est pas moins riche et capable d’une autre moisson. D’ailleurs que savez-vous d’un médiocre aussi longtemps que vous ne l’avez pas observé parmi d’autres médiocres de sa race, dans la communion de la joie, de la haine, du plaisir ou de l’horreur ? Il est vrai que chaque médiocrité paraît solidement défendue contre toute médiocrité d’une autre espèce. Mais les immenses efforts des démocraties ont fini par briser l’obstacle. Vous avez réussi ce coup prodigieux, ce coup unique : vous avez détruit la sécurité des médiocres. Elle paraissait pourtant inséparable de la médiocrité, sa substance même. Pour être médiocre, néanmoins, on n’est pas forcément un abruti. Vous avez commencé par abrutir les imbéciles. Vaguement conscients de ce qui leur manque, et de l’irrésistible courant qui les entraîne vers d’insondables destins, ils s’enfermaient dans leurs habitudes, héréditaires ou acquises, ainsi que l’Américain fameux qui franchissait les cataractes du Niagara dans un tonneau. Vous avez brisé le tonneau, et les malheureux voient filer les deux rives avec la rapidité de l’éclair.
Sans doute, un notaire de Landerneau, il y a deux siècles, ne croyait pas sa ville natale plus durable que Carthage ou Memphis, mais au train où vont les choses, il s’y sentira demain à peu près aussi en sûreté que dans un lit dressé en plein vent sur une place publique. Certes, le mythe du Progrès a bien servi les démocraties. Et il a fallu un siècle ou deux pour que l’imbécile, dressé depuis tant de générations à l’immobilité, vît dans ce mythe autre chose qu’une hypothèse excitante, un jeu de l’esprit. L’imbécile est sédentaire, mais il a toujours lu volontiers les récits d’explorateurs. Imaginez un de ces voyageurs en chambre qui s’aperçoit tout à coup que le plancher bouge. Il se jette à la fenêtre, l’ouvre, cherche la maison d’en face, reçoit en pleine figure l’écume sifflante, et découvre qu’il est parti. Le mot « départ » ne convient guère ici, d’ailleurs. Car si le regard de l’homme moderne ne peut plus se poser sur rien de fixe – cause insigne du mal de mer – le pauvre diable n’a pas l’impression d’aller quelque part. Je veux dire que ses embêtements sont toujours les mêmes, bien que multipliés en apparence, grâce à un effet de perspective. Aucune autre manière vraiment nouvelle de faire l’amour, aucune nouvelle manière de crever.
Tout cela est simple, très simple. Demain ce sera plus simple encore. Si simple qu’on ne pourra plus rien écrire d’intelligible sur le malheur des hommes dont les causes immédiates décourageront l’analyse. Les premiers symptômes d’une maladie mortelle fournissent au professeur le sujet de brillantes leçons, mais toutes les maladies mortelles présentent le même phénomène ultime, l’arrêt du cœur. Il n’y a pas grand-chose à dire là-dessus. Votre société ne mourra pas autrement. Vous discuterez encore des « pourquoi » et des « comment » et déjà les artères ne battront plus. L’image me semble juste, car la réforme des institutions vient trop tard lorsque la déception des peuples est devenue irréparable, lorsque le cœur des peuples est brisé.
***
Je sais qu’un tel langage a de quoi faire sourire les entrepreneurs de réalisme politique. Qu’est-ce que c’est qu’un cœur de peuple ? Où le place-t-on ? Les doctrinaires du réalisme politique ont un faible pour Machiavel. Faute de mieux, les doctrinaires du réalisme politique ont mis Machiavel à la mode. C’est bien la dernière imprudence qu’auraient dû se permettre les disciples de Machiavel. Vous voyez d’ici ce tricheur qui avant de s’asseoir à la table de jeu fait hommage à ses partenaires d’un petit traité de sa façon sur l’art de tricher, avec une dédicace flatteuse pour chacun de ces messieurs ? Machiavel n’écrivait qu’à l’adresse d’un certain nombre d’initiés. Les doctrinaires du réalisme politique parlent au public. Après eux, de jeunes Français, pleins d’innocence et de gentillesse, répètent leurs axiomes d’un fracassant cynisme, dont se scandalisent et s’attendrissent leurs bonnes mères. La guerre d’Espagne, après celle d’Abyssinie, vient de fournir ainsi l’occasion d’innombrables professions de foi d’immoralisme national capables de faire se retourner dans leurs tombes Jules César, Louis XI, Bismarck et Cecil Rhodes. Mais Jules César, Louis XI, Bismarck et Cecil Rhodes n’auraient nullement souhaité chaque matin l’approbation compromettante du pion réaliste suivi de sa classe. Un véritable élève de Machiavel commencerait par faire pendre ces radoteurs.
Ne touchez pas aux imbéciles ! Voilà ce que l’Ange eût pu écrire en lettres d’or au fronton du Monde moderne, si ce monde avait un ange. Pour déchaîner la colère des imbéciles, il suffit de les mettre en contradiction avec eux-mêmes, et les démocraties impériales, à l’apogée de leur richesse et de leur puissance, ne pouvaient refuser de courir ce risque. Elles l’ont couru. Le mythe du Progrès était sans doute le seul en qui ces millions d’hommes pussent communier, le seul qui satisfît à la fois leur cupidité, leur moralisme sommaire et le vieil instinct de justice légué par les aïeux. Il est certain qu’un patron verrier qui, au temps de M. Guizot, et si l’on s’en rapporte à d’irrécusables statistiques, décimait systématiquement, pour les besoins de son commerce, des arrondissements entiers, devait avoir comme chacun de nous, ses crises de dépression. On a beau se serrer le cou dans une cravate de satin, porter à la boutonnière une rosette large comme une soucoupe et dîner aux Tuileries, n’importe ! il y a des jours où on se sent de l’âme. Oh ! bien entendu, les arrière-petits-fils de ces gens-là sont aujourd’hui des garçons très bien, du modèle en cours, nets, sportifs, plus ou moins apparentés. Beaucoup d’entre eux se proclament royalistes et parlent des écus de l’aïeul avec le mouvement de menton vainqueur d’un descendant de Godefroy de Bouillon affirmant ses droits sur le royaume de Jérusalem. Sacrés petits farceurs ! Leur excuse est celle-ci : le sens social leur manque. De qui l’auraient-ils hérité ? Les crimes de l’or ont d’ailleurs un caractère abstrait. Ou peut-être y a-t-il une vertu de l’or ? Les victimes de l’or encombrent l’histoire, mais leurs restes ne dégagent aucune odeur.
Il est permis de rapprocher ce fait d’une propriété bien connue des sels du métal magique, qui préviennent les effets de la pourriture. Qu’un vacher dont les méninges sont en bouillie tue deux bergerettes après les avoir violées, la chronique retient son nom, fait de ce nom une épithète infâme, un nom maudit. Au lieu que ces « Messieurs du Commerce de Nantes », les Grands Trafiquants d’esclaves, comme les appelle avec respect M. le sénateur de la Guadeloupe, ont pu remplir des charniers, toute cette viande noire n’exhale à travers les siècles qu’un léger parfum de verveine et de tabac d’Espagne. « Les capitaines négriers semblent avoir été des gens de noble prestance – poursuit l’honorable sénateur. Ils portent perruque comme à la cour, l’épée au côté, les souliers à boucle d’argent, des broderies sur le costume, des chemises à jabot, des poignets de dentelles. » « Un tel négoce – conclut le journaliste – ne déshonorait nullement ceux qui le pratiquaient, ou ceux qui le subventionnaient. Qui donc parmi les financiers ou les bourgeois aisés n’était négrier, peu ou prou ? Les armateurs qui finançaient ces lointaines et coûteuses expéditions divisaient le capital engagé en un certain nombre de parts, et ces parts, dont l’intérêt le plus souvent était énorme, constituaient pour tous les pères de famille un placement extrêmement recherché. »
Soucieux de mériter la confiance de ces pères de famille, les capitaines négriers s’acquittaient scrupuleusement de leurs devoirs, comme le prouve assez le récit suivant emprunté, parmi beaucoup d’autres témoignages de même qualité, à un intéressant ouvrage dont Candide rendait compte, le 25 juillet 1935 :
Hier, à huit heures, nous amarrâmes les nègres les plus fautifs aux quatre membres, et couchés sur le ventre dessus le pont, et nous les fîmes fouetter. En outre, nous leur fîmes des scarifications sur les fesses pour mieux leur faire ressentir leurs fautes. Après leur avoir mis leurs fesses en sang par les coups de fouet et les scarifications, nous leur mîmes de la poudre à tirer, du jus de citron, de la saumure, du piment tout pilé et brassé ensemble avec une autre drogue que le chirurgien mit et nous leur en frottâmes les fesses pour empêcher que la gangrène n’y soit mise et de plus pour que cela leur eût cuit sur leurs fesses, gouvernant toujours au plus près du vent, l’amure à bâbord.
Nous trouvons ici en passant un bon exemple de la prudente discrétion de la société d’autrefois, lorsqu’elle se trouvait dans la nécessité de proposer des cas de conscience aux imbéciles. La presse italienne se donne aujourd’hui beaucoup de mal pour justifier aux yeux de ces derniers la destruction massive, par l’ypérite, du matériel abyssin. Toute cette mystique de la force décourage les imbéciles parce qu’elle leur impose une concentration d’esprit fatigante. Bref, elle prétend les forcer à se placer au point de vue de M. Mussolini. L’attitude de ce dernier en face du public de notre pays est d’ailleurs curieuse à observer. M. Mussolini est un solide ouvrier, et il aime la gloire. Sur la foi des manuels il pense aussi que le peuple français a plus qu’un autre peuple le sens de la justice, le respect de la faiblesse et du malheur. Devant ces villages où les défenseurs ont réussi à détruire toute vie, même celle des rongeurs ou des insectes, il se retourne vers les descendants de ces Messieurs du Commerce de Nantes, venus avec leurs dames, leurs demoiselles et les garçons qui préparent Centrale. Il est d’abord un peu rouge, je suppose, puis il s’anime, il parle de la grandeur qui depuis que le monde est monde pèse de tout son poids sur les épaules des misérables, de la Puissance et de l’Empire. Les braves bourgeois se regardent entre eux, très gênés. Pourquoi M. Mussolini nous a-t-il amenés là ? Ces paysages sont encore plus tristes que le cimetière Montmartre, et mon épouse est impressionnable à cause de sa tension. Ce n’est vraiment pas le moment d’aligner des phrases à propos d’une simple affaire de nègres. Nos ancêtres ont fait eux aussi, comme ce monsieur, fortune dans les nègres, et ils ne se croyaient pas obligés, pour autant, d’élaborer une philosophie. L’affaire rapporte-t-elle vraiment, oui ou non ?
***
L’idée de grandeur n’a jamais rassuré la conscience des imbéciles. La grandeur est un perpétuel dépassement, et les médiocres ne disposent probablement d’aucune image qui leur permette de se représenter son irrésistible élan (c’est pourquoi ils ne la conçoivent que morte et comme pétrifiée, dans l’immobilité de l’Histoire). Mais l’idée du Progrès leur apporte l’espèce de pain dont ils ont besoin. La grandeur impose de grandes servitudes. Au lieu que le progrès va de lui-même où l’entraîne la masse des expériences accumulées. Il suffit donc de ne lui opposer d’autre résistance que celle de son propre poids. C’est le genre de collaboration du chien crevé avec le fleuve qu’il descend au fil de l’eau. Lorsque après un dernier inventaire l’ancien maître verrier calculait le chiffre exact des bénéfices, il devait bien avoir tout de même une pensée pour le moderne collaborateur qui achevait de cracher ses poumons dans la cendre du foyer, entre le chat galeux qui somnole et le berceau où hurle un avorton à tête de vieillard. L’auteur de Standards rappelle le mot célèbre du patron américain au journaliste qui vient de visiter l’usine et trinque avec son hôte avant de reprendre le train. Tout à coup le journaliste se frappe le front : « À quoi diable employez-vous les vieux ouvriers ? demande-t-il.
Aucun de ceux que j’ai vus ne paraît avoir dépassé la cinquantaine… » L’autre hésite un moment, vide son verre : « Prenez un cigare, dit-il, et, tout en fumant, nous irons faire un tour au cimetière. »
Le maître verrier, lui aussi, devait parfois faire un tour au cimetière. Et à défaut d’y prier car les bourgeois de ce temps-là étaient tous libres penseurs – il est très possible qu’il s’y tînt convenablement, ou même qu’il s’y recueillît. Pourquoi pas ? J’écris cela sans rire. Les gens qui ne me connaissent guère me tiennent assez souvent pour un énergumène, un pamphlétaire. Je répète une fois de plus qu’un polémiste est amusant jusqu’à la vingtième année, tolérable jusqu’à la trentième, assommant vers la cinquantaine, et obscène au-delà. Les démangeaisons polémistes chez le vieillard me paraissent une des formes de l’érotisme. L’énergumène s’excite à froid, comme dit le peuple. Loin de m’exciter, je passe mon temps à essayer de comprendre, unique remède contre l’espèce de délire hystérique où finissent par tomber les malheureux qui ne peuvent faire un pas sans se prendre le pied dans une injustice soigneusement cachée sous l’herbe, ainsi qu’une chausse-trappe. J’essaie de comprendre. Je crois que je m’efforce d’aimer. Il est vrai que je ne suis pas ce qu’on appelle un optimiste. L’optimisme m’est toujours apparu comme l’alibi sournois des égoïstes, soucieux de dissimuler leur chronique satisfaction d’eux-mêmes. Ils sont optimistes pour se dispenser d’avoir pitié des hommes, de leur malheur.
On imagine très bien la page qu’eût inspirée à Proudhon, par exemple, la phrase de l’Américain. Je ne crois pas cette phrase si impitoyable qu’elle en a l’air. Il y aurait d’ailleurs tant à dire de la pitié ! Les esprits délicats jugent volontiers de la profondeur de ce sentiment aux convulsions qu’il provoque chez certains apitoyés. Or ces convulsions expriment une révolte contre la douleur assez dangereuse pour le patient, car elle confondrait aisément dans la même horreur la souffrance et le soutirant. Nous avons tous connu de ces femmes nerveuses qui ne peuvent voir une bestiole blessée sans l’écraser aussitôt avec des grimaces de dégoût peu flatteuses pour l’animal qui probablement n’eût pas demandé mieux que d’aller guérir tranquille au fond de son trou. Certaines contradictions de l’histoire moderne se sont éclairées à mes yeux dès que j’ai bien voulu tenir compte d’un fait qui d’ailleurs crève les yeux : l’homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible. Comme après le Déluge la terre appartiendra peut-être demain aux monstres mous.
***
Il est donc permis de croire que certaines natures se défendent d’instinct contre la pitié par une juste méfiance d’elles-mêmes, de la brutalité de leurs réactions. Les imbéciles ont accepté docilement, depuis des siècles, l’enseignement traditionnel de l’Église sur des questions qui, à la vérité, leur apparaissaient comme insolubles. Que la Souffrance ait, ou non, une valeur expiatoire, qu’elle puisse même être aimée, qu’importe là-dessus l’opinion d’un petit nombre d’originaux, puisque le bon sens, comme l’Église, tolère que les gens raisonnables la fuient par tous les moyens ? Certes aucun imbécile n’eût songé jadis à nier le caractère universel de la Douleur, mais la douleur universelle était discrète. Aujourd’hui elle dispose, pour se faire entendre, des mêmes puissants moyens que la joie, ou la haine. Les mêmes types qui réduisaient peu à peu systématiquement, les relations de famille au point de s’en tenir à l’échange indispensable des faire-part de naissance, de mariage ou de décès, dans le but de ménager leurs minces réserves de sensibilité affective, ne peuvent plus ouvrir un journal ni tourner le bouton de leur radio sans apprendre des catastrophes. Il est clair que pour échapper à une telle obsession, il ne suffit plus à ces malheureux d’entendre une fois par semaine, à la grand-messe, d’une oreille distraite, l’homélie sur la souffrance d’un brave chanoine bien nourri, avec lequel ils découperont un peu plus tard le gigot dominical. Les imbéciles se sont donc résolument attaqués au problème de la douleur comme à celui de la pauvreté. C’est à la science qu’il appartient de vaincre la douleur, pense l’imbécile dans sa logique inflexible, et l’économiste se chargera de la misère, mais en attendant soulevons contre ces deux fléaux l’opinion publique à laquelle chacun sait que rien ne résiste sur la terre ou dans les cieux. Honorer le pauvre ? Ce n’est pas d’honneur que le pauvre a besoin, mais que vous le débarrassiez de la pauvreté. Le pauvre se sent si pauvre qu’il n’oserait même pas coudre à son revers graisseux la plus humble décoration, et vous lui parlez d’honneur ! Honorer le pauvre ? Et pourquoi pas les poux de la pauvreté ? Ces rêveries d’Orient étaient sans malice au temps de Jésus-Christ qui d’ailleurs n’a jamais été un homme d’action. Si Jésus-Christ vivait de nos jours, il devrait se faire une situation, comme tout le monde, et n’eût-il qu’à diriger une modeste usine, force lui serait bien de comprendre que la Société moderne, en exaltant la dignité de l’argent comme en notant d’infamie la pauvreté, remplit son rôle à l’égard du misérable.