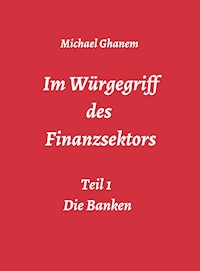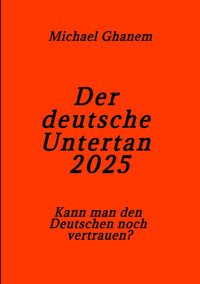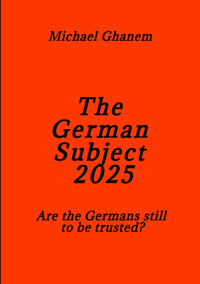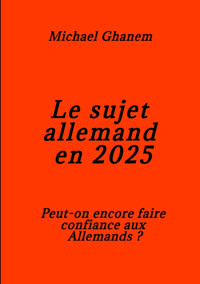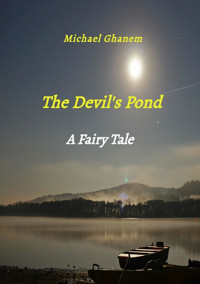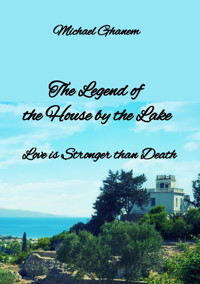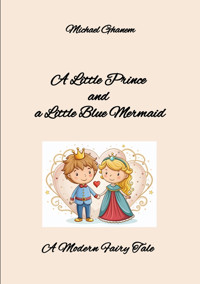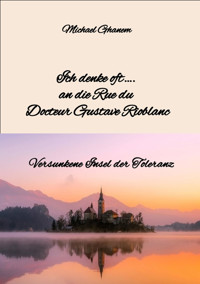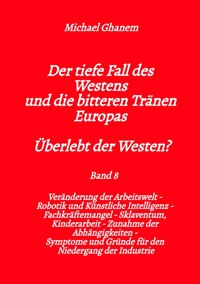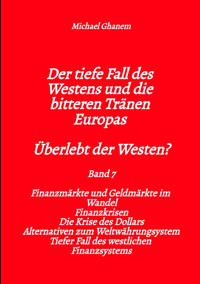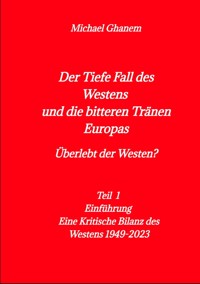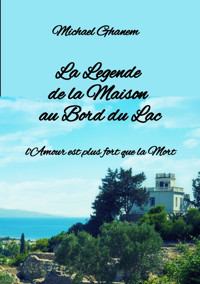
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Destins poignants d'amants dans une maison magique sur fond de guerres du XXe siècle C'est l'histoire d'une maison mythique du nord de la Tunisie. Construite au début du 20e siècle et abandonnée par ses derniers habitants dans les années 60, elle est toujours fermée, envahie par les roses et presque oubliée dans son grand jardin qui surplombe le lac et le volcan Ichkeul. Rares sont les personnes qui connaissent encore le secret de la maison et le triste destin de ses habitants. L'histoire tragique de son constructeur, qui a offert cette magnifique maison à son grand amour Lilith. Ils n'ont pu être heureux ensemble dans la maison que pendant une courte période, car il a été abattu en tant que pilote pendant la Première Guerre mondiale. Lilith l'a enterré dans la petite chapelle du jardin, mais elle ne lui a survécu que peu de temps. Elle aussi fut enterrée dans la petite chapelle. Le destin s'est répété pour les habitants suivants. Eux aussi n'ont pu vivre que quelques années très heureuses dans la maison au bord du lac, jusqu'à ce que la deuxième guerre mondiale frappe ce monde paisible. Les années de guerre ont été marquées par de fortes destructions, de nombreux morts et blessés et des atrocités commises par les Allemands sur la population. La maison était isolée, elle n'a pas été touchée et a servi de refuge à de nombreux parents, amis et persécutés juifs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Contenu
Dedicace
Titre
Droits d'auteur
À propos de l'auteur
1. Avant-propos
2. Bizerte et Ferryville
3. Le lac de Bizerte et le volcan Ichkeul
4. Enfance et adolescence de Léon et Patrice à Ferryville
5. Photos de Bizerte et Ferryville 1915-1940
6. Patrice à Paris et Léon à Toulon, tous deux dans l'armée française
7. Le petit cosmos de Ferryville et Bizerte
8. La légende d'une maison au bord du lac
9. La maison est à vendre depuis des décennies
10. La légende de la Dame en blanc
11. La visite de la maison
12. Les recherches de Patrice
13. Liliane et Julien
14. La rencontre entre Patrice et Liliane
15. Le coup de foudre
16. Le serment d'amour
17. La décision de Patrice d'épouser Liliane et sa demande en mariage
18. Patrice chez les parents de Liliane
19. Liliane chez la famille de Patrice et l'invitation de ses parents
20. Le mariage de Raoul
21. Mariage de Lucille
22. Le mariage de Denise
23. Les fiançailles de Patrice et Liliane
24. Les fiançailles de Léon
25. Les travaux de rénovation de la maison au bord du lac
26. Le coffre et les lettres de Cedric et Lilith
27. Emménagement de Liliane dans la maison de Patrice
28. Mariage de Liliane et Patrice et de Léon et Geneviève
29. Les nuits sous l'érable et la découverte de la grotte
30. Les vases en granit dans le jardin devant la maison
31. Les signes avant-coureurs de la guerre et le 3 septembre 1939
32. La mobilisation et « La Drôle de Guerre »
33. La convocation de Patrice et Léon
34. Campagne de l'Ouest, Blitzkrieg et le 20 juin 1940
35. L'appel de De Gaulle du 18 juin 1940
36. Division entre Pétain et de Gaulle et division au sein des familles et des soldats
37. L'opération Catapult
38. La campagne de Tunisie et l'opération Stoch
39. La séparation : Patrice et Léon pendant la guerre de 1939 à 1943 et leur testament
40. Tensions entre chrétiens et musulmans et sort des Juifs en Tunisie, en particulier à Bizerte et Ferryville pendant la période Nazie
41. Les lettres de Patrice et les lettres de Liliane
42. La grossesse de Liliane et son attente vaine
43. Le refuge de Geneviève, les parents de Patrice, Léon, les parents de Liliane, Denise, Joël Hassan, deux rabbins, le Dr Jamati et quelques Juifs dans la maison au bord du lac
44. Les nuits agitées
45. L'apparition de la femme blanche
46. Prise de Ferryville par les Américains
47. Bombes sur Bizerte, destruction de l'église par les Américains, combats de rue à Bizerte et épidémie de typhus
48. L'abattage de Patrice au-dessus de Rafraf
49. Conquête de Bizerte par les Américains, de Tunis par les Anglais et capitulation des Allemands et des Italiens
50. Annonce de la mort de Patrice
51. Transfert du corps de Patrice, veillée funèbre par son père et son beau-père, le Dr Jamati, Joel Hassan, Leon et ses camarades
52. La floraison et la lumière blanche et l'apparition de la femme blanche
53. Les funérailles avec les honneurs militaires dans la chapelle
54. Liliane perd son enfant
55. Enterrement de l'enfant dans la chapelle
56. La mystérieuse maladie de Liliane et les lettres de Patrice continuent d'arriver.
57. Liliane vend la maison à Léon.
58. La fin de Liliane et ses funérailles aux côtés de Patrice
59. L'amour est plus fort que la mort !
60. Emménagement de Léon avec Geneviève et leurs enfants dans la maison au bord du lac
61. Les années heureuses de 1943 à 1961 et l'indépendance de la Tunisie
62. La crise de Bizerte du 19 juillet 1961 au 23 juillet 1961 – Léon est tué par la foule le mercredi 19 juillet 1961.
63. Funérailles de Léon dans la chapelle au-dessus de la tombe de Patrice
64. Déménagement de Geneviève à Toulon le 17 avril 1963
65. La mort de Geneviève et l'interdiction d'être enterrée aux côtés de Léon
66. Épilogue – La maison au bord du lac reste fermée
67. Annexe
68. Bibliographie
Dedicace
Ce livre est dédié à ceux qui ont lutté toute leur vie contre le nationalisme, le racisme et le colonialisme, souvent à l'insu de l'opinion publique.
Ce livre a également pour but d'informer sur le rôle du colonialisme et sur les conséquences de la guerre menée par l'Empire allemand contre la France et contre des pays non impliqués tels que la Tunisie.
Ce livre est également dédié à ma femme, Marlene, pour ses conseils critiques et avisés. Elle m'accompagne tout au long de ma vie et est toujours une source d'inspiration.
Bonn, novembre 2025
Titre
Michael Ghanem
« Les pensées sont libres »
La Legende
de la Maison
au Bord du Lac
ou
l'Amour est plus fort que la Mort
Droits d'auteur
© 2025 Michael Ghanem
Site web : https://michael-ghanem.de/
Impression et distribution pour le compte de l'auteur :
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Allemagne
ISBN
Softcover978-3-384-73386-3
Hardcover978-3-384-73387-0
E-Book978-3-384-73388-7
L'œuvre, y compris ses parties, est protégée par le droit d'auteur. L'auteur est responsable du contenu. Toute utilisation est interdite sans son consentement. La publication et la diffusion sont effectuées pour le compte de l'auteur, joignable à l'adresse suivante : tredition GmbH, département « Impressumservice », Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Allemagne.
Les illustrations utilisées sont sous licence Adobe Stock, #291467940
Adresse de contact conformément au règlement européen sur la sécurité des produits:
À propos de l'auteur
Bonn, octobre 2025
Né en 1949, il a grandi en France et est diplômé d'une grande école française d'ingénieurs en économie. Après s'être installé en Allemagne, il a suivi des études d'économie, de sociologie, de sciences politiques, de philosophie et d'éthique.
Dans le domaine de la philosophie, il a été fortement influencé par la philosophie et les enseignements de Zarathoustra, Socrate, Platon, Aristote, Marc Aurèle, Rabelais, Michel de Montaigne, Baruch de Spinoza, Thomas d'Aquin, Ibn Khaldoun, Niccolo Machiavelli, René Descartes, Blaise Pascal, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, Gottfried W. Leibniz, Auguste Comte, Arthur Schopenhauer, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Henri Bergson, Karl Popper, Karl Jaspers et Erich Fromm. L'école de Francfort, avec ses professeurs Jürgen Habermas et Adorno, l'a fortement influencé, tout comme Michael Schmidt-Salomon, Claude Lévi-Strauss, le Dalaï Lama, Luc Ferry, Peter Sloterdijk, Werner Lachmann, Amartya Sen, Oswald Nell-Brauning et Niklas Luhmann.
En sociologie, il s'inspire fortement de l'école de Cologne avec ses professeurs René König et Erwin K. Scheuch ainsi que Gustave Lebon. En sciences politiques, il s'inspire également de l'école de Cologne ou de l'école de Cologne-Mannheim.
Dans le domaine de l'économie politique, il a été fortement influencé par les post-keynésiens et les économistes comportementaux. Il est très critique à l'égard des enseignements de Milton Friedmann, des Chicago Boys, de l'école de Fribourg et de Friedrich A. Hayek. Il se sent très proche de Joseph Stiglitz, Paul Krugman, James K. Galbraith, Daniel Kahneman, Thomas Piketty et du Club de Rome.
Sa carrière professionnelle l'a d'abord conduit dans une organisation internationale, pour laquelle il a travaillé pendant 5 ans comme contrôleur de projets pour de grands projets hydrauliques, principalement en Afrique, ce qui lui a permis de découvrir de nombreux pays et leurs dirigeants. Il a ensuite travaillé pendant de nombreuses années dans une organisation européenne ainsi que dans plusieurs cabinets de conseil internationaux en tant que consultant pour la modernisation de diverses industries et entreprises.
Il se considère comme un critique de la mondialisation actuelle et s'engage depuis 1974 très fortement en faveur des thèmes de la gestion de l'eau.
Ces expériences lui ont permis d'acquérir une compréhension approfondie des questions géopolitiques et lui permettent d'évaluer les développements politiques actuels, en particulier dans le contexte des interdépendances économiques.
Depuis sa retraite, il vit retiré à Bonn et travaille comme écrivain. Dans ses publications, il se consacre principalement aux questions sociales, économiques et politiques urgentes de notre époque ainsi qu'à la gestion de l'eau.
À ce jour, de nombreuses publications sur les thèmes de la politique et de la géopolitique, de la société et de l'économie ont été publiées. Il est l'auteur de plus de 100 livres. Dans le domaine de la politique, il porte principalement un regard critique sur l'Allemagne. Il aborde également des thèmes tels que la santé, l'identité, le racisme, l'environnement, les migrations, la gestion de l'eau, l'Afrique, l'évolution démographique et les systèmes économiques alternatifs tels que l'économie anti-fragilité. Il a également publié plusieurs récits et contes.
Voici un extrait de ses publications parues à ce jour :
Ouvrages spécialisés Politique, économie, société
Géopolitique
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 1 - Introduction - Un bilan critique de l'Occident 1949-2023 »
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 2 : chute profonde de l'armée, éléments constitutifs de la géopolitique, ordre mondial en mutation, potentiels de conflit »
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 3 : les fondements du potentiel militaire - La fin de l'hégémonie »
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 4 : profils des pays - Défaillances multiples du système - Accidents de l'histoire - Eau et famine mondiale - Catastrophe climatique et énergétique - BRICS contre G7 »
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 5 : Problèmes : explosion démographique, migration, intégration, pauvreté et famine, matières premières »
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 6 : Les péchés de l'Occident, commerce mondial, économie de bazar, corruption, sujets tabous
Inflation, déflation, dette publique »
« La chute profonde de l'Occident et les larmes amères de l'Europe, partie 7 : marchés financiers et monétaires en mutation, crises financières, la crise du dollar
Alternatives au système monétaire mondial, chute profonde du système financier occidental »
« L'Afrique entre malédiction et bénédiction, partie 1 : l'eau »
« L'eau, puissance mondiale – partie 1 : aperçu et bilan 2021 »
Sur la situation de l'Allemagne
« La chute profonde de l'Allemagne, volume 1A Santé »
« La chute profonde de l'Allemagne, volume 1B Santé »
« 2005-2021 : les 16 années perdues de l'Allemagne – Le bilan d'Angela Merkel »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 1 : Angela Merkel – Un bilan intermédiaire »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 2 : le système politique – Quo vadis ? »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 3 : la société – bilan et perspectives »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 4 : l'économie allemande – Quo vadis ? »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 5 : sécurité intérieure – quo vadis ? »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 6 : justice – quo vadis ? »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 7 : santé – quo vadis ? Volume A »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 7 : santé – Quo vadis ? Volume B »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 7 : santé – Quo vadis ? Volume C »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 8 : pauvreté, vieillesse, soins – Quo vadis ? »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 9 : construire et louer en Allemagne – Non merci »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 10 : l'éducation en Allemagne »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 11 : le déclin des médias »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 12 : littérature – Quo vadis – partie A »
« 2005-2018 : les 13 années perdues de l'Allemagne, partie 13 : politique de développement – Quo vadis – partie A »
Politique allemande
« Identité allemande – Quo vadis ?
« Identité allemande et patrie – Quo vadis ?
« I know we can ! Une chance pour l'Allemagne »
« Les Allemands – un peuple maudit ?
« Les Verts ou le club des féministes – 10 raisons de NE PAS voter pour les Verts »
« AKK – Non merci ! »
« Une chance pour la démocratie »
« Les abstentionnistes sont aussi des électeurs »
« Le Titanic allemand – La République de Berlin »
« Dans l'étau des partis politiques, partie 1 »
« Seigneur, ne leur pardonnez pas ! Car ils savent ce qu'ils font ! »
« Les symptômes de déclin de l'Allemagne – devons-nous l'accepter ? »
« L'Allemagne est-elle construite sur du sable ? »
« Quatre millions d'Allemands privés de leurs droits »
Économie et finances
« Approches d'une économie antifragile »
« Dans l'étau du secteur financier, partie 1 »
« Dans l'étau de la dette publique, partie 1 »
« Dans l'étau de la dette publique, partie 2 »
Population, migration, intégration
« Dans l'étau de la migration et de l'intégration »
« Dans l'étau de la bombe démographique, de la pauvreté, de l'alimentation, partie 1 »
Racisme
« Dans l'étau du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de l'extrémisme de droite, du fascisme, partie 1 »
« Thèses sur l'égalité des races »
« Bilan, déclin et peur de l'homme blanc, partie 1 : principes fondamentaux »
L'homme et la société
« Le pouvoir des mots »
« Les nouveaux cavaliers de l'apocalypse »
« Crises à l'époque du coronavirus, partie 1 »
« Coronavirus 2021 – En attendant Godot »
» Die Zeit - une puissance mondiale méconnue » Tome 1 de la série « L'homme et la société »
« Courage – Lève-toi »
Récits
« Aventure Allemagne Confessions sur ce pays – Un bilan – »
« Un petit prince et une petite sirène bleue »
« Je pense souvent... à la rue du Docteur Gustave Rioblanc – Île engloutie de la tolérance »
« Récits d'un homme de l'ombre »
« 21 jours dans une clinique pleine de fous »
« Proverbes et sagesse »
« Léonidas le Grand – Je suis un être humain »
« 50 ans de vie en Allemagne – Une erreur ? Un destin »
« Une rue sans âme »
« L'étang du diable – un conte de fées »
« La légende de la maison au bord du lac »
« Si j'étais Dieu »
« Aimer, c'est... »
« Merci, Monsieur le Professeur »
« La légende de la source »
« La légende d'Annette – Le rêve d'un amour impossible »
« Paix et liberté : je voulais planter un olivier – Je voulais planter un oranger »
« Le monde est si beau »
« Le vieux bateau – un hommage à la vieille ferraille »
« Si seulement tu savais lire, toi qui es pour moi une petite grande dame si courageuse »
« Je ne pourrai jamais cesser de t'aimer. Tendre souvenir de 50 années passées ensemble »
« La mèche de cheveux oubliée »
« Le lilas »
1. Avant-propos
Au début des années 70, alors qu'il voyageait dans différents pays d'Afrique pour des raisons professionnelles, l'auteur entendit parler dans un café d'une maison légendaire située dans le nord de la Tunisie, près de Bizerte et de Ferryville.
Les récits autour de cette maison et le destin de ses habitants des années 20 aux années 60 du siècle dernier ont éveillé sa curiosité et il a profité de son prochain voyage en Tunisie pour en savoir plus.
Arrivé dans la ville, il a essayé d'en savoir plus dans un café du port de la vieille ville.
Il a rencontré un Maltais âgé, un Italien âgé et deux Français âgés, un prêtre orthodoxe et deux très vieux hommes d'affaires juifs, qui étaient tous extrêmement réservés au début de la conversation et ne voulaient divulguer aucune information.
Cependant, lorsqu'ils ont appris qu'il vivait en Allemagne et qu'il avait promis de publier cette légende un jour, ils ont commencé à lui raconter l'histoire. Il lui a fallu près de dix après-midi pour connaître toute l'histoire. Les personnes âgées ont même insisté pour que l'auteur voie la maison de l'extérieur. Mais il était interdit d'y entrer. Au moment de se quitter, certains hommes avaient les larmes aux yeux.
L'auteur avait longtemps oublié cet épisode, mais il lui est soudainement revenu à l'esprit dans ses vieux jours.
L'auteur assure que cette légende a un fondement historique et que la maison existe bel et bien. Seuls les noms des personnes décrites et leur histoire sont issus de l'imagination de l'auteur.
2. Bizerte et Ferryville
Bizerte et Ferryville sont deux villes voisines situées au nord de la Tunisie, sur la côte méditerranéenne.
À l'époque où se déroule cette histoire, la Tunisie était une colonie française.
Histoire de la période coloniale
La Tunisie pendant la période du protectorat
L'histoire de la période coloniale est certainement encore un sujet difficile en Tunisie et pour les descendants des anciens colons. Aujourd'hui encore, il existe de nombreux vestiges de cette époque. D'une part, il s'agit de nombreux bâtiments datant de cette époque, d'autre part, il s'agit de l'ensemble des infrastructures du pays - notamment la construction des routes, des chemins de fer, l'urbanisme, le système de santé - qui ont été planifiées, construites et mises en place par les Français pendant leurs 76 ans de domination.
En 1878, la décision est prise : la Grande-Bretagne et l'Allemagne cèdent leurs revendications sur le territoire tunisien à la France et sont dédommagées par d'autres moyens. Les violations de la frontière algérienne par des tribus nomades rebelles et le pillage d'un navire français fournissent aux Français un prétexte pour intervenir. Le 12 avril 1881, 32 000 soldats français envahissent la Tunisie depuis l'Algérie. Militairement sans espoir face à la supériorité française, le bey doit signer le traité de protectorat (traité du Bardo) le 12 mai 1881, malgré la forte résistance des tribus du centre de la Tunisie et de la population du sud.
La France y est reconnue comme « puissance protectrice » de Bizerte. Le bey reste officiellement chef de l'État tunisien jusqu'en 1957, mais ses pouvoirs sont fortement limités. Tous les postes importants de l'État sont placés sous contrôle français et occupés par des fonctionnaires français. Le nord conserve ses chefs de clan et de tribu traditionnels, mais le sud rebelle est placé sous administration militaire. L'une des premières mesures prises par la puissance coloniale à partir de 1885 est l'expropriation de toutes les propriétés foncières non enregistrées (par exemple, les terres des nomades).
Ces terres sont déclarées propriété de l'État et attribuées aux nombreux colons français et italiens. En 1911, la Tunisie compte déjà 46 000 Français, 86 000 Italiens et 12 000 Maltais. Les Français améliorent les infrastructures en développant les routes, les ports et les chemins de fer. De grands quartiers neufs (Ville Nouvelle) sont construits à la périphérie des villes sur le modèle français, les mines sont exploitées par des groupes français, des monastères, des écoles et des universités sont construits et de nouveaux centres administratifs et commerciaux régionaux voient le jour dans les campagnes.
Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale (1914-1918) interrompt la colonisation. Sur le front occidental, 80 000 Tunisiens combattent aux côtés des Français, près de 11 000 tombent au combat ! Après la guerre, la colonisation reprend de plus belle et ce sont à nouveau principalement les immigrants français qui en profitent. En termes de chiffres de production et de kilomètres de routes, la Tunisie connaît alors un essor considérable, mais d'énormes problèmes sociaux apparaissent parallèlement. Les petits agriculteurs et les nomades de longue date sont repoussés vers des zones périphériques peu productives, telles que les steppes arides et les régions montagneuses.
Tout cela conduit finalement à l'appauvrissement de la population rurale tunisienne. D'autres agriculteurs se retrouvent dans une situation de dépendance totale vis-à-vis des quelques grands propriétaires terriens en raison de baux et de contrats d'utilisation excessifs. Dans le même temps, les importations massives à bas prix entraînent le déclin de l'artisanat et du commerce traditionnels. Tous ces développements entraînent un exode rural et, par conséquent, une croissance des bidonvilles dans les villes. La période du protectorat plonge la majorité des Tunisiens dans la misère. Si un petit nombre de citoyens tunisiens riches ou influents jouissent de certains privilèges, la grande majorité de la population rurale pauvre s'appauvrit et se trouve de plus en plus privée de ses droits.
À propos de Bizerte
Que ce soit sous le nom d'Hippe Accra, Hippo Diarrhytus, Hippo Zartus ou Banzart, selon la culture et la langue, la ville a été fondée par les Phéniciens de Sidon vers 1100 avant Jésus-Christ. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes villes d'Afrique du Nord. À l'origine, c'était un petit port phénicien pour le commerce maritime dans la partie occidentale de la Méditerranée, situé à environ 50 km au nord-ouest de Carthage. Vers 950 avant J.-C., Bizerte est passée sous l'influence de Carthage pendant le règne du roi Dido-Eliza. Pendant les guerres gréco-punique et après la défaite d'Agathocle, elle est revenue à la ville de Carthage sous Hamilcar Barca, le père d'Hannibal et de sa sœur Salambo.
Elle retrouva sa prospérité pendant l'ascension de Jules César jusqu'à l'époque d'Auguste. Elle entretenait des relations avec la ville phénicienne d'Utique et avec Rome, et le christianisme se répandit dans la ville sous l'Empire romain. En 439 après J.-C., Genséric, roi de la tribu germanique orientale des Vandales, et ses partisans envahirent la ville et utilisèrent le port comme base pour envahir d'autres parties de l'Empire romain d'Occident, telles que la ville de Rome, les îles de Sardaigne, Malte, Corse et Sicile. De 634 à 642 après J.-C., après avoir été conquise par les Vandales, la ville passa sous le contrôle de l'Empire byzantin (les Turcs blancs), qui y construisit la kasbah. Armin d'Arabie s'empara de Bizerte et la ville revint dans la sphère d'influence de Constantinople jusqu'à la défaite des Byzantins. Les troupes de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, ont conquis la ville en 1535, mais les Turcs l'ont reprise en 1574. La ville est ensuite devenue un port corsaire et a combattu les Français et les Vénitiens.
Il convient de noter le bombardement de la ville par le roi de France en 1681 et les 4 et 5 juillet 1770 par le comte de Broves. En 1784 et 1785, la ville fut à nouveau bombardée par les Vénitiens, ce qui détruisit le port. Avec l'abolition de la piraterie en 1818, la ville subit un revers considérable dans son développement et se tourna vers les richesses de la mer. Bizerte devint ainsi l'un des plus grands fournisseurs de poisson vers Tunis, l'Italie, la Sicile et la France. Par décret du Bey en 1786, la France obtint les droits exclusifs de pêche et d'exploitation du corail, en échange de l'obligation de traiter de manière égale les Génois, les Catalans, les Vénitiens, les Siciliens, les pirates, les Corses et les Marseillais.
Le protectorat français
Avec le traité de Berlin en 1878, la France obtint, en compensation de la conquête de Malte par les Anglais, l'administration de la ville. Les navires de guerre entrèrent alors dans le vieux port de la ville et contribuèrent à la conquête de la Tunisie entre 1881 et le 18 mars 1884.
À partir de 1884, la France commença à développer les composantes stratégiques de Bizerte. La construction d'un canal reliant la Méditerranée et le lac intérieur joua un rôle particulier dans ce processus. L'objectif était de relier la Méditerranée au lac de Bizerte et de faire du port de Bizerte le port le plus important de Tunisie. Le canal fut conçu par l'amiral Ponty. Sa longueur a été fixée à 800-900 m et, avec une largeur de 100 m et une profondeur comprise entre 9 et 12 m, les plus grands navires connus à l'époque pouvaient emprunter le canal. Les travaux ont été réalisés à partir de 1890 par le consortium Hersent et Couvreux et achevés en 1892. Le canal reliait la Méditerranée au lac intérieur et un port franc d'environ 100 ha fut créé.
L'occupation de la Tunisie par la France entraîna un conflit politique avec la Grande-Bretagne dans les années 1897-1898.
À 20 km au sud du canal et de l'autre côté du lac, la ville de Ferryville fut fondée. Elle portait le nom de Jules Ferry, alors chef de l'État de la Troisième République. Cette nouvelle ville est devenue le deuxième plus grand arsenal naval français à l'étranger. Le 16 juillet 1884, la ville a reçu le statut officiel de municipalité et un pont reliant les deux rives du canal a été construit, qui a existé jusqu'en 1909.
Après le retrait de l'armée serbe d'Albanie en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, une partie des forces serbes fut transportée à Bizerte avec l'aide des Français. Les soldats et les civils serbes vinrent trois fois à Bizerte pendant toute la guerre et, après la bataille perdue de Salonique, les blessés furent transportés à Bizerte. Selon les estimations, environ 60 000 soldats serbes ont trouvé refuge à Bizerte à un moment ou à un autre. Environ 200 casernes ont été construites. La population, l'administration et les responsables politiques étaient très attachés aux Serbes, en particulier à l'amiral. Les derniers soldats serbes ont quitté la ville le 18 août 1919.
En décembre 1920, le gouvernement français accorda l'asile à une partie de la marine de guerre du tsar russe à Bizerte. Les navires qui avaient alors trouvé refuge dans la ville ne la quittèrent plus jamais et furent progressivement mis au rebut, puis vendus à la ferraille en 1935. Aujourd'hui encore, une église orthodoxe, l'église Saint-Alexandre-Nevski, se dresse à Bizerte.
Bizerte pendant la Seconde Guerre mondiale
Après avoir perdu la guerre civile espagnole, les forces démocratiques espagnoles ont demandé refuge en mars 1939 avec une partie de la marine républicaine espagnole sous le commandement des amiraux Miguel Buisa et Fernandes Palacios, ce que le gouvernement français leur a accordé, car ils disposaient de trois croiseurs, sept torpilleurs, un sous-marin et environ 4 300 soldats.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Bizerte était l'un des ports militaires les plus importants de la Méditerranée. La base aéronavale couvrait une superficie de 300 km² et une partie du commandement de l'armée française y était stationnée. La ville disposait également d'installations de protection pour les sous-marins et les croiseurs, ainsi que du grand aérodrome de Karouba et de l'aéroport de Sidi Ahmed. Sans oublier que Bizerte possédait l'un des plus grands chantiers navals de la Méditerranée et l'un des plus grands hôpitaux militaires français de toute l'Afrique du Nord. Ces infrastructures étaient très stratégiques et particulièrement convoitées par les forces de l'Axe.
Dans le cadre de l'opération Torch, l'amiral Derrien avait ordonné à ses hommes de se rallier aux Alliés, mais il dut céder l'aérodrome et le port aux Allemands le 7 décembre 1942. Cette décision fut prise par le représentant du régime de Vichy et son axe de pouvoir, principalement dans l'espoir que les infrastructures soient épargnées. Lors du bombardement de la ville, les Alliés ont délibérément épargné les infrastructures militaires. Il n'en reste pas moins que 77 % de la partie européenne de la ville a été détruite, notamment la cathédrale catholique, deux synagogues juives et une église orthodoxe. Les bombardements ont été suivis d'une épidémie de typhus qui a emporté une partie de la population.
La ville a été déclarée ville interdite et a été libérée par les Américains le 7 mai 1943 lors d'une bataille de rue. De l'autre côté du canal, une ville ouvrière appelée Zarzouna a été très rapidement construite après la guerre. À titre d'information, il convient de noter qu'à la fin de la bataille, 250 000 soldats allemands et italiens ont été faits prisonniers par les Américains.
À propos de Jules Ferry
Jules Ferry, né le 5 avril 1832 et décédé le 17 mars 1893, était ministre et Premier ministre de la Troisième République française. Il était opposé au Second Empire sous Napoléon III. Juriste de profession, il appartenait au camp républicain de gauche. Dès le 23 septembre 1880, avec son premier cabinet en tant que Premier ministre, il joua un rôle déterminant dans la politique coloniale de la France. Lors du congrès de Berlin en 1878, les puissances européennes lui avaient déjà promis la prise de contrôle de la Tunisie, qui appartenait à l'Empire ottoman en déclin. Immédiatement après son entrée en fonction, il s'attela à la réalisation de cette promesse. À cet égard, Jules Ferry fut responsable de la colonisation de la Tunisie. Il convient toutefois de noter qu'à partir de 1880, il fut soumis à une pression politique considérable, car il avait deux adversaires : les anciens monarchistes et la gauche. Georges Clemenceau était son principal adversaire. L'ascension de Ferry est principalement due à la politique coloniale coordonnée avec Bismarck, ce qui a toutefois entraîné une baisse considérable de la popularité de Jules Ferry et lui a fait perdre tout soutien jusqu'à sa chute en 1885.
À propos de Ferryville
La ville de Ferryville est située à 60 km au nord de Tunis et à 20 km au sud de Bizerte. Elle est située au sud-ouest du lac de Bizerte, sur l'étroite bande de terre entre le lac et la montagne Ichkeul.
En 1897, le gouvernement français décida d'y construire un chantier naval dans la zone stratégique du lac par l'intermédiaire de la société immobilière « Der Nordafrikaner », qui y possédait d'importants biens fonciers. Ils ont commencé à concevoir une ville sur la planche à dessin et à chercher un nom. Après la mort prématurée de Jules Ferry, qui avait toujours voulu cette ville, on lui a donné son nom. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cet endroit a été épargné par presque tous les conflits armés. En revanche, Bizerte a été détruite à 77 %.
3. Le lac de Bizerte et le volcan Ichkeul
Ichkeul
Le parc national d'Ichkeul, avec son lac, ses zones humides et le mont Jebel Ichkeul, s'étend sur une superficie de 12 600 hectares au nord de la Tunisie, à environ 25 km au sud-ouest de la ville de Bizerte. Il constitue une halte importante pour des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs tels que les canards, les oies, les cigognes et les flamants roses, qui viennent ici pour se nourrir et nicher. Ichkeul est le dernier lac restant d'une chaîne de plans d'eau qui s'étendait autrefois sur tout le nord de l'Afrique.
Le lac Ichkeul, dernier grand lac d'eau douce, et les marais environnants se caractérisent par une fonction hydrologique très spécifique, basée sur une double variation saisonnière du niveau d'eau et de la salinité. Cela s'explique par la connexion du lac d'eau douce Ichkeul au lac de Bizerte, qui est une lagune d'eau salée, par le biais d'une rivière. Pendant les étés chauds en Tunisie, il ne pleut souvent pas pendant des mois, ce qui fait baisser le niveau d'eau du lac Ichkeul en raison de la consommation humaine d'eau potable et de l'évaporation. Cela a pour conséquence que l'eau salée peut pénétrer par la connexion entre le lac Ichkeul et le lac de Bizerte. À partir de l'automne, les précipitations entraînent une montée du niveau du lac et le refoulement de l'eau salée.
Diverses interventions humaines, telles que la construction de barrages sur les affluents du lac Ichkeul pour l'approvisionnement en eau potable, ont entraîné une baisse inquiétante du niveau d'eau du lac Ichkeul et ont commencé à le saliniser, de sorte que le parc national a été inscrit sur la liste rouge du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Le parc national a été retiré de la liste des sites menacés en 2006, après que la situation se soit améliorée et que la restauration de l'écosystème se soit déroulée de manière satisfaisante.
Marais près de l'Ichkeul – Image : Radiusmed – Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40187920
Le parc national d'Ichkeul offre des habitats naturels et constitue donc une halte et un lieu d'hivernage importants pour les oiseaux migrateurs vers l'Europe ou l'Afrique. Chaque hiver, le parc national offre un refuge à des centaines de milliers d'oiseaux aquatiques tels que des canards, des oies, des cigognes et des flamants roses. Trois espèces d'intérêt mondial trouvent refuge à Ichkeul : le canard à tête blanche (Oxyura leucocephala), le fuligule nyroca (Aythya nyroca) et le marmillon (Marmaronetta angustirostris). Grâce à cette diversité d'habitats, le parc possède une faune et une flore très riches et variées, avec plus de 200 espèces animales (sangliers, buffles d'eau, chacals, différentes espèces de chats sauvages, mangoustes, chauves-souris) et plus de 500 espèces végétales.
Le lac Ichkeul est surplombé par le mont « Jebel Ichkeul », qui, avec ses 511 mètres d'altitude, est la deuxième attraction du parc national. Il fait partie du prolongement le plus oriental du Tell Atlas et est principalement constitué de calcaire.
Jebel Ichkeul vu depuis le lac
La forêt de Jebel
Vous trouverez plus 'informations dans l'annexe
4. Enfance et adolescence de Léon et Patrice à Ferryville
Nous sommes en 1915 à Ferryville, la nouvelle ville située à la lisière d'un chantier naval et d'un port pour navires de guerre, d'une base militaire et d'un aéroport pour la flotte de guerre française. C'est cette année-là que Léon est né. Sa famille était composée de propriétaires terriens et de colons. Il avait un frère et deux sœurs. Son père était commandant sur l'un des croiseurs de guerre amarrés dans le port de Bizerte. Sa mère était femme au foyer et s'occupait de l'éducation des enfants. Ils vivaient dans un quartier très bourgeois, où se trouvaient uniquement des maisons de la Belle Époque. Pour les enfants, leur parcours était déjà tracé dès leur naissance, puisqu'ils devaient, comme le voulait la tradition familiale, fréquenter les écoles élitistes en France et bien sûr à Paris. Indépendamment de cela, les revenus provenant de l'agriculture avaient apporté une certaine sécurité financière à la famille de Léon. Les fils étaient destinés à l'armée, là où leur père avait lui-même fait carrière.
Il était donc décidé que Léon, après sa formation à Saint-Cyr à Paris, l'école supérieure élitiste de l'armée, commencerait une carrière dans la marine, et plus précisément dans la marine de guerre. Sa famille était plutôt de gauche ou de centre-gauche sur le plan politique et peu religieuse. Bien sûr, son père était également nationaliste. Les visites à l'église se limitaient à la messe obligatoire du dimanche matin. Selon la tradition, le déjeuner du dimanche était un événement familial auquel oncles et tantes, grands-parents et enfants devaient obligatoirement assister.
À trois maisons de chez Léon, Patrice est né en 1916 dans un petit palais de la Belle Époque. Issus d'une vieille famille noble, ils possédaient non seulement un domaine considérable, mais son grand-père, son père, son oncle et son frère étaient membres de l'état-major en Afrique du Nord. Son père lui-même était l'un des plus hauts commandants de l'armée de l'air française. Dès sa naissance, Patrice était donc destiné à étudier à Saint-Cyr et à faire carrière dans l'armée de l'air. La famille de Patrice était plutôt conservatrice et, pour certains, encore attachée à l'ancien régime. À cet égard, ils faisaient partie de la noblesse déchu, où « la noblesse oblige ». Ils étaient très conservateurs et extrêmement religieux. Très axée sur la discipline militaire, l'accomplissement du devoir était la priorité absolue de la famille. Mais dans cette famille, il y avait aussi des moutons noirs qui ne se souciaient pas de la morale familiale. Aller à l'église le dimanche était un devoir absolu, tout comme le déjeuner en famille. Les membres de la famille étaient conditionnés à faire carrière, de préférence dans l'armée. Tous les enfants devaient obtenir les meilleures notes à l'école.
Outre son père Gustave et sa mère Madeleine, Patrice avait deux sœurs, Lucille et Denise, et un frère, Raoul. Il était le deuxième enfant, Raoul était l'aîné. Raoul avait fait carrière dans la marine, ce qui était tout juste toléré par la famille, car celle-ci avait traditionnellement une préférence pour l'armée de l'air. Les femmes de la famille étaient soumises à un régime strict visant à tirer le meilleur parti des enfants. Mais la famille comptait également deux philosophes, qui étaient plus ou moins évités par le reste de la famille. Ces philosophes étaient cependant les oncles préférés des enfants.
Il convient toutefois de mentionner que la culture occupait une place importante : la lecture de livres, les soirées culturelles, les discussions et la musique, ainsi que les lectures de poèmes et les chants étaient à l'ordre du jour. Cela faisait de la maison de la famille de Patrice un centre culturel.
À quelques rues du quartier résidentiel se trouvait le Collège de France. Il était réservé aux enfants de l'Amirauté et des dirigeants des armées françaises, ainsi qu'à quelques notables triés sur le volet. Cette école comptait environ 600 enfants en âge scolaire et les classes ne pouvaient pas compter plus de 25 élèves. Il y avait une grande salle pour le déjeuner et une grande salle où les enfants faisaient leur sieste. Pendant les sept années d'école primaire, de nombreuses amitiés pour la vie se sont nouées.
Un jour, pendant le cours, la porte s'est ouverte et le directeur est entré dans la classe accompagné d'un garçon mince et grand, au visage souriant et au regard quelque peu ironique. Le directeur a présenté l'élève au professeur, qui lui a demandé : « Comment t'appelles-tu ? » « Patrice, Monsieur », a-t-il répondu poliment en souriant. L'une des rares places libres se trouvait à côté de Joël, et Patrice s'est donc assis à côté de lui.
Patrice était très bien élevé et très poli, mais déjà depuis son enfance, c'était un casse-cou. Il était intelligent et particulièrement doué en mathématiques, en français et en histoire. Léon, en revanche, était plutôt du genre calme, mais très minutieux. Il n'était pas particulièrement bon dans les matières principales, mais il faisait tout son possible pour suivre Patrice. Patrice n'était pas facile à convaincre, mais c'était un ami très fiable, même si cela lui causait parfois des problèmes. Il réussit même à convaincre son entourage et sa famille d'accepter Léon comme un ami à part entière. Ils allaient très souvent au terrain de sport, où Patrice fit ses premiers essais avec un ballon. Ses résultats scolaires étaient toujours très bons et il s'efforçait d'aider les élèves plus faibles. À cette époque, le Collège de France était l'une des premières écoles en France et dans les colonies à accueillir garçons et filles dans les mêmes classes. Et bien sûr, Patrice était le chouchou des adolescentes. Lui-même n'y prêtait guère attention.
Les deux amis ont passé leur baccalauréat le même jour et ont reçu leurs résultats environ quatre semaines plus tard, par une très chaude journée d'été. Patrice avait une moyenne nettement supérieure à celle de Léon, ce qui lui permit de passer un examen supplémentaire pour être admis à l'école militaire de Saint-Cyr. Léon, en revanche, avait obtenu une moyenne tout juste suffisante pour être admis dans une école militaire de la marine.
Cet été-là, les deux amis se voyaient presque tous les jours et allaient soit pêcher au lac, soit faire de petites excursions dans la forêt voisine avec d'autres camarades. Léon a toujours gardé en mémoire le souvenir de ces excursions, car ils commençaient par se lever à 4 heures du matin pour profiter de la fraîcheur matinale, puis marchaient 10 à 20 km jusqu'à la forêt. Surtout lorsque des femmes les accompagnaient, elles avaient beaucoup de mal à porter leurs lourds paniers et devaient faire de nombreuses pauses.
Arrivés dans une clairière, ils installaient un coin pour s'asseoir afin que les femmes puissent préparer le repas pendant que les hommes accompagnaient les deux amis à l'eau où ils essayaient de pêcher.
Certains jours, ils pêchaient tellement de poissons et de si gros poissons qu'ils en donnaient une partie sur le chemin du retour. Et s'il n'y avait pas assez de poissons, ils se contentaient de tartines de fromage. Ils buvaient de l'eau et du vin, chantaient et dansaient même dans la forêt. Puis ils rentraient à pied, allumant des torches pour retrouver leur chemin dans l'obscurité, car les chemins n'étaient pas éclairés. Il leur arrivait même de passer la nuit dans cette clairière. La forêt était très dense et traversée par une vieille route.
Pour les adolescents, il était tabou de s'aventurer sur cette route, car la forêt, qui s'étendait jusqu'à la montagne Ichkeul, était entourée de nombreuses légendes, mythes, contes et drames.