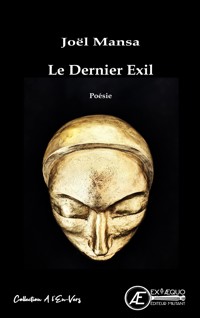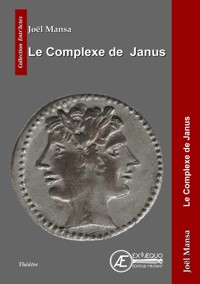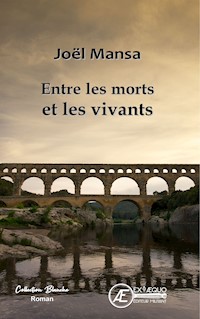Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pourquoi une ancienne réfugiée d’Éthiopie, Izraïla, arrivée enfant dans un camp de Khartoum, assiste-t-elle au procès de l’âme damnée d’Al Mokhtar, l’insaisissable tyran du Soudan ?
Nous sommes dans une Afrique de l’Est imaginaire, au milieu du XXIe siècle, alors qu’une guerre de l’eau oppose les pays qui se disputent le Nil et renforce les pouvoirs militaro-religieux. Sur les toits des immeubles s’entassent les plus pauvres de Khartoum, dans des villages de toile et de tôle, tel celui où Izraïla a vécu : La terrasses des égarés. Elle raconte son histoire comme un conteur une fable, le destin de tout un peuple et le nôtre, nous qui vivons dans un monde où tout semble un éternel recommencement.
Ce roman est aussi un hymne à l’amour, dans les folies d’une dictature où sont entraînés les personnages. La poésie y tient une place essentielle comme une voix qui rappelle que, tant qu’il y aura des artistes, la vie ne sera pas perdue.
Quelle parole est légitime quand la guerre ravage tout et justifie tout, surtout le pire ? Aucune. Sauf pour témoigner. Et je veux témoigner.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Joël Mansa vit à Bordeaux, il est poète, auteur de théâtre et romancier. Après Entre les morts et les vivants, plus autobiographique, ce roman est une pure fiction. Il y dénonce le pouvoir et la religion lorsqu’ils se font tyrannie. Le monde n’est-il pas depuis toujours gangréné par cette réalité ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joël MANSA
La terrasse des égarés
Roman
ISBN : 979-10-388-0723-5
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : juillet 2023
© couverture Ex Æquo
© 2023 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
À Frédéric et Pierre-Emmanuel Faux,
avec toute mon affection.
Préface
La guerre de l’eau viendra un jour, qui gronde déjà sourdement. Dans ce roman, à peine d’anticipation, nous y sommes. Nous sommes dans un Soudan imaginaire, mais à peine, au cœur d’une Afrique de l’Est imaginaire… mais à peine, sous l’étau d’une dictature religieuse absurde, comme il en existe aujourd’hui.
Une tyrannie qui se nourrit de « discours si savants, dits avec tant de douceur, ces discours qui pillaient dans les ouvrages les plus beaux, les plus profonds, dans les textes sacrés, dans les pensées des philosophes cautionnées par des siècles de culture… Ces discours qui s’emparaient des mots les plus envoûtants pour justifier le pire, pour servir tous les mensonges et toutes les folies de ce régime. » Voilà bien une manipulation de tous les instants à laquelle personne ne peut résister, ou presque.
Mais il y a Izraïla, une petite réfugiée d’Éthiopie placée sous la « protection » de cette épouvantable dictature, narratrice prisonnière de sa mémoire recomposée dans le récit douloureux qu’elle nous livre et où se superposent passé et présent. Izraïla qui, dans cette tourmente où rien n’est plus permis, s’autorise à aimer… à aimer une femme, Achoura, une musicienne.
Alors, pour s’opposer à ces discours délétères, ces théologies idéologisées par les fanatiques qui font perdre toute raison à qui les subit, il reste la poésie, celle de la maman d’Izraïla, la musique, celle d’Achoura, l’amour, en liberté, le courage d’être soi, les seules vraies réponses à cette folie d’un monde qui n’est pas si éloigné du nôtre.
C’est le propos de ce roman... Un texte nécessaire, indispensable, à la portée universelle, que je vous invite à découvrir, maintenant…
Dominique Faure
Avant-propos
La terrasse des égarés est une fable, un conte. Les femmes et les hommes qui en sont les personnages vivent dans un monde absurde, une Afrique de l’Est imaginaire où, dans la seconde partie de notre siècle, la Guerre de l’eau ravage tout.
La religion dominante dans cette région du monde est devenue plus syncrétique et plus confuse qu’auparavant, amalgamant davantage d’éléments d’autres cultures, le régime politique, une grande organisation pseudo-humanitaire, une tyrannie militaro-sanitaire qui se nourrit de shows médiatiques et de discours journaliers de son mystérieux chef qui se fait appeler « L’Élu ». Le désert est le royaume des tribus recomposées qui se battent pour ne pas disparaître. Dans les villes, les plus pauvres se terrent dans les caves ou vivent sur les toits-terrasses des immeubles des puissantes multinationales.
Il est difficile de se l’imaginer, mais les toits plats des immeubles de Khartoum, certains grands comme des terrains de football, sont habités. De petites cabanes faites de tôles, de cartons et de toiles y forment des villages suspendus en plein ciel, avec leurs ruelles et leurs poulaillers. Chaque terrasse a un nom et un responsable, un chef de village qui veille sur ses habitants. On doit aussi y entretenir, comme sur le toit d’un hôpital, une aire d’atterrissage pour les hélicoptères du pouvoir qui vient régulièrement exercer des contrôles. Parmi toutes les terrasses, celle « des égarés » est devenue dominante, son chef est aussi celui de toutes les autres.
Rien de cela n’est vrai ni peut-être vraisemblable.
C’est juste une fantaisie, une rêverie où la poésie a toute sa place.
N’y voyez surtout qu’un roman.
"Notre vie est comme le passage d’une ombre, sa fin est sans retour".
La Bible, Le livre de la Sagesse, chapitre II, verset 5.
"La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie".
Sénèque, citation apocryphe.
"Tout enfant, j’ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires : l’horreur de la vie et l’extase de la vie".
Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, publication posthume, 1887.
Prologue
Je m’appelle Izraïla Del Campo et je me récite souvent ce passage du chapitre deux du Livre de la Sagesse que je connais par cœur :
Notre nom tombera dans l’oubli avec le temps et personne ne se souviendra de nos œuvres. Notre vie passera comme une trace de nuée. Elle se dissipera comme un brouillard que chassent les rayons du soleil, et que la chaleur condense en pluie. Notre vie est le passage d’une ombre, sa fin est sans retour.
Mais comment lutter contre la force de l’oubli ?
Notre vie n’est-elle vraiment qu’une trace de nuée dans le désert, bien vite évaporée ?
Quel est le prix à payer pour que demeure encore le souvenir de ceux que nous avons aimés, le souvenir de ceux que nous aimons toujours ?
Raconter son histoire, est-ce un espoir vain de garder la mémoire des évènements et des êtres ?
Est-ce une illusion que de vouloir comprendre un peu de soi et des autres, juste un peu ? Je ne le sais pas.
Tout ça n’est presque rien. J’écris comme me viennent les choses, parfois bien confusément. Il m’arrive de penser soudain à quelqu’un quand je parle d’un autre, de voir surgir un épisode du passé quand je rapporte des évènements présents. Cela rend peut-être mon récit parfois difficile à comprendre, si jamais quelqu’un le lit. Mais je ne cherche qu’à témoigner. Et celles et ceux qui pourraient le lire comprendront que je ne l’ai écrit que pour témoigner. C’est juste comme un pas de côté, pour mieux regarder les jours écoulés. Pour lutter contre l’oubli. Pour vivre encore.
Mardi 23 mai 2056, troisième jour du procès d’Everett Even, l’âme damnée de celui qu’on appelait l’Élu, Al Mokhtar, celui qui était, durant toutes ces années de dictature, le maître de Khartoum. Le matin, le procureur Ibrahim Adam Lacerto a décidé de faire écouter à la Cour deux des plus fameux discours d’Al Mokhtar, et, tout à coup, j’ai été submergée par le souvenir de mon premier jour au Camp Nord. C’est le soir même que j’ai ouvert un carnet à la première page et commencé à rédiger La terrasse des égarés.
Chapitre 1
Longtemps, j’ai affirmé que je n’avais aucun souvenir de mon arrivée au Camp Nord.
Ce n’était pas vrai.
Dire la vérité, cela m’était impossible. Tout simplement impossible.
Je m’étais résolue à rester amnésique. Aveugle aussi. Je ne voulais ni me souvenir, ni voir en moi ce qui était vrai. C’était mieux pour moi. Et pour les autres. Pour ne pas avoir à parler de tout ça. C’était trop douloureux. Et inutile.
Aujourd’hui, après tant d’années, au point où nous en sommes arrivés, j’éprouve le besoin d’écrire notre histoire. Du moins ai-je la volonté de noircir quelques feuilles, même si cela est difficile, quelques feuilles qui seront comme de petits morceaux de ma vie. Pour comprendre. Pour rassembler des fragments, des lambeaux du passé. Il n’y a jamais que des lambeaux aux choses du passé. Des lambeaux que l’on s’efforce de tisser. Qu’il faut essayer de tisser les uns aux autres. Encore et encore. C’est peut-être sans espoir. Peut-être n’irai-je même pas jusqu’au bout de mon projet. Peut-être n’en aurai-je tout simplement pas la force. Cela ne servira certainement à rien ni à personne. Ce carnet tombera dans l’oubli et personne ne s’en souviendra. Personne ne le lira. Ce sera comme dans le Livre de la Sagesse. Il disparaîtra avec moi. Il sera brûlé, déchiré, ou enfoui dans le sable du désert. Mais je me dis que je dois écrire. Je le dois. Je n’ai pas le courage de celle que j’appelle ma mère, ma douce maman. Je n’ai ni son courage ni son talent qui en elle ne font qu’un. Mais je dois essayer d’écrire notre histoire. Ma chère maman a écrit dans l’un de ses plus beaux poèmes :
Écrire,
C’est dessiner les contours du chagrin et de la joie,
Écrire,
C’est dessiner les formes du bonheur et les gouffres affreux du malheur,
Écrire,
C’est vivre encore, c’est vivre toujours.
Moi aussi, je dois essayer de dessiner les contours de mon chagrin et de mes joies, les formes du bonheur quand j’ai été heureuse et les gouffres du malheur où je me vois plongée. Je le dois à ceux que j’aime. À eux seuls. Et à moi-même…
Du voyage pour arriver à Khartoum, j’ai presque tout oublié.
Là, j’ai toujours dit la vérité.
Je n’ai gardé que quelques impressions confuses. Des impressions que le temps, la mémoire et le récit intérieur sans cesse recommencé ont transformé pour moi. Comme la force de l’imagination et les trop nombreuses lectures des textes sur les réfugiés de la Guerre de l’eau, que je n’ai cessé de lire et de relire, ont changé de vagues souvenirs en obsessions. En moi, ce voyage est devenu comme un film fait de flashes, d’images fixes et de séquences répétitives.
Mais le premier matin au Camp, les évènements qui se sont produits sous la grande tente centrale et tout ce qui a suivi, ils sont en moi. Bien présents. Toujours présents et clairs.
J’étais petite. Très petite.
Je ne sais pas exactement quel âge je devais avoir. Peut-être cinq ou six ans. Celui que l’on m’a ensuite attribué arbitrairement a plaidé pour l’incapacité de l’enfant que j’étais à retenir avec précision tous les détails de son histoire. Cela m’a bien arrangée, pendant longtemps, que l’on puisse croire à cette fable.
J’ai assurément une vision claire et précise de ce moment de ma vie.
Je sens encore la brûlure de la lumière du matin dont les rayons aigus traversaient la toile de la tente où on nous avait regroupés, l’odeur étouffante de la poussière que les pieds du troupeau d’hommes, de femmes et d’enfants amassés soulevaient. J’entends distinctement les cris, les appels, le bruit métallique des tables médicales roulantes, des brancards qui grincent.
J’entends encore le ronflement des grands ventilateurs suspendus à des câbles au-dessus de nos têtes.
La bousculade est à son comble pendant le tri.
C’est l’accueil des derniers arrivés de la nuit.
Je vois des hommes et des femmes en blanc qui mettent de côté les enfants seuls, les vieux, les jeunes filles. Sur leurs grandes blouses, il y a écrit en lettres capitales FPIA. En rouge. C’est l’Association Internationale pour la Nourriture et la Paix, une belle escroquerie des fondations humanitaires sous Al Mokhtar, celui qu’on appelait L’Élu.
Instinctivement, je serre plus fort la main de mon frère dont la sueur coule le long de mes doigts. C’est l’odeur que je garde à jamais en moi. Celle de la sueur de mon frère. Elle est forte, poivrée, épaisse. Je lève la tête pour voir son visage, pour regarder ses yeux noirs, toujours si doux. Mais mon regard est capturé par les écrans géants qui se penchent sur nous aux quatre coins de la tente. Ils diffusent des images en kaléidoscope. On y voit des scènes de défilés militaires, de distributions de nourriture, de salles d’hôpitaux où des infirmières courent de lit en lit, des écoles où des enfants bien alignés chantent dans la cour, tous habillés de la même façon, mais aucun son ne correspond à ces vues. Une voix de miel à peine audible dans le brouhaha général verse sur nous un discours incompréhensible, il se superpose aux images qui se suivent à toute vitesse. C’est comme une mélopée. Cette voix me berce. Elle ne me fait pas peur comme les hommes en blanc et les corps agités qui crient ou pleurent autour de moi.
C’était la voix d’Al Mokhtar. Les discours du jour qui passaient en boucle dans les camps de réfugiés. Une voix. Une parole apaisante. Comme une main qui rassure. Le pouvoir et la parole. Le pouvoir est dans la parole. Le pouvoir est dans le code et dans la parole. Celui qui a le code et la parole a le pouvoir. Mon frère m’a serrée plus fort contre lui. Mon visage était caché sous sa chemise tachée de sueur. Je sentais sa peur. Mais je me souviens que mes yeux cherchaient toujours les écrans. J’ai tourné la tête vers le centre de la tente d’où venait la voix, pour la retrouver.
Alors, je l’ai vu, lui.
Chapitre 2
Les choses du passé reviennent toujours, inlassablement. Comment lutter contre le désir irrépressible de s’y abandonner ? Je ne le sais pas. Moi, je ne le peux pas. Même quand ce passé est terrifiant. Surtout quand il est terrifiant.
Sous la tente centrale du camp Nord quand mon frère m’a serré à m’étouffer contre lui, j’ai compris que quelque chose d’insurmontable allait se produire. Je ne savais pas ce que c’était. Je ne pouvais pas le savoir. Mais c’était insurmontable. Et cela allait se produire. Dans mon cœur de petite fille, une petite fille qui ne comprenait rien à la situation dans laquelle elle se trouvait, comme tous les enfants pris dans la folie d’une guerre ou l’effroi d’une fuite et de l’exil, je savais que quelque chose allait se passer là, et que cette chose serait terrible. Et j’ai regardé. Je me suis détachée de la poitrine de mon frère, et j’ai regardé.
Alors, je l’ai vu.
Je l’ai vu arriver jusqu’au milieu de la tente, comme un démon sur son char.
C’était son plateau de télévision roulant. Depuis le fond de la salle de tri, dans un bruit de tonnerre et le déchaînement des musiciens et des danseuses qui l’entouraient sur scène, il traversa la foule des réfugiés dans son dispositif mobile. Il fallait s’écarter pour lui faire place. Les humanitaires saluèrent son arrivée avec des cris de midinettes en transe. Bien sûr, tout cela je l’ai compris après, plus tard, avec le temps. Mais l’effet que cela provoqua en moi fut foudroyant.
C’était Everett Even.
Il faisait son émission du matin, en direct. Trois techniciens tournaient autour de lui comme des mouches, caméras à l’épaule, vêtus de l’uniforme vert du SSD. Le Département Sanitaire et Social, cette organisation militaire n’était rien d’autre que la police politique et religieuse du régime, sous couvert d’être le service des membres actifs du ministère soudanais des affaires sociales et de la santé publique. Près de ce « démon », dans une cage rose posée sur une table haute, il y avait Cicéron, son grand perroquet du Brésil, le deuxième du nom, qui lui servait de faire valoir sur scène. Tous les enfants l’adoraient et plaignaient l’animal que son maître jouait à maltraiter. Et comme les autres, à peine l’avais-je aperçu pour la première fois ce perroquet, blottie que j’étais dans les bras de mon frère, que je ne regardais plus que lui. Je ne comprenais rien, comme tous les malheureux réunis là. Mais je sais, je sais très bien que ce que j’ai ressenti alors était sans issue.
À la droite d’Everett Even dont le procès en était maintenant à son troisième jour, lui, le chef du SSD, se tenait alors, légèrement en retrait, un homme dont le regard faisait vraiment peur. C’était Omar Youssouf, son second, son homme de main, son exécutant. Plus grand que son maître, plus mince, se tenant bien campé sur ses deux jambes, l’uniforme impeccable, il me fit comprendre à la seconde où je traversai son regard que plus rien ne serait comme avant. Il restait impassible quand autour de lui les musiciens et les danseuses s’agitaient, tout comme les cameramen. Cicéron criait dans sa cage et tordait la tête dans tous les sens. Everett Even faisait de grands mouvements avec ses bras pour saluer son public et frappait la cage à coups de coude pour exciter son perroquet.
La confusion était à son comble quand soudain, d’un geste théâtral de chef d’orchestre, Everett Even fit tout arrêter d’un coup.
Je regardais toujours le perroquet qui, surpris par le silence brutal, se figea dans sa cage. Puis on entendit sa voix aigre qui répéta trois fois : "Va te faire pendre ailleurs, vieille canaille ! Mokhtar ! Moookhtar !". "Ta gueule Cicéron, hurla Everett Even en frappant encore une fois la cage de son perroquet posée sur la table près de lui, ta gueule mon chou...". Et, faisant le clown, il fixa du regard, au plus près, une des caméras en faisant signe au caméraman de s’approcher de lui. On voyait son visage grimaçant en gros plan sur tous les écrans de la tente. Je le regardais lui, je regardais Cicéron, je regardais les écrans, j’étais fascinée. Dans les bras de mon frère, mais attirée, irrésistiblement attirée par ce que je voyais là.
Alors, on entendit Everett Even dire comme s’il faisait une confidence à la caméra :
— Oups ! C’est le moment tant attendu de l’inattendu de notre show du matin... Vous avez tous compris ? Nous sommes au tri matinal du camp Nord. Un classique de notre belle cité. Voyons ce qu’il y a à se mettre sous la dent !
Je regardais Cicéron qui tournait la tête en tous sens comme s’il cherchait à comprendre ce que son maître chuchotait à tout le monde, quand Everett désigna mon frère.
— Lui, je ne le sens pas du tout !
Et se tournant une nouvelle fois vers une caméra, il murmura plus bas encore comme s’il parlait à un intime : "Ce garçon va nous créer des ennuis dans un futur plus ou moins proche... Une sorte de révolutionnaire romantique et absurde pourrait bien sortir de cet être encore inoffensif, pour le moment… Il faut agir, avant qu’il ne soit trop tard… Dommage pour le petit bout de chou qui est dans ses bras ! On va s’en occuper bien sûr, car Khartoum La très Glorieuse a du cœur."
Tous les shows d’Everett Even étant soigneusement enregistrés et classés, je sais aujourd’hui au mot près tout ce qu’il a dit. Et j’ai revu, pour mon malheur, les images de ce jour-là, il n’y a pas si longtemps.
Alors qu’il parlait avec cette intonation particulière qu’on lui connaît encore aujourd’hui, tout le monde sous la grande tente s’était écarté de nous et ses hommes, les hommes du SSD, tenaient déjà mon frère fermement. Ils n’essayèrent même pas de m’arracher à ses bras. Everett Even descendit de son estrade et, toujours accompagné au plus près par une caméra, vint jusqu’à nous et me parla. Je ne sais plus les mots exacts qu’il prononça à ce moment précis. Je crois que je n’ai rien compris. Mais je me souviens très bien de l’effet de ses paroles sur moi. Et malheureusement, aujourd’hui, le film de cette séquence ne permet pas d’entendre ce qu’il m’a dit alors à l’oreille.
J’ai lâché les bras de mon frère et je me suis abandonnée à lui. Littéralement. Mon frère a voulu crier, les hommes d’Everett lui ont fermé la bouche et ils l’ont emporté. Plus jamais je ne l’ai revu. Je me vois encore quittant sans remords ses bras pour ceux d’Everett Even où je me suis sentie si bien. Lui, aussitôt, se débarrassa de moi en me déposant dans les bras d’une humanitaire de la FPIA.
— Voilà, dit-il simplement en souriant à tous les écrans, c’était le show du matin !
Après, pour moi, tout s’est brouillé.
Mais Everett n’était que le représentant de L’Élu. Et dire que j’aimais tant ses discours, à L’Élu, Al Mokhtar, quand j’étais petite à Khartoum La très Glorieuse, comme il fallait dire sous sa dictature, sous peine d’être battue !
J’ai toujours aimé les discours de L’Élu. Comme tous les enfants. Sans les comprendre, bien sûr. Ces discours si savants, dits avec tant de douceur, ces discours qui pillaient dans les ouvrages les plus beaux, les plus profonds, dans les textes sacrés, dans les pensées des philosophes cautionnées par des siècles de culture… Ces discours qui s’emparaient des mots les plus envoûtants pour justifier le pire, pour servir tous les mensonges et toutes les folies de ce régime. Les livres, la culture, utilisés comme instruments, comme supports pour disculper les actes les plus horribles.
Aujourd’hui que nous les écoutons pour en décoder les principes et rendre compte en public de leur formidable pouvoir manipulatoire, je comprends comme je les aimais. Ils faisaient partie de ma vie. Au même titre que ma famille. C’est affreux à dire, mais c’est vrai. Et c’est bien pourquoi ces discours auront tout permis. Tout justifié. Beaucoup, tout autant que moi, aimaient écouter la voix de « M ». Cette lettre que l’on trouvait partout peinte sur les murs, les camions, les chars, les ambulances, les autobus, les portes des hélicoptères, ce M pour Al Mokhtar, peinte sur les aires d’atterrissage de ses hélicoptères que chaque terrasse devait avoir et entretenir soigneusement. Cette voix si douce et apaisante. Une mélopée. Un étourdissement. Une habitude. Comme tous les rituels. Toute société repose sur des rituels. Nos sociétés modernes reposent sur trois choses, trois : des codes, le code informatique avant tout, des aliénations et des rituels.
Je sais combien mon père adoptif, celui que l’on m’a donné à Khartoum, a toujours souffert de savoir les enfants tout particulièrement sensibles au discours du jour. Chaque jour, avant la prière de midi, juste avant que le soleil ne soit à son zénith, tout s’arrêtait à Khartoum et dans tout le pays. Impossible d’éteindre les radios, ni les écrans, ni les haut-parleurs des rues, des écoles, des stades ou des mosquées. Il fallait écouter et se recueillir avant la prière de midi. Ils ont été nombreux ceux qui ont prévenu des dangers de ces discours de M, quand nous étions enfants. Qui savaient en montrer les limites, la bêtise même. Mon père, qui était à cette époque instituteur, dans sa classe, était le premier à le répéter. Mais à quoi bon, cette parole était plus forte que sa belle voix, plus forte que ses colères, plus forte que les mots les plus doux de son épouse, ma mère adoptive.
Plus aucune parole n’est légitime depuis. Quelle parole peut être légitime après tant d’années d’Al Mokhtar ? Quelle parole est légitime quand la guerre ravage tout et justifie tout, surtout le pire ? Aucune. Sauf pour témoigner. Et je veux témoigner.
Chapitre 3
Depuis, je pense à mon frère avec effroi, avec colère, et avec cette honte si particulière que les victimes de crimes contre l’humanité ressentent quand ils survivent pour leur plus grand malheur alors que les leurs ont péri.
J’ai lu et étudié tous les documents que j’ai pu trouver sur les réfugiés de la Guerre de l’eau. J’ai reconstitué à peu près le chemin que nous avions parcouru pour nous retrouver, mon grand frère et moi, sous cette tente du camp Nord à Khartoum. Je sais d’où nous venions, même si je n’ai pas pu retourner sur les lieux et, d’ailleurs, je ne sais pas si j’en aurai jamais la possibilité ou le courage. Je n’en suis pas certaine, mais je crois qu’il me serait insurmontable de me confronter avec cette réalité-là, si les circonstances se prêtaient un jour à ce que je revienne dans mon village natal. J’en connais le nom et la localisation exacte. Je sais que l’armée soudanaise l’a bombardé et que mes pauvres parents et mes autres frères y disparurent, ensevelis sous les gravats, dans les ruines d’une vie passée dont je n’ai aucun souvenir, là c’est certain.
Nous venions de la région de Gondar.
Gondar, c’est toute l’histoire de l’Éthiopie, une histoire qu’il faut connaître pour comprendre notre situation, ce qu’il nous est arrivé. Une terre d’agriculteurs, comme l’était ma famille, et l’ancienne capitale de deux empires perdus. C’est sans doute pour cela que mon cher amour, Achoura, ma bien-aimée, s’amuse à m’appeler sa petite reine de Saba. En partie pour cela. Gondar a toujours été attaquée, pillée, occupée, bombardée. Les Soudanais d’Al Mokhtar, de la Guerre de l’eau, ne sont pas les premiers. Les égyptiens, les mahdistes soudanais au XIXe siècle, les Britanniques, les fascistes italiens au XXe siècle ne se sont pas privés pour nous en faire voir aussi, sans compter les guerres civiles entre Éthiopiens. Au fond, je suis née dans un endroit qui est marqué par toute l’histoire des hommes. Déjà, disent les historiens, sous l’empereur Menas, en 1559, les dirigeants de l’Éthiopie ont commencé à résider, à la saison des pluies, près du lac Tana. Et puis l’empereur Fasiladas en 1635 a fondé Gondar qu’on appelait alors Gandar, car un lieu qui commence par GA était signe de prospérité et de paix…
L’Histoire est capable d’ironie. Depuis que je connais mon histoire et celle de Gondar, le fait d’être originaire de cette région me semble avoir beaucoup de sens. Fasiladas fit construire un palais, un pont et sept églises. Ses successeurs firent aussi construire chacun leur palais. Il n’y avait pas plus beau en Éthiopie que Gondar. Et puis toutes les religions du Livre, comme on dit, y étaient heureuses et mêlées quand, en 1668, après un concile de l’Église orthodoxe éthiopienne, l’empereur Yohannes 1er décida que les habitants de Gondar ne devaient plus vivre tous ensemble, mais être séparés selon leur religion. Les musulmans dans un délai de deux ans devaient déménager dans leurs propres quartiers, Islamge qui veut dire en amharique, እስላምጌ, « Pays d’islam ». J’aime écrire des mots dans cette langue, c’est comme revenir à mes origines et c’est affirmer combien la langue est l’expression même d’une grande civilisation. Mais déjà en 1668, c’en était fini de l’harmonie entre les religions, finie de la paix entre les frères d’Éthiopie. Tous les malheurs du monde sont tombés sur Gondar. Tous les malheurs du monde sont tombés sur ma famille, et je me suis retrouvée au Camp Nord avec mon grand frère qui n’y a pas survécu. Le corridor humanitaire qu’Al Mokhtar avait proposé aux survivants ne menait pas dans une autre province éthiopienne, mais au Soudan, évidemment, chez notre ennemi.
Ainsi font toutes les dictatures qui prennent d’assaut leurs malheureux voisins qu’ils accusent de tous les maux de la terre, ainsi fit Al Mokhtar qui accusait Addis-Abeba de lui voler l’eau du Nil. Et nous nous sommes retrouvés aux mains de L’Élu, de son âme damnée Everett Even et de son épouvantable lieutenant Omar Youssouf.
Tout s’est troublé pour moi quand Everett Even m’a laissée aux mains des humanitaires de la FPIA.
Je me souviens de m’être réveillée dans un dortoir malodorant où de nombreux enfants étaient comme moi, perdus. Ce que j’ai entendu n’était que des pleurs et des appels. Ensuite, je ne sais plus très bien dans quel ordre mes souvenirs s’organisent ou se perdent. Je vois une salle immense où les enfants mangent en silence, une voix crie au-dessus de ma tête quelque chose que je ne comprends pas ; je suis dans une file de petites filles qui regardent toutes leurs pieds en passant devant une femme énorme grommelant des injures que je comprends très bien cette fois, j’entends sotte, négresse éthiopienne, saleté.
Je suis dans une cour, nous sommes nombreux, j’ai une robe grise qui me gratte et il faut chanter quelque chose que je fais semblant de chanter. Une assiette de boulettes de viande me fait si plaisir que je ris, et d’autres rient aussi. Un petit garçon me sourit et prend ma main. Je cherche son nom, mais je ne le retrouve pas dans ma mémoire en vrac, pourtant je l’entends me répéter plusieurs fois son nom. Le temps passe. Dans le réfectoire, au dortoir, dans la cour, dans la classe que je revois aussi par bribes où je suis assise toujours près d’une grande fenêtre. Elle m’attire irrésistiblement, cette grande fenêtre. On entend partout la voix de L’Élu et les discours du jour qui défilent et nous enveloppent de leur mélodie douce et rassurante.
Et puis, un jour, combien de temps après mon arrivée je ne le sais pas, on me conduit dans un bureau où Everett Even m’attend. Il est là, souriant, accompagné d’un caméraman qui ne manque rien de notre rencontre. Il me parle et parle à la caméra. Tout est bien organisé, comme toujours avec lui. Il dit et tout est enregistré :
— Nous allons faire une heureuse ! Notre belle cité va une fois de plus être digne de toutes les louanges et, comme toujours, Khartoum la très miséricordieuse méritera son surnom. J’ai trouvé une famille pour cette belle enfant et ce sera pour moi, comme pour elle, un évènement ! Car, écoutez bien tous, je vais confier cette petite fille à mon vieux maître d’école et sa merveilleuse épouse et poétesse du Soudan, Yasmina. Je vais confier cette enfant à celui à qui je dois tout, Alvaro Del Campo. Et Dieu sait comme il ne m’est pas favorable pourtant, mon vieux maître Alvaro ! Il est peut-être aujourd’hui, sûrement même, mon pire adversaire en notre belle cité de Khartoum, la très glorieuse ! Qui osera dire que sous Al Mokhtar nous ne sommes pas les plus indulgents, les plus dévoués à nos concitoyens, les plus magnanimes de tous les hommes !
Chapitre 4
J’ai retrouvé le discours d’Al Mokhtar que j’ai entendu, petite, avant que ne surgisse ce diable d’Everett Even, ce discours qui passait en boucle sous la grande tente du camp Nord, le jour où mon frère a disparu. Je crois que je l’ai si souvent réécouté que je le connais presque par cœur aujourd’hui. Il s’agissait de celui du 29 mars de l’an 7 de la Guerre de l’eau, tel que, sous la dictature, le nouveau calendrier comptait les années depuis le début des hostilités entre les grandes cités de l’Est africain.
Il commence ainsi, ce discours, en citant le livre de l’Exode :
"Tu me verras par-derrière, mais ma face ne peut être vue…"
Le livre de la Splendeur, le Sepher ha-Zohar enseigne que la lettre Beith ] a été placée en tête de l’Écriture parce qu’elle est ouverte d’un côté pour pouvoir tourner ce côté en haut et y faire entrer les lumières et qu’elle est fermée de l’autre côté, ainsi qu’il est écrit dans le livre de l’Exode, chapitre XXXIII, verset 23 : "tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue".
C’est ainsi que les choses doivent être, et nous avons banni les icônes et toute image fausse qui ne peut que voiler la vérité divine.
Et moi-même, vous me voyez bien de cette manière, seulement derrière notre très cher drapeau national, avec tout le respect que je dois à l’Écriture sainte et à notre foi bien sûr…
C’est qu’il nous faut toujours suivre les modèles que l’histoire sainte nous a donnés.
Voyez comme il est doux de penser à Moïse qui fut le meilleur des hommes et qui montra la voie. C’est un miracle qu’un homme si grand fut si humble, et avec Job dont le livre est pure merveille et Abraham, notre père à tous, nous avons là des figures dans lesquelles notre société fait bien de se reconnaître.
N’oublions jamais que le peuple élu fut guidé vers le salut par Moïse et que l’armée d’Égypte fut anéantie par les flots. Voyons combien notre actualité donne du sens à l’histoire biblique, et comme notre cité est en proie aux exactions de dirigeants insensés qui règnent au Caire où nos frères souffrent comme à Addis-Abeba la maudite ou Kampala la grande, ces dirigeants insensés qui nous privent de notre libre accès aux eaux sacrées du Nil !
Voyez, mes chers concitoyens, comme nous avons à apprendre encore et toujours. Aussi devons-nous lire et relire les textes sacrés, les œuvres des sages et des mystiques, mais également nous devons nous intéresser, même pour les démentir, surtout pour les démentir, aux écrits des philosophes et des sociologues de l’époque moderne.
Voyez les très intéressants ouvrages, aujourd’hui oubliés, à tort, de Stanley Milgram le psychologue américain, Pierre Bourdieu, le français ou Sigmund Bauman, un excellent sociologue polonais —La Pologne, terre de tant d’éminents intellectuels et de si merveilleux artistes ! »
Et il continue ce discours, il continue à nous perdre en reprenant à son compte une pensée de ce sociologue polonais dont personne ici au Soudan ne sait vraiment s’il a jamais existé.
« Ce monsieur Bauman analysa si bien le siècle passé et le début du nôtre qu’il en déduisit l’idée généreuse qu’une société bonne est une société qui progresse pour être toujours meilleure.
Ce sont les portes d’un rêve ! Assurément.
Mais il faut se battre, malgré les leçons de l’Histoire récente, et continuer à croire en la nature humaine, en notre foi vraie et notre légitime combat pour notre cité bien aimée, pour notre terre. Et notre société progressera pour être toujours meilleure…
Il faut continuer à croire dans les exemples que sont pour nous les grandes figures des Écritures, croire en nos prophètes, croire que nous construisons le progrès avec nos lois et dans le respect de Dieu.