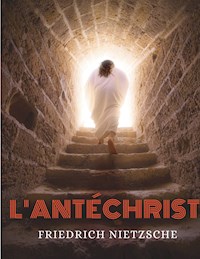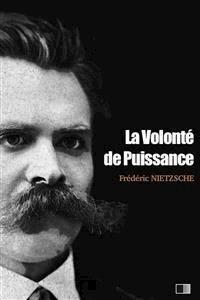
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
* Cet ebook bénéficie d'une mise en page optimisée pour la lecture numérique * Dans la veine de son célèbre Crépuscule des Idoles, ce recueil d’aphorismes qui ne fut jamais achevé par l’auteur — le projet initial fut abandonné en 1888 — visait à exposer l’ensemble de sa doctrine dans un ouvrage synthétique. L’existence même de ce livre suscita de vives polémiques et aujourd’hui encore la fiabilité de certains passages reste à prouver, des études philologiques récentes ayant mis à découvert de nombreuses erreurs que n’aurait pu commettre Frédéric Nietzsche. De quelque manière que cela soit, La Volonté de Puissance constitue une oeuvre singulière, tant sur le fond que sur la forme, dans laquelle le lecteur découvrira, ou retrouvera avec plaisir, le ton si caractéristique de ce philosophe hors-normes, qu’il soit par exemple question de la vive dénonciation du judéochristianisme ou de son profond rejet de tout humanisme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
La volonté de Puissance
Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)
Frédéric Nietzsche
Traduction parHenri Albert
Table des matières
Note de l’éditeur
Frédéric Nietzsche
Note du Traducteur
Esquisse d’un avant-propos
Livre premier
I. Nihilisme
II. Pour une critique de la modernité
III. Pour une théorie de la décadence
Livre deuxième
I. La religion comme expression de la décadence
II. La morale comme expression de la décadence
III. La philosophie comme expression de la décadence
Livre troisième
I. La volonté de puissance en tant que connaissance
II. La volonté de puissance dans la nature
III. La volonté de puissance en tant que morale
IV. Pour une physiologie de l'art
Livre quatrième
I. L’éternel retour
II. La nouvelle hiérarchie
III. Par-delà le bien et le mal
IV.L’idéal aristocratique
V. Dionysos
Note de l’éditeur
Dans la veine de son célèbre Crépuscule des Idoles, ce recueil d’aphorismes qui ne fut jamais achevé par l’auteur — le projet initial fut abandonné en 1888 — visait à exposer l’ensemble de sa doctrine dans un ouvrage synthétique. L’existence même de ce livre suscita de vives polémiques et aujourd’hui encore la fiabilité de certains passages reste à prouver, des études philologiques récentes ayant mis à découvert de nombreuses erreurs que n’aurait pu commettre Frédéric Nietzsche. De quelque manière que cela soit, La Volonté de Puissance constitue une oeuvre singulière, tant sur le fond que sur la forme, dans laquelle le lecteur découvrira, ou retrouvera avec plaisir, le ton si caractéristique de ce philosophe hors-normes, qu’il soit par exemple question de la vive dénonciation du judéochristianisme ou de son profond rejet de tout humanisme.
FVE
Frédéric Nietzsche
« Béni soit le gobelet qui veut déborder, d’où l’eau découle toute dorée, apportant partout le reflet de ta joie ! — »
Zarathustra.
Il est célèbre chez nous et on le connaît à peine. Nommé à tout propos, comme son précurseur Schopenhauer, il partage avec lui cette destinée étrange d’avoir son nom dans toutes les bouches, tout en restant entièrement ignoré. On cite à tout propos ses aphorismes mal compris et son œuvre se cache encore dans les ténèbres de l’inconnu.
En Allemagne, Nietzsche est en train de devenir auteur de bibliothèques. Trop longtemps on voulut faire silence autour de lui ; le nombre de ses adhérents grandissait toujours davantage, mettant en brèche les milieux académiques les plus récalcitrants et maintenant tout le monde l’a lu, si même on ne l’a saisi qu’imparfaitement. Par les soins pieux de Mme Elisabeth Foerster-Nietzsche qui consacre sa vie toute entière aux idées de son frère, les œuvres complètes du philosophe sont en train de paraître. Elles se composeront de huit volumes munis de notes et de variantes, auxquels succéderont plusieurs volumes d’œuvres posthumes, divisées en trois parties, d’après les trois périodes littéraires de Nietzsche (I des appendices à la Naissance de la Tragédie ; des conférences sur L’Avenir de nos établissements pédagogiques. II la vérité et le mensonge au sens extra-moral ; la philosophie de la période tragique des Grecs ; nous autres philologues, etc. III des suppléments et des projets de nouvelles parties de Zarathustra et la première ébauche de la dépréciation de toutes les valeurs.). MM. Fritz Koegel et Ed. von der Hellen ont été chargés de classer les matières de ces volumes. Deux ouvrages sur Nietzsche compléteront l’édition complète : La Vie de Fr. Nietzsche en deux volumes, avec des lettres et d’autres documents personnels, publiés par Mme Foerster-Nietzsche et l'Œuvre de Nietzche, par M. Fritz Koegel. L’autobiographie Ecce Homo écrite par Nietzsche lui-même en 1888 sera incorporé dans ces deux ouvrages.
Quatre volumes des œuvres complètes viennent de paraître, les quatre autres seront publiés encore dans le courant de cette année. Seul le huitième, par la nouveauté de ses matières, offrira un intérêt particulier. Il contiendra deux opuscules jusqu’à présent inconnus du grand public : Nietzsche contra Wagner et l’Antéchrist ; l’un donnera définitivement le point de vue de Nietzsche à l’égard de Wagner, l’autre ses principaux arguments dans sa lutte contre la morale chrétienne.
… La France, elle aussi aura bientôt son Nietzsche — en traduction. « Dans cette France de l’esprit qui est aussi la France du pessimisme » le philosophe aurait voulu naître. « Je ne suis qu’un hasard en Allemagne », disait-il, « — les Allemands n’ont pas de doigts pour nous, ils n’ont en général pas de doigts, ils n’ont que des pattes. » et il se demandait parfois pourquoi il écrivait encore en allemand. Etrange aveuglement du génie ! Que serait Nietzsche sans sa langue, sans cette langue allemande qu’il savait modeler si admirablement, cette langue qu’il avait fait revivre sous sa pensée. Traduites, ses œuvres perdront beaucoup de leur fraîcheur, elles seront des fleurs séchées, aux couleurs pâlies, où l’on cherchera en vain la finesse des lignes et les inflexions gracieuses. Ses idées resteront ; elles dureront encore, quand nous tous et ce qui nous entoure sera oublié dès longtemps. Mais leur terrain véritable est la France, comme aussi le terrain véritable pour Richard Wagner a été, d’une façon bien un peu posthume, la France. « Un fait reste certain pour tous ceux qui connaissent le mouvement de la culture européenne : le Romantisme français et Richard Wagner s’appartiennent de la façon la plus étroite. Tous dominés par la littérature jusque dans leurs yeux et leurs oreilles — les premiers artistes de l’Europe d’une culture littéraire universelle — eux-mêmes, pour la plupart, écrivains, poètes, interprètes et intervertisseurs des sens et des arts, tous fanatiques de l’expression, grands explorateurs dans le domaine du sublime, du laid et de l’horrible aussi, plus grands explorateurs encore dans l’art de l’effet, dans l’art d’attirer et de tirer l’œil, tous avec des talents dépassant de beaucoup leur génie — virtuoses de part en part, avec de mystérieuses approches vers tout ce qui séduit, attire, contraint et renverse, ennemis nés de la logique et de la ligne droite, avides de l’étrange, de l’exotique et de l’immense, tentés par tous les opiats des sens et de la raison. En résumé, un genre d’artistes intrépides et aventureux, superbes et violents, montant très haut avec des attractions très hautes ; un genre d’artiste qui devait enseigner à son siècle — c’est le siècle des masses — ce que signifie le terme « artiste ». Mais malade… »
Ecrire la psychologie de ces artistes malades, remonter à la genèse de leur développement, décomposer la morale de leur époque — le principe de la décadence — édifier l’idéal de force qui les guérira, tel sera l’œuvre de Nietzsche. Chez nous il choquera dès le début notre wagnérisme excessif, on ne comprendra pas pourquoi le philosophe s’est séparé du maître de Bayreuth, pourquoi il craignait l’influence. Séparation cruelle qui devait le faire souffrir toute sa vie ! Wagner est pour Nitezsche le type surélevé de cette génération d’artistes qu’il admire et qu’il craint en même temps, de cette fascinante mollesse qui berce et enveloppe. Raison de plus pour garder un fond de sympathie, même dans les attaques les plus violentes. En une admirable page de la Gaie Science, l’auteur de Zarathustra raconte l’ « Amitié d’Etoile » qui le rattache à Wagner. On entreverra peut-être toute la piété que cachent ces lignes.
« Nous étions amis et nous sommes devenus l’un pour l’autre des étrangers. Mais cela est bien ainsi et nous ne voulons ni nous le cacher ni nous le voiler, comme si nous devions en avoir honte. Nous sommes deux vaisseaux dont chacun a son but et sa route ; nous pouvons nous croiser et célébrer une fête ensemble, comme nous l’avons déjà fait, — et ces braves vaisseaux étaient si calmes dans un seul port, sous un seul soleil, et l’on pouvait croire qu’ils étaient à leur but déjà, qu’ils n’avaient eu qu’un seul but commun. Mais alors la force toute puissante de notre tâche nous a séparés dans des mers différentes, sous d’autres rayons de soleil et peut-être ne nous reverrons-nous plus jamais, — ou peut-être nous reverrons-nous, mais ne nous reconnaîtrons-nous point : les mers et les soleils différents nous ont transformés ! Qu’il fallût que nous devenions étrangers, voici la loi au-dessus de nous et c’est par quoi nous nous devons du respect, par quoi sera sanctifiée davantage encore le souvenir de notre amitié de jadis ! II y a probablement une énorme courbe invisible, une route stellaire, où nos voies et nos buts différents se trouvent inscrits comme de petits chemins à parcourir, — élevons-nous à cette pensée ! Mais notre vie est trop courte et notre faculté de voir trop faible pour que nous puissions être plus que des amis dans le sens de cette altière possibilité. — Et ainsi nous voulons croire à notre amitié d’étoile, même s’il faut que nous soyons ennemis sur la terre. »
Je ne connais pas d’endroit plus tranquille que cette petite ville de Naumbourg-sur-Saale, avec son horizon de collines boisées, ses vieilles maisons et ses vieilles églises, ses promenades et ses jardins, avec sa ceinture de coquettes villas sans bruit. Des gens de robes et des militaires retraités y mènent leur existence paisible. Le matin des chants de vieux cantiques vous réveillent : des écoliers pauvres, en longues soutanes noires, traversent les rues en files, faisant la quête chez les habitants au son de leurs lentes psalmodies. C’était ainsi il y a trois cents ans déjà, au temps de Luther ; ce sera ainsi longtemps encore. Seule une petite garnison — saurait-il ne pas y en avoir dans une ville de Prusse — met un peu d’animation dans cette cité morte. De temps en temps la locomotive d’un tramway à vapeur qui relie la ville aux bords de la Saale et à la gare fait entendre son bruit strident, et deux ou trois wagons traversent les rues très lentement, comme pour ne pas troubler les rêveries des passants, absents d’ailleurs.
Là vit Frédéric Nietzsche, le moraliste de la décadence, calme, sans souffrance et sans pensée. Sa mère, veuve de pasteur luthérien, l’entoure de ses soins. Personne à Naumbourg ne le connaît autrement que comme le fils de la Frau Pastor, l’ancien professeur de Bâle. Qui donc saurait ce que c’est que Zarathustra ? Et quand, pour prendre l’air, le malade traverse la rue à petits pas, on s’incline respectueusement — instinctivement peut-être, sans comprendre… Il a eu cinquante ans il y a quelques jours. Aucun journal n’a parlé de cet anniversaire. Le monde l’a ignoré, mais les soins pieux de sa mère ont dû tâcher de lui rendre cette journée plus douce encore que les autres. Car tout se fait avec piété dans la famille Nietzsche.
À quelques pas de là, dans une rue plus écartée encore, se trouve le Nietzsche-Archiv, où deux archivistes travaillent sans cesse, sous la direction de la sœur du philosophe, à la publication de ses œuvres complètes. Le cœur me battait en montant les marches. Mais quand, assis dans le petit salon de Mme Foerster, ou circulant dans les vastes pièces du Nietzsche-Archiv, en train de feuilleter la bibliothèque et les papiers, de regarder les photographies du maître, nous causions de l’absent, une quiétude me revenait, une quiétude presque religieuse et un sentiment de profond respect devant la résignation de cette femme qui avait mis toute son énergie au service d’une cause si amère. Elle me disait la douceur de son frère, douceur mêlée, aux heures de santé, d’une joie exubérante. Il avait toujours gardé, lui le grand adversaire du Christ, les allures du presbytère luthérien. Son esprit s’attaquait avec une joie tragique aux préjugés religieux et moraux, son âme avait suivi la pente de douceur d’une vieille religiosité. « Vous devez être le plus heureux des hommes », disaient les vieilles femmes du pays, quand, à de longs intervalles, Nietzsche revenait remplir de sa joie la maison paternelle.
Quand, après avoir causé longtemps, pendant des heures, de lui, toujours de lui, je reprenais le train pour Berlin, sans cesse je songeais à la destinée poignante de celui qui marquera de son empreinte le siècle prochain, du génie religieux dont l’esprit vécut des choses surhumaines…
Le train roule à toute vapeur à travers les plaines désolées de la Marche — tournant le dos à Naumbourg la souriante — et toujours me reviennent les paroles des vieilles de là-bas : — Mort de pensée, mais « le plus heureux des hommes ! »
Henri Albert. Berlin, 18 octobre 1894.
Note du Traducteur
La présente traduction a été faite sur l'édition originale allemande, quinzième volume des Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche, publié en novembre 1901, chez C. G. Naumann à Leipzig, par les soins du " Nietzsche-Archiv ".
Nous nous en sommes tenus strictement au texte établi par les éditeurs d'après les manuscrits de Nietzsche. Pour ces Etudes et Fragments, plus encore que pour les autres volumes du philosophe, nous avons eu souci d'une littéralité aussi grande que possible. Mais les idées qui y sont exprimées sont maintenant assez familières au lecteur français pour que les passages, même les plus obscurs en apparence, lui soient intelligibles.
Il nous a semblé que les quelques variantes et indications philologiques, données en appendice par le " Nietzsche-Archiv ", n'ajouteraient rien, à la compréhension de l'œuvre capitale du philosophe, nous les avons donc supprimées, ainsi que les notes matérielles concernant les manuscrits.
Esquisse d’un avant-propos
1.
Les grandes choses exigent que l’on s’en taise, ou qu’on en parle avec grandeur : avec grandeur, c’est-à-dire avec cynisme et innocence.
2.
Ce que je raconte, c’est l’histoire des deux siècles qui vont venir. Je décris ce qui va venir, ce qui ne saurait plus venir autrement : la montée du nihilisme. Cette page d’histoire peut être contée dès maintenant : car, dans le cas présent, la nécessité elle-même est à l’œuvre. Cet avenir parle déjà par la voix de cent signes et présages, cette fatalité s’annonce partout ; pour entendre cette musique de l’avenir toutes les oreilles sont déjà tendues. Notre civilisation européenne tout entière s’agite depuis longtemps sous une pression qui va jusqu’à la torture, une angoisse qui grandit de dix ans en dix ans, comme si elle voulait provoquer une catastrophe : inquiète, violente, emportée, semblable à un fleuve qui veut arriver au terme de son cours, qui ne réfléchit plus, qui craint de réfléchir.
3.
— Celui qui prend ici la parole n’a, au contraire, rien fait jusqu’à présent, si ce n’est réfléchir et se recueillir : en philosophe et en solitaire par instinct, qui a trouvé son avantage dans la vie en dehors, à l’écart, dans la patience, l’ajournement et le retard ; tel un esprit hasardeux et téméraire qui souvent s’est égaré dans tous les labyrinthes de l’avenir, tel un oiseau prophétique qui regarde en arrière lorsqu’il raconte ce qui est l’avenir, premier nihiliste parfait de l’Europe, mais qui lui-même a déjà surmonté le nihilisme, l’ayant vécu dans son âme — le voyant derrière lui, au-dessous de lui, en dehors de lui.
4.
Car il ne faut pas se méprendre sur le sens du titre que veut prendre l’évangile de l’avenir. " La Volonté de Puissance. Essai d’une transmutation de toutes les valeurs " — dans cette formule s’exprime un contre-mouvement, par rapport au principe et à la tâche ; un mouvement qui, dans un avenir quelconque, remplacera ce nihilisme complet ; mais qui en admet la nécessité, logique et psychologique ; et ne peut absolument venir qu’après lui et par lui. Car pourquoi la venue du nihilisme est-elle dès lors nécessaire ? Parce que ce sont nos valeurs elles-mêmes, celles qui ont eu cours jusqu’à présent, qui, dans le nihilisme, tirent leurs dernières conséquences ; parce que le nihilisme est le dernier aboutissant logique de nos grandes valeurs et de notre idéal ; parce qu’il nous faut d’abord traverser le nihilisme, pour nous rendre compte de la vraie valeur de ces " valeurs " dans le passé… Quel que soit ce mouvement, nous aurons un jour besoin de valeurs nouvelles…
Livre premier
Le nihilisme européen
1.
Un plan
Voici venir la contradiction entre le monde que nous vénérons et le monde que nous vivons, que nous sommes. Il nous reste, soit à supprimer notre vénération, soit à nous supprimer nous-mêmes. Le second cas est le nihilisme.
1. Le nihilisme montant, en théorie et en pratique. Dérivation vicieuse de celui-ci (pessimisme, ses espèces : prélude du nihilisme, bien qu’inutile).
2. Le christianisme succombant à sa morale. " Dieu est la vérité " ; " Dieu est l’amour " ; le " Dieu juste ". — Le plus grand événement — " Dieu est mort "— sourdement pressenti.
3. La morale, dès lors privée de sa sanction, ne sait plus se soutenir d’elle-même. On finit par laisser tomber l’interprétation morale — (mais le sentiment est encore saturé des résidus d’évaluations chrétiennes — ).
4. C’est sur des jugements moraux qu’a jusqu’à présent reposé la valeur, avant tout la valeur de la philosophie (de " la volonté du vrai " — ). (L’idéal populaire du " sage ", du " prophète ", du " saint " est tombé en désuétude.)
5. Tendances nihilistes dans les sciences naturelles (" absurdité " — ) ; causalisme, mécanisme. La conformité aux lois est un intermède, un résidu.
6. De même en politique : la croyance en son bon droit fait défaut, l’innocence ; le mensonge règne, l’asservissement au moment.
7. De même en économie politique : la suppression de l’esclavage, l’absence d’une caste rédemptrice, d’un justificateur, — l’avènement de l’anarchiste. " Éducation " ?
8. De même en histoire : le fatalisme, le darwinisme ; la dernière tentative pour l’interpréter dans un sens raisonnable et divin a échoué. La sentimentalité devant le passé ; on ne supporterait pas de biographie ! -
9. De même en art : le romantisme et son contre-coup (la répugnance contre l’idéal romantique et son mensonge). Celui-ci est moral, il a le sens d’une grande véracité, mais il est pessimiste. Les " artistes " purs (indifférents vis-à-vis du sujet). (Psychologie de confesseur et psychologie de puritain, deux formes du romantisme psychologique : mais aussi leur opposé, la tentative de considérer " l’homme " du point de vue purement artistique, — là encore on n’ose pas l’évaluation contraire !).
10. Tout le système européen des aspirations humaines a conscience de son absurdité ou encore de son " immoralité ". Probabilité d’un nouveau bouddhisme. Le plus grand danger. — " Quels sont les rapports entre la véracité, l’amour, la justice et le monde véritable ? " Il n’y en a point ! -
I. Nihilisme
2.
a) Le nihilisme, une condition normale.
Nihilisme : le but fait défaut ; la réponse à la question " pourquoi ? " — Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se déprécient.
Il peut être un signe de force, la vigueur de l’esprit peut s’être accrue au point que les fins que celui-ci voulut atteindre jusqu’à présent ("convictions ", " articles de foi ") paraissent impropres ( — : car une foi exprime généralement la nécessité de conditions d’existence, une soumission à l’autorité d’un ordre de choses qui fait prospérer et croître un être, lui fait acquérir de la force… ) ; d’autre part le signe d’une force insuffisante à s’ériger un but, une raison d’être, une foi.
Il atteint le maximum de sa force relative comme force violente de destruction : comme nihilisme actif. Son opposé pourrait être le nihilisme fatigué qui n’attaque plus : sa forme la plus célèbre est le bouddhisme, qui est un nihilisme passif, avec des signes de faiblesse ; l’activité de l’esprit peut être fatiguée, épuisée, en sorte que les fins et les valeurs préconisées jusqu’à présent paraissent impropres et ne trouvent plus créance, en sorte que la synthèse des valeurs et des fins (sur quoi repose toute culture solide) se décompose et que les différentes valeurs se font la guerre : une désagrégation… ; alors tout ce qui soulage, guérit, tranquillise, engourdit, vient au premier plan, sous des travestissements divers, religieux ou moraux, politiques ou esthétiques, etc.
Le nihilisme représente un état pathologique intermédiaire ( — pathologique est l’énorme généralisation, la conclusion qui n’aboutit à aucun sens — ) : soit que les forces productrices ne soient pas encore assez solides, — soit que la décadence hésite encore et qu’elle n’ait pas encore inventé ses moyens.
b) Condition de cette hypothèse.
Qu’il n’y a point de vérité ; qu’il n’y a pas de modalité absolue des choses, pas de " chose en soi ". — Cela même n’est que du nihilisme, et le nihilisme le plus extrême. Il fait consister la valeur des choses précisément en ceci qu’aucune réalité ne correspond et n’a correspondu à ces valeurs, mais qu’elles ne sont qu’un symptôme de force du côté des taxateurs, une simplification en vue de la vie.
3.
La question du nihilisme " à quoi bon ? " part de l’usage qui fut courant jusqu’ici, grâce auquel le but semblait fixé, donné, exigé du dehors — c’est-à-dire par une quelconque autorité supra-humaine. Lorsque l’on eut désappris de croire en celle-ci, on chercha, selon un ancien usage, une autre autorité qui sût parler un langage absolu et commander des fins et des tâches. L’autorité de la conscience est maintenant en première ligne un dédommagement pour l’autorité personnelle (plus la morale est émancipée de la théologie, plus elle devient impérieuse). Ou bien c’est l’autorité de la raison. Ou l’instinct social (le troupeau). Ou encore l’histoire avec son esprit immanent, qui possède son but en elle et à qui l’on peut s’abandonner. On voudrait tourner le vouloir, la volonté d’un but, le risque que l’on pourrait courir en se donnant un but à soi-même ; on voudrait se décharger de la responsabilité ( — on accepterait le fatalisme). Enfin : le bonheur, et, avec un peu de tartuferie, le bonheur du plus grand nombre.
On se dit :
1) un but déterminé n’est pas du tout nécessaire ;
2) il n’est pas possible de prévoir ce but.
Maintenant que la volonté serait nécessaire dans son expression la plus forte, elle est justement la plus faible et la plus pusillanime. Méfiance absolue à l’égard de la force organisatrice de la volonté d’ensemble.
Époque où toutes les appréciations " intuitives " viennent, les unes après les autres, au premier plan, comme si par elles on pouvait obtenir une direction dont on est privé autrement.
" A quoi bon ? " — On exige une réponse 1) de la conscience, 2) de l’instinct de bonheur, 3) de " l’instinct social " (troupeau), 4) de la raison (" esprit "), — pourvu que l’on ne soit pas obligé de vouloir, de se fixer une raison à soi-même.
Ensuite le fatalisme : " il n’y a point de réponse ", mais " nous allons quelque part ", " il est impossible de vouloir une fin ", — avec résignation… ou révolte… Agnosticisme par rapport au but.
Ensuite la négation considérée comme explication de la vie ; la vie considérée comme quelque chose qui se conçoit sans valeur et qui finit par se supprimer.
4.
Le signe le plus général des temps modernes : l’homme a perdu, à ses propres yeux, infiniment de dignité. Il a longtemps été le centre et le héros tragique de l’existence, en général ; puis il s’est efforcé d’affirmer du moins sa parenté avec la portion décisive de l’existence qui possédait sa valeur par elle-même — comme font tous les métaphysiciens qui veulent maintenir la dignité de l’homme, avec leur croyance que les valeurs morales sont des valeurs cardinales. Celui qui a abandonné Dieu tient avec d’autant plus de sévérité à la croyance en la morale.
5.
Critique du nihilisme
Le nihilisme, en tant que condition psychologique, apparaîtra, premièrement, lorsque nous nous sommes efforcés de donner à tout ce qui arrive un " sens " qui ne s’y trouve pas : en sorte que celui qui cherche finit par perdre courage. Le nihilisme est alors la connaissance du long gaspillage de la force, la torture qu’occasionne cet " en vain ", l’incertitude, le manque d’occasion de se refaire de quelque façon que ce soit, de se tranquilliser au sujet de quoi que ce soit — la honte de soi-même, comme si l’on s’était dupé trop longtemps… Ce sens aurait pu être : l’" accomplissement " d’un canon moral supérieur dans tout ce qui est arrivé, le monde moral ; ou l’augmentation de l’amour et de l’harmonie dans les rapports entre les êtres ; ou la réalisation partielle d’une condition de bonheur universel ; ou même la mise en marche vers un néant universel — un but, quel qu’il soit, suffit à prêter un sens. Toutes ces conceptions ont cela de commun qu’elles veulent atteindre quelque chose par le processus lui-même : — et l’on s’aperçoit maintenant que par ce " devenir " rien n’est réalisé, rien n’est atteint… C’est donc la déception au sujet d’un prétendu but du devenir qui est la cause du nihilisme : soit que cette déception se rapporte à un but tout à fait déterminé, soit que, d’une façon générale, on s’aperçoive que toutes les hypothèses d’un but émises jusqu’ici par rapport à l’ "évolution tout entière " sont insuffisantes ( — l’homme n’apparaît plus comme le collaborateur, et, moins encore, comme le centre du devenir.
Le nihilisme, en tant que condition psychologique, apparaîtra en deuxième lieu lorsque l’on aura mis une totalité, une systématisation, et même une organisation dans tout ce qui arrive et au-dessus de tout ce qui arrive, en sorte que l’âme assoiffée de respect et d’admiration nagera dans l’idée d’une domination et d’un gouvernement supérieurs ( — si c’est l’âme d’un logicien, l’enchaînement des conséquences et la réalité absolue suffiront à tout concilier…). Une façon d’unité, une forme quelconque du " monisme " : et, par suite de cette croyance, l’homme dans un sentiment de profonde connexion et de profonde dépendance vis-à-vis d’un tout qui lui est infiniment supérieur, un mode de la divinité… " Le bien de la totalité exige l’abandon de l’individu "… Or, il n’existe pas de pareille totalité ! Au fond l’homme a perdu la croyance en sa valeur, dès que ce n’est pas un tout infiniment précieux qui agit par lui : ce qui revient à dire qu’il a conçu ce tout, afin de pouvoir donner créance à sa propre valeur.
Le nihilisme, en tant que condition psychologique, possède encore une troisième et dernière forme. Étant donnés ces deux jugements : à savoir que par le devenir rien ne doit être réalisé, et que le devenir n’est pas régi par une grande unité, où l’individu peut entièrement se perdre comme dans un élément d’une valeur supérieure : il reste le subterfuge de condamner ce monde du devenir tout entier, parce qu’il est illusion, et d’inventer un monde qui se trouve au-delà de celui-ci, un monde qui sera le monde-vérité. Mais dès que l’homme commence à s’apercevoir que ce monde n’a été édifié que pour répondre à des nécessités psychologiques et qu’il n’y a absolument aucun droit, une forme suprême du nihilisme commence à naître, une forme qui embrasse la négation d’un monde métaphysique, — qui s’interdit la croyance en un monde-vérité. En se plaçant à ce point de vue, on admet la réalité du devenir comme seule réalité, on se défend toute espèce de chemin détourné qui mène à l’au-delà et à de fausses divinités — mais on ne supporte pas ce monde-ci, bien que l’on ne veuille pas le nier…
— Qu’est-il arrivé en somme ? Le sentiment de la non-valeur était réalisé, mais on comprit que l’on ne pouvait interpréter le caractère général de l’existence ni par l’idée du " but ", ni par l’idée de "I’unité", ni par l’idée de "vérité ". Rien n’est atteint et obtenu par là ; l’unité qui intervient dans la multiplicité des événements fait défaut : le caractère de l’existence n’est pas " vrai ", il est faux…, on n’a décidément plus de raison de se persuader de l’existence d’un monde-vérité… En un mot, les catégories : " cause finale ", " unité ", " être ", par quoi nous avons prêté une valeur au monde, sont retirées par nous — et dès lors le monde a l’air d’être sans valeur…
En admettant que nous ayons reconnu comment le monde ne peut plus être interprété par ces trois catégories, et qu’après cet examen le monde commence à être sans valeur pour nous, il faudra nous demander d’où nous vient cette croyance en ces trois catégories. — Essayons s’il n’est pas possible de leur refuser créance, à elles ! Lorsque nous aurons déprécié ces trois catégories, la démonstration de l’impossibilité de les appliquer au monde n’est plus une raison suffisante à déprécier le monde.
— Résultat : la croyance aux catégories de la raison est la cause du nihilisme, — nous avons mesuré la valeur du monde d’après des catégories qui se rapportent à un monde purement fictif.
— Conclusion : toutes les valeurs par quoi nous avons essayé jusqu’à présent de rendre le monde estimable pour nous, et par quoi nous l’avons précisément déprécié lorsqu’elles se montrèrent inapplicables — toutes ces valeurs sont, au point de vue psychologique, les résultats de certaines perspectives d’utilité, établies pour maintenir et augmenter les terrains de domination humaine : mais projetées faussement dans l’essence des choses. C’est toujours la naïveté hyperbolique de l’homme qui le fait se considérer lui-même comme le sens et la mesure des choses…
6.
Proposition principale. — En quel sens le nihilisme complet est la conséquence nécessaire de l’idéal actuel.
— Le nihilisme incomplet, ses formes : nous vivons au milieu de lui.
— Les tentatives pour éviter le nihilisme, sans transmuer ces valeurs, provoquent le contraire, amènent le problème à un état aigu.
7.
Toute évaluation purement morale (comme par exemple l’évaluation bouddhiste) aboutit au nihilisme : il faut aussi s’attendre à sa venue pour ce qui est de l’Europe ! On croit pouvoir s’en tirer avec un moralisme sans arrière-plan moral : mais par là le chemin du nihilisme est nécessairement ouvert. — La contrainte qui nous force, nous, à nous considérer comme taxateurs de valeurs, n’existe pas dans la religion.
8.
Rien n’est plus dangereux qu’un objet de désirs contraire à l’essence de la vie. La conclusion nihiliste (la croyance à la non-valeur) conséquence de l’évaluation morale : — nous avons perdu le goût de l’égoïsme (quand même nous aurions compris qu’il n’existe pas d’acte non égoïste) ; nous avons perdu le goût de la nécessité (quand même nous aurions reconnu l’impossibilité d’un libre arbitre et d’une " liberté intelligible "). Nous nous apercevons que nous ne pouvons atteindre la sphère où nous avons placé nos valeurs — mais, par ce fait, l’autre sphère, celle où nous vivons, n’a nullement gagné en valeur : au contraire, nous sommes fatigués, parce que nous avons perdu notre principal stimulus. " En vain, jusqu’à présent ! "
9.
Le nihilisme radical c’est la conviction d’un absolu manque de solidité de l’existence, lorsqu’il s’agit des valeurs supérieures que l’on reconnaît ; à quoi s’ajoute la connaissance que nous n’avons pas le moindre droit de fixer un au-delà ou un " en soi " des choses.
Cette connaissance est la suite de " l’esprit véridique " qui a grandi en nous : c’est donc aussi une conséquence de la foi en la morale. — Voici l’antinomie : en tant que nous croyons à la morale, nous condamnons l’existence. — La logique du pessimisme poussée jusqu’aux extrêmes limites du nihilisme : qu’est-ce qui est le principe agissant ? — Notion du manque de valeur, du manque de sens : comment les évaluations morales se trouvent derrière toutes les autres valeurs supérieures.
— Résultat : les évaluations morales ont des condamnations, des négations, la morale éloigne de la volonté de vivre… Problème : mais qu’est-ce que la morale ?
10.
Le nihilisme européen
Quels avantages offrait l’hypothèse de la morale chrétienne ?
1) elle prêtait à l’homme une valeur absolue, en opposition avec sa petitesse et son accidence dans le fleuve du devenir et de la disparition ;
2) elle servait les avocats de Dieu, en ce sens qu’elle laissait au monde, malgré la misère et le mal, le caractère de la perfection — y compris la fameuse " Liberté " — : le mal apparaissait plein de sens ;
3) elle admettait que l’homme possède un savoir particulier au sujet des valeurs absolues et lui donnait ainsi, pour ce qui importait le plus, une connaissance adéquate ;
4) elle évitait à l’homme de se mépriser, en tant qu’homme, de prendre partie contre la vie, de désespérer de la connaissance : elle était un moyen de conservation.
En résumé : la morale était le grand antidote contre le nihilisme pratique et théorique.
Mais, parmi les forces que la morale a nourries, se trouvait la véracité : celle-ci finit par se tourner contre la morale, elle découvre sa téléologie, sa considération intéressée, et maintenant l’intelligence de ce mensonge longtemps incarné et dont on désespère de se débarrasser agit précisément comme stimulant. Nous constatons sur nous, implantés par la longue interprétation morale, des besoins qui nous apparaissent dès lors comme des exigences de non-vérité : d’autre part, ce sont les besoins, à quoi la valeur semble attachée, à cause desquels nous supportons de vivre. Nous n’estimons point ce que nous connaissons et n’osons plus estimer ce par quoi nous aimerions nous faire illusion : — de cet antagonisme résulte un processus de décomposition.
De fait, nous n’avons plus besoin d’un antidote contre le premier nihilisme : dans notre Europe, la vie n’est plus incertaine, hasardeuse, insensée à un tel point. L’élévation de la valeur de l’homme, de la valeur du mal, etc., à une puissance si énorme, n’est plus nécessaire maintenant, nous supportons une réduction importante de cette valeur, nous admettons la part du non-sens, du hasard : la puissance atteinte par l’homme permet maintenant un abaissement des moyens de discipline dont l’interprétation morale fut le coté fort. " Dieu " est une hypothèse beaucoup trop extrême.
Cependant les positions extrêmes ne sont pas relevées par des positions plus modérées, mais par d’autres également extrêmes, seulement ce sont des positions à rebours. C’est ainsi que la croyance en l’immoralité absolue de la nature, le manque de but et de sens devient la passion psychologiquement nécessaire, lorsque la foi en Dieu et un ordre essentiellement moral n’est plus soutenable. Le nihilisme apparaît maintenant, non point parce que le déplaisir de l’existence est devenu plus grand qu’autrefois, mais parce que, d’une façon générale, on est devenu méfiant à l’égard de la " signification " qu’il peut y avoir dans le mal, ou même dans l’existence. Une seule interprétation a été ruinée : mais comme elle passait pour la seule interprétation, il pourrait sembler que l’existence n’eût aucune signification et que tout fût en vain.
Il reste à démontrer que cet " en vain " est le caractère de notre nihilisme actuel. La méfiance de nos évaluations antérieures s’accentue jusqu’à oser la question : " Toutes les " valeurs " ne sont-elles pas des moyens de séduction, pour faire traîner la comédie en longueur, mais sans que le dénouement approche ? " Cette durée, avec un " en vain ", sans but ni raison, paralysante, surtout lorsque l’on comprend que l’on est dupé, sans avoir la force de ne pas se laisser duper.
Imaginons cette idée sous la forme la plus terrible : l’existence telle qu’elle est, sans signification et sans but, mais revenant sans cesse d’une façon inévitable, sans un dénouement dans le néant : " l’Éternel Retour ".
C’est là la forme extrême du nihilisme : le néant (le " non-sens ") éternel !
Forme européenne du bouddhisme : l’énergie du savoir et de la force contraint à une pareille croyance. C’est la plus scientifique de toutes les hypothèses possibles. Nous nions les causes finales : si l’existence tendait à un but ce but serait atteint.
On comprend que ce à quoi on vise ici est en contradiction avec le panthéisme : car l’affirmation que " tout est parfait, divin, éternel ", force également à admettre " l’éternel retour ". Question : cette position affirmative et panthéiste en face de toutes choses est-elle rendue impossible par la morale ? En somme, c’est seulement le Dieu moral qui a été surmonté. Cela a-t-il un sens d’imaginer un Dieu " par delà le bien et le mal " ? Un panthéisme dirigé dans ce sens serait-il imaginable ? Supprimons-nous l’idée de but dans le processus et affirmons-nous le processus malgré cela ? — Ce serait le cas si, dans le cercle de ce processus, à chaque moment de celui-ci, quelque chose était atteint — et que ce soit toujours la même chose. Spinoza a conquis une pareille position affirmative, en ce sens que, pour lui, chaque moment a une nécessité logique : et il triomphe d’une pareille conformation du monde au moyen de son instinct logique fondamental.
Mais le cas de Spinoza n’est qu’un cas particulier. Tout trait de caractère fondamental, formant la base de tous les faits, s’exprimant dans tous les faits, chaque fois qu’il serait considéré par un individu comme son trait fondamental à lui, devrait pousser cet individu à approuver triomphalement chaque moment de l’existence universelle. Il importerait précisément que ce trait de caractère fondamental produisît chez soi-même une impression de plaisir, qu’on le ressentit comme bon et précieux.
Or, la morale a protégé l’existence contre le désespoir et le saut dans le néant chez les hommes et les classes qui étaient violentés et opprimés par d’autres hommes : car c’est l’impuissance en face des hommes et non pas l’impuissance en face de la nature qui produit l’amer désespoir de vivre. La morale a traité en ennemis les hommes autoritaires et violents, les " maîtres " en général, contre lesquels le simple devrait être protégé, c’est-à-dire avant tout encouragé et fortifié. Par conséquent la morale a enseigné à haïr et à mépriser ce qui forme le trait de caractère fondamental des dominateurs : leur volonté de puissance. Supprimer, nier, décomposer cette morale : ce serait regarder l’instinct le plus haï avec un sentiment et une évaluation contraires. Si l’opprimé, celui qui souffre, perdait la croyance en son droit à mépriser la volonté de puissance, sa situation serait désespérée. Pour qu’il en soit ainsi il faudrait que ce trait fût essentiel à la vie et que l’on pût démontrer que, dans la volonté morale, cette " volonté de puissance " n’était que dissimulée, cette haine et ce mépris n’étant eux-mêmes qu’une manifestation de celle-ci. L’oppressé se rendrait alors compte qu’il se trouve sur le même terrain que l’oppresseur et qu’il ne possède pas de privilège, pas de rang supérieur sur celui-ci.
Bien au contraire ! Il n’y a rien dans la vie qui puisse avoir de la valeur, si ce n’est le degré de puissance — à condition bien entendu que la vie elle-même soit la volonté de puissance. La morale préservait les déshérités contre le nihilisme, en prêtant à chacun une valeur infinie, une valeur métaphysique, en le rangeant dans un ordre qui ne correspondait pas à la puissance terrestre, à la hiérarchie du monde : elle enseignait la soumission, l’humilité, etc. En admettant que la croyance en cette morale soit détruite, il s’ensuivrait que les déshérités seraient privés des consolations de cette morale — et qu’ils périraient.
Cette tendance d’aller à sa perte se présente comme la volonté de se perdre, comme le choix instinctif de ce qui détruit nécessairement. Le symptôme de cette auto-destruction des déshérités c’est l’auto-vivisection, l’empoisonnement, l’enivrement, le romantisme, avant tout la contrainte instinctive à des actes, par quoi l’on fait des puissants ses ennemis mortels ( — se dressant pour ainsi dire ses propres bourreaux), la volonté de destruction comme volonté d’un instinct plus profond encore, l’instinct de l’auto-destruction, la volonté du néant.
Le nihilisme est un symptôme : il indique que les déshérités n’ont plus de consolation ; qu’ils détruisent pour être détruits, que, détachés de la morale, ils n’ont plus de raison de " se résigner ", — qu’ils se placent sur le terrain du principe opposé, et qu’ils veulent aussi de la puissance de leur côté, en forçant les puissants à être leurs bourreaux. C’est là la forme européenne du bouddhisme, la négation active, par quoi la vie tout entière a perdu son " sens ".
Il ne faudrait pas croire que la " détresse " soit devenue plus grande : bien au contraire ! " Dieu, la morale, la résignation " étaient des remèdes sur des degrés de misère excessivement bas : le nihilisme actif se présente dans des conditions relativement bien plus favorables. Le fait même de considérer la morale comme surmontée implique un certain degré de culture intellectuelle ; celle-ci de son côté un bien-être relatif. Une certaine fatigue intellectuelle, poussée, par une longue lutte d’opinions philosophiques, jusqu’au scepticisme désespéré en face de toute philosophie, caractérise également le niveau, nullement inférieur, de ces nihilistes. Que l’on songe dans quelles conditions Bouddha entra en scène. La doctrine de l’Éternel Retour reposerait des hypothèses savantes (telles qu’en possédait la doctrine de Bouddha, par exemple l’idée de causalité, etc.).
Que signifie maintenant " déshérité " ? Il faut envisager la question avant tout au point de vue physiologique et non pas au point de vue politique. L’espèce d’hommes la plus malsaine en Europe (dans toutes les classes) forme le terrain de ce nihilisme : elle considérera la croyance à l’Éternel Retour comme une malédiction — lorsque l’on est frappé on ne recule plus devant aucune action. Elle voudra effacer, non seulement d’une façon passive, mais encore faire effacer tout ce qui est à ce point dépourvu de sens et de but. Bien que ce ne soit chez elle qu’un spasme, une fureur aveugle devant la certitude que tout cela existait de toute éternité — même ce moment de nihilisme et de destruction. La valeur d’une pareille crise, c’est qu’elle purifie, qu’elle réunit les éléments semblables et les fait se détruire les uns les autres, qu’elle assigne à des hommes d’idées opposées des tâches communes -mettant aussi en lumière, parmi eux, les faibles et les hésitants, et provoquant ainsi une hiérarchie des forces au point de vue de la santé ; qu’elle reconnaît pour ce qu’ils sont ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Naturellement en dehors de toutes les conventions sociales existantes.
Quels sont ceux qui s’y montreront les plus forts ? Les plus modérés, ceux qui n’ont pas besoin de dogmes extrêmes, ceux qui non seulement admettent, mais aiment aussi une bonne part de hasard, de non-sens. Ceux qui peuvent songer à l’homme, en réduisant quelque peu sa valeur, sans qu’ils se sentent par là diminués et affaiblis : les plus riches par rapport à la santé, ceux qui sont à la hauteur du plus grand malheur et qui, à cause de cela, ne craignent pas le malheur, — des hommes qui sont certains de leur puissance et qui, avec une fierté consciente, représentent la force à laquelle l’homme est parvenu.
Comment de pareils hommes songeraient-ils à l’Éternel Retour ?
11.
Les valeurs supérieures au service desquelles l’homme devrait vivre, surtout lorsqu’elles étendaient sur lui leurs lourdes mains : ces valeurs sociales, pour en renforcer le ton, comme si elles étaient des commandements de Dieu, on les a adressées au-dessus des hommes, telles des "réalités ", comme si elles étaient le " vrai " monde, l’espérance d’un monde à venir.
Maintenant que l’origine mesquine de ces valeurs nous apparaît clairement, l’univers par là nous semble déprécié, nous semble avoir perdu son " sens "… mais cela n’est qu’un état intermédiaire.
Point de vue principal. — Il ne faut pas voir la tâche de l’espèce supérieure dans la direction de l’espèce inférieure, comme fit par exemple Comte — ), mais il faut considérer l’espèce inférieure comme une base sur laquelle une espèce supérieure peut édifier sa propre tâche — une base nécessaire à sa croissance.
Les conditions qui permettent à une espèce forte et noble de se conserver (par rapport à la discipline intellectuelle) sont [à l’ ? ] opposé des conditions qui régissent la " masse industrielle ", les épiciers à la Spencer.
Ce qui n’est permis qu’aux natures les plus fortes et les plus fécondes, pour rendre leur existence possible — les loisirs, les aventures, l’incrédulité, les débauches même, — si c’était permis aux natures moyennes, les ferait périr nécessairement — et il en est ainsi en effet. L’activité, la règle, la modération, les " convictions " sont de mise, en un mot les " vertus du troupeau " : avec elles cette espèce d’hommes moyens atteint sa perfection.
Causes du nihilisme : 1) l’espèce supérieure fait défaut, c’est-à-dire celle dont la fécondité et la puissance inépuisables maintiennent la croyance en l’homme. (Que l’on songe à ce que l’on doit à Napoléon : presque tous les espoirs supérieurs de ce siècle.)
2) L’espèce inférieure, — " troupeau ", " masse ", " société " — désapprend la modestie et enfle ses besoins jusqu’à en faire des valeurs cosmiques et métaphysiques. Par là l’existence tout entière est vulgarisée : car, en tant que la masse gouverne, elle tyrannise les hommes d’exception, ce qui fait perdre à ceux-ci la foi en eux-mêmes et les pousse au nihilisme.
Toutes les tentatives pour imaginer des types supérieurs ont échoué (le " romantisme " ; l’artiste, le philosophe ; — contre la tentative de Carlyle de leur prêter des valeurs morales supérieures).
La résistance contre les types supérieurs comme résultat.
Abaissement et incertitude de tous les types supérieurs. La lutte contre le génie (" poésie populaire ", etc.). La compassion pour les humbles et ceux qui souffrent, comme étalon pour l’élévation de l’âme.
Le philosophe fait défaut, l’interprète de l’action, et non pas seulement celui qui transforme en poésie.
13.
En quel sens le nihilisme de Schopenhauer continue à être la conséquence d’un même idéal, créé par le théisme chrétien. — Si grand était le degré de certitude par rapport à l’objet du désir le plus élevé, par rapport aux valeurs supérieures et à la plus grande perfection, que les philosophes s’appuyaient dessus, comme sur une certitude absolue, sur une certitude a priori : avec Dieu au sommet comme vérité donnée. " Devenir l’égal de Dieu ", " se fondre en Dieu " — ce fut là, pendant des milliers d’années, l’objet du désir le plus naïf et le plus convaincu ( — mais une chose qui convainc, par là n’en est pas plus vraie : elle est seulement convaincante. Remarque destinée aux ânes).
On a désappris de prêter à cette fixation d’idéal une réalité personnelle : on est devenu athée. Mais a-t-on par là renoncé à l’idéal ? — Les derniers métaphysiciens cherchent en somme toujours dans celui-ci la " réalité " vraie, la " chose en soi ", par rapport à quoi tout le reste n’est qu’apparence. Ils érigent en dogme que, notre monde des apparences n’étant visiblement pas l’expression de cet idéal, il ne saurait être " vrai " — il ne saurait même pas remonter à ce monde métaphysique qu’ils considèrent comme cause. Il est impossible que l’inconditionné, en tant qu’il représente cette perfection supérieure, soit la raison de tout ce qui est conditionné. Schopenhauer, qui voulait qu’il en fut autrement, était forcé d’imaginer ce fond métaphysique comme antithèse à l’idéal, comme " volonté mauvaise et aveugle " : celui-ci pouvait être ainsi " ce qui apparaît ", ce qui se manifeste dans le monde des apparences. Mais par là il ne renonçait pas à cet absolu d’idéal…
(Kant semblait avoir besoin de l’hypothèse de la " liberté intelligible " pour décharger l’ens perfectum de sa responsabilité dans la façon dont est conditionné ce monde, en un mot pour expliquer le mal : une logique scandaleuse chez un philosophe…) La morale en tant qu’évaluation supérieure. Ou bien notre monde est l’œuvre et l’expression (le mode) d’un dieu : alors il faut qu’il soit d’une perfection suprême (conclusion de Leibniz… ) — et l’on ne doutait pas de savoir ce qui appartient à la perfection -, alors le mal ne peut être qu’apparent (chez Spinoza, d’une façon plus radicale, l’idée de bien et de mal) ou bien il faut le déduire de la fin suprême de Dieu ( — peut-être comme conséquence d’une faveur spéciale de la divinité qui permet de choisir entre le bien et le mal : c’est le privilège de ne pas être un automate ; la " liberté " au risque de se tromper, de choisir mal… par exemple chez Simplicius dans son commentaire d’Epictète).
Ou bien notre monde est imparfait, le mal et la faute sont réels, sont déterminés, absolus, inhérents à leur être ; alors il ne peut pas être le monde-vérité : alors la connaissance n’est que le chemin pour arriver à la négation de celui-ci, alors il est une erreur que l’on peut reconnaître comme telle. C’est là l’opinion de Schopenhauer basée sur des hypothèses de Kant. Pascal est plus désespéré encore : il comprit que sa connaissance, elle aussi, devait être corrompue, falsifiée, — que la révélation est nécessaire pour comprendre le monde, même d’une façon négative…
14.
Les causes qu’il faut prêter à la venue du pessimisme :
1) Les instincts vitaux les plus puissants et les plus féconds ont été calomniés jusqu’ici, de sorte qu’une malédiction repose sur la vie ;
2) la bravoure croissante et la méfiance plus audacieuse de l’homme comprennent que ces instincts ne peuvent être détachés de la vie et par conséquent elles se tournent contre la vie ;
3) seuls prospèrent les plus médiocres qui ne sentent pas ce conflit, l’espèce supérieure échoue et indispose contre elle, en tant que produit de la dégénérescence, — d’autre part on s’indigne contre le médiocre qui veut se donner pour la fin et le sens ( — personne ne peut plus répondre à un pourquoi ? — ) ;
4) le rapetissement, la faculté de souffrir, l’inquiétude, la hâte, le grouillement augmentent sans cesse, -l’actualisation de tout ce mouvement, ce que l’on appelle la " civilisation ", devient de plus en plus facile et l’individu désespère et se soumet, en face de cette énorme machinerie.
15.
Évolution du pessimisme au nihilisme. — Dénaturation des valeurs. Scolastique des valeurs. Les valeurs isolées et idéalisées, au lieu de conduire et de dominer l’action, se tournent contre l’action qu’elles réprouvent.
Des contradictions au lieu de degrés et d’ordres naturels. Haine de la hiérarchie. Les contradictions correspondent à une époque populacière parce qu’on les saisit plus facilement.
Le monde réprouvé en présence d’un monde édifié artificiellement, d’un " monde-vérité ", qui est seul à avoir un prix. — Mais enfin l’on découvre de quels matériaux est fait le " monde-vérité ", l’on s’aperçoit qu’il ne reste plus que le monde réprouvé et l’on porte au compte de celui-ci cette suprême désillusion.
Alors on est en face du nihilisme : on a conservé les valeurs qui jugent — et rien de plus !
Ceci donne naissance au problème de la force et de la faiblesse :
1) les faibles s’y brisent,
2) les forts détruisent ce qui ne se brise pas,
3) les plus forts surmontent les valeurs qui jugent.
Tout cela réuni crée l’âge tragique.
16.
Pour la critique du pessimisme. — La " prépondérance de la peine sur la joie " ou bien le contraire (l’hédonisme) : ces deux doctrines sont déjà des signes du nihilisme.
Car, dans les deux cas, on ne fixe pas d’autre sens final que les phénomènes de plaisir ou de déplaisir.
Mais ainsi parle une espèce d’hommes qui n’a plus le courage de se fixer une volonté, une intention, un sens : — pour toute espèce d’hommes plus saine la valeur de la vie ne se mesure pas à l’étalon de ces choses accessoires. Et l’on pourrait facilement imaginer un excès de douleur qui provoquerait malgré cela une volonté de vivre, une affirmation de la vie, en face de la nécessité de cet excès.
" La vie ne vaut pas la peine d’être vécue " ; " résignation " ; " à quoi servent les larmes ? " — c’est là une argumentation débile et sentimentale. " Un monstre vaut mieux qu’un sentimental ennuyeux. "
Le pessimisme des natures énergiques : " à quoi bon " après une lutte terrible, même après la victoire. Qu’il existe quelque chose qui a cent fois plus d’importance que de savoir si nous nous trouvons bien ou mal : c’est l’instinct fondamental de toutes les natures vigoureuses — et par conséquent aussi de savoir si d’autres se trouvent bien ou mal. Cet instinct leur dit que nous avons un but, pour lequel on n’hésite pas à faire des sacrifices humains, à courir tous les dangers, à prendre sur soi ce qu’il y a de pire : c’est la grande passion. Car le " sujet " n’est qu’une fiction ; l’ego dont on parle lorsque l’on blâme l’égoïsme n’existe pas du tout.
17.
Le philosophe nihiliste est convaincu que tout ce qui arrive est dépourvu de sens et se fait en vain : mais il ne devrait pas y avoir d’être inutile et dépourvu de sens. Où cherche-t-il les raisons qui le poussent à faire cette objection ? Où cherche-t-il un " sens ", cette " mesure " ? — Le nihiliste veut dire en somme qu’un regard jeté sur un pareil être vide et inutile ne satisfait point le philosophe, lui cause une impression de vide et de désolation. Une telle constatation est en contradiction avec notre subtile sensibilité de philosophe. C’est là conclure à cette évaluation absurde : il faudrait que le caractère de l’existence fît plaisir au philosophe, pour que celle-ci pût subsister de plein droit…
Il est dès lors facile à comprendre que le plaisir et le déplaisir, dans le domaine de ce qui arrive, ne peuvent être considérés que comme des moyens : il faut encore se demander si, d’une façon générale, il nous serait possible de voir le " sens ", le " but ", si la question du manque de sens ou de son contraire ne serait pas insoluble pour nous. -
18.
Pour l’histoire du nihilisme européen
La période d’obscurité, les tentatives de tout genre pour conserver l’ancien et pour ne pas laisser échapper le nouveau. La période de clarté : on comprend que l’ancien et le nouveau sont des antithèses fondamentales :
21.
Le nihiliste parfait. — L’œil du nihiliste idéalise dans le sens de la laideur, il est infidèle à ce qu’il retient dans sa mémoire — : il permet à ses souvenirs de tomber et de s’effeuiller ; il ne les garantit pas de ces pâles décolorations que la faiblesse étend sur les choses lointaines et passées. Et ce qu’il ne fait pas à l’égard de lui-même, il ne le fait pas non plus à l’égard de tout le passé des hommes, — il laisse s’effriter ce passé.
22.
Pour la genèse du nihiliste. — On n’a que très tard le courage de s’avouer ce que l’on sait véritablement. Que j’ai été jusqu’à présent foncièrement nihiliste, il y a très peu de temps que je me le suis avoué à moi-même : l’énergie ou la nonchalance que je mis, comme nihiliste, à aller de l’avant m’ont trompé sur ce fait principal. Lorsque l’on marche vers un but il semble impossible que " l’absence de but par excellence " soit un article de foi.
23.
Les valeurs et les changements de valeurs sont en proportion avec l’augmentation de puissance de celui qui fixe les valeurs. Le degré d’incrédulité, de " liberté " accordé à l’esprit : expressions de l’augmentation de puissance. Le " nihilisme ", idéal de la plus haute puissance de l’esprit, de la vie la plus abondante : il est en partie destructeur, en partie ironique.
24.
Qu’est-ce qu’une croyance ? Comment naît-elle ? Toute croyance tient quelque chose pour vrai.
La forme extrême du nihilisme, ce serait de se rendre compte que toute croyance, toute certitude, sont nécessairement fausses : parce qu’il n’existe pas du tout de monde-vérité. Ce serait donc un reflet, vu en perspective, dont l’origine se trouve en nous (dans ce sens que nous avons sans cesse besoin d’un monde plus étroit, raccourci et simplifié).
— De se rendre compte que c’est le degré de force qui fait que nous pouvons nous avouer à nous-mêmes l’apparence, la nécessité du mensonge, sans provoquer notre perte.
En ce sens le nihilisme pourrait être la négation d’un monde véritable, d’un être, d’une intelligence divine.
II. Pour une critique de la modernité
25.
Renaissance et réforme — Que démontre la Renaissance ? Que le règne de l’" individu" a ses limites — La dissipation est trop grande, il n’y a pas même la possibilité d’assembler, de capitaliser, et l’épuisement suit pas à pas. Ce sont des époques où tout est gaspillé, où l’on gaspille même la force qui devrait servir à amasser, à capitaliser. à accumuler richesse sur richesse… Les adversaires d’un pareil mouvement sont eux-mêmes forcés de pratiquer un gaspillage insensé de leurs forces ; eux aussi s’épuisent aussitôt, ils s’usent et se vident.
Nous possédons dans la Réforme un pendant désordonné et populacier de la Renaissance italienne, un mouvement issu d’impulsions similaires, avec cette différence que, dans le nord, demeuré en retard, demeuré vulgaire, ce mouvement dut revêtir un travestissement religieux, — l’idée d’existence supérieure ne s’étant pas encore dégagée de l’idée de vie religieuse. Dans la Réforme, l’individu veut aussi parvenir à la liberté ; " chacun son propre prêtre ", ce n’est là qu’une formule du libertinage. En réalité, un mot suffit — " liberté évangélique " — pour que tous les instincts qui avaient des raisons de demeurer secrets se déchaînassent comme des chiens sauvages, les appétits les plus brutaux eurent soudain le courage de se manifester, tout semblait justifier… On se gardait bien de comprendre à quelle liberté on songeait en somme, on fermait les yeux devant soi-même… Mais clore les yeux et humecter les lèvres de discours exaltés, cela n’empêchait pas d’étendre les mains et de saisir ce qu’il y avait à saisir, de faire du ventre le dieu du " libre évangile ", de pousser tous les instincts de vengeance et de haine à se satisfaire dans une fureur insatiable…
Cela dura un certain temps : puis vint l’" épuisement ", tout comme il était venu dans le midi de l’Europe ; et ce fut là encore, dans l’épuisement, une espèce vulgaire, un universel ruere in servitium… Alors vint le siècle indécent de l’Allemagne…
26.
Les trois siècles. — Leurs différentes sensibilités s’expriment le mieux de la façon suivante :
Aristocratisme : Descartes, règne de la raison, témoignage de la souveraineté dans la volonté ;
Féminisme : Rousseau, règne du sentiment, témoignage de la souveraineté des sens, mensonger ;
Animalisme : Schopenhauer, règne des appétits, témoignage de la souveraineté des instincts animaux, plus véridique, mais plus sombre.
Le XVIIe siècle est aristocratique, il coordonne, il est hautain à l’égard de tout ce qui est animal, sévère à l’égard du cœur, dépourvu de sentimentalité, " non-allemand ", " ungemüthlich " ; adversaire de ce qui est burlesque et naturel ; il a l’esprit généralisateur et souverain à l’égard du passé, car il croit en lui-même. Il tient au fond beaucoup plus de la bête féroce et pratique la discipline ascétique pour rester maître. Le siècle de la force de volonté et aussi celui des passions violentes. Le XVIIIe siècle est dominé par la femme, il est enthousiaste, spirituel et plat, mais avec de l’esprit au service des aspirations et du cœur, il est libertin dans la jouissance de ce qu’il y a de plus intellectuel, minant toutes les autorités ; plein d’ivresse et de sérénité, lucide, humain et sociable, il est faux devant lui-même, très canaille au fond…