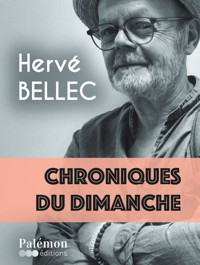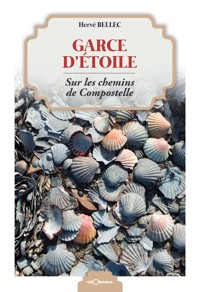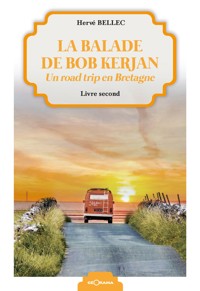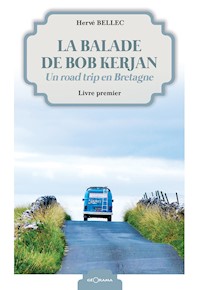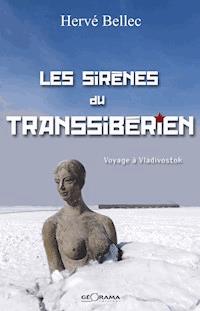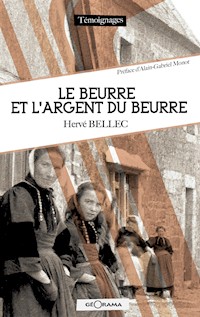
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Géorama Éditions
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Un merveilleux récit en forme d’hommage à une grand-mère témoin d’un monde disparu dans le centre-Bretagne d’antan. Sans nostalgie et sans pathos toutefois, avec à l’inverse toujours la distance et la verve insolente d’Hervé Bellec, marques de fabrique qui n’excluent pas, loin s’en faut, la sincérité tendre ou l’humour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préface
D’abord je lus La Nuit blanche et je fus sous le charme. Lisant, ah oui lisant avidement, comme à grandes goulées impatientes d’une eau dure, fraîche et froide.
Et courant encore d’une ligne à l’autre, fièvre contradictoire qui désire à la fois de la page lue épuiser tout le suc en même temps que découvrir, vite, plus vite la suivante.
D’emblée je sus que la façon romanesque d’Hervé Bellec serait une école d’émotion qui ne se découvrirait que comme à regret, avec cette pudeur bourrue de belles écritures de la part sensible.
Je découvrais un prosateur poignant au négligé savamment délicat et finement bordé d’une belle poésie farouche qui rougissait un peu de dire son nom.
Je devinais aussi qu’il était sans doute ennuyé par telles écritures d’aujourd’hui (ou d’hier déjà), tel pseudo-lyrisme affecté, si replet, si court, si satisfait de lui-même, telles fadeurs languissantes.
Aussi bien, La Nuit blanche allait à l’essentiel ; il s’agissait de dire une perte, de nommer une douleur. Une femme, une amie du narrateur allait mourir, était morte, et on l’enterrait.
Ainsi, suivant à la simple lettre le fil chétif de cet avis de décès, le roman travaillait au plus serré du chagrin, des paroles à fleur de bouche, du grand paradoxe de cette cohérence hallucinée des temps de deuil. Par sa brièveté caustique, son cynisme déchiré, son art précis de la désillusion, le romancier s’acharnait à porter le haut témoignage de ce désastre qui pour dire le seul vrai nous constitue, la compagnie de la mort.
Hervé Bellec : un écrivain navré. Nulle foi, nulle rédemption pour accompagner d’un peu de douceur – fût-elle irrationnelle – son goût de cendre aux lèvres. Rien qu’un adieu violent donc, La Nuit blanche était au sens propre un désenchantement. Mais un livre de Bretagne aussi, avec ses paysages incendiés de beauté, la mer qui s’engouffre sous le pont de l’Iroise au pied des rochers noirs, son sel de larmes océaniques qui collent aux paupières lourdes, aux joues lavées et tièdes.
Un livre comme un temps de sanglots, une hésitation à décider si l’on pouvait vivre encore, exister, tout accepter enfin.
Mais cette écriture lapidaire qui donnait à souffrir permettait enfin d’être soi, un peu, dans la lucidité conquise et acceptable. L’on faisait sienne cette beauté violente qui irradiait de ces pages comme retournées de l’intérieur ; il semblait que le romancier écrivait en blanc lacté sur le fond noir éternel de notre condition.
Garce d’étoile, premier roman publié en 1990, ne disait pas autre chose. Au-delà de l’argument fondateur – un pèlerinage de Brest à Saint-Jacques-de-Compostelle –, on lisait déjà l’évocation de temps trop vite enfuis, la fragilité des rencontres hasardeuses du pérégrin, et cette douleur surtout, laquelle toujours nimbait de très anxieuse désespérance le parcours superficiel joyeux de l’écrivain-voyageur.
Retour à Brest, la nouvelle publiée dans le recueil collectif Brest, l’ancre noire, évoquait la petite chronique des gens de la nuit dans un port de l’Atlantique nord, chaleur des soirées sans fin, repères rassurants des enseignes du quartier Saint-Martin, son école de la place, ses cafés posés à la façon du jeu des quatre coins. Mais des zones d’ombre encore, des bières bues à l’emporte-pièce comme on se débarrasse de soi – âme encombrante, bonheurs ratés.
Le Beurre et l’Argent du beurre, enfin. Un livre pour se chercher, se consoler peut-être. Prendre la route encore, celle de la Bretagne intérieure, qui ne figure pas au catalogue des voyagistes, entamer une descente toute proche aux portes de la mémoire. Il fallait que pareil ouvrage fût écrit – et l’on s’étonne que cela survienne finalement si tard – pour que compte soit enfin tenu des générations aujourd’hui enfuies nées à la veille de la Première Guerre mondiale. Celles-là dont le « mode de vie » demeura jusqu’aux années cinquante, peut-être même soixante, si peu différent de celui de la longue cohorte de leurs ancêtres, bons à toute peine, à toute nuit, à toute misère.
« Seulement des paysans de père en fils. Sans doute sont-ils là depuis plusieurs siècles, je ne prendrais pas beaucoup de risques à affirmer qu’ils se sont installés sur ces terres grasses et lourdes dès leVesiècle, au temps des grandes migrations barbares, que, chassés par les Angles et les Saxons de leur Bretagne originelle, ils durent traverser la Manche dans quelque embarcation de fortune comme le moine Caradec, pour venir se réfugier en Armorique. L’histoire est connue. À moins que nos ancêtres n’aient occupé les lieux depuis le néolithique et n’aient dû se plier à la loi des nouveaux envahisseurs. Je ne sais pas. Je sais seulement qu’ils s’appellent Pierre, Julienne et Catherine, qu’ils sont cultivateurs et que nous sommes le produit de tout ça, le miracle devrais-je dire, car c’est miracle d’avoir pu passer à travers tous les filtres meurtriers de l’histoire, les guerres, les famines, les pestes et les grands hivers. »
Le Beurre et l’Argent du beurre est un récit à deux voix. La première est celle du narrateur à la recherche de son enfance et, partant de ses origines, en Morbihan intérieur, au Pays Pourleth. La seconde, porteuse de la parole de sa grand-mère, est recueillie précieusement, mot à mot, et a valeur d’irremplaçable témoignage d’une longue existence paysanne qui se confond avec leXXesiècle, et meurt en même temps que lui.
En somme, le récit d’Hervé Bellec est à mi-chemin exact entre la partition romanesque et l’étude ethnologique, le « collectage ». C’est qu’il s’agit, dans les deux cas, de creuser plus loin et plus longuement au-dedans de soi, de fouailler la matière épaisse des choses qui furent et qui fuient, de recueillir lamémoire étiolée, le verbe dense et fragile de ceux qui vont nous quitter. Car la mort vient, les liens familiaux se détissent, la main de toute fin pèse sur l’histoire en marche. De là que le roman bien sûr « finit mal » car toute vie en somme finit mal. L’essentiel toutefois est sauf, qui nous donne en partage une connaissance affermie des choses qui furent de ce temps-là (c’est l’expression qui revient le plus souvent et porte l’armature rythmique de l’ouvrage) – de cette outre-vie, de ce monde désormais mort et qu’Hervé Bellec ranime comme on le fait d’une chandelle qui n’est plus qu’un point rouge hésitant dans la ténèbre s’il doit périr ou reparaître.
ALAIN-GABRIEL MONOT
Me mamm eùé e laboura
— Ha gwenn hé blèu –
Geti, en hwéz ar on taleu
Disket em-es bihannig tra
Médein ha tennein avaleu
Me mamm eùé e laboura
D’hounit bara.
Ma mère aussi travaille
— et blancs sont ses cheveux.
Avec elle, la sueur sur nos fronts,
J’ai appris, tout petit,
À moissonner et à arracher les pommes de terre.
Ma mère aussi travaille
Pour gagner son pain…
Yann-Ber Calloc’h (1888-1917)
à ma sœur, à mes cousines.
Le beurre et l'argent du beurre
Il faudra bien un jour ou l’autre se résoudre au tirage au sort. Mémé est morte brutalement il y a quelques semaines et ses affaires personnelles doivent être partagées entre nous tous, les enfants et les petits-enfants. J’ignore encore ce qui a été vraiment décidé mais je me suis laissé dire que ce qui nous reviendrait, à ma sœur et à moi, c’est le vieux buffet de la cuisine ainsi que l’horloge. Ma nièce qui vient de s’installer et qui attend un bébé pour l’hiver a déjà pris une option sur le buffet, ce à quoi je n’ai fait aucune opposition. Il n’est pas d’une grande valeur, ni marchande, ni esthétique, quoique ce style un peu lourdaud des années cinquante semble revenir à la mode ces derniers temps. On en voit désormais chez les antiquaires, affichant parfois des prix exorbitants. Et le renard, que va-t-on faire du renard empaillé qui trônait en haut du buffet ? Une belle bête capturée dans le bois de Maneven, avec des crocs pointus et des yeux jaunes qui nous fichaient la trouille, à tous.
En ce qui concerne l’horloge, c’est une tout autre histoire. Tout le monde désirait l’horloge, bien évidemment, la pièce maîtresse de l’héritage et la chance semble nous sourire, à Édith et à moi, enfin, façon de parler puisque pour l’instant, rien n’a été encore tranché. J’imagine que les cousines enragent. J’ai téléphoné à ma sœur dimanche dernier pour lui souhaiter un bon anniversaire et nous avons tous deux soigneusement évité le sujet. Ce n’est hélas pas si rare de voir des familles entières se déchirer à peine le cercueil refermé. Alors il convenait d’être prudent, d’aborder la question avec tact. Je n’avais nullement l’intention de me fâcher avec mon unique frangine à qui je n’avais rien à reprocher, ou si peu. Elle n’avait jamais abusé de son droit d’aînesse si ce n’est les rares fois où mon comportement l’avait exigé et il m’était arrivé plus d’une fois d’avoir eu besoin d’un petit coup de main. Je prenais dans ces cas-là un air de chien battu. Elle protestait pour la forme puis, excédée ou dépitée, finissait toujours par le sortir de son porte-monnaie, ce billet de cent balles. Ce qui en aucun cas ne résout la question.
Édith serait en effet bien en peine de prétendre à l’horloge en arguant d’un droit désuet de primogéniture puisque ce privilège ne concernait que les mâles. Et d’une ! Reste le tirage au sort, je ne vois pas d’autre solution. Pile ou face ? Personne n’ignore que la pièce tombe sur le côté face dans plus de soixante-dix pour cent des cas. Les dés sont pipés. Courte paille, alors ? Pif-pif-ce-se-ra-toi-qui-au-ra-l’hor-lo-geuh. Oui… bon. N’insistons pas !
S’adresser à un huissier de justice sous un prétexte aussi futile, ce serait vraiment chercher la petite bête, sans compter les honoraires qui nous incomberaient. D’ailleurs, ce n’est pas le genre de la famille. Bref, la question reste en suspens mais nous devons y réfléchir. Nous avons le temps. Qui plus est, je me demande bien où je pourrais l’installer, cette foutue horloge, au cas où le hasard me désignerait. Ma maison n’a pas de style, j’ai ajouté les meubles et les bibelots au gré de mes fantaisies ou de mes disponibilités financières, et si l’ensemble manque peut-être de cohérence, il n’est pas dénué de charme. C’est du moins mon avis. Alors une horloge de plus ou de moins…
Je tourne en rond dans le salon. Il me faudrait déplacer le piano, ça risque de faire trop encombré, trop chargé. La cuisine serait sans doute plus appropriée mais je connais mes garçons. Le balancier de cuivre serait un jeu bien tentant et le grand coffre en châtaignier verni subirait à coup sûr les assauts belliqueux de leurs épées et autres mitraillettes à eau. Donc, je reviens au salon, pièce où il leur est, en théorie, formellement interdit de chahuter. C’est ici que je m’allonge de temps en temps sur le canapé, j’ouvre un bouquin que je ne lis pas, je ferme les yeux, j’écoute de la musique, je réfléchis. Quant aux enfants, qu’on ne les plaigne pas, ils ont à leur entière disposition une grande salle de jeux équipée d’une télé et d’un ordinateur. Je n’avais pas ça, moi.
À Maneven, maintenant que j’y pense, il n’y avait que deux pièces. Maneven, c’était la ferme de nos grands-parents où nous passions tous nos étés. L’une était très vaste et très sombre, enfin mes souvenirs la voient ainsi, mais j’avais les yeux d’un petit garçon de sept ans et ma perception de l’espace était bien sûr très différente. Cette pièce en terre battue servait de cuisine, de chambre et de salle à manger, c’était la maison, quoi ! La table m’apparaissait démesurée, mon grand-père était un géant (je fus d’ailleurs surpris en consultant un jour ses vieux papiers militaires qu’il ne mesurait qu’un mètre soixante-dix-sept), la cheminée un gouffre dantesque, l’horloge, n’en parlons pas ! Une vraie tour de contrôle. Elle nous toisait énorme, mastoc, tel un clocher dominant toute sa paroisse, figée entre une vieille armoire du même acabit et le lit clos de Mémé Vieille, la maman à Mémé. On l’appelait comme ça pour ne pas les confondre toutes les deux, Mémé Vieille et Mémé tout court. L’horloge était d’ailleurs un legs de Mémé Vieille qui avait renoncé à l’emporter avec elle lorsqu’elle était partie s’installer dans sa petite maison du bourg. En contrepartie, Mémé lui avait offert une jolie pendule murale de style néobreton qu’un brocanteur lui avait sournoisement troquée quelque temps plus tard contre un machin moderne en plastique qui marchait à piles. Une horreur. Mémé Vieille adorait le Formica. Ces escrocs-là ratissaient la campagne à la recherche de lits clos et autres curiosités rustiques qu’ils revendaient vingt fois leur prix à des gens pas regardants. Patricia, ma cousine qui me relate l’anecdote, m’assure que Mémé n’avait pas décoléré.
Et puis il y avait l’autre pièce, à droite quand on entrait par le couloir, une sorte de sanctuaire au parquet impeccablement entretenu par Mémé, où l’on ne pénétrait qu’en marchant sur des patins sous peine d’avoir à subir ses foudres. Les volets étaient clos la plupart du temps. Dès qu’on entrait, un parfum brutal d’encaustique nous saisissait à la gorge. L’été, c’était pourtant notre chambre, à nous les gosses, les Parisiens. Pépé et Mémé n’y dormaient jamais, ils utilisaient le vieux lit de chêne de la salle commune, sans doute pour des questions de chauffage, sûrement par respect pour ces beaux meubles qu’ils avaient dû avoir tant de mal à se payer. Durant les années soixante, le revenu moyen des agriculteurs était enfin devenu décent. La mécanisation ainsi que les engrais chimiques avaient fait croître les productions et ils étaient peu à peu entrés dans l’économie de marché. Ils investissaient dans le meuble. Le lot, dont la belle armoire en merisier, a été décroché par mes cousines, alors qu’elles ne viennent pas râler. Le reste n’a guère d’intérêt : une table, quelques chaises, une vieille télé, des babioles.
Si j’hérite de l’horloge, une chose est sûre, il sera hors de question de la mettre en route.
Les deux gros poids pendant comme des andouilles resteront immobiles ad vitam aeternam. Rien d’aussi exaspérant que le goutte-à-goutte d’un robinet qui fuit. Rien de plus insupportable que ces obsédants allers et retours entre le tic et le tac, ces deux sons creux égrenant un sinistre compte à rebours. À chaque fois qu’elle sonnait, on avait l’impression d’entendre retentir le glas. C’était toujours vers la fin du film, au moment le plus tendu – on allait enfin découvrir dans les cinq dernières minutes le nom de ce salopard qui avait jeté la jolie blonde aux yeux verts dans le vieux port de Marseille – que toute la machinerie se mettait à carillonner à tout va pour sonner les dix heures, un raffut du diable, on serrait les dents, on se bouchait les oreilles, elle nous refaisait la même sérénade une minute plus tard au cas où on aurait mal entendu, et c’est encore elle, tyrannique, qui nous imposait le moment d’aller au lit alors la ferme, l’horloge. Silence. Tic tac, ta gueule ! Pas besoin d’un métronome pour me marteler à chaque seconde que poussière tu es, poussière tu resteras. C’est con, une horloge. C’est réglé comme une horloge, voilà. Et c’est exactement ça qu’on lui reproche.
Je ne changerai rien à mes habitudes. J’ai déjà tout ce qu’il faut chez moi, merci. Le magnétoscope, l’ordinateur, le radioréveil et j’en passe sont amplement suffisants pour me rappeler avec force électronique la cruauté de la fuite du temps et l’heure de partir au boulot. Pour le reste, je ne dis pas non. C’est ma foi une bien belle pièce, une véritable œuvre d’art doublée d’une mécanique prodigieuse. Je ne me souviens pas de l’avoir vue une seule fois tomber en panne, la teigneuse. Pépé la remontait tous les dimanches matin avant d’aller à la messe et c’était reparti pour la semaine. Tic tac, tic tac, le tac répondait comme en écho au tic et en effet, les deux sons étaient nettement opposés, l’un creux, l’autre plus clair. Un certain J. Mahé, horloger à Guémené-sur-Scorff, l’avait fabriquée au début du siècle. La signature l’atteste. Je me suis posé la question du prix. Ça va chercher dans les combien, de nos jours, une horloge de cette trempe ? Je n’ai pas de projet mercantile, ce serait bien évidemment sacrilège de la vendre, mais c’est juste pour avoir une idée de sa valeur. Cette horloge a été le seul signe extérieur de richesse de mes grands-parents.
Mémé approchait de ses quatre-vingt-dix ans, elle avait tenu le choc, vaille que vaille. On pourrait faire la comptabilité morbide du nombre de fois où ce sablier bavard a hoqueté ses tics et ses tacs, on dépasserait aisément le milliard. Évidemment, ça ne servirait à rien. Qu’as-tu fait, ma pauvre Mémé, de ces milliards de secondes ? Qu’as-tu fait de ta vie ? Elle est partie sans prévenir, à peine. Quelques mois après les hirondelles. Sa vie avait été exemplaire, au sens premier du terme.
En fait, il y avait des années que j’y pensais. Bien sûr, je savais que le temps lui était compté, aucune tergiversation possible, Mémé n’allait pas vivre éternellement mais le projet n’était pas mûr et je n’avais jamais le temps et comment allait-elle prendre ça et je n’aimais pas trop le mot collectage et ceci et cela, bref mille et une excellentes raisons de remettre au lendemain ce que j’aurais dû faire la veille tandis que les saisons défilaient à la queue leu leu, sournoises. Ma femme m’avait regardé ce soir-là droit dans les yeux alors que je remettais pour la énième fois la question sur le tapis.
— Depuis le temps que tu en parles ! Un jour, il sera trop tard, le sais-tu, et tu ne cesseras de te le reprocher.
C’était il y a trois ou quatre ans, peut-être plus mais les dates et moi… Peu importe, Claire, ma femme, était déjà stylo en main en train d’établir un planning pour les vacances de Pâques. Ce serait simple, disait-elle. On mettrait les enfants chez mes parents et j’aurais quelques jours à consacrer à ma grand-mère, l’idée était géniale, si, si, elle y tenait. Elle me donnerait un coup de main pour la retranscription. Recueillir ses souvenirs, écrire son histoire, en faire un livre. Un vrai livre. Le téléphone était juste derrière moi, si je voulais, je n’avais qu’à tendre la main. Maintenant, tu crois ? Oui, tout de suite.
J’ai composé le numéro. Ma grand-mère avait tendance à hausser la voix au téléphone, et plus grande était la distance qui la séparait de son interlocuteur, plus il lui paraissait naturel de parler fort. Je vivais à deux heures de route de chez elle et déjà, il me semblait qu’elle hurlait. Je n’ose imaginer les appels que devait recevoir une de nos cousines qui vivait en Nouvelle-Calédonie.
Mémé décrocha au bout de trois sonneries. Elle s’était résolue à se faire brancher une ligne voici deux ans sur l’insistance de ses filles – on ne sait jamais ce qui peut arriver, insinuaient-elles, l’air de rien – et je dois avouer penaud aujourd’hui que mis à part les vœux de bonne année et les anniversaires, et encore, mes appels avaient dû se compter sur les doigts d’une main. Aussi, c’est avec une surprise teintée de méfiance qu’elle écouta ma proposition non sans que je me sois au préalable enquis de sa santé. D’emblée, j’avais été clair avec elle.
— Un livre, me lança-t-elle dans son accent nasillard, pour quoi faire ? Qu’est-ce que tu veux savoir ? J’ai rien à dire, moi ! Je ne suis qu’une pauvre vieille, j’ai eu mon compte de malheurs, mais j’étais pas la seule, oh dame non ! Qui veux-tu qui s’intéresse à mes histoires ? Tu vas perdre ton temps, c’est moi qui te le dis.
Je n’ai jamais vraiment su si ma grand-mère avait le don de l’humilité feinte, bien plus subtil que la vanité affichée et autrement efficace, par ailleurs propre à beaucoup de personnes du monde paysan, ou si c’était chez elle un comportement naturel, une sorte de fatalisme pathologique, toujours est-il qu’elle m’invitait quand même – oh, ce « quand même » ! – à venir prendre un café à la maison depuis le temps qu’elle ne m’avait pas vu et que les enfants avaient dû bien changer. Je lui proposais un rendez-vous pour le lundi suivant. T’as pas besoin de rendez-vous pour venir chez moi, grommelait-elle mais elle préférait quand même le mardi, dame oui. Le lundi, c’était le jour de la réunion pour la préparation du pardon de Sainte-Marguerite. Elle devrait s’occuper des crêpes avec Madame de Kerfraval ainsi que Marie Le Fur, du Stang, et aussi Catherine, Catherine Le Cunff, tu sais bien, la grand-mère à Chantal qui était à l’école avec toi, celle qui est aux Impôts à Vannes maintenant, une brave fille, travailleuse et tout, mais c’est dommage, le curé ne pourra pas venir, il est en cure à Quiberon pour ses rhumatismes, le pauvre homme, alors il y aura Joséphine Lescop, la femme du maire, si, si, tu connais bien, donc pas avant mardi, non, lundi, je serai trop fatiguée après la réunion. Mardi, ça sera bien mais je n’aurai rien à dire, venez prendre un café quand même. Ah bon, Claire sera pas là, pourquoi qu’elle sera pas là ? Elle a du travail. Oui, c’est bien aussi. Faut s’occuper, c’est ça, faut bien s’occuper, mais ça lui fait du tracas en plus, la pauvre fille, avec les enfants et tout mais bon, si elle vient pas, elle vient pas, hein, le travail, ça n’attend pas, c’est comme ça ! Dame, tu n’auras qu’à venir tout seul alors, pour ce que j’ai à dire.
Elle vit dans une petite maison du bourg. C’est inutile de frapper, la porte est à deux battants et la partie supérieure est la plupart du temps ouverte. Il suffit de s’annoncer, de dire « c’est moi » et d’entrer. Je me penche pour l’embrasser, Mémé est toute petite. Elle m’examine du haut en bas en fronçant les sourcils.
— Dis-moi, tu n’aurais pas un peu maigri, toi ? Tu n’as pas bonne mine, en tout cas.
Je lui souris. À chaque fois que ma grand-mère me voit, j’ai maigri. À l’heure qu’il est, je ne dois pas être plus épais qu’un fil de canne à pêche. Je la regarde à mon tour. C’est ma Mémé à moi, la mère de ma mère. La vieillesse est là, bien sûr, la peau fripée de ses mains et de son visage sont là pour en témoigner mais elle a toute sa tête, comme on dit. Une tête sur les épaules. Une forte tête, Mémé, parfois même une tête de lard mais une belle tête, je veux dire un beau visage, fin et racé, malgré les stigmates du temps. J’ai devant moi sa photo de mariage et je sais que ma grand-mère était une belle femme. Depuis une bonne quinzaine d’années, depuis l’époque qui a suivi la mort de Pépé si mes souvenirs sont exacts, elle a coupé ses longs cheveux qui lui tombaient jusqu’au creux des reins et qu’elle ramassait en chignon. Gosses, on était toujours très impressionné de la voir faire sa toilette le dimanche matin à l’évier de la cuisine. Elle rabattait ses cheveux mouillés par-devant et les peignait soigneusement de haut en bas. C’était comme un rideau qui tombait, une longue crinière déjà grise qu’elle faisait disparaître en deux temps trois mouvements sous sa coiffe. Mais au fil des années, prendre un shampooing lui causait du souci et puis c’était l’époque où toutes ses copines abandonnaient, elles aussi, la mode traditionnelle. Evelyne Baron, la jeune coiffeuse qui vient à domicile tous les deux mois, lui taille les mèches rebelles et lui fait une permanente.
Elle m’explique tout cela pendant que je déballe mon magnétophone sur la table de la cuisine qu’elle a pris soin de nettoyer en attendant ma venue.
— C’est joli ces reflets mauves, ça te rajeunit, si, si, Mémé, je t’assure.
Elle hausse les épaules. Une toux rauque la casse en deux. Je n’aime pas trop ça.
— Tu tousses, Mémé ? Peut-être devrions-nous remettre ça une autre fois.
— C’est rien ça, c’est rien. Je vais te faire un café. Comment va Claire ?
— Elle va bien, elle t’embrasse. Les enfants vont passer quelques jours chez Papa et Maman. Es-tu allée voir le docteur, au moins ?
— Un docteur, qu’est-ce que j’irai faire avec un docteur ? Laisse donc. Tiens, assois-toi, je vais ouvrir une boîte de gâteaux.
Mémé fait tous les matins une grande cafetière qui reste au chaud toute la journée sur la cuisinière en fonte émaillée. Les premiers appareils ménagers arrivés en Bretagne et que vendaient des sortes de colporteurs – on les appelait alors des voyageurs avant qu’ils ne deviennent des représentants de commerce – étaient les moulins à café électriques. Mémé en avait acheté un avec ses économies bien avant que l’électricité tant promise ne soit installée. Dans certains coins paumés du Morbihan, il a fallu parfois attendre la fin des années cinquante. Le moulin, nouvelle icône, trônait pompeusement sur la cheminée entre le crucifix et la Sainte Vierge, attendant en silence le raccordement au réseau et même s’il devait briller d’une parfaite inutilité, Mémé le nettoyait chaque matin avec soin. On promettait l’électricité, on promettait des routes goudronnées, des tracteurs, des éclairages publics, on promettait à chaque élection cantonale mais bon, il a fallu encore patienter. Ils votaient malgré tout, parce qu’ils étaient aussi respectueux de la République que de l’Église. Le devoir, c’est le devoir, disait Pépé en ajustant sa cravate devant la glace du couloir. Elle a fini par venir, cette sainte électricité mais au cas où, Mémé avait conservé l’ancien moulin mécanique, avec sa manivelle et son petit tiroir, un bleu de marque Peugeot. C’est moi qui l’ai déniché je ne sais où, sans doute au moment du déménagement de Maneven, et qui l’ai nettoyé. Je l’ai placé au-dessus des étagères de ma cuisine. Décoration.
Mémé verse le café dans des verres Arcopal, ronds et trapus. Les tasses, c’est pour le dimanche ou quand Monsieur le curé vient aux nouvelles. Elle me tend la boîte de sucre, une boîte en fer qui à l’origine renfermait des biscuits. J’ai le même type de boîte à la maison, avec des Bigoudènes en costume qui dansent la gavotte devant le calvaire de Tronoën. C’est une permanence à laquelle je tiens. Ça s’adapte parfaitement à la masse du kilo de sucre. Je hais les sucriers de porcelaine, je hais les pinces à sucre. Dès que je vois une pince à sucre, je sens sourdre en moi une haine féroce de tout ce qui évoque l’ordre bourgeois, c’est vrai.