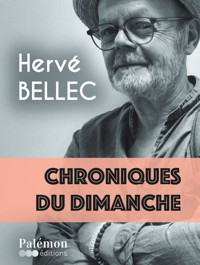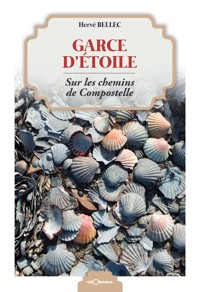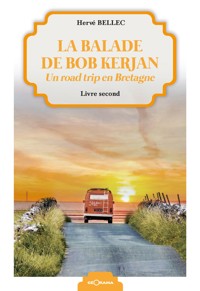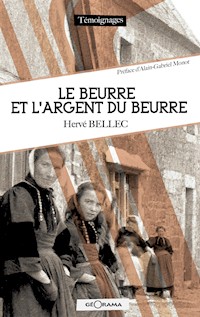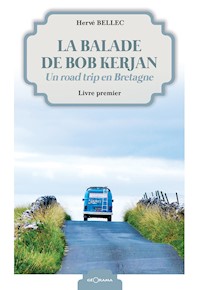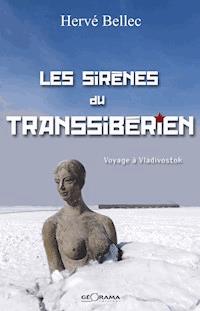
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Géorama Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Embarquez à Brest et partez à l'assaut de la Sibérie !
Après Saint-Jacques-de-Compostelle, Hervé Bellec reprend sa plume d’écrivain voyageur et nous entraîne vers un autre voyage initiatique, à bord du mythique transsibérien, au cœur de l’hiver russe, jusqu’à la ville de Vladivostok. Une plume alerte et précise, beaucoup d’humour et d’humanité, un savoir voir et un billet de train pour Vladivostok sont les ingrédients de ce récit envoûtant et profond, qui nous mène loin, très loin, dans un pays sans fin nommé Russie !
La taïga sibérienne est de loin la plus grande forêt du monde puisqu'elle représente le tiers de la surface boisée de la planète et par là même demeure une des principales réserves d’oxygène de la biosphère. En Sibérie, elle occupe une bande de 1000 kilomètres de large sur 5000 km de long. Les pins, les mélèzes, les cèdres et les bouleaux se succèdent inlassablement et quand on regarde à travers la vitre du train, on a parfois l’impression de voir défiler le plus long code-barre du monde. C’est à mourir d’ennui et bizarrement, on n’en meurt pas.
On dit que le Transsibérien est un train de légende. A mon sens, c'est plutôt un train de réalités, passées ou présentes, avec une histoire faite de sang et de larmes, avec des voyageurs en chair et en os. De Brest à Vladivostok, c'est à dire des deux points les plus opposés de l'Eurasie, via Moscou, la ville aux mille surprises, mon périple n'aura duré qu'une quinzaine de jours. Quinze jours à travers la Sibérie au coeur de l'hiver le plus cinglant. A mourir de froid et pourtant, je n'en ai ramené que de la chaleur.
Hervé Bellec nous livre dans son carnet de route son voyage initiatique à bord du célèbre train, de la Bretagne à l'extrême Russie, en passant par la taïga.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Hervé Bellec est né en 1955. Après avoir été successivement musicien puis patron de bar, il est aujourd'hui professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Brest. Il a publié de nombreux romans et nouvelles ayant pour théâtre la Bretagne dont il sait à merveille traduire les ambiances.
Ses récits de voyages, servis par un style littéraire alerte et une profonde humanité, lui valent toujours un large succès auprès des lecteurs. Avec
Les Sirènes du Transsibérien, Hervé Bellec confirme son statut d'écrivain voyageur et nous entraîne loin, très loin, au cœur de l'hiver russe.
EXTRAIT
Un matin d’hiver, sur les coups de dix heures, j’embarque dans mon vieux VW et mets cap à l’ouest, direction la pointe de Corsen, située face à la mer d’Iroise sur la paroisse de Trezien. Les gens d’ici connaissent. Si l’on excepte les îles Molène et Ouessant ainsi que le chapelet d’îlots qui égrène l’océan comme des points de suspension oubliés à la queue du continent, il s’agit du cap le plus occidental du pays. Nous nous trouvons à 4° 37’ de latitude ouest. Plus au sud, sur les côtes portugaises et galiciennes, ou plus au nord en Irlande, la vieille Europe continue sa percée dans l’Atlantique mais ici, l’endroit reste emblématique. On est au bout du bout de tout, sans vraiment savoir si l’on se trouve au début ou à la fin de l’histoire mais c’est la raison pour laquelle je me trouve ici, engourdi jusqu’aux os. J’ai un rendez-vous. Un bien étrange rendez-vous avec la géographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Décidément, je ne te comprends pas !
Tu as la chance de faire un voyage exceptionnel
et tu râles dès les premiers kilomètres.
Il y a des millions de gens
qui rêvent de prendre le Transsibérien. »
Cinglante, elle répond :
« Je me fous du Transsibérien et du rêve des autres. »
Jacques Lanzmann, Les Transsibériennes, 1978
à Phine et Armand, mes parents.
Trajet du Transsibérien, de Moscou à Vladivostok
POINTE DE CORSEN
Un matin d’hiver, sur les coups de dix heures, j’embarque dans mon vieux VW et mets cap à l’ouest, direction la pointe de Corsen, située face à la mer d’Iroise sur la paroisse de Trezien. Les gens d’ici connaissent. Si l’on excepte les îles Molène et Ouessant ainsi que le chapelet d’îlots qui égrène l’océan comme des points de suspension oubliés à la queue du continent, il s’agit du cap le plus occidental du pays. Nous nous trouvons à 4° 37’ de latitude ouest. Plus au sud, sur les côtes portugaises et galiciennes, ou plus au nord en Irlande, la vieille Europe continue sa percée dans l’Atlantique mais ici, l’endroit reste emblématique. On est au bout du bout de tout, sans vraiment savoir si l’on se trouve au début ou à la fin de l’histoire mais c’est la raison pour laquelle je me trouve ici, engourdi jusqu’aux os. J’ai un rendez-vous. Un bien étrange rendez-vous avec la géographie. Aujourd’hui la brume est trop épaisse pour distinguer les îles mais une pluie de lumière crevant les nuages tombe à ma gauche sur le port du Conquet. À cette heure de la journée, le lieu est désert. Qui s’emmerderait à venir se cailler les miches dans un tel endroit en plein cœur de l’hiver ? Je gare ma bagnole sur un petit terre-plein qui domine la falaise et me risque à quelques pas. J’ai froid, j’aurais dû prendre mon bonnet et mes gants. En haut de la falaise, une plaque commémore une bataille navale dont je ne prends pas la peine de noter les détails. Ce n’est pas ça qui me retient. L’objet de ma présence, c’est ce poteau planté dans le sol et sur lequel sont cloués plusieurs petits panonceaux tournés dans diverses directions qui indiquent les distances vers New York, Londres, Paris, Agadir et Moscou.
Qu’est-ce que je fous là ? Je crois qu’à chaque fois que je m’embarque pour une aventure, je me pose la même colle. Je crois aussi que je ne suis pas le seul dans mon cas. Bruce Chatwin, qui s’y connaît mieux que quiconque en matière de pérégrinations aux quatre coins de la planète en avait même fait le titre d’un bouquin. What am I doing here ? Excellente question. Qu’est-ce que je fous là à me gercer les lèvres et recevoir des embruns plein la tronche pour pas un rond, à regarder béatement l’océan qui continue à faire son remue-ménage comme si je n’étais pas là ? C’est con la mer, n’est-ce pas, et les marins sont encore plus cons. Toujours à se croire au-dessus de la mêlée au prétexte que Platon leur aurait dit un jour avant Jésus-Christ qu’il y a deux sortes d’hommes, ceux qui sont en mer et les autres. Foutaises ! Il y a deux sortes d’hommes, oui, ça, j’en suis certain : ceux qui restent à la maison et les autres, en effet, ceux qui auraient mieux fait d’y rester. Voilà où en est mon état d’esprit en cette matinée de février. Je n’y peux rien, les départs me mettent toujours dans une rogne impossible.
Il y a quelque temps, j’avais écrit sur ces mêmes lieux un petit croquis comme il m’arrive d’en faire de temps à autre quand ces lieux me touchent. Au cours d’une balade sur le sentier des douaniers, je m’étais trouvé nez à nez avec une vieille Lada immatriculée en Russie qui était garée sur ce terreplein où je me trouve maintenant. La voiture, couleur bleu gendarmerie, avait gardé un petit côté kitsch de l’époque soviétique. Les occupants n’étaient pas là mais j’avais imaginé sans mal qu’ils venaient de loin, qu’ils se trouvaient à la dernière halte d’un long raid qui les avait conduits jusqu’ici depuis la grande Sibérie, va savoir, depuis Vladivostok et j’avais simplement écrit un petit papier sur leur bonheur supposé d’être arrivés enfin ici. Peut-être étaient-ce simplement un couple d’étudiants de Saint-Pétersbourg en stage dans la région qui s’étaient permis une virée au bord de la mer mais dans mon esprit, je voulais qu’ils viennent de loin, de très loin. De l’autre bout du monde pour être précis. Et qu’ils soient jeunes et amoureux. Et je leur avais inventé une histoire qu’ils ne liront jamais, une histoire bousculée par diverses péripéties plus ou moins spectaculaires qui pimentent un voyage, une histoire avec un début et une fin, une fin heureuse de préférence.
C’est vrai que l’endroit semble forgé pour le bonheur, du moins quand je suis bien luné, un endroit d’une beauté presque douloureuse bien qu’il y ait de fortes chances que des gens pressés d’en finir avec leur vie de tartempion se soient déjà jetés du haut de cette falaise. Sans doute des couples ont choisi ce sentier côtier pour décider de leur séparation après des années de vie commune et d’amour passionné. Un homme plus téméraire ou plus fou que les autres s’est peut-être fait emporter ici par une lame scélérate. Je préfère ne pas y songer, pas ce matin en tout cas. J’ai assez de soucis comme ça de mon côté et je me sens si vulnérable. Entendez, je claque des dents.
Ma petite nouvelle concernant la Lada bleu avait été publiée dans une revue locale et puis je n’y avais plus pensé. C’est bien connu, l’écrivain laisse tomber ses personnages aussi lâchement que ces salopards qui abandonnent leur chien sur la route des vacances en l’attachant ni vu ni connu à l’arbre d’une aire d’autoroute avant de s’enfuir aussitôt dans leur bagnole sans même jeter un coup d’œil dans le rétroviseur.
Je descends prudemment la falaise. C’est assez casse-gueule et je serais plutôt du genre trouillard mais je n’ai pas fait le déplacement pour des clopinettes. Ici, l’un des derniers tentacules de la pieuvre eurasienne va étancher sa soif dans l’océan. Derrière moi, à l’autre extrémité, ou plutôt devant moi, si l’on tient compte de la chronologie plutôt que de l’orientation, Vladivostok, une ville de l’Extrême-Orient russe située en bordure du Pacifique, sur la mer du Japon. 12 867 kilomètres, si mes comptes sont exacts. Un panonceau à rajouter un de ces quatre au poteau de la pointe de Corsen. Pas de quoi sauter au plafond ni d’en faire un drame, c’est à peu près la distance que je déclare annuellement en frais de transport sur ma déclaration d’impôts. Sans doute y a-t-il ce matin-là quelques goélands dont les piaillements idiots déchirent la brume mais je n’y prête guère d’attention. Je regarde le sol et non le ciel. Je cherche un caillou et n’en trouve point. Pourtant, il me faut absolument trouver cette pierre, c’est l’unique raison pour laquelle je suis venu me perdre ici. Je remonte sur le sentier côtier et le suis vers le nord. À cet endroit, on arrive assez vite à la plage de Ruscumunoc, une superbe crique que les naturistes utilisent dès les beaux jours et par conséquent le sentier côtier est sillonné par tout un bataillon de voyeurs armés de jumelles qui font mine d’observer les macareux moines et les fous de bassan. Ce matin, personne. Ni voyeur, ni exhibitionnisme, sinon moi, qui fais fonction des deux. J’aperçois au loin un couple de promeneurs qui se tiennent par la main mais il semble que la plage n’ait été créée que pour accueillir ma venue. Le sable est d’une texture parfaite, comme s’il avait été préalablement passé au tamis. Je marche sur une moquette de pépites d’or et je persiste à chercher mon caillou. Celui-ci est trop gros, celui-là trop riquiqui, celui-ci ressemble à un vieux crapaud, celui-là n’est pas un caillou, c’est une galette de mazout. Et merde ! je me retrouve à présent à genoux en train de frotter frénétiquement les doigts avec du sable pour tenter de nettoyer cette saloperie et ça me coûte, Dieu sait que ça me coûte. J’ai envie de renoncer, là, tout de suite, un coup de fil à l’éditeur, désolé vieux, mais ton plan de dingue, cette histoire d’aller en train de Brest à Vladivostok, et pourquoi pas à cloche-pied pendant qu’on y est, sois gentil, laisse ça à d’autres, à des plus jeunes, des jeunes fous aux mollets encore soyeux, à des plus téméraires. Sans vouloir faire de jeux de mots foireux, moi, je serais plutôt du genre train-train quotidien que Transsibérien, Bas Berry que Sibérie, si tu comprends le fond de ma pensée. Vois-tu, les Russkoffs, c’est pas vraiment mon truc. C’est tout mafia et compagnie, ces gens-là. Ils assaisonnent la vodka à coup de polonium, ils envoient des braves gens trimer dans les mines de sel pendant vingt ans pour le vol d’une mobylette, ils prennent les étrangers en otage pour les échanger contre des contrats faramineux d’armement et les journalistes trop bavards, ils les enferment à l’hôpital psychiatrique. C’est bien connu, les pilotes de ligne de l’Aéroflot et les cheminots du Transsibérien sont bourrés du matin au soir. Leur bouffe, n’en parlons pas, soupe aux choux à midi, soupe aux choux le soir. Le charme slave ? Des coups à se choper une chtouille carabinée et par ailleurs, ma mère m’a bien mis en garde : je risque de prendre froid, là-bas en plein cœur de la Sibérie, et d’attraper la mort sans compter que certains soirs, j’ai déjà assez de mal comme ça à me déplacer de mon canapé jusqu’à mon lit alors vraiment, mais vraiment désolé, vieux, je laisse tomber. J’ai passé l’âge de jouer les aventuriers tatoués, les cadors du kilométrage, les mercenaires du rail. Ton putain de train, avec tout le respect que je dois au monde de l’édition, t’as qu’à le prendre toi-même !
Le couple descend maintenant sur la plage par l’escalier de service qui épouse la falaise. Sans s’en rendre compte, ils viennent à ma rencontre en s’approchant du rivage. Ils regardent la mer, se tiennent la main, doivent se dire des choses sentimentales assez cucul, à moins qu’ils n’évoquent le futur papier peint de leur salle de bains. C’est ça, regardez la mer ! C’est joli, c’est vaste, c’est bleu. Regardez la mer et foutez-moi la paix. Je n’ai pas envie de les voir ni qu’ils me voient. J’ai besoin d’être seul pour mes petites emplettes, j’ai besoin d’être seul pour régler mes comptes avec ma propre angoisse. C’est au moment où je décide de faire demi-tour et de tout abandonner séance tenante que mon pied frappe un petit galet de la taille d’un œuf de poule, en plus plat. Il est presque parfait. Ce salopiot se cachait derrière une gerbe de laminaires et faisait de son mieux pour se confondre avec le paysage, pas trop volontaire pour se faire embarquer dans l’expédition. Je me baisse pour le ramasser. Il tient parfaitement dans la paume. Sa texture est à peine rugueuse et son grain est très fin. Les couleurs virent du gris à l’ocre rouge. Sur la face externe, on distingue assez nettement quelques éclats de quartz. Je souffle dessus et le frotte longuement entre mes mains avant de le glisser dans ma poche. Il est dit que c’est ce caillou et pas un autre que je jetterai bientôt dans le golfe de l’Amour, c’està-dire dans la mer du Japon, c’est-à-dire dans l’océan Pacifique. Du moins l’ai-je promis à cet éditeur qui m’a souhaité un bon voyage comme si cela allait de soi. Schlastlivogo puti, dit-on au pays de Youri Gagarine, le premier pèlerin de l’espace avec qui je ressens soudain, toutes proportions gardées, comme une certaine complicité.
Je ne suis pas un grand voyageur mais je suis connu pour avoir commis quelques récits de voyage. Dans une semaine, je remets ça. Le train, puis l’avion, puis encore le train vers ma destination finale, le pays de nulle part, le plus grand terrain vague du monde, selon les propres termes d’Alexandre III, tsar de toutes les Russies.
Je me fous des tsars, je me fous des cosmonautes comme des éditeurs, j’ai les jetons.
LANDERNEAU
Ma datcha à moi se situe sur les bords de l’Élorn, côté Cornouaille, à quelques encablures du vieux pont du Rohan, célèbre pour être l’un des derniers ponts habités d’Europe. Ma datcha est une jolie petite maison aux volets bleus nichée au fond d’une adorable venelle. Lors des grandes marées, la rivière a tendance à jouer les filles de l’air et s’est même invitée plus d’une fois dans ma cour, ayant toutefois la courtoisie de s’arrêter juste au seuil de ma porte. Une colonie de colverts bavards occupe les lieux, les disputant parfois à quelques ragondins qui tracent sur l’eau un sillage d’une inquiétante rectitude. Il arrive aussi qu’un couple de cygnes s’installe sur les marches qui autrefois servaient de lavoir municipal. Arrivé au gué, le fleuve se jette à la mer par une cascade située sous le pont. Son grondement m’a plus d’une fois aidé à m’endormir. Je dis la mer, mais bien que l’eau soit salée et que la marée fasse des va-et-vient du matin au soir, je devrais plutôt parler d’un fond de rade et si j’utilise à dessein le mot fleuve, c’est parce que je n’ai pas encore traversé l’Iénisséï ou l’Amour et que jusqu’à présent, j’ignore encore ce qu’est un vrai fleuve.
Il faut bien vivre quelque part et la maison que j’ai choisie, qui jadis servait d’abattoir à un boucher du bourg, a gardé un petit cachet attendrissant. Question taxe foncière, c’est assez sévère mais la rue est calme si l’on fait abstraction de ce fou furieux qui envoie plein gaz, été comme hiver, sa musique techno par ses fenêtres toutes grandes ouvertes comme s’il voulait annoncer l’imminence d’un quelconque Jugement dernier. Aujourd’hui, il a préféré la mettre en sourdine. Il fait bien. Je ne suis pas d’humeur à supporter ses frasques. J’ai laissé mes gosses à leur mère et j’ai demandé à Véronique, la marchande de couleurs qui tient de l’autre côté de la rue une droguerie comme on n’en fait plus, de ramasser le courrier, d’arroser les plantes et de s’occuper de Doucig. Ma chatte est un peu comme moi, elle n’aime pas les départs. Elle est toute nerveuse et ne cesse de me suivre de la chambre à la salle d’eau, du bureau à la cuisine. Elle traîne entre mes pattes et pousse des cris très désagréables dès que je lui marche sur la queue. Non, elle n’aime pas me voir partir et elle me le fait cruellement sentir. Comme ma mère, elle doit également craindre que je prenne froid, que je ne puisse manger à ma faim ou je ne sais quoi. Boudeuse, elle s’allonge de tout son poids sur la valise pleine à craquer et fait le gros dos, pensant ainsi m’amadouer, ou tout au moins retarder le départ mais peine perdue, j’ai déjà mon billet dans une poche et dans l’autre mon passeport estampillé du visa de la Fédération de Russie avec mon patronyme écrit tout sens dessus dessous en jolies lettres cyrilliques.
« Ne t’inquiète pas, lui dis-je en lui grattouillant le crâne, Véro va s’occuper de toi comme une petite mère. Tu seras une reine ! » J’ajoute que mes dernières volontés ainsi que les détails de ma succession sont couchés sur papier et clos par nécessité dans une enveloppe kraft que j’ai pris soin de poser sur l’ordinateur que je viens de débrancher après avoir vérifié une dernière fois par Internet les températures de Moscou et d’Irkoutsk : –17 ° et –28 °. Un scalpel me tranche le dos en deux. Enfin, je coupe le gaz et le chauffage. Des grandes marées étant prévues pendant mon absence, j’ai installé devant ma porte un dispositif composé d’une planche de bois fixée sur rail et colmatée par une mousse synthétique étanche pour prévenir ou du moins retenir toute inondation.
J’avais eu vent dans je ne sais plus quel livre d’une antique tradition russe. Celle-ci disait qu’avant de partir en déplacement, chacun devait s’asseoir sur ses bagages rassemblés dans l’entrée de la maison et consacrer quelques instants à méditer en silence sur la précarité de l’existence et la vanité des voyages. Par superstition, je suppose, ou pour chercher quelconque consolation, je fis de même, assis sur ma valise, le temps d’une cigarette. Oui, l’existence était précaire et les voyages étaient vains mais l’homme n’avait de cesse de parcourir le monde, de partir à la poursuite du nomade qu’il n’était plus. Piètre consolation, le silence qui régnait alors autour de moi était plus froid qu’une pierre tombale. J’en aurais pleuré.
Au moment où j’ai fermé le portail, Doucig m’a lancé un regard qui ne cessera de me hanter tout au long de l’aventure, un regard éperdu d’amour et d’abandon. L’église Saint-Houardon a sonné les six coups de l’angélus auquel a répondu quelques secondes plus tard le clocher de Saint-Thomas au timbre plus clair et plus guilleret. Se retourner vers le clocher de son village porte malheur alors j’ai préféré regarder devant moi, c’est-à-dire en plein dans les ténèbres. Il faisait nuit depuis déjà plus d’une heure. L’air était humide sans être réellement froid. Les eaux de l’Élorn bouillonnaient sous le pont comme une soupe de goudron.
J’habite à un quart d’heure de la gare et de fait, je suis parti à pied, à la manière d’un pèlerin russe, portant sur mes épaules un petit sac à dos et traînant derrière moi une valise à roulettes qui, dans cette paisible nuit provinciale, faisait le raffut d’une mobylette décalaminée. La moindre des choses aurait été de passer inaperçu mais les gens s’en foutaient finalement de ma destination. Vladivostok ou Pétaouchnok, pour eux, c’était un peu la même chose alors inutile d’aller le brailler sous tous les toits. Les gens ne voyaient qu’un individu de plus, vêtu d’une ridicule parka kaki, qui traînait une valise derrière lui comme un caniche. C’est à peine si ça les amusait. Les gens qui montaient dans ce train-express-régional n’étaient pas des voyageurs. C’étaient des passagers comme l’avait si bien dit le haut-parleur. Ils n’avaient qu’une seule envie : rentrer chez eux en prenant bien soin de fermer la porte à double tour, se glisser bien au chaud dans leurs chaussons avant de s’installer sur le canapé moelleux en demandant à une silhouette apparaissant dans l’embrasure de la cuisine s’il restait de la bière, bordel, dans cette putain de baraque !
Oui, les gens s’en foutaient de moi et de ma valise comme de leur première cuite sauf cette jeune fille, peut-être, debout en face de moi, celle qui portait une demi-douzaine de piercings aux sourcils et aux pieds, des chaussures à faire pâlir Vampirella. Elle, au contraire des autres, semblait n’avoir qu’un seul désir, à voir sa mine renfrognée et son sac surchargé : partir de chez elle, changer de vie, s’enfuir au plus vite, de préférence pour toujours. J’imagine. Ça sert à ça, les trains, partir et revenir, rentrer ou s’enfuir. Ça ne sert qu’à ça. Et puis imaginer. La jeune fille ne cherchait même pas à s’asseoir. Elle se tenait debout, près de la porte, le front collé contre la vitre et semblait fixer avec un air de défi son propre reflet.
Le trajet entre Landerneau et Brest coûte 3,30 € et ne dure qu’une douzaine de minutes. J’avais à peine le temps de ruminer une fois de plus les circonstances qui m’avaient embarqué dans cette galère. L’éditeur, parlons-en ! Un type que je connaissais de loin pour lui avoir acheté il y a quelques années sur le stand d’un salon un globe un peu particulier pour l’anniversaire d’un de mes fils. Par un effet électromagnétique, la petite boule restait en suspension dans le vide, un peu comme notre planète dans le cosmos, sauf qu’il fallait brancher la prise mais l’effet était saisissant. Les premières semaines, on ne se lassait pas de s’extasier devant le phénomène et puis mon fils a grandi et les conneries sont arrivées, les portables, les MP3, les MP4 et le globe a peu à peu perdu de sa magie. L’éditeur me connaissait par mes bouquins, j’avais quant à moi souvent feuilleté ses productions et le hasard voulut qu’au même moment, à l’entrée d’une salle polyvalente de la région brestoise où chaque année se déroule un salon du livre, on ressentît le besoin de s’en griller une petite.
C’est quelque chose que les non-fumeurs ne connaissent pas. En effet, depuis la chasse menée tout feu tout flamme contre les accros de la nicotine, ces derniers ont coutume de se réfugier dans des endroits reculés, des sortes de léproseries, en général situés dans des recoins froids et souvent sinistres, sur des voies de garages en somme et là, ils partagent ensemble, souvent sans se connaître, des moments d’une rare complicité. Un bon plan pour draguer, prétendent certains, ou pour nouer des liens, envisager des affaires. Raison de plus pour ne pas renoncer à la cigarette. En ce qui nous concernait, l’éditeur et moi, c’est ainsi que les choses se sont passées. Il faisait déjà nuit et bien frisquet. Je cherchais du feu. Il m’a proposé une cigarette. Une cigarette ouzbek. Ouzbek d’Ouzbékistan, s’est-il cru obligé de préciser en ajoutant de manière assez laconique que la cartouche entière ne lui avait coûté que trois euros dans un bazar de Samarcande.
– Tu connais ? s’est-il permis de me demander.
– Abdoujaparov, ai-je répondu du tac au tac alors que la flamme de son briquet m’éclairait sur la perplexité de son expression.
– Pardon ?
– Djamolidine Abdoujaparov, un coureur ouzbek. Le roi du sprint dans les années 90. Plusieurs fois maillot vert du Tour de France. Fallait le voir clouer ses concurrents sur place, c’était quelque chose. Un spectacle comme on n’en voit plus.
– Ah, bon ? Bafouilla l’éditeur.
– Je ne sais pas ce qu’il est devenu, ai-je continué. Il a connu son heure de gloire, on se souvient tous de sa remarquable victoire sur l’avenue des Champs-Élysées mais il a dû tremper à son tour dans la piquouze. Comme les autres, contrôle antidopage, condamnation de l’U.C.I. et tout le bordel. Triste.
– Ouais, sans doute…
– D’autant plus qu’aujourd’hui, on a affaire à des guignols, des fumistes. Tom Boonen, Thor Hushvold, ce sont des tâcherons, des besogneux, rien de plus. Regardez-les se chamailler dans les cent derniers mètres. C’est lamentable, non ?
– Excuse-moi, je crains ne pas pouvoir comprendre.
Ça commençait mal, mon futur éditeur ne connaissait rien au cyclisme et, qui plus est, ne paraissait pas en pâtir toujours estil que c’est par le biais tortueux d’un sprinter oublié que nous en sommes venus à parler du Transsibérien. Il parlait de l’Ouzbékistan comme moi j’évoquerais aujourd’hui Brasparts et les Monts d’Arrée à ceci près, comme je l’ai appris par la suite, qu’il se rendait plus souvent à Samarcande que moi à Brasparts. Dieu est témoin que j’étais pourtant à jeun, que nulle drogue ne pervertissait à ce moment-là ma lucidité et pourtant, je me livrais tout à trac à cet inconnu, évoquant ce vieux rêve, ce fantasme d’adolescent qui depuis la lecture d’un poème de Blaise Cendrars ne m’avait guère laissé tranquille. Et pourtant La Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, n’était pas, loin de là, ce que je préférais chez Cendrars, d’autant plus, en rajoutai-je, qu’il y aurait eu tromperie sur la marchandise. En effet, il n’y a aucune preuve tangible que Frédéric Sauser, alias Blaise Cendrars, ait pris le Transsibérien. Mais tout bien réfléchi, était-ce si important que cela ? On dit également que les aventures ibériques racontées par Laurie Lee dans Un beau matin d’été ne sont qu’affabulations. Il n’empêche, c’est peut-être l’un des plus beaux récits de voyage qu’il m’ait été donné de lire.
Très vite, on a laissé tomber ces vaines discussions littéraires pour en venir au fait, à voix basse, puisqu’il était question d’affaires, et à la lueur diaphane d’un réverbère qui, comme il se doit, sentait la pisse de chien.
En résumé, il s’agissait d’une sorte de contrat tacite et somme toute habituel. Je devais transporter à Vladivostok dix kilos de cocaïne pure destinée au marché coréen et escorter au retour une demi-douzaine de prostituées sibériennes jusqu’à Paris sous couvert d’une agence matrimoniale ayant pignon sur rue. Bien évidemment, un « correspondant » m’attendrait à Moscou pour régler quelques problèmes d’intendance. Inutile de marchander, on s’en tiendrait au tarif syndical de la pègre. Rondement menée, la tractation devait s’avérer juteuse. En dollars et en petites coupures, bien évidemment. On s’est frappé virilement la paume des mains et j’ai dit banco puis, sur le chemin de la salle polyvalente, il m’a demandé en posant sa main sur son épaule :
– Abdou… comment déjà ?
– Abdoujaparov, j’ai dit, Djamolidine Abdoujaparov. Retiens bien ce nom-là.
Bien sûr, il ne s’agissait de rien de tout cela. Nulle question de trafic de drogue ou de traite des blanches, il s’agissait de bien pire. Il s’agissait d’écrire un livre. Les éditeurs s’imaginent que pour un écrivain, c’est la chose la plus facile qui soit au monde, aussi simple que pour un couvreur poser des ardoises, pour un comptable faire des additions ou pour un cheminot conduire une locomotive. J’étais pour l’heure dans le TER de 18 h 23 en partance pour Brest et je n’osais même pas sortir de ma poche le joli petit carnet de notes protégé par une couverture en cuir très bien imitée que je venais de me payer dans un magasin du quai de Cornouaille. En fait, je n’avais rien à y écrire sinon mon désappointement. Vampirella contemplait toujours en boudant son reflet dans la vitre par laquelle on pouvait également deviner les illuminations bordant la rade de Brest avant que le train ne s’engouffre soudain dans une tranchée plus ténébreuse que mes pensées.
Dans l’introduction d’un guide que je venais de lire il y a peu, une phrase à la con, sentencieuse à souhait, me revenait en mémoire. L’auteur prétendait à propos de la Sibérie qu’on n’y partait jamais impunément et qu’on n’y revenait jamais indemne. À une vingtaine de kilomètres de là, une chatte abandonnée poussait des miaulements plaintifs qui déchiraient de manière atroce le voile pourpre de la nuit.
BREST
Quelques jours précédant mon départ, j’avais demandé audience à Pierre Maille, le président du Conseil général du Finistère, dans le but avoué de lui chiner quelques pacotilles, colifichets ou ferblanteries à offrir aux indigènes que je croiserais éventuellement sur ma route vers l’Extrême-Orient, ceci bien sûr dans un but éminemment humaniste. Ceux qui connaissent la noblesse de mon âme ne seront pas surpris. Non que je veuille évangéliser la Russie déjà trois fois sainte ni que je me prenne pour un Marco Polo au service de son bon prince mais je suis un garçon bien élevé qui n’arrive jamais les mains vides quand il est invité chez son prochain.
Manquement à l’histoire, Brest tout comme le Finistère n’a jamais entretenu la moindre relation avec Vladivostok. Les deux villes avaient pourtant de quoi se trouver quelconques accointances, ne serait-ce que par leurs affinités géographiques et leur fonction de port militaire mais jusque maintenant rien n’avait été scellé. Le grand explorateur La Pérouse aux commandes d’une expédition navale autour du monde qui partit de Brest en 1785 avait un peu traîné dans les parages. Deux navires en faisaient partie : l’Astrolabe et la Boussole. Quittant le Japon, La Pérouse s’était risqué dans les contrées hostiles de l’île Sakhaline et du Kamtchatka. Le détroit qui sépare Hokkaïdo de Sakhaline porte d’ailleurs son nom. J’ai ouï-dire qu’il aurait fait escale à Pétropavlosk, un port de la côte est où débarqua par la même occasion Barthélemy de Lesseps, l’interprète de l’expédition, chargé de rentrer en France par voie terrestre pour rendre compte à Versailles des avancées de l’expédition et ramener des documents de première importance parmi lesquels les notes et les cartes dressées par La Pérouse en personne. Ce Barthélemy de Lesseps, l’oncle du constructeur du canal de Suez, fut sans doute le premier français à traverser d’est en ouest la Sibérie. C’est sous le titre de Journal Historique du voyage de M. de Lesseps, consul de France, employé dans l’expédition de M. le comte de la Pérouse en qualité d’interprète du roi ; depuis l’instant où il a quitté les frégates Françaises au port Saint-Pierre et Saint-Paul du Kamtchatka jusqu’à son arrivée en France le 17 octobre 1788 qu’il a relaté son périple en deux volumes aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale.
Dans son bureau, Pierre Maille m’évoqua également un cycliste finistérien qui lors d’un tour du monde à vélo avait fait halte à Vladivostok sans qu’il n’y eût de suite avérée. C’était il y a une bonne dizaine d’années. Pour le reste, il me conseillait de m’adresser à la Marine nationale qui de temps en temps envoie ses plus beaux fleurons, la Jeanne-d’Arc en tête, faire escale dans les ports de l’Extrême-Orient. À vrai dire, depuis une petite polémique, je n’étais plus en odeur de sainteté ni dans les couloirs de la Préfecture maritime ni dans ceux du Cercle naval et je préférais me passer de leurs bons offices.
Donc, point de lettre de recommandation, point de réseau ni d’appui, c’est en chemise, pieds et mains nus, que je partais à la rencontre des peuples du Levant. En me serrant la main, Pierre Maille m’assura qu’il ferait de son mieux quant aux cadeaux. En échange, je lui promis solennellement de prendre possession au nom du Conseil général du Finistère de tous les territoires que je découvrirai et d’y planter notre drapeau. Mais la veille du départ je n’avais toujours aucune nouvelle des fameux cadeaux. La mission diplomatique que je m’étais assignée tournait déjà en eau de boudin.
Descendu en gare de Brest, j’avais traversé la gare au pas de charge en direction de la rue de la République où un couple d’amis m’hébergeait pour la nuit. Je devais prendre le lendemain matin le premier train pour Paris, celui de 4 h 43, et j’avais choisi leur domicile pour des raisons, entre autres, de proximité. Les autres raisons étaient moins avouables puisqu’une bouffe était prévue quelque part avec d’autres connaissances communes. Certes, ce n’était pas des plus raisonnables que de se risquer à une fiesta la veille d’une si grande aventure – j’avais même proposé à ces amis de rester chez eux garder leurs deux filles le temps qu’ils se livrent à leurs agapes – mais je me sentais si désemparé qu’un peu de compagnie ne pouvait me faire de mal. On laissa donc les filles à la grand-mère et l’on fila tous les trois directement vers un lotissement flambant neuf de Daoulas dans le but affiché de s’arsouiller toute la soirée au motif que des gens y pendaient leur crémaillère.
On en était à l’apéro quand sonna mon portable. À qui avaisje l’honneur ? Au président du Conseil général lui-même qui s’excusa de son oubli mais se trouvait tout à fait disposé à me livrer sur l’heure et par ses propres soins les cadeaux qu’il avait prévus et qui se trouvaient depuis plusieurs jours dans un coin de son bureau. Il fallait convenir d’un lieu et d’une heure. Difficile car je n’étais ni à Brest ni chez moi à Landerneau. Qu’à cela ne tienne, je le remerciais mais il me voyait navré, je ne trouvais d’autres solutions que de lui demander de laisser son colis dans une poubelle de la rue de la République, celle des amis qui m’hébergeaient. La chose fut entendue mais aujourd’hui encore, je ne peux résister au plaisir d’imaginer le Président du Conseil général roder en pleine nuit autour des poubelles de la rue de la République alors qu’au même moment, comble de la tuile, une patrouille de police faisant sa ronde habituelle aurait surgi à l’angle de la rue.
Il était environ une heure du matin quand nous rentrâmes dans un état plus ou moins aléatoire à la maison sauf pour le conducteur qui une fois de plus s’indigna que celui-ci fût de manière quasi-systématique une conductrice. Passons. Dans le container à ordures de la rue de la République nous attendaient en effet deux grands sacs aux armes du département. Le Président avait bien fait les choses, trop bien même, puisque ma valise déjà pleine à ras bord était bien trop étroite pour accueillir tous ces paquets. On y trouvait des magazines à papier glacés, des beaux-livres vantant les côtes du Finistère, un assortiment de boîtes de conserves de luxe amoureusement fabriquées dans la région, des flacons de bains aux algues et de sels marins et, cerise sur le gâteau, une pièce précieuse à peine sortie du four d’une faïencerie de Quimper, le tout avec les compliments du Conseil général du Finistère. Lestée de ces nouveaux trésors, ma valise était plus remplie que les soutes d’un navire en partance pour Valparaiso.
En bref, j’avais dormi deux heures tout au plus sur le canapé du salon et c’est dans un état second que je filais dès potronminet vers la gare, bien décidé à prolonger ma nuit sur la banquette d’un TGV.
J’ignore quel est son architecte mais la gare de Brest à ceci de particulier qu’elle ressemble à une mosquée. Une tour carrée qui a tout d’un minaret veille sur une sorte de rotonde coiffée d’une coupole, le tout étant badigeonné d’un blanc cru. Un étranger échouant soudainement ici par le plus grand des hasards se croirait sans équivoque en terre d’islam et ne tarderait pas à ôter ses souliers avant d’y pénétrer. Certes, il s’étonnerait assez vite que des haut-parleurs jaillissent d’étranges prières où il serait question de départs et d’arrivées de trains, que le muezzin porte une étrange casquette à étoiles et que les versets du Coran soient affichés en lettres lumineuses défilant sur un grand tableau électronique, à moins qu’il ne se crût déjà parvenu dans une sorte de sas préalable à l’entrée d’un drôle de paradis mais hélas, nul jardin des délices, nulles vierges à sa disposition. Au mieux, on pourrait comparer les gares à un purgatoire et dans toutes celles que je traverserais en Sibérie, je ressentirai toujours cette même sensation de désolation, cette impression d’avoir le cul entre deux chaises.
Le TGV en partance pour Paris partait à 4 h 47. Un changement à Rennes est nécessaire. J’avais la tête dans le coaltar et je grelottais déjà de froid. À ma gauche, une femme abandonna le dernier roman de Nancy Huston pour tenter de poursuivre sa nuit. J’essayai d’en faire autant bien qu’il me soit quasiment impossible de m’endormir dans un train, si discrète soit la marche d’un TGV. Je comptabilisais les toussotements de toutes sortes, les raclements de gorge, les froissements des pages des magazines ou des journaux qu’on tournait avec empressement, les discussions à voix basse, sur le ton de la confidence, les portes automatiques qui ne cessaient de s’ouvrir ou de se fermer, les accoudoirs se rabattant rageusement et ce bébé qui ne savait que geindre autour du généreux téton de sa mère. C’était un brouhaha feutré et permanent auquel il aurait fallu peut-être ajouter mes propres ronflements que j’avais surpris dans un moment d’abandon. D’une délicatesse toute maternelle, ma voisine me réveilla d’un coup de coude juste avant que ma tête ne s’affaissât sur son épaule. Je m’excusai en baillant, elle me lança un sourire indulgent avant de refermer les yeux et de faire semblant de dormir.
C’était ma première compagne de voyage. Je l’observais de biais. Assez jolie, oui, pas mal du tout et le fait qu’elle lise du Huston montrait que je n’étais pas tombé sur la dernière des abruties. Elle était simplement vêtue d’une jupe et d’un chandail mais elle avait pris le temps ce matin de se maquiller légèrement les yeux et de se mettre deux gouttes de parfum sur la nuque qui, de toute évidence, n’était pas à mon intention bien que je n’en perdisse point une miette. À côté d’elle, j’avais l’air d’un rustre tout droit sorti de sa caverne. C’est à peine si j’avais eu le temps de me brosser les dents. Pourtant demeurait le besoin de lui parler, de lui dire deux mots pour qu’elle apprenne qu’à son corps défendant, elle était le premier témoin de cette fantastique aventure humaine et géographique, cet incroyable défi à l’espace, ce rendez-vous solennel avec l’histoire avec un grand H, s’il vous plaît mais, voyageur timoré et maladroit, je n’osais pas, bien sûr. En fait, j’aurais plutôt eu envie qu’elle me prenne très fort dans ses bras, qu’elle m’enveloppe de tout son parfum et qu’elle me sourit comme elle l’avait fait l’instant d’avant en me réveillant, juste envie qu’elle me rassure un petit peu mais j’imaginais qu’elle devait avoir d’autres chats à fouetter, la pauvre fille, et d’autres rêves à caresser qu’un vieux marlou de mon espèce.
« Excusez-moi, Mademoiselle ! »
Ce furent les seules paroles que je lui ai dites pour lui demander de me laisser le passage. Elle fut obligée de se lever et en profita pour ajuster son chandail et défroisser sa jupe. Ses gestes étaient félins, les miens balourds. J’ai enfilé mon bonnet et ma grosse moumoute au-dessus de ma polaire. Je ressemblais à un grizzli, un grizzli kaki qui plus est, puisque j’avais fait mes emplettes dans un surplus militaire du port de commerce fréquenté par les motards et chacun sait que les motards se débrouillent à merveille pour se protéger du froid. Même mes chaussettes étaient de couleur kaki, un stock de l’armée polonaise, avait certifié le vendeur. J’ai attrapé mon sac à dos. J’ai lancé à la demoiselle un regard de gratitude avant d’essayer de me faufiler dans le couloir central pour retrouver mon énorme valise à roulettes. Il était 6 h 48, ça faisait maintenant deux heures que j’étais parti, j’avais parcouru 250 kilomètres et je me sentais déjà à ramasser à la petite cuillère.
Il faisait encore nuit quand je suis descendu à Rennes pour changer de correspondance. Cette autre ligne que je ne connaissais pas allait jusqu’à Lille via Le Mans et quelques arrêts en banlieue parisienne dont Massy, Marne-la-Vallée et bien sûr Roissy. Le train était bondé. Nous étions au début des vacances de février et une flopée de gamins excités comme des poux au prétexte qu’ils étaient en partance pour Eurodisney avaient envahi les wagons avec la ferme intention de pousser les autres passagers hors de leurs gonds. À vous dégoûter de faire des gosses. De la fenêtre, il ne restait plus grand-chose à se mettre sous la dent et ce qu’on voyait, c’était des pavillons de banlieue, des jardins « ouvriers », des terrains vagues, des entrepôts. Quand on traverse les villes en train, dans quelque pays du monde où l’on se trouve, on ne voit que le côté cour des choses et ce n’est jamais ce qu’il y a de plus ravissant. Parfois mais c’était rare, du linge séchait sur le fil malgré le froid et l’absence de vent. Ce linge était à peu près la seule forme tangible d’occupation humaine de ces banlieues. Au loin, se hérissaient les tours de béton des quartiers dits sensibles. Et puis les sempiternels panneaux publicitaires, les pulpeuses des affiches 3615, les terrains de foot, les transformateurs et encore des pavillons, des jardins, des usines abandonnées, des entrepôts, le tout orné de tags et de graffitis comme une longue bande dessinée narrant l’indicible ennui des banlieues et que je lisais en diagonale en essayant d’oublier que c’est aussi dans cet univers que j’avais passé mon enfance.
Enfin, j’ai osé sortir de ma poche mon joli carnet à jaquette imitation cuir pour prendre acte de la difficulté d’écrire dans un train en marche. Aussi mœlleux semblaient les rails, le TGV bougeait dans tous les sens, tanguait et roulait à qui mieux mieux, penchait dangereusement à bâbord comme à tribord pendant qu’une espèce de mal de mer commençait à m’enserrer l’estomac. J’ai gribouillé en tout et pour tout une dizaine de lignes que j’ai attentivement relues avant de déchirer aussitôt la page.
ROISSY
Une amie qui revenait de Nouvelle-Zélande m’avait fait observer qu’entre Auckland et Brest, elle ne s’était pas trouvée une seule seconde à l’extérieur. Tout n’était que couloirs, souterrains, avions, corridors, halls, trains et boyaux. Elle venait des antipodes, avait traversé la planète dans toute sa longueur, parcouru plus de 18 000 kilomètres, et pas une fois l’air qu’elle avait respiré ne venait directement de l’atmosphère comme si les organisateurs de ces réseaux de transports voulaient que les voyageurs ignorent tout de la vraie vie et ne puissent aspirer que l’air aseptisé qui s’échappait des gaines en aluminium. À l’escale de Singapour, les haut-parleurs des couloirs menant d’un terminal à l’autre diffusaient des bruits d’oiseaux ou de cascade tandis que des aérateurs distillaient des parfums de sous-bois. Et partout, des plantes tropicales égrenaient le chemin. S’il n’y avait pas eu ces cinq minutes d’arrêt en gare de Rennes et ces deux heures d’attente à l’aéroport, le même cauchemar aurait pu m’arriver entre Brest et Moscou.
À l’origine, j’avais rêvé de tout accomplir en train du début jusqu’à la fin, ce qui aurait été à n’en point douter beaucoup plus glorieux que ce sandwich famélique et pourtant hors de prix que je grignotais assis sur ma valise dans le grand hall du terminal 2 de Roissy. Un changement aurait été prévu à Cologne pour traverser l’Allemagne, la Pologne et la Biélorussie. J’aurais fait halte à Brest, l’ancienne Brest-Litovsk du traité de paix germano-russe de 1917, c’est-à-dire à la frontière entre l’ex-URSS et la Pologne. C’est ici que les essieux des locomotives et des wagons sont changés de manière à s’adapter à l’écartement des voies, plus large dans l’empire, selon le vœu du tsar Alexandre III et ceci pour d’évidentes raisons stratégiques. Du reste, les armées allemandes lors de l’invasion de 1941 ne purent profiter du réseau ferroviaire soviétique, ce qui explique en partie l’échec de Hitler. 1,63 mètre par rapport au 1,52 mètre occidental pour être précis et mine de rien, ces onze petits centimètres de différence se feront sentir une fois que je naviguerais dans les trains russes, ne serait-ce que pour m’étaler de tout mon long sur la banquette. Pour des raisons de temps et de correspondance, je fus à mon corps défendant obligé de raccourcir mon périple en montant dans cet engin de malheur qui volait par-dessus la banquise et même au-delà des nuages.
Je peux affirmer que l’aéroport international de Roissy-Charles-de-Gaulle est l’endroit que je déteste le plus au monde et encore heureux que je n’emprunte pas souvent l’avion. Tout n’est que béton, murs de béton, plafonds de béton, sols de béton, alvéoles de béton évoquant les pires cauchemars d’une société totalitaire. Bien évidemment, des flics partout comme si le béton, par une loi physique que j’ai encore du mal à m’expliquer, les attirait. Ici, nulle plante verte, nulle diffusion de parfum sinon celui de la sueur des voyageurs exténués et nulle place où s’asseoir, ou si peu que j’en suis à me demander si ce déficit de sièges n’a pas été délibérément voulu. Et surtout, tout n’est qu’attente. C’est exactement le genre d’endroit où l’on peut se faire une idée assez précise du quotidien des porcs engraissés dans les élevages industriels. Les gens se bousculaient devant les guichets comme si leur vie en dépendait. Les gens devenaient fous, objectivement fous, perdaient leur bon sens et le peu d’humanité qui leur restait s’effilochait dans les files d’attente. Les gens auraient été capables d’égorger leur prochain pour ne pas rater un avion qui devait les emmener sous le soleil des Seychelles ou des Antilles.
Le mien devait décoller à 13 h 40. J’avais donc trois heures à tuer au sens premier du terme, trois heures à égorger de sangfroid, à étouffer lentement, à crucifier à moins que ce ne fût ces trois heures qui voulaient ma mort. J’ai tenté une sortie