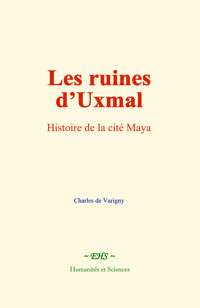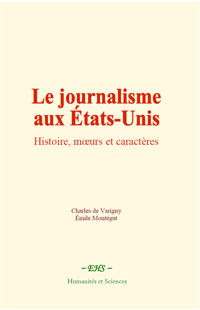
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Si l’on se reporte par la pensée à ce qu’étaient les colonies anglaises et à ce que sont les États-Unis aujourd’hui, on se demande quels puissants engins de civilisation ont pu favoriser, précipiter cet essor si rapide d’un peuple dont l’histoire, pour être courte, n’en est pas moins bien remplie, et à qui n’ont été épargnées ni les épreuves de l’adversité, ni celles, plus difficiles peut-être à supporter, d’une éclatante prospérité. L’exposition de Philadelphie a répondu à ces questions. En assignant à la presse à imprimer la place d’honneur dans la galerie des machines, les commissaires américains ont voulu rendre hommage à cette force dont Napoléon Ier disait qu’elle était plus à redouter que des centaines de mille baïonnettes. Elle l’a prouvé aux États-Unis ; elle y est parvenue à un tel degré de puissance et d’influence, elle a, sous un régime de liberté complète, donné des résultats parfois si inattendus qu’il nous a paru utile de résumer ici l’ensemble de nos études et de nos observations sur le journalisme américain...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le journalisme aux États-Unis.
Le journalisme aux États-Unis
Histoire, mœurs et caractères
Première partie
Le Journalisme aux États-Unis{1}
L’exposition universelle de Philadelphie, en inaugurant dans le Nouveau-Monde ces grandes fêtes de l’industrie dont l’Europe a pris l’initiative, nous a permis de juger des progrès accomplis par les États-Unis dans tous les domaines de l’activité humaine. On peut mesurer le chemin parcouru par cette nation, qui ne compte encore qu’un siècle d’existence, et le sentiment qui domine est celui de l’étonnement. Des critiques de détail ont pu être formulées ; mais, pour qui s’attache à la réalité des choses, les résultats obtenus sont ! prodigieux et de nature à faire réfléchir l’homme d’état et l’économiste.
Si l’on se reporte par la pensée à ce qu’étaient les colonies anglaises et à ce que sont les États-Unis aujourd’hui, on se demande quels puissants engins de civilisation ont pu favoriser, précipiter cet essor si rapide d’un peuple dont l’histoire, pour être courte, n’en est pas moins bien remplie, et à qui n’ont été épargnées ni les épreuves de l’adversité, ni celles, plus difficiles peut-être à supporter, d’une éclatante prospérité. L’exposition de Philadelphie a répondu à ces questions. En assignant à la presse à imprimer de Hoe la place d’honneur dans la galerie des machines, les commissaires américains ont voulu rendre hommage à cette force dont Napoléon Ier disait qu’elle était plus à redouter que des centaines de mille baïonnettes. Elle l’a prouvé aux États-Unis ; elle y est parvenue à un tel degré de puissance et d’influence, elle a, sous un régime de liberté complète, donné des résultats parfois si inattendus qu’il nous a paru utile de résumer ici l’ensemble de nos études et de nos observations personnelles sur le journalisme américain.
Cette histoire de la presse a été faite et bien faite pour la France et pour l’Angleterre. En ce qui concerne ces deux pays, les livres et les documents abondent. M. Hatin, dans son savant ouvrage : Manuel de la liberté de la presse en France, nous a retracé les débuts et les tâtonnements de nos devanciers, les luttes soutenues depuis François Ier jusqu’à la chute du second empire par les journalistes contre les divers pouvoirs qui se sont succédé. M. Germain nous a donné le Martyrologe de la presse de 1789 à 1864. Le même sujet a été traité par M. Fernand Girardin dans son livre : la Presse périodique de 1789 à 1867. En Angleterre, F. Knight Hunt a publié the Fourth Estate, Alexander Andrews the history of British Journalism, James Grant the Newspaper press, its origin, progress and present position. Aux États-Unis, les documens sont rares, et ce n’est que tout récemment qu’un écrivain consciencieux, Frédéric Hudson, a publié sur l’histoire du journalisme en Amérique un livre curieux, plein de faits intéressants, mais groupés sans ordre et d’une lecture fatigante. Avant lui, Isaïah Thomas avait écrit, en 1810, une Histoire de l’imprimerie aux États-Unis, et Joseph Buckingham un ouvrage intitulé : Buckingham’s reminiscences, dans lequel il parle incidemment de la presse dans les états de la Nouvelle-Angleterre. Ce dernier ouvrage parut en 1852 ; l’édition en est épuisée depuis longtemps. C’est à l’aide de ces matériaux divers et des écrits récents de Bennett, d’Henri Raymond et d’autres journalistes éminents qui nous ont laissé dans leurs mémoires les résultats de leurs travaux et de leur expérience personnelle, que nous essaierons de retracer l’histoire du journalisme aux États-Unis, depuis ses débuts jusqu’à nos jours.
I.
C’est en 1438 que l’imprimerie fut découverte à Mayence. Le premier journal connu ne parut que dix-neuf ans plus tard à Nuremberg en 1457. En 1499, Ulrich Zell imprima la Chronick à Cologne. Ces premiers essais informes rappellent les acta diurna qui circulaient de main en main à Rome sous forme de manuscrits, et rendaient compte des incendies, des jugements, exécutions, phénomènes atmosphériques et autres nouvelles locales. L’Italie dispute à l’Allemagne l’honneur de l’avoir devancée dans cette voie, et réclame la priorité pour Venise. La Grazetta, — ainsi nommée suivant les uns parce qu’elle se vendait une grazetta, petite pièce de monnaie d’alors, suivant d’autres du mot grazza, commérage, bavardage, — fut imprimée en 1570. On affirme qu’il en existe des copies dans une ou deux collections particulières à Londres. D’autre part, le catalogue la collection du British Muséum indique un numéro d’une feuille imprimée sous le titre de New Zeitung aus Hispanien und Italien, qui porte la date du mois de février 1534. Ce journal, publié à Nuremberg, et dont on ne possède qu’un exemplaire unique, je crois, contient la nouvelle de la conquête du Pérou. C’est le premier écrit périodique qui rende compte d’un fait extérieur. Voici comment il s’exprime : « Le gouvernement de Panumyra (Panama) a écrit à sa majesté Chartes V qu’un navire venait d’arriver du Pérou avec une lettre du régent Francisco Piscara (Pizarro), annonçant qu’il s’était emparé du pays ; avec 200 Espagnols, infanterie et cavalerie, il avait attaqué un grand seigneur nommé Cassiko (cacique). Les Espagnols avaient été vainqueurs et lui avaient pris 5,000 castillons (pièces d’or), et 20,000 marcs d’argent. Enfin on avait fait payer au même Cassiko 2 millions en or. »
Des journaux que nous venons de citer, si tant est qu’on puisse leur donner ce nom, il ne reste qu’un souvenir confus et quelques rares numéros enfouis dans des collections peu faciles d’accès, A mesure que nous avançons, l’obscurité disparaît, les faits et les dates se précisent. En 1615 paraît à Francfort die Frankfurter-Oberpostamts-Zeitung, qui fut le premier journal quotidien et qui existe encore. Jusqu’ici l’Angleterre ne figure pas sur cette liste chronologique. Ce n’est qu’en 1622 qu’elle prend le cinquième rang avec l’apparition du Weekly Newes, journal hebdomadaire, comme son nom l’indique, et qu’elle précède la France de neuf années. En 1631, la Gazette de France, est publiée à Paris. La Suède, l’Ecosse, la Hollande, inaugurent successivement l’ère du journalisme en 1644, 1653 et 1656.
C’est en 1690 que paraît à Boston le premier journal publié aux États-Unis sous le titre de Publick Occurrences. On a cru longtemps que le News Letter, publié quatorze ans plus tard, était le doyen des publications périodiques américaines. Il n’en est rien ; les recherches faites par le rév. J.-B. Felt constatent que la priorité appartient sans conteste à Benjamin Harris, éditeur du Publick Occurrences. J’ai sous les yeux une copie de son premier numéro, daté Boston, 25 septembre 1690. L’éditeur débute modestement : « Mon intention, dit-il, est de fournir au public une fois par mois un compte-rendu de ce qui pourrait se passer d’important. Si, par extraordinaire, il venait à ma connaissance quelque nouvelle sérieuse dans l’intervalle, je publierai une feuille extra. Je prie toutes les personnes honorables de Boston de me tenir au courant. Considérant surtout qu’il importe de faire la guerre à l’esprit de mensonge, je n’imprimerai rien dont je n’aie contrôlé l’exactitude, et si je commets quelque erreur involontaire, je la rectifierai dans le numéro suivant. » Il n’en eut ni le temps ni le loisir. Ge programme hardi, ou du moins qui parut tel aux autorités anglaises, attira sur la tête de l’éditeur la censure administrative ; dans les vingt-quatre heures, les exemplaires furent saisis, et Benjamin Harris invité à s’occuper d’autre chose que de renseigner, une fois par mois, ses concitoyens sur ce qui pouvait se passer à Boston ou ailleurs. Ce début était peu encourageant. Harris quitta Boston, se rendit à Londres et y fonda en 1705 le Post, qui vit encore et occupe un rang distingué dans la presse anglaise.
Pendant quatorze ans, aucune nouvelle tentative ne fut faite. De temps à autre, on recevait quelques feuilles imprimées à Londres ; on les lisait à haute voix sur les places publiques, elles circulaient ensuite de mains en mains jusqu’à ce qu’elles tombassent en morceaux, ou qu’un riche individu s’en rendît propriétaire. Maculées, à peine lisibles, elles se vendaient encore une livre sterling. Le génie pratique des Américains ne pouvait longtemps s’accommoder d’un pareil état de choses, et la presse allait faire son apparition définitive ; dans quelles conditions et dans quel milieu politique et social ? C’est ce que nous allons examiner. Pour avoir une idée du chemin parcouru, il importe de se rendre un compte exact du point de départ. Le contraste est tellement grand entre les colonies anglaises de l’Amérique en 1690 et la puissante république qui achève de célébrer l’anniversaire séculaire de son indépendance qu’aucun pays à aucune époque de l’histoire n’en a offert de pareil.
Les colonies anglaises comptaient alors près d’un million d’habitants de race blanche et de nègres, la plupart esclaves. Cette population, dispersée sur la côte et sur les rives des grands fleuves, était comme perdue dans un espace immense. Peu de grandes villes, quelques villages, beaucoup de fermes très éloignées les unes des autres, et çà et là sur la frontière française ou indienne quelques campements de hardis colons, pionniers, chasseurs, trappeurs, ainsi se groupaient dans les colonies du nord les occupants du sol. Boston et Philadelphie étaient alors les villes principales ; elles renfermaient chacune environ 8,000 habitants. New-York, qui naissait à peine, en avait 6,000, et offrait l’aspect d’un grand village. On tirait tout d’Angleterre : en fait de commerce, celui du cabotage existait seul, mais déjà les populations des côtes s’exerçaient à la pêche et préludaient par de timides essais aux entreprises hardies qui devaient les entraîner plus tard à la poursuite des cachalots jusqu’aux régions du pôle. L’argent était rare, presque inconnu ; on avait recours aux échanges. En 1635, les achats se soldaient au moyen de balles de fusil ; une balle équivalait à un sou. En 1652, on frappa quelques pièces de monnaie ; pendant trente ans, on se servit de la même matrice et les pièces ainsi frappées portèrent toutes la même date. Les routes étaient rares. Une diligence reliait New-York à Philadelphie et mettait deux jours à faire ce trajet ; aussi l’avait-on surnommée l’Éclair, Le système postal était des plus primitifs ; on expédiait les lettres de New-York à Boston une fois par mois. Benjamin Franklin fut un des premiers directeurs de la poste ; il raconte que, pour développer le système postal, il visita, avec sa fille Sally, les diverses stations, et qu’il mit cinq mois à ce voyage, que l’on peut accomplir aisément aujourd’hui en cinq jours.
Par contre, l’éducation fit de bonne heure de grands progrès. Les puritains émigrants avaient apporté avec eux et implanté dans ce continent à peine connu deux idées fortes et vivaces : le sentiment religieux auquel ils avaient tout sacrifié, et comme complément direct le culte de la Bible. Cela impliquait la lecture assidue des livres saints : aussi vit-on, dès le début, partout où se groupaient quelques colons, s’élever le temple, construction aussi grossière et primitive que les cabanes de troncs d’arbres, et la maison d’école. Si pauvres, qu’ils fussent, ils ne reculaient devant aucun sacrifice de temps et de travail pour satisfaire à ces deux besoins de leur nature. A Boston, où fut fondée la première école, chaque famille donnait par année un boisseau de maïs ou 1 fr. 25 c. en argent pour le soutien de l’école et de l’instituteur. En 1700, dix pasteurs se réunirent dans une salle d’école, et déposèrent sur une table une dizaine de volumes chacun, en disant l’un après l’autre : Je donne ces livres pour aider à la fondation d’un collège dans le Connecticut. Telle fut l’origine du Yale College.
Alors comme aujourd’hui l’instituteur était entouré d’une grande considération. Il était, après le ministre, l’homme le plus estimé et le plus influent de la communauté. Il jouissait de privilèges particuliers et exerçait une juridiction spéciale sur les parents, qu’il pouvait même contraindre à envoyer leurs enfants à son école.
Si des colonies du nord nous passons à celles du sud, le contraste est frappant, et nous retrouvons en germe ces divergences de vues et d’idées qui devaient aboutir, le 12 avril 1861, au premier coup de canon tiré par les confédérés sur le fort Sumter, et à la guerre civile la plus longue et la plus sanglante des temps modernes. L’esprit puritain dominait d’une manière absolue dans les états de la Nouvelle-Angleterre. La vie sociale était gouvernée par les préceptes de la loi religieuse, dont la loi civile n’était que le reflet et la consécration. Cette vie grave, austère, condamnait l’homme à lutter contre les penchants de sa nature dans l’ordre moral, de même que le climat et les difficultés de la vie matérielle l’obligeaient à un labeur incessant. Le plaisir sous toutes ses formes, même les plus modestes, était banni, La musique était condamnée comme un instrument de Satan, le chant dans les temples devait être sans accompagnement. Amos n’avait-il pas écrit : « Je ne veux plus entendre la mélodie de tes violes ? » L’élément puritain, fortifié par d’élément hollandais, qui colonisa New-York, réussit, dans les premières années, à faire dominer ses vues et ses tendances dans les colonies du sud ; mais, bien que la race fût la même, le milieu était changé. Les conditions de la vie étaient autres, autres aussi le climat, les productions du sol. La grande divergence des peuples du nord et des peuples du midi s’accusait et s’accentuait, en attendant l’heure de la lutte inévitable, lutte aujourd’hui terminée en apparence.
Le point de départ de ces deux civilisations parallèles est le même. Chez toutes deux, nous retrouvons les mêmes traits caractéristiques : l’amour de l’indépendance, le sentiment religieux. Mais dans le nord la nature même du sol et du climat limite l’indépendance excessive et facilite le groupement de la population ; dans le sud, au contraire, tout favorise et développe le premier au détriment du second. Dans les états de la Nouvelle-Angleterre, l’église est le centre autour duquel se construisent les habitations. Constamment en lutte avec la nature, l’homme a besoin de se rapprocher de l’homme, l’isolement est un danger et une difficulté nouvelle ajoutée à tant d’autres.
Les conditions de la vie sont bien différentes dans la Virginie, dans la Caroline du sud. Les colons qui s’y fixent se recrutent dans une autre classe de la population anglaise que les émigrants du nord. Les modestes ressources de ces derniers les contraignent au travail aussitôt débarqués et ne leur permettent pas les dépenses nécessitées par un long et coûteux voyage pour ce rendre de New-York ou de Boston dans les colonies du sud. De grandes concessions de terres ont d’ailleurs précédé les colons. Certaines familles de l’aristocratie anglaise ont reçu de la couronne, à titre d’apanage ou de don, de vastes espaces incultes qu’elles abandonnent aux fils cadets. Ces dernière viennent demander à ce nouveau continent la fortune que leur enlève le droit de primogéniture, et la vie large et facile à laquelle ils sont habitués. Des plantations se fondent, isolées les unes des autres ; le sol, puissamment riche, donne en abondance le nécessaire et bientôt le superflu.
Si la vie est rude et simple, si le luxe et le confort n’existent pas encore, les éléments qui les constituent ne font pas défiant ? d’abord la grande propriété, puis un nombreux personnel de serviteurs ou d’esclaves ; les travaux d’une plantation l’exigent. Les chevaux importés d’Angleterre se multiplient rapidement sous ce climat où l’hiver est presque inconnu. Le planteur du sud, à cheval dès le matin, parcourant son estate, dirigeant ses nombreux travailleurs, retrouve ici la vie anglaise du gentleman farmer. Il sait commander et se faire obéir. Souverain absolu de tout ce qui l’entoure, il peut donner à ses goûts, plus athlétiques qu’intellectuels, pleine satisfaction. Combats de taureaux, courses, classe, tels sont les seuls plaisirs à sa portée, et ce sont ceux que les puritains du nord ont le plus en horreur. Çà et là quelques rares églises s’élèvent dans le voisinage des plantations, mais elles sont peu fréquentées, les distances sont grandes, et les plus proches voisins s’y rendent, seuls, Pour aller d’une plantation à l’autre, il faut remonter ou descendre en bateau les grands cours d’eau, ou parcourir à cheval, par des chemins à peine tracés, de vastes espaces. La vie sociale est à peu près nulle au début, et le sentiment de l’individualité se fortifie de tout ce que perd l’instinct de sociabilité.