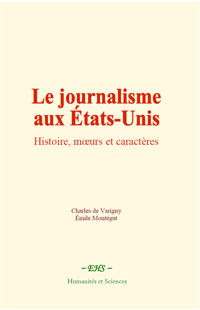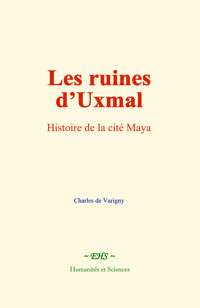
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Vous ignorez l’existence des ruines d’Uxmal ? Vous ne savez pas qu’il y a là, enfouie dans les forêts, toute une ville indienne, des palais gigantesques qui s’écroulent, des sculptures étranges, des hiéroglyphes indéchiffrables ? En 1854, deux Américains, Stephens et Catherwood, ont passé ici une année à étudier ces ruines, et ils ont publié à Boston un récit de leurs découvertes qui a fait, m’a-t-on dit, grande sensation dans le monde savant…
Uxmal est désert. L’herbe croît dans la Cour du Nain, et la forêt enserre de sa formidable étreinte les grands palais muets dont les épaisses murailles chargées de hiéroglyphes, de bas-reliefs et d’idoles, semblent défier les efforts du temps. Les siècles seuls en auront raison. Ces derniers vestiges d’un peuple inconnu et d’une civilisation éteinte disparaîtront-ils à leur tour sans livrer leur secret ? La science un jour nous dira-t-elle quelles mains les ont élevés, quelles races les ont habités ?...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Charles Victor Crosnier de Varigny, né le 25 novembre 1829 à Versailles et mort le 9 novembre 1899 à Montmorency, est un journaliste, voyageur et homme politique franco-hawaïen. Naturalisé, il séjourna quatorze ans à Hawaï, jusqu'à la chute de la monarchie, et y devint même ministre sous le règne du roi Kamehameha V.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les ruines d’Uxmal
Les ruines d’Uxmal
Histoire de la cité Maya
Première partie
I.
Le 15 octobre 1867, le brick Montezuma, déployant toutes ses voiles à la brise alizée, doublait le cap San-Antonio, pointe extrême de l’île de Cuba, et se dirigeait en droite ligne vers le sud-ouest. Depuis trois jours il avait quitté les parages fréquentés des grandes Antilles. Pas un navire ne se montrait à l’horizon, et sur les eaux bleues de la mer du Mexique le Montezuma seul traçait son sillage profond. Le soleil se couchait dans l’ouest empourpré et ses rayons obliques teintaient de rose la crête des grandes lames que la houle de l’Atlantique chassait par le détroit de Cordova. Assis sur le pont, deux jeunes gens causaient.
— Si mon calcul est exact, et il doit l’être, nous serons après-demain en vue de terre.
— Oui... si le vent tient, si le courant est favorable, et si notre capitaine ne se grise pas abominablement.
— Voilà bien des si... Mais le vent est bon, le baromètre monte, et quant à Pedro, s’il se grise, ce sera avec de l’eau claire, car j’ai les clés de la cambuse. Restent les courants, nos cartes n’en font pas mention.
— Pas plus que de ceux de los Colorados, où nous avons perdu deux jours à lutter contre un jusant qui nous poussait dans la mer du Honduras. Je crois, Fernand, qu’il y a quelque chose de plus menteur qu’une épitaphe, c’est une carte marine des côtes du Yucatan.
— On y vient si rarement.
— On devrait n’y pas venir du tout. Près d’un mois pour franchir les 22 degrés qui nous séparent de New-York, et cela dans un siècle de chemins de fer et de bateaux à vapeur, c’est absurde.
— Que veux-tu ? Tout le monde ne possède pas vingt lieues de terre dans le Yucatan.
— Pour ce que cela rapporte ! Je n’en tire pas par an de quoi payer un déjeuner chez Delmonico.
— Alors tu persistes dans ton idée de mettre ces terres en valeur ?
— Je crois que oui ; mais sur ce point tu me conseilleras.
— Ton père avait toujours ajourné ce projet.
— C’est vrai, mais il avait, lui, autre chose à faire. Le gouvernement mexicain lui devait en 1854 des sommes assez considérables pour des fournitures faites à l’armée. Hors d’état de s’acquitter, il offrit en paiement une concession de terrains dans le Yucatan ; faute de mieux, mon père s’en contenta, il fit mettre ses titres en règle, puis ne s’en occupa plus. Un grand négociant de New-York ne pouvait s’attarder à ces détails. Les spéculations avec l’Angleterre, la Chine, le Pérou, absorbaient toute son attention, et voilà comment il m’a laissé, outre deux cent mille dollars de revenu, ces vingt lieues de terre que je vais visiter par curiosité ou par devoir, je ne sais trop. Ce disant, George Willis alluma un cigare et s’absorba dans la contemplation d’un banc de poissons volants dont il suivit avec curiosité le vol inhabile et les capricieux plongeons.
George Willis et Fernand de C… étaient cousins. Le père de George, armateur à New-York, mort depuis deux ans, avait légué à son fils une fortune considérable, mais une fortune américaine, embarquée dans des spéculations sur toutes les mers et sous tous les climats. George Willis la réalisa prudemment, lentement et fit preuve en cette circonstance d’une entente des affaires que son père avait toujours mise en doute. De fait George ne les aimait guère, et ne s’en occupait que contraint et forcé : il leur préférait les voyages, les études historiques et passait volontiers, à observer, le temps que ses compatriotes emploient à agir. Sous une apparence flegmatique, il cachait un cœur généreux, capable de dévouement pour les autres et d’enthousiasme pour les grandes causes. On le tenait pour un original, il le savait et n’y contredisait pas, estimant qu’il eût été fort en peine de s’analyser lui-même.
Une vive amitié l’unissait à son cousin Fernand, plus âgé que lui de deux ans. La mère de Fernand, sœur du père de George, avait épousé à Washington M. de C…, alors secrétaire de la légation de France. Fernand avait perdu son père et sa mère de bonne heure. Recueilli par son oncle qui prit soin de l’orphelin et administra habilement sa petite fortune, Fernand, hardi et aventureux, fit partie de l’expédition du colonel Williamson à travers l’Amérique. Géologue expérimenté, dessinateur habile, savant modeste et homme de ressources, il rendit d’utiles services et fut, à son retour, désigné par le gouvernement pour le tracé des frontières indiennes. Quand éclata la guerre de sécession, Fernand, dont toutes les sympathies étaient du côté du sud, donna sa démission et attendit les événements. La lutte terminée, il aida son cousin à liquider les affaires de la succession paternelle et consentit à l’accompagner, séduit par la perspective d’un voyage avec George Willis dont il appréciait les qualités sérieuses et auquel il portait une affection toute fraternelle.
Fernand ne s’était pas trompé dans ses calculs nautiques, et le surlendemain à la pointe du jour le brick mouillait en rade de Sisal, à l’extrémité nord de la presqu’île du Yucatan.
En temps ordinaire. Sisal, le second port du pays après Campêche, est aussi totalement dépourvu d’intérêt que de navires. Du pont du Montezuma on apercevait des terres basses, sablonneuses, plaquées çà et là d’une végétation rabougrie. Les pluies abondantes des derniers mois avaient converti la plaine environnante en un vaste marais d’où surgissaient de rares îlots couverts d’herbe. Dans le lointain, par delà le port, d’immenses forêts dessinaient une ligne continue de feuillage qui fermait l’horizon. La chaleur était étouffante, les rayons du soleil pompaient l’humidité, et une vapeur miroitante et confuse s’élevait lentement de la plaine surchauffée.
— Sisal promet, dit George Willis, accoudé sur le bastingage.
— Mais oui, ce paysage ne manque pas d’originalité. Il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu’ici.
— M’est avis que le pays mérite sa réputation d’être un des plus fiévreux qu’il y ait, sur la côte du moins. Si tu m’en crois, nous ne ferons pas long séjour à Sisal, et nous nous hâterons de gagner Mérida.
Les jeunes gens donnèrent l’ordre de débarquer leurs bagages, et pendant que l’on procédait à cette opération assez compliquée grâce aux approvisionnements commandés par George Willis, qui n’avait qu’une médiocre confiance dans les ressources locales, ils se rendirent à Sisal où leur présence ne laissa pas de faire une vive impression sur la population. On n’avait depuis longtemps vu d’étrangers si bien mis ; ils n’étaient ni marins ni acheteurs d’écaillés, ils semblaient disposés à payer un bon prix pour ce qu’ils demandaient ; aussi en moins d’une heure se furent-ils procuré une caleza pour eux et deux caretas pour leurs bagages. On entassa sur ces dernières les malles, les caisses de provisions, vivres, conserves, et à neuf heures du matin, la caravane s’ébranla à la grande admiration des oisifs, c’est-à-dire des six cents habitants de Sisal, dont quelques blancs, nombre de mestizos ou métis, et une grande majorité d’Indiens mayas.
Dans l’après-midi, nos deux voyageurs arrivaient à Mérida et se faisaient descendre chez dona Micaëla. Mérida est la principale ville de cette partie du Yucatan, et dona Micaëla est, après le curé, la personne la plus importante de Mérida. Elle loue des chambres aux rares voyageurs de passage, elle fait leur cuisine, sait quelques mots d’espagnol et d’anglais, entend mal l’une et l’autre langue, et traduit en maya, pour le bénéfice de ses auditeurs, les nouvelles qu’elle bâtit sur les fragments de conversation qu’elle peut surprendre et qu’elle croit comprendre ; dona Micaëla est la gazette de Mérida, une autorité qui ne se discute pas. Elle accueillit de son mieux les deux cousins, leur prépara en toute hâte un repas très passable, des chambres suffisamment propres, mais fut fort désappointée de ce qu’ils parlaient en français, langue dont personne à Mérida ne savait un traître mot. Prévenu par elle, le curé vint, suivant l’usage, rendre visite aux voyageurs.
Ainsi que presque tous les prêtres du Yucatan, le curé de Mérida était un métis, d’origine espagnole par son père. Il avait reçu une certaine éducation ; ses études, commencées à Campêche, s’étaient achevées à la Havane. Il parlait bien l’anglais et l’espagnol et possédait à fond la langue indienne. Ses paroissiens l’adoraient, et il le méritait. Excellent homme, d’humeur joviale, indulgent pour les peccadilles, inflexible sur le chapitre des droits de l’église, il ne trouvait pas mauvais qu’après avoir assisté au service divin jeunes gens et jeunes filles passassent l’après-midi à danser. Il avait un faible pour les combats de coqs, tolérait la loterie, passion des mayas, et prenait un vif intérêt aux courses de taureaux. Partisan déclaré des vieux usages, il excellait à donner aux assemblées patronales et aux foires locales de Mérida un éclat qui attirait de dix lieues à la ronde les rancheros et les Indiens.
Le lendemain était la fête de saint Cristobal. Depuis quinze jours le curé Carillo n’en dormait guère. Il dirigeait les préparatifs de la cérémonie, allant de l’église à la salle de bal, exerçant ses choristes, surveillant les femmes chargées de préparer les vêtements du saint. Tout était prêt et non sans peine. Le curé Carillo tenait fort à ce que les deux voyageurs assistassent à la fête ; leur présence lui paraissait indispensable, et il employa toute son éloquence à les persuader. Assuré de leur assentiment, il donna libre cours à sa joie : — Vous verrez quelque chose de beau, leur dit-il, et puis c’est demain le bal des mestizas. — Il leur expliqua alors qu’après la cérémonie religieuse, dans l’après-midi, aurait lieu un bal de jour, célèbre dans tout le district sous le nom de bal des mestizas. Les Indiens n’y figuraient que comme simples spectateurs. Les rancheros ou propriétaires des environs y venaient avec leurs femmes et leurs filles. Les cavaliers n’étaient admis qu’en costume de vaqueras, et les danseuses étaient habillées en mestizas ; tuniques blanches, flottantes, bordées de rouge autour du cou et de la jupe, colliers et bracelets d’or.
— Il y aura de bien jolies filles, ajouta le curé, avec le clignement d’yeux d’un connaisseur, jolies et sages. Je crois même, mais là-dessus je ne puis rien affirmer encore, que dona Mercedes y sera.
— Qui est dona Mercedes ? demanda Fernand.
— Au fait, c’est la première fois que vous venez ici, et vous ne connaissez pas dona Mercedes. C’est la plus belle personne du Yucatan. Elle n’habite pas Mérida, mais Uxmal, à quelques milles d’ici. Vous avez entendu parler d’Uxmal ?
— Nullement.
— Quoi ! vous ignorez l’existence des ruines d’Uxmal ? Vous ne savez pas qu’il y a là, enfouie dans les forêts, toute une ville indienne, des palais gigantesques qui s’écroulent, des sculptures étranges, des hiéroglyphes indéchiffrables ? En 1854, deux Américains, Stephens et Catherwood, ont passé ici une année à étudier ces ruines, et ils ont publié à Boston un récit de leurs découvertes qui a fait, m’a-t-on dit, grande sensation dans le monde savant.
— C’est vrai ! reprit George Willis, et j’ai parcouru ce volume. Tout m’y a paru extraordinaire. Ainsi Uxmal existe, près d’ici, et est habitée.
— Dona Mercedes y vit, dit le curé d’un ton plus grave. Tout le territoire sur lequel se trouvent ces ruines lui appartient. C’est une jeune fille aussi singulière que belle et bonne. Venue ici, de Mexico, il y a plus d’un an, elle a fait réparer quelques pièces dans la casa del gobernador, et, malgré mes avis et ceux des gens sensés de Mérida, elle est allée s’y installer avec sa sœur, ses domestiques femmes et quelques Indiens. Dona Mercedes vient rarement ici et, comme on ne va jamais à Uxmal, elle ne voit personne.
— Et pourquoi ne va-t-on jamais à Uxmal ?
— Ces ruines inspirent dans tout le pays une terreur superstitieuse. Les Indiens n’en approchent qu’avec répugnance, tous ceux du moins qui sont bons chrétiens. On ignore par qui ces palais ont été construits. Leurs formes bizarres, les figures grimaçantes sculptées le long des murs, les fièvres qui règnent dans les forêts en éloignent tout le monde. Ce n’a pas été sans peine que dona Mercedes a pu trouver parmi les Indiens quelques serviteurs disposés à la suivre dans cette solitude. On raconte, ajouta le curé en baissant la voix, qu’autrefois ces ruines étaient peuplées d’idoles et que les Antiguos, comme on désigne ceux qui les habitaient, y faisaient des sacrifices humains. Pour moi, je n’en sais rien et n’en veux rien savoir. Les Indiens d’ailleurs n’ont là-dessus que des traditions bien vagues. Tout ce que je puis dire, c’est que je regrette que dona Mercedes ait eu cette fantaisie. — Mais elle a des parents, des amis ?
— Non ; cependant on prétend que la famille de sa mère habitait Mérida il y a bien, bien longtemps. Elle a été élevée loin d’ici. On ajoute qu’orpheline depuis quelques années, elle aurait acheté au gouvernement mexicain les terres d’Uxmal, d’autres disent qu’elle en a hérité d’une parente de sa mère. Quoi qu’il en soit, elle est généreuse et me donne largement pour les pauvres, sans compter ce qu’elle a dépensé à la casa del gobernador, où elle a fait faire de grands travaux.
Le curé Carillo achevait de dîner avec les jeunes gens. Dona Micaëla s’était surpassée pour ses hôtes. Un flacon de vieux porto avait délié la langue du bon prêtre, et tous trois, au dessert, fumant d’excellens puros, passaient la soirée à causer. On dut pourtant se séparer d’assez bonne heure, le curé alléguant avec raison les fatigues que lui tenait en réserve la journée du lendemain. Restés seuls, les voyageurs, peu disposés au repos, tentèrent vainement de faire parler dona Micaëla et d’obtenir d’elle quelques renseignements sur la belle Mercedes et les ruines d’Uxmal. Très loquace d’ordinaire, l’hôtelière ne l’était pas sur ce sujet, et, soit qu’elle ne sût rien ou ne voulût rien dire, elle embrouilla si bien le peu de mots anglais et espagnols qui faisaient le fond de son répertoire qu’ils renoncèrent promptement à leur entreprise.
— Attendons à demain, dit flegmatiquement George Willis ; je me méfie un peu de ces réputations locales de beauté. J’ai trop voyagé pour n’avoir pas remarqué que les gens ont le crâne et les yeux faits différemment. Quant aux ruines, c’est une autre affaire, et j’en aurai le cœur net. J’ai visité celles d’Europe, d’Asie et d’Afrique ; les États-Unis n’en ont pas et pour cause, et on m’a si mal enseigné la géographie que je ne savais pas même le nom d’Uxmal.
— A en juger par ce que nous dit le curé, ces ruines valent bien une visite ; mais il ne faut pas qu’elles nous fassent négliger le but de notre voyage.
— Cousin Fernand, ne soyons pas trop impatiens. Voici douze ans que mes terres attendent la visite de leur propriétaire. Quand elles attendraient encore quelques semaines, cela n’a que peu d’importance. Nous sommes à Mérida, bien approvisionnés de tout ce qui est nécessaire à l’existence. La ville me paraît originale, le curé me plaît, dona Micaëla fait les tortillas en perfection, la saison des pluies est finie, il y a ici près des ruines que l’on dit intéressantes, une jeune fille mystérieuse que l’on dit belle ; rien ne nous presse, personne ne nous attend nulle part... ne brusquons pas la vie.
— Soit, seulement je croyais que ton intention était de passer une partie de l’hiver en Europe. — Ici ou là, qu’importe ? Nice est charmant en février, et Paris en mai, j’en conviens, mais je connais Nice et Paris. Je sais d’avance ce que j’y ferai. Tu m’écriras de longues lettres ; tu blâmeras ma vie, oisive il est vrai, inoffensive après tout. Ici je rencontre sans l’avoir cherché un problème archéologique ; il me prend fantaisie de l’étudier, de le résoudre peut-être, où est le mal ? J’ai grimpé, moi cinq cent millième, dans la pyramide de Chéops, où je n’ai trouvé que de la poussière et des puces. Tout le monde connaît l’Egypte, on ne connaît pas le Yucatan. Voilà une bonne raison, j’espère. Puis enfin et surtout nous serons plus longtemps ensemble.