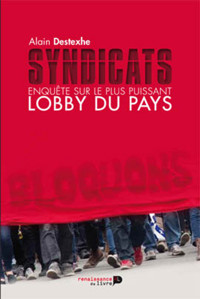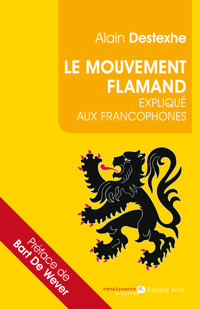
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le mouvement flamand a joué un rôle fondamental dans la transformation de la Belgique. Pour comprendre la position flamande sur Bruxelles, les « facilités » et BHV, il est nécessaire d’en revenir à l’histoire. Or, cette histoire tellement actuelle, peu de francophones la connaissent. La frontière linguistique, l’unilinguisme en Flandre, le bilinguisme intégral à Bruxelles : toutes ces revendications plongent leurs racines dans le mouvement flamand qui naît après 1830. Saviez-vous que la traduction officielle de la Constitution ne date que de 1967 ? Que l’université de Gand n’est devenue flamande qu’en 1930 ? Que le mouvement wallon est né à... Bruxelles, Gand et Anvers en réaction aux revendications flamandes et que ce sont les francophones qui se sont opposés au bilinguisme de la Belgique ? Aujourd’hui, en Flandre, les revendications des « flamingants » ont gagné tous les partis. Une histoire du mouvement flamand de 1830 à nos jours pour mieux comprendre la crise actuelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Mouvement flamand expliqué aux francophones
Alain Destexhe
Préface de Bart De Wever
Nouvelle édition revue et augmentée
[C’est l’histoire du] curé wallon auquel unFlamand vient se confesser et lui dit : « Excusez-moi mon père, je suis Flamand ». Et le bon curéwallon, goguenard, de répondre : « Ne vous en accusez pas mon fils, ce n’est pas un péché, c’est un malheur ».
Jules Destrée
Annales parlementaires, Chambre, 1913
Préface Bart De Wever
Alain Destexhe est un homme courageux. Un homme qui ose naviguer à contre-courant. Un homme qui a une opinion claire et qui n’hésite pas à la défendre. Je lui tire mon chapeau pour son attitude courageuse pendant et après la visite parlementaire en Corée du Nord, où il a été l’un des seuls à exprimer publiquement ses critiques par rapport au régime en place et à la situation misérable du peuple nord-coréen. Et je ne peux qu’exprimer ma plus grandeadmiration pour le rôle qu’il a joué lorsqu’il était secrétaire général de Médecins Sans Frontières. Alain Destexhe est ce que nous appellerions en Flandre un « Tijl Uilenspiegel ». Un homme qui, par sa soif de liberté et d’engagement à contre-pied, met la société face à son reflet, sans aucun détour.
C’est également cette approche à contre-courant de la pensée dominante qui a profondément marqué sa carrière politique nationale. L’analyse économique qu’il s’est permis d’avancer dans son ouvrageWallonie, la vérité des chiffreset sa critique du système socialiste wallon en sont de bons exemples. Son analyse du drame rwandais ou sa vision de la politique belge témoignent également de cette clarté. Et cette subversion est une caractéristique que j’affectionne particulièrement. Pourtant, Alain Destexhe n’est pas un exalté. C’est un citoyen qui souhaite servir sa communauté et qui, pour ce faire, n’hésite pas à nous montrer la réalité. Même si nous souhaiterions ne pas être confrontés à celle-ci. Alain Destexhe ne mâche pas ses mots et n’est pas du genre à flatter son prochain. En bref, un homme comme je les aime.
J’ai donc pris beaucoup de plaisir à lire son ouvrageLe Mouvement flamand expliqué aux francophoneset j’ai été très honoré qu’Alain Destexhe me demande d’en rédiger la préface de la seconde édition. Cette initiative démontre également une certaine bravoure, car il n’est pas évident deproposer une telle tribune à un homme qui est parfois présenté comme un « Milosevic flamand » par certains médias francophones.
Naturellement, je n’approuve pas la totalité des idées présentées dans ce livre. J’ai, de certains épisodes, une interprétation différente de celle de l’auteur et je n’aurais pas formulé certains passages de la même manière. Ces divergences sont frappantes et plutôt éloquentes. Pour les Flamands, la scission de la KUL (l’Université Catholique de Louvain) est, par exemple, toujours considérée comme la victoire morale du mouvementLeuven Vlaams, tandis que pour les francophones, cette même scission constitue un traumatisme collectif lié au slogan «Walen buiten !». Cela donne la mesure de la différence avec laquelle nous percevons les mêmes faits historiques. Et parfois, nous sommes très semblables dans ces perceptions divergentes. Les Flamands et les francophones sont unis dans le fait qu’ils considèrent tous deux les lois de 1932 et de 1962 comme une défaite pour leur communauté. Les complaintes liées aux gifles reçues sont peut-être des éléments qui nous unissent ?Heureusement,Le Mouvement flamand expliqué aux francophonesdépasse largement les clichés et stéréotypes mutuels entre les Flamands et les francophones. C’est loin d’être une présentation maussade de quelques Wallonsfainéants et autres Flamands fascistes. Alain Destexhe adopteune position neutre et donne une image honnête de l’histoire. Une histoire qui n’est pas toujours reluisante, chose qu’il faut également oser reconnaître.
J’espère sincèrement que cet ouvrage contribuera à une meilleure compréhension entre Flamands et francophones. Je ne peux que conseiller de lireLe Mouvement flamand expliqué aux francophonesà tous ceux qui souhaitent mieux comprendre la soif d’autonomie flamande et s’intéressent, avec un esprit ouvert, à la vie de la Flandre. Le livre que vous tenez en main en est une excellente introduction, mais ne présente que le volet historique. C’est pourquoi je souhaiterais un instant exploiter cet ouvrage très enrichissant pourque nous tournions ensemble le regard vers l’avenir. Vers mes attentes réelles : celles du nationalisme flamand démocratique.
Les aspirations contemporaines flamandes en faveur d’une plus grande autonomie ne sont pas dictées par une rancœur historique due aux « souffrances infligées » dans le passé. Elles ne constituent pas non plus une réaction à la soi-disant dominance culturelle des francophones, ni au prétendu dénigrement du peuple flamand. Les Flamands qui prétendent encore aujourd’hui être victimes de l’oppression se leurrent complètement. La Flandre occupe une position relativement forte et a le devoir moral d’être solidaire avec ses voisins. La motivation de la recherche d’autonomie flamande n’est pas la rancune, mais bien une soif de gestion démocratique et efficace. Pour les Flamands comme pour les francophones.
Comme vous le lirez dans cet ouvrage, la Belgique créée en 1830 était une nation francophone, dirigée par une élite francophone en mesure de maintenir sa domination politique, grâce au suffrage censitaire, sur une population flamande majoritairement pauvre. Ce suffrage censitaire excluaitles Flamands du processus démocratique et les condamnait à la marginalité sociale et culturelle. Le Mouvement flamand qui vit alors le jour se présenta comme un mouvement réformateur. Son ambition n’était pas de scinder la Flandre de la Belgique, mais bien de redéfinir la démocratie belge, de sorte que les Flamands puissent participer, en tant qu’individus égaux, au processus démocratique. L’introduction du suffrage universel tempéré par le vote plural en 1893 fit entrer la masse flamande dans la démocratie belge, ouvrant ainsi la porte à la lutte pour l’égalité des droits, l’abolition des barrières linguistiques (et donc sociales) et la justice sociale.
Le professeur Herman Van Goethem considère l’introduction du suffrage universel tempéré par le vote plural comme la première fissure dans l’unité de la Belgique, le point de jonction critique où les voies flamande et wallonne se séparent. Car le Mouvement flamand a échoué dans sa mission de redéfinir la démocratie belge. L’élite politique n’a accepté les réformes qu’à contrecœur et a toujours tenté d’en tempérer les conséquences, ce qui a entraîné une radicalisation de l’opinion publique flamande et alimenté la méfiance des francophones vis-à-vis des réformes. Une méfiance motivée par la crainte de se voir minorisée au sein de la Belgique par une majorité démographique flamande.
La réponse à cette crainte a pris la forme d’un mécanisme de protection politique : le choix initial des francophones du principe de territorialité plutôt que du principe de personnalité (avec pour conséquence la frontière linguistique), la parité politique, les recours récurrents aux majorités des deux tiers, les verrous de la Constitution, les lois à majorités spéciales, la procédure dite « de la sonnette d’alarme », les conflits d’intérêts… : au lieu de créer une seule démocratie belge, où Flamands et francophones auraient été unis dans une même nation, on a tenté de créer une démocratie francophone afin de contrer la majorité flamande. Cette démocratie francophone s’est greffée sur la nation belge, faisant passer la Flandre d’un regroupement d’identités régionales à une sous-nation puis à une contre-nation. Le pays s’est scindé en deux populations.
Actuellement, la Belgique n’est plus une démocratie. C’est un pays à deux courants : la démocratie flamande et la démocratie francophone. Chacune de ces deux démocraties possède ses propres partis, ses propres médias, son propre consensus social et politique et, grâce à la fédéralisation, ses propres institutions politiques. Lorsque le commissaire européen Karel De Gucht affirme que la Belgique n’est pas une démocratie mais bien une conférence diplomatique permanente entre deux États, ce n’est pas de la propagande nationaliste flamande mais un simple constat : ce pays est bien composé de deux démocraties.
Cette réalité est renforcée par le fait que les centres politiques de ces deux démocraties sont fortement éloignés l’un de l’autre. En Flandre, la majorité des avis estime que le rôle des autorités doit être limité, autant dans l’économie que dans la société, que le marché et la communauté doivent faire leur travail et que les autorités peuvent uniquement soutenir ce fonctionnement. En Belgique francophone, la pensée majoritaire veut, par contre, que les autorités jouent non seulement un rôle actif dans l’économie et la société, mais aussi qu’elles régulent ou contrôlent ces deux aspects. Après des élections fédérales, ces deux démocraties se regroupent pour négocier la formation d’un gouvernement fédéral. Et c’est là que les choses coincent. Le résultat de ces visions divergentes aboutit à une quasi-non-gestion dont personne ne veut dans un pays qui combinela pression fiscale et la dette parmi les plus élevées au monde.
En confiant la responsabilité du processus décisionnel aux entités fédérées, nous augmentons non seulement la légitimité démocratique, mais nous renforçons également nos régions au niveau économique. Une plus grande autonomie doit permettre à la Wallonie, grâce à une gestion adaptée, de retrouver le chemin de la justice sociale ainsi quesa position de communauté riche, économiquement forte. La Wallonie a besoin des compétences nécessaires pour mettre en œuvre une politique qui réduise l’écart de prospérité et de taux d’emploi entre la Wallonie et la Flandre. LaWallonie a besoin d’un marché du travail spécifique et d’unepolitique de l’emploi adaptée, d’une politique fiscale propre et d’une culture d’entreprise dynamique et innovante. Je suis convaincu que si la Wallonie reçoit ces compétences, elle entamera enfin une véritable relance économique.
Les Flamands et les francophones ne sont pas des ennemis. Nous partageons le même passé et nous partagerons toujours l’avenir. La question est toutefois de savoir comment nous allons organiser cet avenir. Je n’aspire pas du toutà ce « Grand Soir » qui sonnerait l’heure de la Flandre. Je ne suis pas un révolutionnaire. Plus encore, je m’oppose à ce type de radicalisme. Mais je suis malgré tout le fervent partisan d’une évolution en douceur vers une autonomie accrue,vers une plus grande démocratie. Une évolution qui renforcera la Flandre et la Wallonie et qui préservera la solidarité entre le nord et le sud de notre pays.
Nous devons réformer ce pays. Et ce n’est pas une sinécure. Les problèmes et les divergences d’opinion auxquels nous faisons face sont immenses. Et le gouffre semble souvent infranchissable. La compréhension des points de vue mutuels, des visions, des aspirations et des craintes des uns et des autres fait office de flambeau dans notre quête desolutions politiques. Alain Destexhe, avec le présent ouvrage,apporte une contribution particulièrement éclairante à ce sujet.
Bart De Wever
Président de la N-VA
Introduction
Je me répète : s’il était possible de réaliser les réformes indispensables dans l’État Belgique, je ne m’y opposerais pas. Mais ce n’est pas possible. Les Wallons, et les socialistes en particulier, en tant que premier parti francophone, empêchent toute réforme sensée. C’est ce qui me fait dire : la Belgique ne fonctionne plus ! La Belgique est une nation qui a échoué.
Bart De Wever,Der Spiegel, 2010
Le 13 juin 2010, la Belgique connaît un séisme politique. Près de 50% des Flamands votent pour des partis nationalistes. La victoire de Bart De Wever et de la N-VA à l’occasionde ces élections anticipées constitue un tournant historique pour le Mouvement flamand ; l’aboutissement électoral, sinon politique, d’un combat commencé dès 1830.
Ce succès nationaliste s’inscrit dans une longue histoire que les francophones connaissent mal. Pour comprendre les arguments des partis flamands au sujet de Bruxelles, de BHV, de l’emploi des langues, du territoire ou du statut des francophones de la périphérie, il est pourtant indispensable de connaître les principales étapes de l’histoire du Mouvement flamand. En effet, tant la Commission des griefs de 1856, qui avait pour objectif, déjà, de « résoudre la question flamande », que les cinq résolutions votées par le Parlement flamand en 1999, en passant par le succès de la N-VA, s’inscrivent dans une continuité historique.
Pendant longtemps, la Belgique, dirigée par une élite francophone, tenta de résoudre la question flamande par des lois linguistiques. À partir de 1873 dans les domaines de la justice, de l’administration et de l’enseignement, puis en 1898 avec la grande loi sur l’égalité des langues. Les années 1930 virent la consécration de l’unicité linguistique de la Flandre (à la demande des francophones) ainsi que l’apparition de cette notion si typiquement belge des « facilités linguistiques ». L’histoire du Mouvement flamand fut également marquée par les deux guerres mondiales qui le discréditèrent, une frange radicale tentant d’utiliser le conflit pour liquider la Belgique. Les années 60 constituèrent uneautre étape importante, avec la fixation définitive de la frontière linguistique (ainsi que la suppression des recensementset de la possibilité de changer de régime linguistique), mais aussi avec de nouvelles revendications liées à l’autonomie culturelle, notamment relayées par la Volksunie. Couplées au programme régionaliste d’une partie de la classe politique wallonne, ces demandes accouchèrent d’une Belgique fédérale, un fédéralisme que, 60 ans plus tôt, un grand leader flamand comme Frans Van Cauwelaert rejetait encore catégoriquement.
Rappelons quelques étapes importantes :
– 1854 : unification de l’orthographe entre la Flandre et les Pays-Bas ;
– 1873 : première loi linguistique ;
– 1888 : premier discours en néerlandais à la Chambre ;
– 1898 : loi d’égalité des langues ;
– 1930 : enseignement en néerlandais à l’Université de Gand ;
– 1931 : première déclaration gouvernementale bilingue ;
– 1932 : frontière linguistique ;
– 1936 : traduction simultanée à la Chambre et au Sénat ;
– 1963 : fixation « définitive » de la frontière linguistique ;
– 1967 : traduction officielle de la Constitution en néerlandais ;
– 1994 : fédéralisation de l’État ;
– 1999 : cinq résolutions votées au Parlement flamand ;
– 2010 : la N-VA devient le premier parti en Flandre.
Le Mouvement flamand : une mouvance
Le Mouvement flamand et son histoire ne se réduisent ni à un parti, ni à une succession de lois : c’est une mouvance, un groupe informel d’organisations et de personnes qui rassemble des défenseurs de la langue, des régionalistes, des nationalistes et des séparatistes. Depuis la création de la Belgique, il milite pour l’émancipation de la Flandre et des Flamands, mais celle-ci a pris différentes formes au cours del’Histoire : unification de la langue, « flamandisation » de l’enseignement, lois linguistiques, lien entre un territoire et une langue, régionalisme et fédéralisme. Aujourd’hui, il se partage essentiellement entre nationalisme, « confédéralisme » et, chez certains, réelle aspiration à l’indépendance.
Il existe une constante dans l’histoire du Mouvement flamand. Par la force des choses, il s’est construit en se positionnant par rapport à la Belgique, à la langue française et aux francophones, souvent en opposition avec ceux-ci.
La première édition de ceMouvement flamand expliqué aux francophonesa été épuisée en quelques mois. Cette seconde édition est une refonte complète de la première. Le texte a été profondément remanié pour le rendre plus lisible. Le nombre de chapitres a été augmenté, mais nombre de détails historiques superflus ont été éliminés. Le dernier chapitre, qui retrace l’évolution depuis 1960, a été dédoublé et développé pour tenter de mieux expliquer la période récente qui aboutit au succès de la N-VA.
À l’heure où notre pays se trouve dans une impasse politique qu’il se doit pourtant de surmonter, alors que les médias du nord et du sud du pays présentent à leurs opinions publiques respectives des visions radicalement différentes de la crise et de l’évolution du royaume, il nous semble plus que jamais nécessaire de comprendre les racines historiques des revendications flamandes actuelles.
Ce livre est écrit par un francophone attaché à la Belgique. Il cherche d’abord à établir les racines historiques de la crise actuelle, mais aussi – sans le partager et, dans ce cadre, sans le juger – à mieux faire comprendre le discours dominant en Flandre.
Le consensus flamand
La majorité des Flamands se retrouve aujourd’hui dans un projet qui est méconnu ou incompris du côté francophone. Certes, la plupart de nos compatriotes néerlandophones se déclarent toujours attachés à la Belgique. Mais, pour eux, le maintien d’une Belgique fédérale passe par une profonde régionalisation de presque toutes les compétences, y compris la sécurité sociale, la dette belge, voire l’arméedans le cadre d’une armée européenne. Certes, la plupart des Flamands ne s’opposent pas au maintien d’une forme de solidarité dans un cadre belge, mais ils ne veulent plus payer pour le retard économique de la Wallonie dont ils attribuent la cause à des politiques trop à gauche et au rôle dominant du Parti Socialiste au sud du pays. Aux dernièresélections, à peine 21,5 % del’électorat flamand a voté pour un parti de gauche (sp.a et Groen!) alors que le seul PS a obtenu plus de 37% des voix en Wallonie.
Bruxelles constitue, à mon avis, le grand traumatisme refoulé de nombreux Flamands puisque la majorité des habitants parlaient encore au début du XXesiècle un dialecte brabançon flamand que le français a progressivementsupplanté. Le Mouvement flamand a clairement pour objectif improbable, voire impossible, d’arrêter la progression du français dans la périphérie, tout en tentant de masquer de diverses façons cette omniprésence du français dans une capitale historiquement flamande. Outre le caractère intangible de la frontière linguistique, qui fait l’unanimité au nord du pays, les partis flamands n’ont cessé ces dernières années d’invoquer un arrêt de la Cour constitutionnelle pour toucher à un autre « tabou » politique belge : l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV).
Enfin, les revendications en faveur d’une vaste réformede l’État ont été coulées dans cinq résolutions votées en 1999par le Parlement flamand. Un véritable programme politique qui n’a pas connu le moindre début d’application, ni dutemps du Premier ministre Verhofstadt (1999-2007), ni sous les gouvernements Leterme et Van Rompuy de 2007 à2010.
Beaucoup de Flamands ont le sentiment que la minorité francophone a voulu imposer une « mise au frigo » des revendications de 60% de la population belge. Et cette donne a pesé lourd dans le blocage que nous avons connu de 2007 à 2010, dans les résultats des dernières électionsmais également dans l’acharnement de ces partis (au premierrang desquels la N-VA et le CD&V) à refuser toute forme d’accord intérimaire (même socioéconomique) sans avoir au préalable pu conclure un accord communautaire majeur pour la Flandre.
La dimension économique de la crise
L’idée de séparation administrative entre le nord et le sud a d’abord été avancée, dès la fin du XIXesiècle, par des francophones (à l’époque on disait des « Wallons »). Dans les années 60 et 70, la Wallonie a par ailleurs connu, sous l’impulsion de syndicalistes et de leaders politiques socialistes, un fort courant régionaliste qui préconisait rien moins que la scission de la sécurité sociale et de toute la politique économique.
Certains leaders politiques, et non des moindres, continuent à tricher avec l’Histoire. Au nord, pour affirmer l’existence d’une nation flamande préexistant à une Belgique qui ne serait qu’une parenthèse. Au sud, pour soutenir que le nord a longtemps bénéficié de la solidarité du sud. S’il est vrai que les travailleurs flamands ont immigré en masse enWallonie et sont devenus de bons Wallons unilingues, fautede volonté politique de leur accorder le moindre droit linguistique (équivalents à ceux longtemps réclamés par les francophones de Flandre), les transferts d’une région à l’autren’ont pris toute leur ampleur qu’avec le développement de la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale. Dès 1965, la richesse par habitant en Flandre dépassa celle de la Wallonie. Et cela fait donc maintenant plus de 40 ans que les transferts (incontestables, même si l’ampleur en est discutée) vont dans le même sens – Bruxelles étant un cas à part.
La dimension économique n’est pas assez prise en compte dans les analyses de la crise actuelle. Depuis le milieu des années 60, l’écart économique entre les deux grandes régions du pays n’a cessé de se creuser, même si cet écart, important, semble s’être stabilisé. Cinquante ans après le début de son déclin économique, la Wallonie souffre d’un taux de chômage avoisinant les 15% (contre 7% en Flandre) et hypothèque son avenir avec un enseignement en dessous de la moyenne de l’OCDE, alors que la Flandre caracole en tête des classements PISA. Autre statistique interpellante, celle relative au PIB : la Flandre se situe 16% au-dessus de la moyenne européenne des 27 (pays de l’Est compris), alors que la Wallonie se situe 17% en dessous de la moyenne établie par Eurostat, le Brabant wallon tirant les statistiques vers le haut.
En Flandre, on considère que chaque Flamand paye 1000 euros par an pour la Wallonie. Il est probable que si les deux plus grandes régions du pays se trouvaient à un niveau socioéconomique équivalent, le débat se poserait tout à fait autrement. Peut-être même ne se poserait-il pas. Et il n’est pas impossible que, dans quelques décennies, les historiens mettent davantage l’accent sur ces données socioéconomiques que la polarisation du débat communautaire tend à occulter.
Des occasions manquées
M’étant plongé durant quelques mois dans l’histoire de la Belgique et du Mouvement flamand, je suis frappé par les occasions manquées de construire une Belgique bilingue. Refus d’accorder le moindre droit culturel aux Flamands en Wallonie, refus de construire un État bilingue dans les années 30, refus du bilinguisme pour les fonctionnaires des administrations centrales, refus d’une administration bilinguesur l’ensemble du territoire, refus d’imposer le néerlandais comme seconde langue obligatoire dans l’enseignement francophone, et j’en passe.
Il est probable que le coup de grâce fut donné par la scission des partis traditionnels sur une base linguistique. Depuis lors, chaque parti est condamné à une sorte de surenchère communautaire permanente dans sa propre communauté linguistique. Aucun autre État fédéral ne fonctionne sans partis fédéraux ! Voilà pourquoi je n’ai guère d’admiration pour ces générations d’hommes politiques belges de l’après-guerre qui ont développé, au fil des décennies, ce soi-disant modèle belge fait de compromis permanents, mais qui portait en lui les germes de sa propre condamnation. À chaque grande étape historique, d’autres options politiques étaient possibles. Peu de responsables politiques ont osé les proposer à l’époque. S’il est trop tard désormais pour faire marche arrière, gageons qu’une meilleure connaissance de l’autre et de ses aspirations permettra à nos deux communautés de mettre un point final à ce fédéralisme évolutif (« fédéralisme de crise », commel’appellent certains politologues) qui mine notre pays depuis 40 ans et l’empêche de s’atteler aux réformes profondes qui lui permettraient de faire face aux grands défis du XXIesiècle.
chapitre 1
Avant 1830
Belgia, the Netherlands.
William Shakespeare
Le Mouvement flamand n’existe pas avant l’indépendance de la Belgique et si la démarcation entre parlers romans et germaniques est ancienne, la Belgique n’est nullement concernée par la question linguistique avant le XIXesiècle.Durant des siècles, ce que nous appelons aujourd’hui la Flandreest en fait le comté de Flandre avant de devenir les provinces du même nom.
Une démarcation linguistique « naturelle »
La séparation linguistique apparaît avec les invasions germaniques. Avant la conquête des Gaules par les Romains, nos régions sont occupées par plusieurs tribus celtes qui se reconnaissent elles-mêmes comme « belges ». Lorsque Jules César envahit la Gaule (50 av. J.-C.), le territoire des Belges devient une province romaine et, progressivement, le latin remplace les langues celtiques.
À partir du IIIesiècle, le pouvoir romain commence à s’effriter, l’Empire se désagrège, permettant aux Francs de traverser lelimes, cette frontière qui délimite les territoires romains. Ils s’installent en très grand nombre au nord de l’actuelle frontière linguistique, pour des raisons qui restent floues. Les populations locales auraient ensuite tout naturellement adopté les parlers germaniques de leurs envahisseurs. Le sud de la Belgique, vraisemblablement plus peuplé que le nord, aurait vu en revanche les Germains se fondre parmi les Belges romanisés.
L’Empire de Charlemagne, qui englobe nos régions,tombe en 843. Jusqu’au règne de Charles Quint (1519-1556), nos régions sont séparées par l’Escaut, frontière naturelle entre la Flandre – terre du royaume de France – et la Lotharingie, qui fera bientôt partie du Saint-Empire germanique. Si l’on veut vraiment parler d’une ligne de fracture, il faut la voir selon un axe nord-sud.
La bataille des Éperons d’or : la légende des dissensions communautaires
À partir du IXesiècle, les grands seigneurs de nos contrées acquièrent des privilèges et s’émancipent des pouvoirs royaux et impériaux.
Le comte de Flandre est à la tête de la principauté la plus septentrionale de France. Elle couvre la partie occidentale de la Belgique et une partie du nord de la France actuelle et comprend des populations aux parlers germaniques, mais aussi romans. Ce puissant souverain, qui compte parmi les Grands du royaume de France, est donc à la tête d’un territoire qui ne correspond que très partiellement à la région flamande actuelle. Il s’exprime en français, de même que la noblesse, et son administration est également régie par cette langue. Le Limbourg actuel, la province d’Anvers et le Brabant ne sont alors en rien des « territoires flamands ».
Au XIIIesiècle, dans le comté de Flandre, les patriciens – ou membres de la classe urbaine dirigeante – et la noblesse soutiennent la France. On les appelle lesLeliaerts, en référence au lys qui représente la France. En face d’eux, lesKlauwaerts–klauwsignifiant griffe, en référence au lion adopté comme emblème par le comte de Flandre – rassemblent les petits bourgeois et les artisans des villes. Ils sont soutenus par le comte Gui de Dampierre, favorable àl’Angleterre. Furieux de l’alliance de son vassal le comte de Flandre avec les Anglais, le roi de France Philippe le Bel l’emprisonne et occupe le comté. Mais les Flamands se révoltent. Dans la nuit du 18 mai 1302, un millier de partisansdu roi de France sont massacrés lors des « matines brugeoises ». Philippe le Bel envoie une armée de 50000 hommes près de Courtrai, où 20000 bourgeois et artisans, soutenus par des troupes namuroises et brabançonnes, les attendent de pied ferme. Les chevaliers français s’élancent mais, malgré leur nombre, ils se heurtent auxgoedendag, les lourdes lances dressées par lesKlauwaerts. Les Français s’embourbent dans les marécages et, acculés aux murailles de Courtrai, sont massacrés. Le jour de la victoire, le 11 juillet 1302, les vainqueurs ramasseront des dizaines d’éperons d’or sur le lieu de la bataille qui trouvera ainsi son nom. Symbolisant la fin des visées du roi de France sur la Flandre, elle ne comporte aucune dimension linguistique ou culturelle au sens où on l’entend aujourd’hui. On oublie par ailleurs trop souvent que les milices flamandes reçurent une aide salutaire des milices namuroises et brabançonnes. Le roi de France prend sa revanche deux ans plus tard, lors de la bataille de Mons-en-Pévèle. Surpris par la résistance des troupes flamandes, il fait le choix d’une paix négociée.