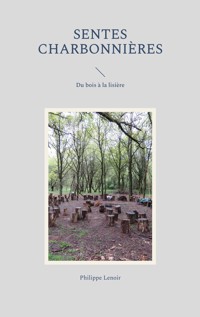Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'historienne Françoise Brunel écrivait : "Des acteurs célèbres de la Révolution, Billaud-Varenne est l'un des plus mal connus. " Pour les royalistes de la Restauration, il fut le prototype des "buveurs de sang" . Pour les libéraux de la monarchie de Juillet, il était le héros qui ne plie pas, qui a refusé la grâce offerte par Bonaparte. Sa destinée s'achève en terre américaine : à Cayenne , où il survit à quatre ans de prison, cultive ses girofliers auprès de sa compagne guadeloupéenne Virginie, puis à Saint-Domingue devenue Haïti , première terre noire libre grâce au général mulâtre Pétion, qui lui sert une pension jusqu' à sa mort en 1819. Cette grande figure de la Convention montagnarde se dérobe au jugement de l'historien : où situer celui qui a condamné Danton avant de jouer un rôle décisif dans la chute de Robespierre ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Billaud était la terreur pure ; il ignorait solidement et volontairement le passé, et il n'avait au cœur aucun sens de l'avenir ... Billaud sans sourciller eût proscrit toute la vie. »Michelet
« La pensée sociale de Billaud-Varennes est bien plus large, plus forte, plus pénétrante. Ce n’est pas seulement une sorte de révolte occasionnelle de l’esprit déterminée par le renchérissement momentané des subsistances, il a sondé les plaies profondes et permanentes d’une société où la propriété de quelques-uns refoule le plus grand nombre dans la misère et la servitude. »Jaures
Sommaire
Portraits
De la déportation à l’exil
Nature
Vertu
Liberté – Égalité – Fraternité
Institutions et régénération du peuple
Représentant du peuple
Qu’un sang impur
Flectere si nequeo superos acheronta movebo
Moments Thermidor
Épilogue
Postface
Bibliographie
Index
Portraits
Dans son exil de la Guyane, Jacques Nicolas Billaud-Varenne*, une des premières victimes de « la guillotine sèche », demande à son père les œuvres de Salluste, Cicéron, Montaigne, Locke, Montesquieu, Rousseau … qu’il veut relire. Ainsi, répudié par l’Histoire à Cayenne, sa destinée s'achève en terre américaine. A Cayenne , il survit à quatre ans de prison, cultive ses girofliers auprès de sa compagne guadeloupéenne Virginie*, puis à Saint-Domingue devenue Haïti, première terre noire libre grâce au général mulâtre Pétion, qui lui sert une pension jusqu' à sa mort en 1819.
Cette grande figure de la Convention montagnarde Billaud-Varenne se dérobe au jugement de l'historien. Pourtant, à la tribune des Jacobins, à la tribune de la Convention, il réclame le premier la mise en accusation du roi, l’abolition de la royauté et l’instauration de la République (ni Robespierre, ni Danton, ni même Marat n’y songeaient). Il s’oppose à la guerre à outrance des Girondins ; il réorganise l’armée (avec Carnot), veille à l’approvisionnement de Paris et des grandes villes ; il établit les règles pointilleuses de la comptabilité nationale (avec Lindet), soutient l’affranchissement des esclaves (avec l’abbé Grégoire) ; il s’échine à faire cesser les guerres de l’Ouest … Mais l’historiographie ne retiendra contre lui que la mise en accusation des Girondins, celle d’Hébert et des Ultras, l’élimination de Danton, l’acquiescement à la Grande Terreur, avant de jouer un rôle décisif dans la chute de Robespierre ‒ le prix du sang. C’est ainsi que François Boddaert introduit le personnage dans son livre « De la vertu, disparue des tribunes. »
Pour les royalistes de la Restauration, il fut le prototype des " buveurs de sang ". Pour Michelet, « la Terreur pure », et selon Richir « une machine à tuer ».
Pour les libéraux de la monarchie de Juillet, il était par contre le héros qui ne plie pas, qui a refusé la grâce offerte par Bonaparte. Camille Desmoulins*, qu’il envoya aussi à la guillotine, l’appelait « le patriote rectiligne » !
Mais d’abord portons notre curiosité sur son apparence physique. Quelques portraits nous le décrivent.
L’un est de 1790. Il a été réalisé par Jean-Baptiste Greuze, le peintre le plus moralisateur de son temps et prodigieux portraitiste, auquel il fit appel. L’homme est pensif, regard sombre et grave, bouche serrée et menton ferme. Il sort de sa poche intérieur un livret vert. S’agit-il d’un ouvrage de sa propre composition ou d’un traité sur le Droit naturel ? Peut-être un livre de Burlamaqui ou de Vattel ? Peut-être est-ce le peintre qui demanda au modèle d’accepter ce portrait ? On sait combien Greuze était attiré par la morale et la vertu.
L’autre de 1791 est de Jeanne Doucet de Surigny qui le représente en redingote rayée, plus souriant et curieusement portant perruque. Et pourtant ces deux portraits avec leurs particularités respectives peuvent se superposer.
Pour Arthur Conte, « il est court de taille, sans qu’il fasse petit. Il respire la gravité. Vous découvrez un visage très pâle et allongé, un front bas de coriace, des yeux enfoncés, peu mobiles, dont vous pouvez avoir l’impression qu’ils louchent, très légèrement. La bouche est secrète. L’homme ne rit jamais, sourit peu. Les lèvres, minces, elles-mêmes pâles, ne sont certes pas d’un épicurien. Excepté à la tribune, il parle peu. Il est toujours sobrement – et sombrement – vêtu, toujours très correctement, jamais débraillé, jamais chiffonné. Vous imaginez aussitôt un pasteur, dur, probe, convaincu, qu’on ne doit pas aisément décourager, intimider, contredire. »
Un autre témoignage vient de Louis-Ange Pitou, poète et chansonnier, déporté lui aussi en Guyane où il le vit et le décrit : « Billaud tranquille marchait à pas comptés, la tête haute, un perroquet sur son doigt qu'il agaçait d'une main nonchalante, se tournait par degrés vers les flots de la multitude à qui il donnait un rire sardonique ne répondant aux malédictions dont on le couvrait que par ces mots à qui l'accent donne beaucoup d'expression dans la bouche d'un homme de son caractère: Pauvre peuple ! … Jacquot ! Jacquot ! … Viens-nous-en, Jacquot ! »
Le capitaine Bernard qui habitait près de chez lui à l’Hermitage à Cayenne, décrit « sa haute stature fière … sa figure large et pâle … sa physionomie pleine de douceur … sa perruque rousse taillée à la jacobine … un accent, des manières annonçant une distinction que son costume, plus que simple, ne peut effacer ».
Je le vois effectivement plutôt grand que court de taille et sa pâleur me semble exagérée car trop plaquée à l’image du vampire qu’on souhaite trop souvent lui donner. Un troisième portrait par J. Gauchard étonnamment et malencontreusement dénommé portrait de Billaud-Varennes, est en fait celui d’un théologien méthodiste Anglais, Samuel Drew, mais qui pourrait bien convenir à son image, en tout cas à celle que je me suis construite en imagination.
De son dernier portrait, écoutons le docteur Chervin qui venait souvent le visiter à Haïti:
" Le temps avait creusé profondément ses joues et fatigué sa forte tête ; sa figure, plus pâle que jamais, était devenue d’une maigreur effrayante ; elle semblait plus longue, plus resserrée et plus expressive. Ses cheveux, autrefois noirs et plats, qui simulaient la crinière du lion, suivant des paroles devenues historiques, étaient tout blancs. Ses regards, seuls, avaient conservé leur premier feu, et quelquefois leur fixité terrible ; on sentait bien, en l’approchant, qu’il restait encore en lui quelque chose des habitudes d’un ancien grand pouvoir, mais ce n’était que passagèrement qu’on s’en apercevait. Vous étiez-vous débarrassé de certains souvenirs, sa figure redevenait à vos yeux calme et bienveillante, malgré le reste de fierté que Billaud ne pouvait cacher ".
portrait par Jean-Baptiste Greuze – 1790
portrait par Jeanne Doucet de Surigny - 1791
dessin par Ken Welsh - Engraved by J. Gauchard after D. Bocourt. From "Histoire de la Révolution Française" by Louis Blanc.
De la déportation à l'exil
Billaud était assis sur un fauteuil en osier et voyait de sa terrasse arriver le jeune Colombel*, lequel, sur son cheval, lui fit signe. Déjà une semaine qu’ils avaient quitté Port au Prince pour atteindre les Mornes Charbonnières avec sa bien-aimée et dévouée Virginie. Il pensait qu’il se reposerait mieux dans ces hauteurs ventées loin des chaleurs de la plaine et de l’humidité de la côte. Deux ânes avaient porté leurs affaires et son corps bien fatigué jusqu’à destination, voyage qui dura toute une journée. Il sentait la fin venir et n’était pas mécontent de voir son ami qui souhaitait relever par écrit son histoire ou, plutôt, préférait-il penser, sa justification. Tant de souffrances endurées depuis les événements tragiques de la Révolution, puis sa déportation en Guyane et maintenant son exil à Haïti. Tant de souvenirs, d’images innombrables dans sa tête, ses discours à la Convention, les tumultes des débats, les cours pavées ensanglantées, la guillotine et puis pour lui la « guillotine sèche », sans jugement, et les moiteurs nauséabondes des marais de Sinnamary, les serpents, les moustiques, les fièvres et la dysenterie qui peu à peu l’amenait au tombeau. Il appela Virginie pour qu’elle aide Colombel à attacher son cheval et pour préparer un punch de sa composition qui ravissait plus d’un palais. Le soleil se couchait vers l’île de la Gonâve qu’on devinait au travers des grands pins qui faisaient la fraîcheur des Mornes.
Noël Colombel, jeune mulâtre ambitieux et intelligent, était le secrétaire particulier de son Excellence le Président de la République Haïtienne, Alexandre Pétion. Il aimait partagé avec Billaud ses réflexions sur la République, et, en accord avec ce dernier, s’était engagé à rédiger un récit historique de la Révolution Française. Sentant la mort prochaine du grand Conventionnel, ils avaient convenus de se revoir un soir ou deux chez celui-ci. Billaud se leva pour inviter son ami à s’asseoir à coté de lui et demanda à Virginie de partager ce moment avec eux .
Mon ami, dit Billaud, je souhaiterai d’abord te raconter les événements liés à ma déportation en Guyane puis l’exil que j’ai choisi ici, à Haïti, grâce à l’hospitalité que m’offrit le Président Pétion.
Je bénéficiai ainsi de la bienveillance qu’il apporta aux révolutionnaires victimes de circonstances contraires, de son accueil si chaleureux le même qu’il a pu manifester, un peu moins d’un an avant ma venue, pour Simon Bolivar, cette grande figure de la Liberté.
Échappé d’Europe comme par miracle à tant de fureur me voilà ainsi relégué au bout du monde, passant dans les ténèbres de la fosse aux lions de l’aviso qui me transféra de La Rochelle en Guyane, puis mis au fond des cachots du fort de Cayenne et, saisi par des fièvres mortifères, envoyé par l’acharnement haineux du gouverneur Jeannet dans les sous-sols de l’hôpital parmi les galériens. J’étais non seulement un proscrit mais en plus de l’isolement, j’étais en butte à des vexations permanentes de la part des habitants de Cayenne qui n’hésitaient pas non plus à proférer des menaces.
Tous les déportés de Guyane* possédaient cette certitude de côtoyer en permanence la mort. Lors de mon arrivée à Cayenne en messidor an III, je fus enfermé au fort. Je fus ensuite transporté à Sinnamary le 3 frimaire an IV (24 novembre 1795). A mon arrivée, une tempête tropicale ébranla ce petit bourg de quelques cases et cet événement n'aida pas à favoriser mon acceptation par la petite communauté du lieu composée surtout de noirs qui, on le sait, versent facilement dans la superstition la plus débridée. La rumeur était que le ciel tonnait contre un grand coupable.
L’air malsain de ce pays ne tarda pas à m’être fatal. Atteint d’une fièvre chaude très violente, je fus reconduit à Cayenne, et placé à l’hôpital militaire de cette ville qui était dirigé par les sœurs grises de Saint-Paul de Chartres.
Ma maladie s’est alors aggravée d’une dysenterie violente qui devint chronique puisque c’est elle qui me tue encore à petit feu. Je revis alors Collot d’Herbois*, lui aussi pris de fortes fièvres tropicales. Je me souviens bien des discussions que j’eus alors avec des colons présents dans l’hôpital pour garder un malade. Ils me prirent à part et m’interrogèrent sur ma conduite jugée criminelle lors de la révolution. J’eus beau la rapprocher des guerres intestines et des menaces extérieures qui nous obligeaient à nous battre comme des lions et à porter nos coups de façon urgente et radicale, ils restèrent dans une position critique à mon égard et à l'égard de Collot qui tremblait de fièvre à coté. Las de cette polémique, je leur dis qu’il fallait faire le procès de la république s’ils voulaient faire le mien.
Le 20 prairial an IV (8 juin 1796), Collot meurt à côté de moi. Resté seul dans un état d’agonie, j’en étais réduit à espérer bientôt aussi dans la mort le terme de mes souffrances. Une fois encore les Sœurs réussirent à me soulager et finalement à me sauver.
C’est à cette époque que Jeannet vint remplacer le gouverneur Cointet et nous ne pouvions rien espérer de cet ami de Danton.
Dès qu’il connut mon infirmité, il demanda à ce que l’on me transféra dans la salle des galériens où à la puanteur et à la moiteur de ces cachots, s’ajoutaient les cliquetis des chaînes et les gémissements de ces pauvres êtres. Les sœurs en étaient toutes remuées et malgré les ordres, arrangèrent quelque peu ma situation en m’isolant des autres. Je leur disais : « Que j’admire vos vertus, mes respectables sœurs ! Et c’est moi, moi, le triste objet d’une exécration générale, que vous comblez à ce point de soins et de bienveillance ! Votre générosité surpasse à mes yeux l’élévation des plus grandes âmes ». C’est grâce à la supérieure que je pus avoir l’aide du citoyen Bosquet quand je retournai à Sinnamary.
Lorsque Jeannet appris la mort de Collot, il dit : « qu’on l’enterre, il aura plus d’honneur qu’un chien ».
Son enterrement se fit un jour de fête. Les nègres fossoyeurs, pressés d’aller danser, l’inhumèrent à moitié ; son cadavre devint la pâture des cochons et des corbeaux. Pour souligner la haine de ce Jeannet à mon égard, il faut savoir qu'il décida de réduire ma pension, qui n’était déjà pas suffisante pour vivre, et qu'il suspendit toutes distributions d’effets en ma faveur.
Je retournai donc à Sinnamary le 6 frimaire an V (26 novembre 1796). Mon départ de Cayenne fut accompagné par une foule hostile qui me huait et m’insultait.
Mais je marchais tranquillement, la tête haute, un perroquet que j’avais apprivoisé sur mon doigt. Je méprisais ces lâches et portais mon attention sur l’animal que j'avais appelé Jacquot.
Sinnamary - église et mairie – 1883
Case - 1743
A Sinnamary, je vis alors arriver seize nouveaux déportés et je reconnus la plus part d’entre eux qui avait été mes ennemis. Il y avait là le général Pichegru*, lequel vint m’arrêter chez moi à Paris et présida à notre déportation, Barère, Vadier, Collot et moi. Il y avait là Bourdon de l’Oise*, qui s’est couvert de crimes dans la Vendée, qui s'associa à la vindicte de Lecointre et de ses complices portée contre nous. Il y avait Rovère*, l’un des plus acharné dénonciateur, qui plus est, un prévaricateur et un massacreur, l'ami de Jourdan Coupe-Tête, Rovère, ci-devant marquis de Fontvieille qui changea son habit de montagnard en royaliste. Il y avait Laffon-Ladebat, Barbé-Marbois, l'abbé Brottier, … J’observai alors leurs petits arrangements dignes d'écoliers immatures, leurs chamailleries, les affinités réciproques qu'ils se construisaient et défaisaient. J’avais sur eux la prérogative du premier venu et l’avantage du proscrit. Et mieux que tout, proscrit par les proscrits eux-mêmes qui me regardaient de loin et m'isolaient.
Dès leurs arrivées ils se mirent en binôme pour occuper les cases. Et Rovère, punition bien méritée, dut supporter les délires, la perfidie et l’agressivité de Bourdon. Ainsi, tel individu ayant manifesté une autorité morale ou une force de caractère dans certaines circonstances peuvent se révéler dans d’autres circonstances le plus pleutre, le plus enfantin, le plus exécrable des hommes. Et comment ne pas s’interroger sur l’incongruité d’une telle situation où, acteurs incontestés de la grande Révolution, nous nous retrouvions hors du temps, dans ce désert lointain, sans se parler, sans non plus aussi se détester. Je bénissais la providence de m’avoir fait rencontrer chez Bosquet l’abbé Brottier, un fervent royaliste, un homme d’une grande culture et d’une non moins grande sensibilité. Nous partagions pendant de longs mois nos réflexions philosophiques avec une multitude de références puisées dans la nombreuse littérature qui l’accompagnait. Je bénéficiais de son esprit et de ses connaissances qui le rendaient très aimable en société.
Je n'ai pas refusé de goûter le mérite littéraire de ce savant dans plus d'un genre, à qui je suis redevable d'avoir répandu sur nos entretiens, au milieu de l'affreuse solitude d'une espèce de désert, la seule diversion amusante qu'il m'était possible de m'y procurer. L’un comme l’autre nous avions fait fi des divergences qui quelques années auparavant nous auraient opposé, une amitié qui amena contre Brottier les critiques mesquines de ses compagnons d’infortune.
Les maladies ravagèrent toute la colonie ; il y en eut beaucoup à Cayenne, dit-on, et il y eut vingt malades à Conanama, sans aucun secours ! Les images de la mort frappèrent nos sens. Le premier qui mourut fut Bourdon. Je ne le plaignis point non qu’il s’acharna de me détruire après thermidor, mais parce que son comportement égoïste et colérique indisposait toute notre société. Il mourut de rage, désespéré de n’avoir pas été convié à partager les projets des autres déportés, en dehors de moi il s’entend, notamment concernant l’évasion que planifiait Pichegru. Le 25 fructidor an VI , Rovère cessa de vivre à trois heures du matin … Combien il a dû souffrir ! Quatorze des nouveaux déportés étaient déjà morts. Ce malheureux Brottier, après une agonie très longue et très violente, a cessé de vivre à dix heures. Quel spectacle ! Dans les lieux même que la peste ravage, il est impossible que la destruction soit plus rapide et plus douloureuse !