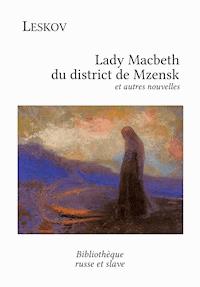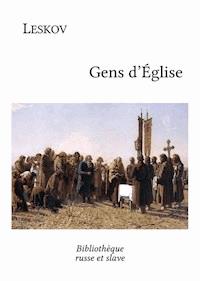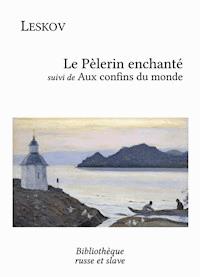
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dans ces deux récits, Leskov, que Gorki considérait comme le plus russe des écrivains, emmène le lecteur à travers les immensités de la Russie européenne et de la Sibérie, « aux confins du monde » ; et son Pèlerin, poursuivi par une singulière malédiction, semble l'image même de la Russie.
Traductions d'Alice Orane, 1959, et d'Hélène Iswolsky, 1931.
EXTRAIT
Nous voguions sur le lac Ladoga, de l’île Konévetz à l’île Valaam, et en cours de route nous accostâmes à Koréla pour les besoins du service. Beaucoup de passagers eurent la curiosité de descendre à terre, pour visiter l’agglomération déserte, sur de fringants petits chevaux finnois. Puis le capitaine se prépara au départ et nous poursuivîmes notre voyage.
Après l’escale à Koréla, on parla naturellement de cette localité russe très ancienne, mais pauvre et d’une tristesse inimaginable. Tout le monde à bord était de cet avis, et l’un d’entre nous, enclin à philosopher et à ironiser en matière de politique, déclara ne pas comprendre qu’on déportât les indésirables de Pétersbourg dans des lieux plus ou moins éloignés, ce qui imposait à l’État de gros frais de transport, alors qu’on avait sur le Ladoga, tout près de la capitale, un excellent endroit comme Koréla, où les esprits les plus libertins et les plus frondeurs céderaient à l’apathie de la population et à l’ennui mortel d’une nature chiche et déprimante.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Nikolaï Semionovitch Leskov est un écrivain et journaliste russe. Il écrivit aussi sous le pseudonyme de M. Stebnitski. De nombreux Russes le considèrent comme « le plus russe de tous les écrivains russes ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Nikolaï Leskov
Лесков Николай Семёнович
1831-1895
LE PÈLERIN ENCHANTÉ
suivi de
AUX CONFINS DU MONDE
Очарованный странник — На краю света
1873-1875
Traductions d’Alice Orane et d’Hélène Iswolsky.
© La Bibliothèque russe et slave, 2016
© Alexandra Oranovskaïa [Le Pèlerin enchanté], 1959 ; Elena Isvolksaïa [Aux confins du monde], 1931
Couverture : Mikhaïl NESTEROV, Solovki (1917)
LE PÈLERIN ENCHANTÉ
Очарованный странник — 1873
CHAPITRE PREMIER
NOUS voguions sur le lac Ladoga, de l’île Konévetz à l’île Valaam, et en cours de route nous accostâmes à Koréla pour les besoins du service. Beaucoup de passagers eurent la curiosité de descendre à terre, pour visiter l’agglomération déserte, sur de fringants petits chevaux finnois. Puis le capitaine se prépara au départ et nous poursuivîmes notre voyage.
Après l’escale à Koréla, on parla naturellement de cette localité russe très ancienne, mais pauvre et d’une tristesse inimaginable. Tout le monde à bord était de cet avis, et l’un d’entre nous, enclin à philosopher et à ironiser en matière de politique, déclara ne pas comprendre qu’on déportât les indésirables de Pétersbourg dans des lieux plus ou moins éloignés, ce qui imposait à l’État de gros frais de transport, alors qu’on avait sur le Ladoga, tout près de la capitale, un excellent endroit comme Koréla, où les esprits les plus libertins et les plus frondeurs céderaient à l’apathie de la population et à l’ennui mortel d’une nature chiche et déprimante.
— Je suis sûr, dit ce voyageur, que la faute en est à la routine ou, pour le moins, au manque d’information.
Un autre, qui s’était souvent rendu dans ces lieux, répondit que des exilés y avaient vécu à différentes époques, mais que tous finissaient par succomber.
— Un séminariste fut envoyé ici comme diacre pour sa grossièreté (c’est vraiment là un genre d’exil qui dépasse mon entendement). Le gaillard fit longtemps le brave, espérant en appeler à la justice ; puis il se mit à boire, s’enivra à en perdre la raison et adressa aux autorités la demande d’être au plus vite « fusillé ou enrégimenté, ou pendu en cas d’incapacité ».
— Et quelle fut la réponse ?
— Hum... je n’en sais rien ma foi ; mais il ne prit pas la peine de l’attendre et se pendit tout seul.
— Il a très bien fait, intervint le philosophe.
— Très bien ? répéta le narrateur, un marchand, sans doute, qui semblait fort respectable et dévot.
— Dame ! Il est mort en tout cas, un point c’est tout.
— Un point c’est tout ? Et qu’adviendra-t-il de lui dans l’autre monde ? Les suicidés y sont condamnés aux tourments éternels. On n’a même pas le droit de prier pour eux.
Le philosophe eut un sourire caustique, mais s’abstint de répondre. Alors un nouveau contradicteur intervint subitement contre lui et le marchand, plaidant la cause du diacre qui s’était fait justice sans l’autorisation de ses supérieurs.
Ce passager s’était embarqué à Koréla sans que nous l’ayons vu. Il n’avait pas dit un mot et personne n’avait fait attention à lui ; mais à présent tous le regardaient, étonnés de ne pas l’avoir remarqué jusque-là. C’était un homme de taille gigantesque, au visage basané et franc, avec une chevelure ondulée, abondante, dont la couleur grise avait d’étranges reflets de plomb. Il portait une soutanelle de novice, une large ceinture de cuir et un haut bonnet noir. On n’aurait su dire s’il était novice ou s’il avait prononcé ses vœux, car les moines du Ladoga, dans leur simplicité rustique, préfèrent à la calotte traditionnelle l’humble bonnet du noviciat, non seulement en voyage, mais encore dans leurs couvents des îles. Notre nouveau compagnon de voyage, qui par la suite se trouva être un homme très intéressant, devait avoir un peu plus de la cinquantaine, mais c’était un véritable hercule, un preux russe, naïf et bon, qui rappelait l’Ilya Mourometz de l’admirable tableau de Véréchtchaguine et du poème d’Alexéi Konstantinovitch Tolstoï. Plutôt que de revêtir la soutanelle, il aurait dû, chaussé d’énormes lapti, courir les bois sur un destrier pommelé, en savourant placidement la « senteur de résine et de fraises qu’exhalait la sombre sapinière ».
Mais sous cette candeur, on devinait sans peine l’homme plein d’expérience, qui « avait vu de tout », comme on dit. Il avait un maintien ferme, assuré, sans désinvolture toutefois, et parlait d’une voix de basse mélodieuse et un peu traînante.
— Ce n’est pas ça, dit-il en lâchant lentement les mots de sous sa grosse moustache grise, retroussée à la hussarde. Pour ce que vous dites des suicidés qui n’auraient jamais de pardon, je ne suis pas d’accord. Et ce n’est pas vrai non plus qu’on ne prie jamais pour eux, car il y a une personne qui peut arranger très simplement leur situation.
On lui demanda quelle était cette personne qui se préoccupait des suicidés et veillait à adoucir leur sort dans l’autre monde.
— Je vais vous le dire, répondit l’hercule en habits monastiques. Dans un village du diocèse de Moscou, il est un petit pope qu’on a failli dégrader pour ivrognerie incorrigible ; eh bien, c’est lui qui s’occupe des suicidés.
— D’où le savez-vous ?
— On le sait dans tout le diocèse de Moscou, car l’affaire a passé par son Éminence le métropolite Philarète.
Après un temps, quelqu’un fit observer que c’était plutôt douteux.
Le moine reprit, nullement vexé de cette remarque :
— C’est en effet douteux à première vue. Rien d’étonnant du reste, puisque son Éminence elle-même se refusa longtemps à y ajouter foi et n’y crut qu’après en avoir eu des preuves certaines.
Les passagers pressèrent le moine de leur conter cette histoire singulière, et il consentit de bonne grâce :
— Un beau jour, à ce qu’on dit, son Éminence révérendissime reçoit d’un doyen un rapport sur un petit pope qui buvait sans vergogne et faisait honte à la paroisse. Or, c’était la pure vérité. Son Éminence fait donc mander le petit pope à Moscou. Elle voit que c’est réellement un pochard et décide de le destituer. Le pope affligé ne boit plus et de gémir et de se lamenter : « Voilà où j’en suis venu, que me reste-t-il à faire sinon à me donner la mort ? Alors son Éminence prendra en pitié ma famille infortunée et donnera à ma fille un mari pour me remplacer et nourrir les miens. » Le sort en est jeté : il résout de se tuer et fixe même le jour ; sa foi seule l’arrête : « Mourir, c’est très bien, mais je ne suis pas un animal : j’ai une âme, où ira-t-elle ? » Et du coup, il s’afflige davantage encore. Mais, il a beau s’affliger, le métropolite décide de le destituer.
Une fois après le repas, son Éminence s’étant allongée sur le canapé, un livre à la main, s’assoupit. Endormi ou seulement assoupi, il voit s’ouvrir subitement la porte de sa cellule. « Qui est là ? » fait-il, croyant que c’est un frère convers. qui vient annoncer un visiteur ; mais au lieu du frère, c’est un vieillard qui entre, doux et vénérable, et son Éminence reconnaît aussitôt saint Serge.
« Est-ce toi, très saint père Serge ? » questionne le métropolite. Le saint répond :
« C’est moi, Philarète, serviteur de Dieu. »
Son Éminence questionne :
« Que désire ta sainteté de mon indignité ? »
Saint Serge réplique :
« Te demander une grâce. »
« Pour qui ? »
Le saint nomme le petit pope destitué pour ivrognerie et se retire ; son Éminence se réveille et ne sait si c’était un simple songe, une rêverie ou une apparition prophétique. Quand il eut bien réfléchi, sa sagesse réputée dans le monde entier le porte à croire que c’était un simple songe, car était-il admissible que saint Serge, renommé pour sa vie austère et ses jeûnes rigoureux, intercédât en faveur d’un prêtre faible, qui négligeait les règles du sacerdoce ? Ayant conclu de la sorte, son Éminence laisse la chose suivre son cours naturel, emploie son temps comme il convient et fait de nouveau la sieste à l’heure accoutumée. Mais à peine a-t-elle fermé les yeux, qu’une autre apparition jette son grand esprit dans le désarroi. Figurez-vous un fracas terrifiant... Quelque chose d’inouï... Une cavalcade... Une légion de chevaliers tout verts, armures et panaches, galopent sur des chevaux noirs, fougueux comme des lions ; un orgueilleux polémarque, également tout en vert, les précède et leur montre le chemin en brandissant un étendard sombre, qui porte l’image d’un serpent. Son Éminence ne sait ce que signifie ce cortège, dont le chef arrogant commande : « Torturez-les, ils n’ont plus d’intercesseur » et passe en trombe, à la tête de ses guerriers ; des ombres mornes les suivent, telle une troupe de maigres oies du printemps, et gémissent doucement, tout en larmes, et implorent son Éminence avec des gestes désolés : « Fais-lui grâce, il est le seul à prier pour nous. »
Son Éminence, sitôt levée, fait venir le petit pope ivrogne et lui demande pour qui il prie. Le pope, dans sa simplicité d’esprit, perd contenance et proteste : « J’officie selon les rites, mon père révérendissime. » C’est à grand-peine que son Éminence finit par obtenir ses aveux : « Mon unique faute, dit-il, c’est qu’étant moi-même pusillanime et songeant dans mon désespoir à me tuer, je prie toujours à l’oblation pour ceux qui se suicident et meurent sans confession... » Alors son Éminence comprend ce qu’étaient ces ombres qui lui étaient apparues, telles des oies décharnées ; et pour ne point complaire aux démons prêts à les martyriser, il bénit le petit pope et eut la bonté de lui dire : « Va, ne pèche plus et continue à prier pour eux. » Et il le restitua dans ses fonctions. Ainsi, cet homme peut toujours être utile à ceux qui n’ont pas supporté la lutte de la vie, car il ne renoncera pas à sa vocation audacieuse et ne cessera jamais d’importuner à leur sujet le Seigneur, qui sera obligé de leur pardonner.
— Pourquoi obligé ?
— Parce qu’il a dit lui-même : « Frappez, et on vous ouvrira. » Il en sera donc toujours ainsi.
— Êtes-vous sûr qu’à part ce prêtre moscovite personne ne prie pour les suicidés ?
— Je ne sais vraiment pas que vous répondre. On ne doit, paraît-il, pas solliciter Dieu en leur faveur, parce que ce sont des révoltés, mais il est possible que certains prient pour eux par ignorance. À la Pentecôte, cependant, tout le monde peut prier pour eux, je crois. On récite alors de prières spéciales. Des prières merveilleuses et si émouvantes que je ne me lasserais jamais de les entendre.
— Ne peut-on pas les réciter les autres jours ?
— Je ne sais pas. Il faudrait le demander à quelqu’un d’instruit ; quant à moi, comme ce n’est pas mon affaire, je ne me suis pas renseigné.
— N’avez-vous jamais remarqué, durant les offices, que ces prières se répétaient quelquefois ?
— Non, je ne l’ai pas remarqué ; mais ça ne prouve rien, car j’assiste rarement aux offices.
— Pourquoi donc ?
— Mes fonctions ne me le permettent pas.
— Vous êtes moine-prêtre ou moine-diacre ?
— Non, je ne suis que novice.
— Vous êtes déjà moine par conséquent ?
— Euh... oui, c’est tout comme.
— C’est tout comme, intervint le marchand, n’empêche qu’un novice peut être enrégimenté.
Le bon géant ne parut nullement vexé de cette remarque ; il dit après un moment de réflexion :
— C’est exact, et on a vu des cas pareils ; mais je suis trop vieux, moi, je vais sur ma cinquante-troisième année, et puis le service militaire n’est pas pour m’étonner.
— Vous avez servi ?
— Parfaitement.
— Tu étais sous-off, ou quoi ? reprit le marchand.
— Non pas.
— Soldat, magasinier, aumônier, que sais-je ?
— Rien de tout cela ; je suis pourtant un vrai militaire, j’étais en rapport avec le régiment presque depuis mon enfance.
— Enfant de troupe alors ? insistait le marchand agacé.
— Non plus.
— Qui es-tu donc, à la fin ?
— Connaisseur.
— Hein ? Qu’est-ce que c’est ?
— Le connaisseur, en langage plus populaire, c’est quelqu’un qui s’y connaît en chevaux et qui est adjoint aux officiers chargés de la remonte, pour les conseiller.
— Ah, bon !
— Eh oui, j’ai choisi et dressé des milliers de bêtes. J’en ai maté même de celles qui se cabrent et se renversent tout à coup sur le dos, au risque de défoncer la poitrine du cavalier avec l’arçon de la selle. Mais moi, je ne me laissais pas faire.
— Comment vous y preniez-vous ?
— Mais... c’est bien simple, j’ai pour ça un don qui me vient de la nature. Sitôt en selle et avant que le cheval ne se ressaisisse, je l’empoigne de la main gauche par une oreille et je tire dessus de toutes mes forces ; de la droite, je lui martèle la tête à coup de poing, et je grince des dents d’une manière terrible ; la cervelle lui en sort parfois des naseaux avec le sang, et il s’apaise.
— Et ensuite ?
— Je mets pied à terre, j’examine la bête, je me laisse bien regarder pour qu’elle se souvienne de moi et je l’enfourche de nouveau.
— Et le cheval reste sage ?
— Bien sûr, parce qu’il est assez intelligent pour comprendre à qui il a affaire et ce que son cavalier lui veut. Moi, par exemple, tous les chevaux m’aimaient et me comprenaient. Au manège de Moscou, il y en avait un qui se rebiffait contre tous les écuyers et qui avait pris la sale manie, le traître, de les mordre aux genoux. Un coup de dents infernal, et la rotule est arrachée net. Il a massacré ainsi beaucoup de monde. L’Anglais Raray, surnommé « le dompteur enragé », qui se trouvait alors à Moscou, a failli y passer comme les autres ; s’il en a été quitte pour la honte, c’est qu’il avait, dit-on, une genouillère d’acier : ne pouvant lui entamer la jambe, ce cheval de malheur l’a jeté bas ; autrement l’homme était mort. Quant à moi, j’ai conduit l’animal dans le droit chemin.
— De quelle façon ?
— Par la grâce de Dieu, car, je vous le répète, c’est un don de la nature. Mister Raray, « le dompteur enragé » et les autres comptaient uniquement sur la bride, pour empêcher le cheval de tourner la tête à droite et à gauche ; tandis que moi, j’ai inventé un moyen tout différent. Dès que l’Anglais eut renoncé à ce cheval, je dis : « Ce n’est pas malin, la bête est simplement possédée. L’Anglais ne peut pas le concevoir, mais moi, je le conçois et je trouverai le remède. » Le directeur accepte. « Emmenez le cheval par-delà la porte Drogomilovskaïai » que je dis. C’est ce qu’on fait. On le conduit dans un vallon proche de Fili, où le beau monde a ses maisons de campagne. Je vois que l’endroit est dégagé, commode, et je passe à l’action. J’enfourche ce cannibale, le torse et les pieds nus, ne gardant que ma culotte, ma casquette et la cordelière du prince valeureux Vsévolod-Gavriil de Novgorod, un saint que je vénérais beaucoup pour sa bravoure ; cette cordelière portait en lettres tissées : « Nul n’aura mon honneur ». Je tenais d’une main une solide cravache tartare avec un plomb au bout, qui ne pesait pas plus de deux livres, et de l’autre un simple pot vernissé, plein de pâte liquide. Me voilà en selle, tandis que quatre hommes tirent le cheval des deux côtés par la bride, pour l’empêcher de mordre. Et lui, le démon, voyant qu’on s’en prend à lui, il hennit, glapit, transpire et frémit de rage, prêt à me dévorer. Je m’en aperçois et j’ordonne aux palefreniers de débrider au plus vite le scélérat. Ils n’en croient pas leurs oreilles et ouvrent de grands yeux. Je les apostrophe : « Alors, vous êtes sourds ? Qu’est-ce que vous attendez ? Faites donc ce que je vous dis ! » Et ils me répondent : « C’est-y possible, Ivan Sévérianytch (on m’appelait dans le siècle Ivan Sévérianytch, monsieur Fliaguine), c’est-y possible que tu veuilles qu’on le débride ? » Du coup je prends la mouche, car je sens le cheval qui se démène entre mes jambes ; je le presse des genoux en criant aux gars : « Débridez ! » Comme ils essayent encore de répliquer, je me mets en fureur et je grince des dents, la mine terrible. Ils obéissent en un clin d’œil, se sauvent à la débandade, et au même instant je brise le pot contre la tête du cheval. La pâte lui coule dans les yeux et les naseaux. Il se demande, effaré : « Qu’est-ce que c’est ? » Et moi, je saisis vite ma casquette de la main gauche et lui fais descendre encore plus de pâte dans les yeux, avec ça un coup de cravache sur le flanc... Hop ! il bondit, mais je lui frotte toujours les yeux avec ma casquette pour lui brouiller complètement la vue, et je donne de la cravache sur l’autre flanc... Ce que je lui ai passé ! Sans le laisser souffler, j’étale la pâte sur sa tête, je l’aveugle, je l’épouvante en grinçant des dents et je le cravache à droite, à gauche, pour qu’il comprenne que ce n’est pas de la rigolade... Il a compris, il cesse de piétiner sur place et part à fond de train. Il galope comme un forcené, et plus il va, plus je le fouette, jusqu’à ce qu’on se sente fatigués, tous les deux : j’ai l’épaule endolorie, le bras gourd, et lui ne louche plus et tire la langue. Voyant qu’il demande grâce, je saute à terre, lui nettoie les yeux et l’empoigne par son toupet : « Halte-là, pâture de chien ! » que je dis et je le tire en bas. Il tombe à genoux devant moi, et depuis ce jour il est devenu doux comme un mouton et obéissant au possible ; il se laissait bien monter, mais il est mort peu après.
— Vraiment ?
— Eh oui ; il avait trop d’orgueil, l’animal, il s’était soumis, mais ne pouvait sûrement pas changer de caractère. Quant à monsieur Raray, lorsqu’il a su l’histoire, il m’a proposé d’entrer à son service.
— Et vous avez travaillé pour lui ?
— Que non.
— Pourquoi ?
— Comment vous dire ! D’abord, attendu que j’étais connaisseur, j’avais plus l’habitude de choisir les bêtes que de les dresser, tandis que lui, il avait besoin de dompteurs de bêtes sauvages ; ensuite, je pense que ce n’était de sa part qu’une ruse perfide.
— Laquelle ?
— Il voulait avoir mon secret.
— L’auriez-vous vendu ?
— Ma foi oui.
— Qu’est-ce qui vous a donc empêché ?
— Dame... c’est sans doute lui qui a eu peur de moi.
— Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ? Racontez-nous-la, s’il vous plaît !
— Ce n’était pas une histoire, il m’a seulement dit : « Révèle-moi ton secret, mon ami, je te payerai bien et te prendrai comme connaisseur ». Moi qui n’ai jamais pu tromper qui que ce soit, j’ai répondu : « Il n’y a pas de secret, voyons. » L’Anglais, qui prend tout du point de vue savant, ne me croit pas. « Si tu ne veux pas me le dire carrément, qu’il fait, allons boire du rhum ensemble. » Après ça, nous en avons bu à tire-larigot. Il en est devenu tout rouge et me redemande dans son jargon ce que j’ai fait au cheval. Alors je lui réponds : « Voilà... » et je le regarde d’un air féroce, en grinçant des dents, et à défaut de pot rempli de pâte, je fais mine de le frapper avec mon verre. De me voir dans cet état, il plonge sous la table, file vers la porte et prend ses jambes à son cou. Je ne l’ai plus revu.
— C’est pour cela que vous n’êtes pas entré à son service ?
— Oui. Le moyen de le faire, puisqu’il avait peur de me rencontrer ? Ce n’était pourtant pas l’envie qui me manquait, car en jouant avec lui à qui boirait le plus de rhum, je l’avais pris en amitié ; mais il faut croire que personne ne peut échapper à son sort, et j’avais une autre vocation à suivre.
— Quelle vocation ?
— Je ne sais vraiment pas comment vous dire... J’ai subi beaucoup d’épreuves, j’ai monté des chevaux et passé dessous, j’ai été en captivité, j’ai fait la guerre, j’ai massacré des gens et reçu moi-même des blessures dont d’autres seraient morts.
— Quand est-ce que vous êtes entré au couvent ?
— Il y a quelques années à peine, après un long passé.
— C’était aussi une vocation ?
— Hum... je... je ne sais comment vous expliquer... je pense que oui...
— Pourquoi semblez-vous dans l’incertitude ?
— De quoi pourrais-je être certain, moi qui ne puis comprendre toutes les aventures de ma vie ?
— Pour quelle raison ?
— Parce que j’ai souvent agi contre ma volonté.
— Comment cela ?
— Il s’agit d’un vœu de ma mère.
— Et qu’est-ce que ce vœu vous a fait faire ?
— J’ai couru toute ma vie à ma perte, sans périr.
— Vraiment ?
— C’est comme je vous le dis.
— Racontez-nous donc votre vie.
— Si vous y tenez, je peux vous raconter ce dont je me souviens, mais il faut commencer par le commencement.
— Parfait ! Ce ne sera que plus intéressant..
— C’est à savoir ; écoutez toujours.
CHAPITRE II
L’ex-connaisseur, Ivan Sévérianytch, monsieur Fliaguine, commença son récit de la façon suivante :
— Je suis né serf et je descends de la domesticité du comte K. de la province d’Orel. Ces domaines, qui ont fondu maintenant entre les mains des héritiers, étaient alors très vastes. Au village de G., résidence de monsieur le comte, il y avait une maison énorme, immense, des appartements pour les invités, un théâtre, une galerie spéciale pour le jeu de quilles, un chenil, des ours enchaînés, des vergers, une chorale qui donnait des concerts, une troupe d’acteurs qui jouait toute sorte de scènes ; il y avait même des tissages et d’autres industries où travaillaient des serfs, mais c’est au haras qu’on accordait le plus d’attention. Chaque entreprise avait son personnel qualifié, mais le haras était particulièrement à l’honneur, et de même qu’à l’armée on est soldat de père en fils pour se battre, on était chez nous cocher, palefrenier, fourrageur de père en fils, pour conduire, soigner et affourager les chevaux. Mon père Sévérian, sans être premier cocher (il y en avait un grand nombre), conduisait pourtant un attelage de six bêtes ; un jour même, il avait été septième dans le cortège du tsar, ce qui lui avait valu un assignat de cinq roubles. J’ai perdu ma mère en bas âge et ne me souviens pas d’elle, car j’étais un fils imploré : ma mère, restée longtemps stérile, avait prié Dieu avec ferveur et, son vœu enfin exaucé, elle était morte en couches, parce que j’étais venu au monde avec une très grosse tête. Aussi m’a-t-on surnommé Têtard. J’habitais avec mon père dans les communs et passais les journées aux écuries ; c’est là que j’ai appris à connaître les bêtes et à les aimer, car je rampais tout petit entre leurs jambes, sans qu’elles me fassent de mal. En grandissant, j’ai achevé de m’habituer à elles. Le haras était complètement séparé des écuries, nous en recevions les chevaux adultes et les dressions. Chaque cocher et son postillon avaient un attelage de six chevaux ; il y en avait de toute provenance : de Viatka, de Kazan, de Kalmoukie, de Bitioug, du Don ; c’étaient tous de bêtes achetées aux foires. Quant à celles de notre propre haras, pas la peine d’en parler : elles étaient paisibles, sans caractère, sans caprice, tandis que les autres, les sauvages, c’étaient de vrais fauves. Le comte les achetait par troupeaux entiers, au rabais, huit ou dix roubles la pièce, et on se mettait aussitôt à les dresser. Ce qu’ils étaient récalcitrants ! Ils crevaient en grand nombre, sans se laisser dompter : parqués dans la cour, l’œil fou, épouvantés par les murs, ils regardaient à tout moment le ciel, comme font les oiseaux. Ça faisait même pitié de les voir souffrir à ce point de la captivité... Ils refusaient de boire et de manger et dépérissaient. On en perdait parfois plus de la moitié, surtout des chevaux kirghiz. C’est inouï ce qu’ils aiment les grands espaces de la steppe. Et parmi les survivants, on était encore obligé d’en massacrer pas mal, car pour venir à bout de leur sauvagerie il fallait être rude ; en revanche, ceux qu’on réussissait à mater, donnaient une sélection supérieure à tous les chevaux de haras.
Sévérian Ivanytch, mon père, conduisait des chevaux kirghiz, et quand je devins grand on m’adjoignit à lui comme postillon. Les bêtes étaient autrement plus fougueuses que celles qu’on choisit de nos jours pour les officiers. Nous appelions celles-ci des mazettes, parce qu’on n’a aucun plaisir à les monter, du moment que les officiers mêmes peuvent le faire, tandis que celles-là c’étaient des fauves, des aspics et des basilics tout à la fois : il fallait voir ces mufles aux babines retroussées, ces pattes, ces crinières... quelque chose d’effroyable ! Et avec ça, jamais fatigués : ils faisaient jusqu’à cent ou cent cinquante verstes d’une trotte, du village à Orel, et revenaient à la même allure, sans une halte. Une fois lancés, on n’avait qu’à veiller à ce qu’ils ne dépassent pas le but. Or moi, quand je suis devenu postillon, je n’avais que onze ans et la voix aiguë, perçante, qui convenait aux postillons stylés. Je pouvais lancer le fameux : « Gare ! » en le soutenant une bonne demi-heure d’affilée. Mais comme je n’étais pas encore assez vigoureux pour supporter de longues chevauchées, on m’attachait à la selle et aux sangles avec des courroies, pour éviter que je ne tombe. J’étais souvent meurtri à en perdre connaissance, mais je gardais toujours la même posture et finissais par revenir à moi. C’était un dur métier, je me pâmais ainsi de la selle à moitié mort, on me couchait et me faisait sentir du raifort. Puis je me suis habitué et tout a bien marché ; je m’amusais même à allonger un coup de fouet dans le dos de quelque paysan de rencontre. Ces frasques de postillon sont bien connues. Un jour d’été, le comte s’en va en visite dans notre équipage. Il fait un temps magnifique, le comte est assis avec son chien dans la calèche découverte, mon père conduit quatre chevaux, et moi, je trotte devant. Nous quittons la grand-route pour prendre un chemin qui aboutit, une quinzaine de verstes plus loin, à un couvent. Les moines avaient aménagé ce chemin pour attirer les visiteurs ; la route nationale est crasseuse, bordée de saules chétifs aux branches tordues, tandis que le chemin du couvent, propre et bien balayé, passe entre deux rangs de bouleaux verdoyants qui sentent bon, et alentour les champs s’étendent à perte de vue... Bref, toute cette beauté donnait envie de pousser des cris d’allégresse, mais c’était défendu de crier sans cause. Or voici qu’à trois ou quatre verstes du monastère, en descendant une pente douce, j’aperçois devant moi un petit point... quelque chose qui chemine comme un hérisson. Tout heureux de l’occasion, je claironne à tue-tête mon « gare » sur une bonne verste de distance ; j’étais si excité, qu’en rattrapant celui à qui je lançais mon cri, je me dresse sur les étriers et je vois un bonhomme étendu sur une télègue de foin. Caressé par le grand air et le soleil, il dort du sommeil du juste, couché sur le ventre et les bras en croix, comme s’il étreignait son chariot. Comprenant qu’il ne se mettra pas à l’écart, je le contourne et, parvenu à sa hauteur, debout sur les étriers, je lui allonge à toute volée un coup de fouet dans le dos. Ses chevaux s’emportent, il sursaute, petit vieux en soutane et bonnet de novice, avec une pauvre figure de vieille femme, tout effaré, larmoyant, et de se tortiller sur le foin, comme un goujon sur la poêle... Mal éveillé sans doute, il ne se méfie pas du bord, dégringole à terre, sous la roue, et se traîne dans la poussière... ses jambes s’empêtrent dans les rênes... Au début, mon père et moi et le comte lui-même s’amusent de ses cabrioles, mais voici que la télègue, arrivée au bas de la pente, s’accroche au parapet d’un pont, les chevaux s’arrêtent, et lui ne bouge plus... En approchant, je m’aperçois qu’il est tout gris de poussière et n’a même plus de nez dans le visage, rien qu’une crevasse d’où le sang coule... Le comte fait stopper, descend de voiture, regarde et déclare : « Il est mort. »
Son excellence me promet une bonne correction au retour et commande d’aller vite au couvent. Pendant que des moines s’en vont sur les lieux, le comte s’entend avec le supérieur, et en automne on leur expédie tout un convoi de vivres : avoine, farine, poisson sec. Moi, mon père me fustige derrière une remise du monastère, par-dessus la culotte. On ne m’a pas fouetté pour de bon, vu que je devais remonter aussitôt en selle. Les choses en sont restées là, mais la même nuit, le moine que j’ai tué se présente devant moi et pleure de nouveau comme une bonne femme. Je lui demande : « Qu’est-ce que tu me veux ? Va-t’en ! »
Et lui me répond :
« Tu m’as fait mourir sans confession. »
« Tant pis, que je dis. Que veux-tu que j’y fasse ? Je ne l’ai pourtant pas fait exprès. Et puis, qu’est-ce qui te manque à présent ? Tu es mort, un point c’est tout. »
« En effet, qu’il reprend, et je t’en suis bien reconnaissant, mais je viens te demander de la part de ta mère si tu sais que tu es un fils imploré ? »
« Parbleu, que je dis, grand-mère Féodossia me l’a raconté plus d’une fois. »
« Et sais-tu encore que tu es un fils promis ? »
« Comment ça ? »
« Tu es promis à Dieu. »
« Qui m’a promis ? »
« Ta mère. »
« Eh bien, que je fais, elle n’a qu’à venir me le dire elle-même, peut-être que tu mens, toi. »
« Non, je ne mens pas ; quant à ta mère, elle ne peut venir. »
« Pourquoi ? »
« Parce que là-haut, ce n’est pas comme ici-bas : les âmes des morts ne sont pas toutes douées de la parole et du mouvement, chacune fait ce qu’elle peut. Mais si tu y tiens, je te jetterai un sort en confirmation. »
« Bien, que je dis, quel sort ? »
« Tu courras maintes fois à ta perte sans périr, mais quand tu seras sur le point de périr pour de vrai, tu te ressouviendras du vœu de ta mère et entreras en religion. »
« À merveille, que je réponds, je ne demande pas mieux et j’attends. »
Il disparut, je m’éveillai sans rien me rappeler ni me douter que les épreuves allaient s’abattre sur moi d’ici peu, les unes après les autres. Un peu plus tard, je m’en fus avec le comte et la comtesse à Voronèje, où ils espéraient que des reliques récemment découvertes guériraient leur fillette infirme. Pendant une halte que nous fîmes au village de Kroutoï, dans le district d’Eletz, pour donner à manger aux chevaux, je m’endormis à l’écurie et je revis mon moinillon qui me dit :
« Écoute, Têtard, j’ai pitié de toi, demande donc à tes maîtres de te laisser entrer au couvent, ils y consentiront. »
Je répliquai :
« En quel honneur ? »
Et le moine me prévint :
« Sinon, gare aux calamités qui vont t’assaillir. » Je me dis à moi-même : « Ça va, il faut bien que tu fasses le prophète de malheur, puisque je t’ai tué. » Là-dessus, je me lève, j’aide mon père à réatteler et on se remet en route. Or, il y avait là une côte très raide, surplombant un ravin où un tas de gens ont trouvé la mort. Le comte me dit :
« Sois prudent, Têtard. »
J’étais adroit dans le métier, et bien que les rênes des timoniers qui devaient s’accroupir à la descente fussent aux mains du cocher, j’étais d’un grand secours à mon père. Les timoniers, très vigoureux, savaient plier les jarrets au point de traîner la queue sur le sol, mais l’un d’eux, le lascar, était astronome : dès qu’on tirait un peu fort, il dressait la tête vers le ciel pour y contempler je ne sais quoi. Il n’y a pas plus mauvais pour un timonier, et au timon c’est encore plus dangereux ; le postillon doit toujours avoir l’œil sur l’astronome, car il fourre ses pieds n’importe où, sans rien voir. Je lui connaissais naturellement cette manie et j’aidais mon père à le conduire : je serrais la bride à mon cheval de selle et au sous-verge, de façon à ce que leurs queues touchent presque les museaux des timoniers ; le timon leur passait entre les croupes et je tenais constamment le fouet en attente, devant le chanfrein de l’astronome ; dès qu’il pointait le nez en l’air, je tapais dessus pour l’abaisser, et tout marchait bien. Cette fois encore, à la descente, je m’agite devant le timon et je fais entendre raison à l’astronome, mais je m’aperçois tout à coup qu’il ne sent plus ni rênes ni fouet, la bouche ensanglantée par le mors et l’œil exorbité ; j’entends que ça craque par derrière, l’équipage s’affaisse... C’est le frein qui est cassé ! Je crie à mon père : « Halte ! Halte ! » Il hurle à son tour : « Halte ! Halte ! » Peine perdue : les six bêtes foncent en avant, affolées, quelque chose a sauté sous mes yeux, je me retourne et je vois mon père qui dégringole de son siège... une rêne s’est rompue... Et le gouffre est devant nous... Je ne sais si j’ai eu pitié des maîtres ou de moi-même, le fait est que nous voyant au seuil de la mort, je me jette hors de la selle, droit sur le timon et m’y suspends... Je ne sais plus combien je pesais en ce temps-là, mais en porte-à-faux le poids est toujours beaucoup plus lourd, les timoniers étouffés râlent... Voici que les chevaux de devant ont disparu, comme tranchés net, moi je pends au-dessus de l’abîme et l’équipage butte contre les timoniers écroulés.
Revenu à moi et glacé de peur, mes mains se desserrent, je tombe et ne vois plus rien... Je reprends connaissance dans une isba, où un robuste paysan me dit :
— T’es donc vivant, petiot ?
Je réponds :
— Faut croire que oui.
— Tu sais au moins ce qui t’est arrivé ?
Je fais un effort et me souviens que les chevaux se sont emportés, que je me suis accroché au bout du timon et suis resté suspendu dans le vide ; la suite, je l’ignore.
Le paysan sourit :
— Pardi, tu ne peux pas savoir. Tes deux chevaux se sont fracassés au bas du talus, mais toi t’as été sauvé comme par miracle : t’es tombé sur une grosse motte de glaise qui a descendu la pente à la manière d’un traîneau. On te croyait mort ; mais non, tu respirais, seulement t’étais étourdi par le souffle d’air. À présent, qu’il dit, lève-toi si tu peux et cours à l’église : le comte a laissé de l’argent pour t’enterrer ou te mener chez lui à Voronèje, si t’étais en vie.
Je repartis et gardai le silence tout le long du chemin, écoutant le paysan, qui me conduisait, jouer de l’accordéon, toujours le même air de danse.
À Voronèje, le comte me fait venir au salon et dit à la comtesse.
— Voici, madame, le gamin à qui nous devons la vie.
Elle ne fait que hocher la tête, et le comte reprend :
— Demande-moi ce que tu veux, Têtard, je n’ai rien à te refuser.
— Je ne sais pas quoi demander ! que je déclare.
— Qu’est-ce que tu voudrais, voyons ?
Après avoir bien réfléchi, je déclare :
— Un accordéon.
Le comte dit en riant :
— Tu es vraiment sot, mais n’importe, je repenserai à toi au moment voulu. En attendant, qu’on lui achète l’accordéon, et tout de suite.
Un valet s’en va au magasin et m’apporte un accordéon à l’écurie.
— Tiens, joue, qu’il me dit.
J’essaie de jouer, mais ça ne donne rien ; alors j’abandonne l’accordéon, et le lendemain des pèlerins me le volent près de la remise.
Il aurait fallu profiter des bonnes grâces du comte pour demander à entrer au couvent, selon le conseil du moine ; mais au lieu de ça, je ne sais ce qui m’a pris de réclamer un accordéon. En reniant ainsi, dès le début, ma vocation, je me condamnais aux multiples malheurs que je devais subir sans jamais succomber, jusqu’à ce que toutes les prédictions du moine se fussent réalisées, en châtiment de mon incrédulité.
CHAPITRE III
À peine revenu à la maison avec un nouvel attelage acheté à Voronèje par mes maîtres et bienfaiteurs, j’entrepris d’élever sous le toit de l’écurie un couple de pigeons. Le mâle était gris, la femelle blanche, avec de petites pattes rouges, mignonne à ravir... Ils me plaisaient beaucoup ; la nuit, surtout, il faisait bon entendre le mâle roucouler gentiment ; le jour ils voletaient parmi les chevaux, se posaient dans les mangeoires pour picorer l’avoine et se bécotaient... C’était amusant pour un gamin de mon âge.
Après leurs bécots, ils firent deux petits, et quand ceux-ci devinrent grands, les bécots recommencèrent puis vint la ponte et une autre nichée... Des oisillons tout menus, sans plumes, duvetés et jaunes comme les boulettes de l’herbe qu’on appelle la « mauve des chats » ; et avec ça des nez énormes, pires que ceux des princes tcherkesses... Je les couvais des yeux, ces tourtereaux, et pour ne pas les meurtrir, j’en pris un par le bec, et de l’admirer si frêle et délicat, cependant que le père tâchait de me le reprendre. Moi, je m’amusais à le taquiner avec ; mais au moment de remettre l’oisillon au nid, je m’aperçus qu’il ne respirait plus. Quel dommage ! Je le réchauffais dans mes mains, j’essayais de le ranimer de mon haleine : rien à faire ! Furieux, je le jetai par la fenêtre. Tant pis, il en restait toujours un de vivant ; quant à celui-là, une chatte survenue à l’improviste s’en saisit et l’emporta. J’avais bien remarqué son pelage tout blanc, avec une tache noire sur le front, pareille à un bonnet. C’est bon, que je me dis, elle n’a qu’à manger le mort. Mais la nuit, j’entends tout à coup les pigeons qui se battent avec quelqu’un. Je saute du lit, je regarde, et je vois au clair de lune la chatte blanche qui s’est emparée de l’autre tourtereau.
« Ça c’est vraiment trop fort ! » que je me dis, et de lui jeter ma botte, mais je la manquai et elle emporta le pauvret, pour le dévorer sans doute. Mes pigeons étaient en deuil, mais ils ne tardèrent pas à se bécoter de nouveau et firent encore une paire de petits. Or, revoici cette sale bête de chatte... Le diable sait comment elle les a épiés, mais elle en chipe un en plein jour, et si lestement que je ne trouve rien à lui jeter après. Décidé à la punir, j’installe un piège à la fenêtre. La chatte s’y fait prendre dès la nuit suivante et miaule plaintivement. Aussitôt je la sors de là, je lui fourre la tête et les pattes de devant dans la tige de ma botte, pour l’empêcher de griffer, je lui saisis les pattes de derrière et la queue de ma main gauche, protégée par une moufle, j’empoigne de la droite un fouet pendu au mur, et de la corriger sur mon lit. Je lui ai flanqué cent cinquante coups au moins, de toutes mes forces au point qu’elle ne bouge plus. Je la retire alors de la botte et me demande si elle est crevée ou non. C’est ce qu’on va voir : je la pose sur le seuil et lui tranche la queue d’un coup de hache : miau ! elle tressaille, se retourne dix fois de suite et décampe.
« Bon, que je me dis, tu ne reviendras plus me chaparder mes tourtereaux » ; et pour l’effrayer davantage, je cloue sa queue dehors, au-dessus de ma fenêtre. J’étais très content, mais au bout d’une heure ou deux, voilà la femme de chambre de la comtesse qui s’amène, elle qui n’a jamais mis les pieds à l’écurie. Elle crie, un parapluie à la main :
— Ah, ah ! c’est donc lui, c’est donc lui !
Je demande :
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— C’est toi qui a estropié Zizi ? Avoue, c’est à ta fenêtre que sa queue est clouée ?
Je riposte :
— Et après ?
— Tu as osé ? qu’elle fait.
— Elle a bien osé manger mes tourtereaux !
— Tes tourtereaux ? La belle affaire !
— Une chatte, ce n’est pas une grosse légume non plus.
Vous savez, en grandissant, j’étais devenu hargneux.
— Une chatte, tu parles d’un trésor ! que je dis.
Et la péronnelle :
— Ce toupet ! Tu ne sais donc pas qu’elle est à moi, cette chatte, et que madame la comtesse elle-même l’a caressée. Et vlan ! elle m’envoie le manche de son parapluie sur la joue. Moi qui avais la main leste depuis mon enfance, j’empoigne aussitôt un balai crasseux et je lui applique en travers de la taille...
Seigneur ! c’en a fait une histoire ! On m’emmena au bureau, devant le régisseur allemand, pour être jugé. Il décida de me faire fouetter sans pitié et de me renvoyer des écuries pour casser des cailloux dans l’allée du jardin anglais... On m’administra une terrible raclée, au point que je ne pouvais me relever et qu’on dut m’emporter chez mon père sur une bâche. Mais ce n’était rien en comparaison de l’autre peine : rester à genoux et casser des pierres... j’en souffrais tant que je songeai à me donner la mort. Je me procure avec l’aide d’un petit laquais une bonne corde d’emballage ; le soir venu, je vais me baigner, puis je gagne un bois de trembles derrière le pailler, je m’agenouille et prie pour tous les chrétiens, j’attache ma corde à une branche, je fais un nœud coulant et y passe la tête. Il n’y a plus qu’à me laisser choir et le tour est joué... J’étais d’un caractère à exécuter jusqu’au bout mon projet, mais à peine avais-je sauté de la branche, que je me retrouvai par terre, tandis qu’un Tzigane armé d’un couteau se tenait devant moi, rigolant de toutes ses dents blanches qui brillaient dans la nuit, au milieu de sa gueule noire.
— Qu’est-ce que tu fabriques, larbin ? qu’il demande.
— Ça te regarde ?
— T’en as donc marre de la vie ?
— Apparemment qu’elle n’est pas rose.
— Alors, plutôt que de te pendre toi-même, viens avec nous, peut-être que t’iras à la potence d’une autre manière.
— Qui êtes-vous, comment gagnez-vous votre vie ? Je parie que vous êtes des voleurs ?
— Oui, des voleurs et des filous.
— Là, que je dis, et à l’occasion il vous arrive peut-être d’égorger les gens ?
— Ça nous arrive.
Je réfléchis longuement : si je reste, demain et après-demain ce sera toujours pareil : je casserai des cailloux du matin au soir. Or, j’en avais déjà les genoux endoloris et plein les oreilles d’entendre le monde se moquer de moi, parce que ce coquin d’Allemand m’avait condamné à émietter un monceau de pierres pour une queue de chat. On me raillait : « Dire que t’es un sauveur, que t’as sauvé la vie à leurs excellences. » C’en était trop, et à l’idée que si je ne me pendais pas, il faudrait revenir à cette existence de misère, je pleurai et consentis, dans mon désespoir, à me faire brigand.
CHAPITRE IV
Ce Tzigane roublard ne me laissa pas le temps de me raviser :
— Pour que je sois sûr que tu ne t’en retourneras pas, amène-moi tout de suite une paire de chevaux de ton maître, et choisis les meilleurs, pour qu’on soit loin d’ici avant le jour.
Hélas ! Il m’en coûtait de voler ; mais qui se fait brebis, le loup le mange. Comme je connaissais les écuries sur le bout des doigts, je n’eus aucun mal à emmener derrière les meules de blé une paire de coursiers fougueux, infatigables. Le Tzigane qui avait sorti de sa poche des dents de loup, les pendit à leur cou et nous montâmes en selle. Sentant les os de fauves contre leur peau, les bêtes filaient à fond de train, et au lever du jour nous étions à cent verstes, devant la ville de Karatchévo. Nous vendîmes les chevaux à un concierge et allâmes partager l’argent au bord d’une rivière. Il y avait trois cents roubles en assignats, mais le Tzigane ne me donna qu’un rouble d’argent et dit :
— Voici ta part.
J’étais vexé.
— Comment, c’est moi qui ai volé les chevaux, j’ai donc couru plus de risques que toi, et tu me donnes une si petite part ?
— C’est celle qui te revient.
— Pas de bêtises : pourquoi prends-tu tant que ça ?
— Dame, parce que je suis maître, et toi tu n’es qu’apprenti.
— Des blagues !
Et de discuter et de nous chamailler. Je dis finalement :
— Je te quitte, parce que t’es une fripouille.
Et il me répond :
— Tu me rendras bien service, l’ami, car t’es sans papiers, tu vas encore m’attirer des embêtements.
Là-dessus on s’est séparés. Je me rends chez l’assesseur pour avouer que j’étais un serf évadé, mais à peine ai-je raconté mon histoire au greffier, qu’il me dit :