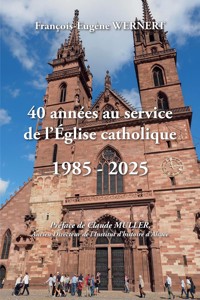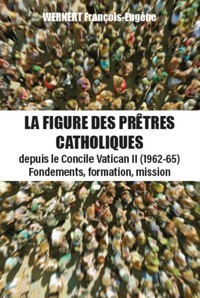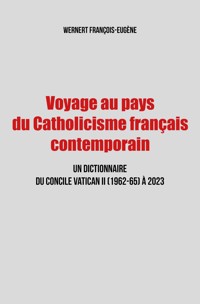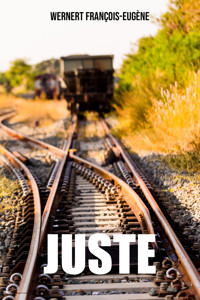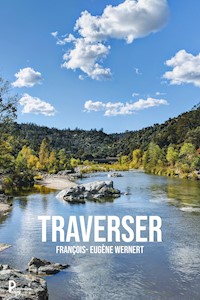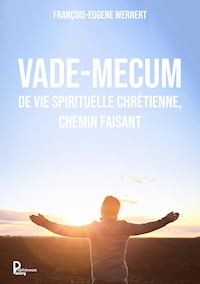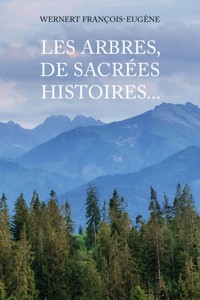
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Pourquoi s’intéresser aux arbres ? Je dédie cet ouvrage à mes grands-parents paternels qui ont travaillé toute leur vie en forêt, mon grand-père Joseph comme bûcheron et ma grand-mère Madeleine active dans les plantations de jeunes pousses dans la forêt de Haguenau, l’une des plus grandes forêts de France.
J’ai aussi eu la grande chance de grandir à côté de cette belle et vaste forêt, espace ludique, endroit silencieux et mystérieux, havre de paix. Quand on a goûté aux forêts, on ne peut plus s’en passer. Dès mes premières années, les arbres m’ont fasciné. Oui, bien sûr, comme chacun, je les trouve beaux, majestueux, imposants, élancés, tordus ou bizarres. Mais depuis mon enfance je suis habité par cette conviction indéfectible que l’arbre que l’on voit n’est pas essentiel. Derrière la majesté ou la beauté se cache une autre réalité qui nous échappe.
Il y a quelques années, j’ai eu le bonheur de revoir l’abbaye cistercienne de Fontenay en Bourgogne. Ce lieu parfaitement conservé accueillait à cette époque une exposition sur Saint Bernard (1090-1153) fondateur de l’ordre cistercien. Sur un des panneaux, quelques textes, dont celui-ci, retiennent mon attention : « La forêt et les arbres t’apprendront plus que tous les livres » (Homélie 16). Ce jour-là, j’ai eu envie de me replonger dans le monde des arbres…
Quand un homme d’Eglise, comme moi, parle de nature, certains peuvent réagir vivement : « C’est encore du New Age, ce mouvement qui exalte la nature de manière démesurée ; c’est de la pseudo-religiosité ou pseudo-spiritualité… » Il convient d’écouter ces remarques. C’est vrai, dès le XVIIIème siècle, il y a eu des mouvements et des philosophies tournés vers la nature excluant par là même toute religion révélée (Révélation du Dieu fait homme). Pour moi, il ne s’agit nullement de mettre l’arbre au centre d’une religion naturaliste ou même au centre d’une recherche spirituelle. Mais pourquoi ne pas oser s’émerveiller devant un bel arbre ou une belle forêt. J’invite le lecteur, au hasard de ses balades et de ses voyages, à ouvrir l’œil pour contempler et à (re)découvrir les arbres et les forêts… quelle joie !
À PROPOS DE L'AUTEUR
François WERNERT, né en 1960, est l’auteur d’une thèse en théologie catholique sur "Vie liturgique et Mouvement Liturgique en Alsace de 1900 à nos jours", parue aux Editions Ercal à Strasbourg en 1992. Il est Maître de Conférences en théologie pastorale-théologie pratique, habilité à diriger des recherches à la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg.
Depuis 2021 il est en détachement de l’Université comme prêtre dans la communauté de paroisses du Piémont du Hohenbourg en centre Alsace, à Obernai et alentours.
ll lui tient à cœur de corréler théories et pratiques, notamment dans le domaine de la pastorale et de la pastorale liturgique et sacramentelle.
Titulaire également d’un Diplôme d’études approfondies de musicologie (Université de Strasbourg, 1987) il lui importe de mettre en résonance les dimensions cultuelles et culturelles.
Dans ses écrits il conjugue sa ligne de créativité en alternant des ouvrages de réflexions fondamentales avec des ouvrages de spiritualité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
François-Eugène WERNERT
Les arbres, de sacrées histoires…
En hommage à mes grands-parents paternels Madeleine
(1902-1992) et Joseph WERNERT (1899-1967)
qui ont gagné leur vie en forêt, en plantant et en abattant des arbres…
à Madame le Docteur Angèle HICKEL, en toute amitié
« La sagesse est l’arbre du bonheur dont les racines sont synonymes de contentement, le tronc de discernement, le feuillage de considération et le fruit de serviabilité »
–(Mohamed LAZREK)
Du même auteur
•Voyage au pays du Catholicisme français contemporain - Un dictionnaire du Concile Vatican II (1962-65) à 2023, Orthez, Editions Publishroom Factory,2023.
•Juste, Orthez, Editions Publishroom Factory,2023.
•Traverser, Orthez, Editions Publishroom Factory,2023.
•La vie intérieure, pas à pas, Orthez, Editions Publishroom Factory,2023.
•Vade-mecum de vie spirituelle chrétienne, Orthez, Editions Publishroom Factory,2022.
•Traces brûlantes dans la rumeur du monde, Editions Libre Label, Vannes,2021.
•Etre et devenir adulte - Comment mieux aller vers ses potentialités ?, Paris, Editions L’Harmattan, 2021.
•Gammes humaines aux multiples sonorités, Paris, Editions Vérone, 2021.
•Vers de nouveaux métiers d’Eglise, Vannes, Editions Libre Label, ,2020.
•Essai sur la vie spirituelle - Fondements et perspectives avec une approche interdisciplinaire, Vannes, Editions Libre Label,2020.
•Souffles pour les voiles de la vie, Vannes, Editions Libre Label,2019.
•Pépites de bonheur, Vannes, Editions Libre Label,2019.
•Chemin de Pâques 2014 - Donnez vie à notre baptême, Strasbourg, Editions du Signe, 2014.
•Traversées au fil des jours - 365 pensées, Bordeaux, Editions Libre Label,2013.
•L’attente - Chemin faisant vers Noël, Strasbourg, Editions du Signe,2013.
•Ouverture(s), Strasbourg, Editions du Signe,2012.
•Le dimanche en déroute - Les pratiques dominicales dans le catholicisme français au début du III millénaire, Paris, Editions Médiaspaul, 2010 (Prix européen du meilleur livre de théologie décerné par l’AETC, Association européenne de théologie catholique, le 28 août 2011, à Vienne en Autriche).
•Une Parole au quotidien, Strasbourg, Editions du Signe,2006.
•Vie liturgique et Mouvement liturgique en Alsace de 1900 à nos jours, Strasbourg, Editions de l’Ercal,1992.
En collaboration :
•Célébrations dominicales de la Parole, Strasbourg, Editions du Signe,2010.
•Une Parole au quotidien, Strasbourg, Editions du Signe,2007.
•Pour vivre ensemble l’eucharistie, Paris, Editions de l’Atelier,2002.
Ce dossier se base sur les documents suivants :
BOUCHARDON P., De l’énergie des arbres à l’Homme, Editions Le courrier du Livre, 2011.
CHEVALIER J., GHEERBRANT A., Dictionnaire des symboles, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Editions Robert Laffont/Jupiter, 1982.
COLLECTIF, Arbres et forêts, Calendrier - Semainier, Département de Hugo Publishing, 2019, 34-36 rue La Pérouse 75116 Paris.
CORBIN A., La douceur de l’ombre - L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours, Paris, Editions Fayard,2013.
DUCHEMIN G., Les arbres - Anthologie, Frontignan, Editions Le chat rouge,2018.
LECU A., La prière des arbres dans la Bible, Hors-série de Prions en Eglise, Montrouge, Bayard-Presse,2018.
MEYER V., Les arbres remarquables du Bas-Rhin - Remarkable trees, Strasbourg, Editions du Signe,2018.
WERNERT F., Ouverture (s), Strasbourg, Editions du Signe, 2012.
WOHLLEBEN P., La vie secrète des arbres - ce qu’ils ressentent - comment ils communiquent, Paris, Editions des Arènes,2017.
(Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt – traduction par Corinne Tresca, Munich, Ludwig Verlag, 2015).
Prélude
Pourquoi s’intéresser aux arbres ? Je dédie ce dossier à mes grands-parents paternels qui ont travaillé toute leur vie en forêt, mon grand-père Joseph comme bûcheron et ma grand-mère Madeleine active dans les plantations de jeunes pousses dans la forêt de Haguenau1.
J’ai aussi eu la grande chance de grandir à côté de cette belle et vaste forêt, espace ludique, endroit silencieux et mystérieux, havre de paix. Quand on a goûté aux forêts, on ne peut plus s’en passer. Dès mes premières années, les arbres m’ont fasciné. Oui, bien sûr, comme chacun, je les trouve beaux, majestueux, imposants, élancés, tordus ou bizarres. Mais depuis mon enfance je suis habité par cette conviction indéfectible que l’arbre que l’on voit n’est pas essentiel. Derrière la majesté ou la beauté se cache une autre réalité qui nous échappe.
Il y a quelques années, j’ai eu le bonheur de revoir l’abbaye cistercienne de Fontenay en Bourgogne. Ce lieu parfaitement conservé accueillait à cette époque une exposition sur Saint Bernard (1090-1153) fondateur de l’ordre cistercien. Sur un des panneaux, quelques textes, dont celui-ci, retiennent mon attention : « La forêt et les arbres t’apprendront plus que tous les livres » (Homélie 16). Ce jour-là, j’ai eu envie de me replonger dans le monde des arbres…
Quand un homme d’Eglise, comme moi2, parle de nature, certains peuvent réagir vivement : « C’est encore du New Age, ce mouvement qui exalte la nature de manière démesurée ; c’est de la pseudo-religiosité ou pseudo-spiritualité… » Il convient d’écouter ces remarques. C’est vrai, dès le XVIIIème siècle, il y a eu des mouvements et des philosophies tournés vers la nature excluant par là même toute religion révélée (Révélation du Dieu fait homme)3. Pour moi, il ne s’agit nullement de mettre l’arbre au centre d’une religion naturaliste ou même au centre d’une recherche spirituelle. Mais pourquoi ne pas oser s’émerveiller devant un bel arbre ou une belle forêt.
J’invite le lecteur, au hasard de ses balades et de ses voyages, à ouvrir l’œil pour contempler et à (re)découvrir les arbres et les forêts… quelle joie !
Le monde des arbres et des forêts est très complexe et l’on ne s’improvise pas spécialiste en la matière ; pour cette raison, ce dossier est essentiellement nourri de lectures d’ouvrages spécialisés de sylviculture ; les passages d’ouvrages consultés et cités sont toujours strictement mentionnés.
Le dossier commence par une première partie intitulée « Racines » donnant une large place à la symbolique de l’arbre vue à travers plusieurs cultures.
La seconde partie porte comme titre : « Troncs », partie centrale assurant le lien entre les racines et les branches avec les feuilles. Partie visible, majestueuse qui mérite un développement important.
Le troisième chapitre porte le nom de « Houppier », ensemble des branches, des rameaux du feuillage au-dessus de la première couronne des grosses branches. On y trouve un ensemble de textes plus légers et plus courts.
La quatrième partie s’intitule « Canopée », zone d’une forêt qui correspond à la cime des arbres, lieu de contact avec le ciel. Est ici présentée la prière des arbres dans la Bible.
Le cinquième chapitre est nommée « Feuilles… poétiques » ; il rassemble de courts dictons et un panel de poésies…
1 La forêt indivise de Haguenau est une des plus grandes forêts de France par sa superficie. Elle compte plus de quatre-vingt arbres remarquables. Le pin sylvestre et le chêne occupent une place importante dans la forêt, viennent ensuite le hêtre et le bouleau. L’écotype pin sylvestre de Haguenau possède des caractéristiques forestières intéressantes et reconnues (taux de croissance rapide pour une grande qualité du bois produit). Au-delà de sa taille remarquable, la forêt indivise de Haguenau se caractérise par une biodiversité et une richesse patrimoniale spectaculaires. Ce sont ces caractéristiques qui ont permis l’engagement d’acteurs locaux dans une démarche de labellisation « forêt d’exception ». Surnommée « forêt sainte » elle conserve de nombreuses traces de son passé avec des tumulus préhistoriques et un arbre mythique, le « Gros Chêne », associé à la légende de saint Arbogast.
2 Prêtre du diocèse de Strasbourg depuis 1987.
3 Voir : CORBIN A., La douceur de l’ombre - L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours, Paris, Editions Fayard, 2013.
Chapitre 1 Racines
Qu’est-ce qu’un arbre ?
Il est nécessaire au début de ce dossier de répondre à cette question. Le dictionnaire historique de la langue française4rappelle que le nom masculin arbre est issu du latin arbor,arboris, nom féminin de forme exceptionnelle qui signifie « arbre » et aussi « mât », mot obscur (il n’y a pas un type « arbre » en indoeuropéen). Le féminin en latin s’explique par la féminisation ; la « mère (productrice) des fruits », phénomène lié à un concept religieux qui est, lui, à peu près universel. L’accusatif arborem, en latin populaire arbrem, a donné arbre. Le mot est passé en italien (albero), espagnol (arbol) ; en portugais il est resté féminin, les autres langues ayant adopté le genre masculin du bas latin, par analogie avec les autres mots enor.
Arbre est courant en français à toutes époques (depuis 1080), avec des valeurs symboliques d’origine mythique (dans arbre de Noël ; arbre de la science du bien et du mal, d’après la Genèse dès le XIIème s.) et métaphoriques, symbole de force et aussi de lignée, de race, d’où la figure de l’arbre de Jessé et le sens de arbre généalogique.
De nombreux syntagmes servent à désigner des plantes, arbres et arbustes, d’après une caractéristique ou une utilisation : arbre de Judée (XVIème s.), arbre saint (1768), l’azédarach dont les graines servaient à la fabrication des chapelets, arbre à la glu, le houx, etc.
Des objets de forme analogue au tronc d’un arbre ont reçu ce nom : « mât » (XIIIè-fin XVIIIè « moyeu » (XIIè s., d’un moulin, d’un pressoir), sens réemprunté au latin arbor, très vivant en mécanique, par exemple au sens d’«axe (d’un pendule) » (1690) et dans arbre de couche (1866), arbre de manivelle (1873).
Arbre désigne en particulier des arborescences, par exemple arbre de corail (1672), arbre des philosophes (1721).
L’idée de schéma à bifurcations, également présente dans arborescent, s’est developpé abstraitement à partir du XVIIIè s. (arbre encyclopédique, 1755), puis au XIXè et XXè s. en logique, en linguistique, sous l’influence de l’anglais tree, qui témoigne de la même métaphore.
Arbrisseau, nom masculin vient du latin populaire arboriscellum, diminutif de arbor. Le mot, depuis le XIIIè s. sous cette forme désigne un végétal ligneux plus petit que l’arbre et ramifié depuis labase.
Arbuste, nom masculin est emprunté (1495) au latin arbustum « bosquet », de l’adjectif arbustus « de l’arbre » ; le mot désigne un petit arbrisseau et est devenu courant.
Qu’est-ce qui est arbre et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Le dictionnaire définit l’arbre comme un végétal ligneux possédant un tronc d’où partent des branches. La tige principale doit être dominante et présenter une croissance en hauteur constante. A défaut de tronc unique, le végétal n’est pas un arbre mais un arbrisseau et ce qui ressemble à plusieurs petits troncs partant d’une souche commune sont en réalité des petites branches.
Et quand un arbre est coupé, meurt-il ? Qu’en est-il, par exemple, de cette souche multicentenaire ? Est-ce un arbre ? L’affaire se complique encore quand la souche forme un rejet. Et cela est d’autant plus fréquent que, dans de nombreuses forêts, les feuillus ont longtemps été exploités par des charbonniers qui les coupaient pour faire du charbon de bois. Les souches ont formé des rejets qui constituent aujourd’hui, des siècles plus tard, la base d’une majorité de nos forêts de feuillus, notamment de chênes et de charmes. La méthode consistait à couper et à laisser repousser les rejets une quinzaine d’années environ avant de les couper à nouveau, de sorte que jamais les arbres n’atteignaient une grande ampleur. A l’époque, cette pratique du taillis était dictée par la pauvreté des populations qui ne pouvaient pas se permettre d’attendre que les arbres grossissent.
« S’il y a un enseignement à tirer de la recherche actuelle, c’est bien que le délicat réseau racinaire n’est jamais avare de surprises. Jusque-là, il était unanimement admis qu’il pilotait chimiquement toutes les fonctions. Rien de déshonorable à cela, chez nous aussi de nombreux processus sont régulés par des messagers chimiques. Les racines absorbent les éléments nutritifs, les transportent, diffusent en retour les produits de la photosynthèse aux partenaires champignons et transmettent même des avertisseurs chimiques aux arbres voisins. Mais il y aurait un cerveau ? Pour ce que nous en savons, pour qu’il y ait cerveau, il faut qu’il y ait des processus neuronaux, et ceux-ci impliquent qu’il y ait, outre des messagers chimiques, également des signaux électriques. Des signaux électriques, justement, la science en détecte, depuis le XIXè s. Alors, les plantes ont-elles un cerveau ? Sont-elles intelligentes ? Ce n’est rien de dire que le débat qui anime la communauté scientifique depuis des années est vif. Frantisek Baluska, de l’Institut de botanique cellulaire et moléculaire de l’Universitaire de Bonn, pense, en accord avec d’autres de ses collègues, que les pointes des racines sont équipées de dispositifs similaires à un cerveau. Elles présentent en effet, outre un système de transmission des signaux, des structures et des molécules que l’on observe chez les animaux. La racine qui progresse dans le sol est à même de capter des stimuli. Les chercheurs ont détecté des signaux électriques qui, après avoir été traités dans une zone de transition, induisent des modifications du comportement. Quand les racines rencontrent des substances toxiques, des pierres infranchissables ou des milieux trop humides, elles analysent la situation puis transmettent les changements nécessaires aux zones qui assurent la croissance. Celles-ci changent alors de direction et contournent l’obstacle. En déduire que les racines sont le siège d’une intelligence, d’une aptitude à se souvenir et à ressentir des émotions est vivement critiqué par une majorité d’universitaires. Ils contestent le rapprochement avec des situations similaires chez les animaux, notamment parce qu’il tend à effacer la frontière entre monde végétal et monde animal. Et alors ? Serait-ce si terrible ? La division entre végétal et animal est un choix arbitraire essentiellement basé sur le mode de nutrition : l’un pratique la photosynthèse, l’autre ingère des organismes vivants. La seule véritable différence concerne le temps nécessaire au traitement des informations puis à leur transformation en actions. Mais les organismes lents sont-ils nécessairement inférieurs aux organismes rapides ? Je me demande parfois si nous ne serions pas contraints de traiter les arbres et l’ensemble des végétaux avec plus d’égards s’il s’avérait sans contestation possible qu’ils partagent de nombreuses facultés avec les animaux5. »
Enfin, il est important de distinguer dans le vocabulaire usuel le terme de houppier, de ramure et de canopée.
La canopée est la strate supérieure d’une forêt, composée des feuillages directement exposés au rayonnement solaire. Elle est parfois considérée comme un écosystème distinct, notamment en forêt tropicale où elle constitue un habitat riche de biodiversité et de productivité biologique
Le houppier : en botanique, un houppier ou couronne est la partie d’un arbre constituée d’un ensemble structuré des branches situées au sommet d’un tronc.
La ramure est, elle, l’ensemble des branches, des rameaux et du feuillage. Le houppier comprend donc la ramure et le feuillage.
La symbolique des arbres
L’un des thèmes symboliques les plus riches et les plus répandus6 ; celui également dont la bibliographie, à elle seule, formerait un livre. Mircea Eliade distingue sept interprétations principales (ELIT, 230-231) qu’il ne considère d’ailleurs pas comme exhaustives, mais qui s’articulent toutes autour de l’idée du Cosmos vivant en perpétuelle régénérescence.
En dépit d’apparences superficielles et de conclusions hâtives, l’arbre, même sacré, n’est pas partout un objet de culte : il est la figuration symbolique d’une entité qui le dépasse et qui, elle, peut devenir objet de culte.
Symbole de la vie, en perpétuelle évolution, en ascension vers le ciel, il évoque tout le symbolisme de la verticalité : ainsi l’arbre de Léonard de Vinci. D’autre part, il sert aussi à symboliser le caractère cyclique de l’évolution cosmique : mort et régénération ; les feuillus surtout évoquent un cycle, eux qui se dépouillent et se recouvrent chaque année de feuilles.
L’arbre met aussi en communication les trois niveaux du cosmos : le souterrain, par ses racines fouillant les profondeurs où elles s’enfoncent ; la surface de la terre, par son tronc et ses premières branches ; les hauteurs, par ses branches supérieures et sa cime, attirées par la lumière du ciel. Des reptiles rampent entre ses racines ; des oiseaux volent dans sa ramure : il met en relation le monde chthonien et le monde ouranien. Il réunit tous les éléments : l’eau circule avec sa sève, la terre s’intègre à son corps par ses racines, l’air nourrit ses feuilles, le feu jaillit de son frottement.
On ne retiendra ici que la symbolique générale de l’arbre ; des précisions sur des espèces particulières seront données à leur nom : acacia, amandier, chêne, cyprès, olivier,etc.
Parce que ses racines plongent dans le sol et que ses branches s’élèvent dans le ciel, l’arbre est universellement considéré comme un symbole des rapports qui s’établissent entre la terre et le ciel. Il possède, en ce sens, un caractère central, à tel point que l’Arbre du monde est un synonyme de l’Axe du monde. C’est bien ainsi que le décrit lyriquement le Pseudo-Chrysostome, dans la sixième homélie sur la Pâque : ferme soutien de l’univers, lien de toutes choses, support de toute la terre habitée, entrelacement cosmique, comprenant en soi toute la bigarrure de la nature humaine. Fixé par les clous invisibles de l’Esprit, pour ne pas vaciller dans son ajustement au divin ; touchant le ciel du sommet de sa tête, affermissant la terre de ses pieds, et, dans l’espace intermédiaire, embrassant l’atmosphère entière de ses mains incommensurables. (cité par H. de Lubac, dans Catholicisme – Les aspects sociaux du dogme, Paris, 1941, p. 366). Figure axiale, il est tout naturellement le chemin ascensionnel par lequel transitent ceux qui passent du visible à l’invisible : c’est donc cet arbre qu’évoquent aussi bien l’échelle de Jacob que le poteau chamanique de la yourte sibérienne, le poteau-mitan du sanctuaire vaudou, Chemin des esprits (METV, 66), ou celui de la loge des Sioux, autour duquel s’accomplit la danse du soleil. C’est le pilier central qui soutient le temple ou la maison, dans la tradition judéo-chrétienne, et c’est aussi la colonne vertébrale soutenant le corps humain, temple de l’âme.
L’arbre cosmique est souvent représenté sous la forme d’une essence particulièrement majestueuse. Tels apparaissent, dans les croyances de ces peuples, le chêne celtique, le tilleul germanique, le frêne scandinave, l’olivier de l’orient islamique, le mélèze et le bouleau sibériens, tous arbres remarquables par leurs dimensions, leur longévité ou, comme dans le cas du bouleau, leur blancheur lumineuse. Sur le tronc de ce dernier des entailles matérialisent les étapes de l’ascension chamanique. Dieux, esprits et âmes empruntent le chemin de l’arbre du monde, entre ciel et terre. Ainsi en va-t-il en Chine avec l’arbre Kien-Mou, dressé au centre du monde, comme en témoigne le fait qu’il n’y a, à son pied, ni ombre, ni écho ; il a neuf branches et neuf racines, par lesquelles il touche aux neuf cieux et aux neuf sources, séjour des morts.
Par lui, montent et descendent les souverains, médiateurs entre le Ciel et la Terre, mais substituts aussi du soleil. Soleil et lune descendent également par le mélèze sibérien, sous forme d’oiseaux ; en outre, de part et d’autre de l’arbre Kien se trouvent l’arbre Fou au levant et l’arbre Jo au couchant, par où monte et descend le soleil. L’arbre Jo porte aussi dix soleils qui sont dix corbeaux.
Pour les musulmans chiites de rite ismaélien, l’arbre nourri de la terre et de l’eau et dépassant le septième ciel symbolise la hakikat, c’est-à-dire l’état de béatitude où le mystique dépassant la dualité des apparences rejoint la Réalité suprême, l’Unité originelle où l’être coïncide avec Dieu.
Il existe, dans certaines traditions, plusieurs arbres du monde. Ainsi les Gold en situent un premier dans les cieux, un second sur terre, un troisième dans le royaume des morts (HARA,56).
Aux antipodes du pays des Gold on trouve, dans la cosmologie des Indiens Pueblo le grand sapin du monde souterrain qui reprend le symbolisme ascensionnel de la migration des âmes en fournissant l’échelle au moyen de laquelle les Ancêtres, inillo tempore, purent grimper jusqu’à la terre de notre soleil (ALEC,56). Mais cet arbre central qui, du cosmos jusqu’à l’homme, couvre tout le champ de la pensée de sa présence et de sa puissance, est aussi, nécessairement, l’arbre de vie, qu’il soit à feuilles persistantes, tel le laurier, symbole d’immortalité, ou à feuilles caduques dont la régénération périodique exprime le cycle des morts et renaissances, et donc la vie dans sa dynamique : s’il est chargé de forces sacrées, note M. Eliade, c’est qu’il est vertical, qu’il pousse, qu’il perd ses feuilles et les récupère et que, par conséquent, il se régénère : il meurt et renaît d’innombrables fois (ELIT,235).
L’arbre de vie a pour sève la rosée céleste, et ses fruits, jalousement défendus, transmettent une parcelle d’immortalité. Ainsi en est-il des fruits de l’arbre de vie de l’Eden, qui sont au nombre de douze, signe de renouvellement cyclique, et de celui de la Jérusalem céleste, des pommes d’or du jardin des Hespérides et des pêches de la Si-wang mou, de la sève du Haoma iranien, sans parler des diverses résines de conifères. Le himorogi japonais, amené dans la Terre centrale, paraît bien être un Arbre de Vie. L’Arbre de Vie est un thème de décoration très répandu en Iran où on le figure entre deux animaux affrontés ; à Java, il est représenté avec la montagne centrale sur l’écran (kayon) du théâtre d’ombres.
L’Arbre de la Boddhi, sous lequel le Bouddha atteignit l’illumination, est encore un Arbre du monde et un Arbre de Vie : il représente, dans l’iconographie primitive, le Bouddha lui-même. Ses racines, dit une inscription d’Angkor, sont Brahmâ, son tronc Civa, ses branches Vishnu. C’est une représentation classique de l’axe du monde. L’Arbre cosmique qui, dans le Barattage de la Mer de Lait, sert à l’obtention du breuvage d’immortalité, est représenté à Angkor avec Vishnu à sa base, sur son tronc et à son sommet. Mais, en d’autres circonstances, Civa est un arbre central dont Brahmâ et Vishnu sont les branches latérales.
L’association de l’Arbre de Vie et de la manifestation divine se retrouve dans les traditions chrétiennes. Car il y a analogie, et même reconduction du symbole entre l’arbre de la première alliance, l’arbre de vie de la Genèse, et l’arbre de la croix, ou arbre de la Nouvelle Alliance, qui régénère l’Homme. Pour H. De Lubac, la Croix, érigée sur une montagne, au centre du monde, reconduit totalement l’antique image de l’arbre cosmique ou arbre du monde. Fréquentes sont du reste dans l’iconographie chrétienne, les représentations de croix feuillue ou d’Arbre-Croix, où l’on retrouve, avec la séparation des deux premières branches, la symbolique de la fourche et de sa représentation graphique, l’Y, ou de l’Unique et du duel. A la limite, c’est le Christ lui-même qui, par métonymie, devient l’arbre du monde, axe du monde, échelle : la comparaison est explicite chez Origène.
En Orient comme en Occident, l’arbre de vie est souvent renversé. Ce renversement, selon les textes védiques, proviendrait d’une certaine conception du rôle du soleil et de la lumière dans la croissance des êtres : c’est d’en haut qu’ils puisent la vie, c’est en bas qu’ils s’efforcent de la faire pénétrer. De là, ce renversement des images : la ramure joue le rôle des racines, les racines celui des branches. La vie vient du ciel et pénètre la terre : suivant un mot de Dante, il est un arbre qui vit de sa cime. Cette conception n’aurait rien d’anti-scientifique ; mais l’en-haut oriental est sacralisé et la photogenèse s’explique par la puissance d’êtres célestes. Le symbolisme hindou de l’arbre renversé, qui s’exprime notamment dans la Bhagavad-Gitâ (15, 1) signifie aussi que les racines sont le principe de la manifestation et les branches la manifestation qui s’épanouit. Guénon y découvre encore une autre signification : l’arbre s’élève au-dessus du plan de réflexion, qui limite le domaine cosmique inversé au-dessous ; il franchit la limite du manifesté, pour pénétrer dans le réfléchi et y introduire l’inspiré.
L’ésotérisme hébraïque reprend la même idée : L’arbre de vie s’étend du haut vers le bas et le soleil l’éclaire entièrement (Zohar). Dans l’Islam, les racines de l’Arbre du Bonheur plongent dans le dernier ciel et ses rameaux s’étendent au-dessus et au-dessous de la terre.
La même tradition s’affirme dans le folklore islandais et finlandais. Les Lapons sacrifient chaque année un bœuf, au profit du dieu de la végétation et, à cette occasion, un arbre est posé près de l’autel, les racines en l’air et la couronne par terre.
Schmidt rapporte que dans certaines tribus australiennes, les sorciers avaient un arbre magique qu’ils plantaient renversé. Après en avoir enduit les racines de sang humain, ils le brûlaient.
Dans les Upanishad, l’Univers est un arbre renversé, plongeant ses racines dans le ciel et étendant ses branches au-dessus de la terre tout entière. Selon Eliade, cette image pourrait avoir une signification solaire. Le Rig-Veda précise : C’est vers le bas que se dirigent les branches, c’est en haut que se trouve sa racine, que ses rayons descendent sur nous ! La Katha-Upanishad : Cet Açvattha éternel, dont les racines vont en haut et les branches en bas, c’est le pur, c’est le Brahman ; le Brahman, c’est ce qu’on nomme la Non-Mort. Tous les mondes reposent en lui. Mircea Eliade commente : l’arbre Açvattha représente ici dans toute sa clarté la manifestation du Brahman dans le Cosmos, c’est-à-dire la création comme mouvement descendant (ELIT, 239-241).
Et Gilbert Durand de conclure : Cet arbre renversé insolite, qui choque notre sens de la verticalité ascendante, est bien signe de la co-existence, dans d’archétype de l’arbre, du schème de la réciprocité cyclique (DURS, 371). Cette idée de réciprocité conduit à celle d’union entre le continu et le discontinu, l’unité et la dualité, au glissement symbolique de l’Arbre de Vie à l’Arbre de la Connaissance, cet arbre de la Science du Bien et du Mal, qui est pourtant distingué du premier. Dans le paradis terrestre, il sera l’instrument de la chute d’Adam, comme l’arbre de vie sera celui de sa rédemption, avec la crucifixion de Jésus. Cette distinction de l’Ancien Testament, qui renforce encore l’idée de réciprocité, introduirait aussi, selon André Virel, le parallélisme et la distinction de deux évolutions créatrices, biologique d’une part