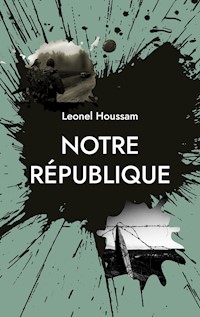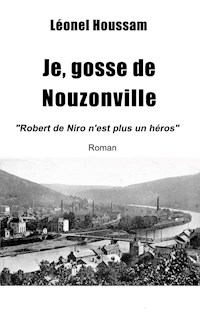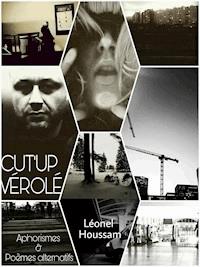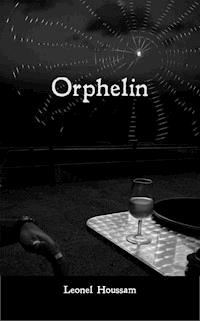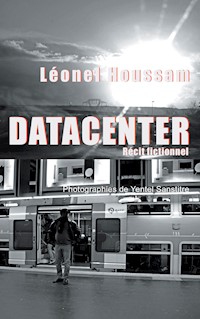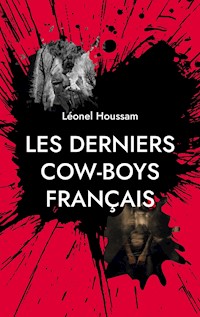
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
C'est une non-road story bousillée par mon incapacité à planter le décor. Ainsi l'auteur présente-t-il son livre, à classer dans les bibliothèques au rayon brûlant. Car attention, voilà du hardcore. Du méchant, du mauvais, du sale. Du pas correct, du nihiliste. Le genre de livre à ne pas donner à votre belle-mère. Ni à votre supérieur hiérarchique, à moins de chercher un motif de licenciement pour faute grave. Le sujet ? Un flic se fait virer par sa femme et cogne sur de sales petits vendeurs de shit. Dégoûté, il démissionne pour se jeter dans les bras d'un gourou, un énorme Black dont il tombe éperdument amoureux. Ensemble, dans une virée sans issue, ils vont rentrer dans un infernal cycle de décadence, physique et morale. Un livre déjanté et qui présente mal. Rien à voir avec la nouvelle chanson française. Mais à l'image, lui, du monde moderne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Romans, micro-roman et nouvelles :
Seconde Chance – Editions La Matière Noire puis BOD – 2013/2016
Chronique de la mort au bout – CreateSpace - 2015
DATACENTER – Editions du Pont de l’Europe (version papier) et BOD (version numérique) - 2017
Je, Gosse de Nouzonville – Editions du Pont de l’Europe (version papier) et BOD (version numérique) - 2020
Dracula fille de joie – BOD - 2022
Biographies :
Manu Chao, le clandestino – Editions Pimientos - 2009
Noir Désir, Post-Mortem – Editions Camion Blanc - 2019
Collaborations :
Ablation de mon prépuce mentale. Avec Insolo Veritas. – BOD – 2021
Douleurs Fantômes. Avec Dystophotographie – BOD - 2022
Sommaire
PRÉMICES
L’EAU C’EST ELLE, ET MOI C’EST L’EAU
ELLE S’EST BARRÉE DEPUIS UNE SEMAINE
EN DESCENDANT DANS LA RUE, JE RÉALISE QUE JE NAGE DANS MON FROC
JUSTINE NE SOURIAIT PAS BEAUCOUP
ELLE, C’EST MOI. MOI, C’EST ELLE. ET ELLE, C’EST L’EAU
ON JUMPE !
ON PATROUILLE
JE « JUMPE » SEUL DEVANT TOUT LE MONDE
DERNIERS SOUVENIRS D’UNE SOIRÉE SENSUELLE/AVANT LE DÉPART
DÉPART VERS LE FAR WEST
ALLER À BEAUVAIS
LA PLUIE EN TOUTE SAISON
MA P’TITE LANGUE À CALIFOURCHON CONTRE LA SIENNE
HEUREUSEMENT MAINTENANT
LONG LENT À RACONTER
IL EST PLONGÉ, JUSQU’À L’ASPHYXIE, DANS SON LAÏUS
ICI PAS ICI
POUR DORMIR. POUR VIVRE. POUR PARTIR
LE SEUL VRAI RÊVE EST DE FAIRE DÉGUEULER SON POT D’ÉCHAPPEMENT DANS L’AIR PEU VICIÉ DES CAMPAGNES
DES INFUSIONS INFECTES EN PERMANENCE
LA MAUVAISE GESTION DE NOS MIGRATIONS
LE CHEMIN DANS LE CHEMIN
« L’ALIÈNE »
COMME ÉTOUFFÉ DANS L’AMOUR D’UN AUTRE ?
T’ES UN BON COW-BOY MON POTE
NON LOIN DE TROYES
LA ROUTE EST CONNE
LE NOEUD DES PROBLÈMES
LES PHRASES FRACASSÉES
J’AI DES SOUVENIRS D’HOMMES ROUGES
DANS LA TÊTE DE STAR
L’ULTIME RODÉO
GRANDEMENT BESOIN DE REPOS
LES DOUTES, C’EST LA MÉMOIRE QUI REVIENT TROP VITE
LE BANC DES G’NOUX QUI CRAQUENT, RECRAQUENT ENFIN
LES HERBES
MIMOU MON MÉTRO
DES PENSÉES D’ENFANT MÊLÉES À CELLES D’UN ADULTE
L’AMOUR À BALLES RÉELLES
Les voici maintenant au monde : un monde dont ils sont les maîtres. Et ce monde, eh bien, non, n’est pas heureux pour ceux, bien qu’ils le voient d’un œil plein d’un humble enjouement : leur jeunesse ne revêt pas grand-chose de plus que leur tête blonde, la force intérieure, le feu de la pudeur, au long des rues immenses, des immenses immeubles, jetés sur le vide de la cité puissante et sans forme qui accueille leur vie nouvelle. Mais religieuse est l’ardeur qui emplit, jusqu’à l’aveuglement, en leur regard hardi, tout comme pour s’offrir, ou bien pour témoigner, leur âme amicale, et qui tremble.
Extrait de La Religion de notre temps (La Religione del mio tempo), Pier Paolo Pasolini, 1959.
PRÉMICES
L’écoumène sature d’hommes voraces. Ils gesticulent beaucoup pour produire, se reproduire et s’imposer comme la seule puissance organique terrestre. Les Occidentaux sont victimes d’une gemmiparité redoutable permettant la confusion entre les individus, leurs messages contendants, parfois, ou leur passivité à toute épreuve. En fait, les destins obscurs se croisent. Plus le monde est marché, et plus le quidam devient lycose, terré dans un immeuble immonde au loyer excessif et aux fuites de robinetterie ingérables. Les enfants. Peut-être les enfants ne sont-ils finalement plus que des êtres spumescents (jolie écume, écume grise pourquoi pas, que l’on voit s’accumuler sur les plages en hiver) ou même d’affreux aspergillus. Leur sort ne dépend plus de leurs parents trop infantilisés par le scintillant des vitrines. Ils sont livrés à eux-mêmes. Livrés comme des bêtes au temple des sans/dalle. Ils sont simplement les gonades de l’avenir, les glandes reproductrices assurant une pérennité évidente à un capitalisme rageur, crevard, affamé de non-sens, de destruction massive enjolivée.
Le précipice devient l’horizon.
La chute, c’est l’héboïdophrénie…
Chaque époque a livré son lot de malheurs aux hommes. Chaque période de rupture génère ses tonnes/décès, ses vagues de massacres et de dépit.
L’acier du canon est froid. La perte de repère, la certitude de nager, compressé à l’excès, dans l’abysse contemporain… Le pantalon sale. Le pull imbibé. Le corps de celui qui n’a pas su s’intégrer à la folie collective est couvert de miasmes. Hébété, il regarde l’autre, ne le perçoit pas vrai-ment comme un être vivant. Il reçoit son visage affable. Il sait l’obstination du bonhomme à être « bon », peut-être généreux… Mais il sait qu’il ne sert à rien, à personne. Personne ne sert à personne. Dieu est mort. La mort est le seul dieu servant l’angoisse du vivant. L’acier du canon est impeccablement froid. Ces paltoquets gisant sanglants sur le parquet lui font penser à une fosse commune.
L’acier du canon est froid. Ils en donnaient des leçons. Ils en donnaient sans cesse. « Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas penser comme ça. Tu réfléchis trop. Sois plus spontané. Laisse-toi vivre. Te prends pas la tête. » Il apprécie le goût particulier de l’acier du canon. Il fait partie, qu’on le veuille ou non, de ces êtres qui portent la douleur du monde sur leur dos, sans jamais agir. Sa longanimité passée n’a d’égale que son inflexion actuelle. L’acier du canon est glace. Sa langue gesticule contre.
Fin de cette logomachie, place au récit/fiel.
I L’EAU C’EST ELLE, ET MOI C’EST L’EAU
ELLE S’EST BARRÉE DEPUIS UNE SEMAINE
Mes pensées/gangrènes se juxtaposent aux envies de sexe en toute liberté. La désolation. Les trahisons. Mettre des mots les uns derrière les autres. Ma tête est capharnaüm. Naturellement la flasque est vide et empeste. Ces «dosettes» de cognac sont infectes.
Dans sa Touraine natale si sereine, elle s’est planquée, comme une chienne qu’elle est, avec mon gosse. Ma vie. Mes meubles.
Tout. Tout ce fatras et ces vides vertigineux, c’est mon chez-moi de trentenaire célibataire. Fraîchement célibataire… Les scenarii actuels des pires navets télévisés ne proposent plus ces histoires grotesques : la pétasse se casse avec tout le bordel du ménage parce que son connard de Jules la gonflait avec ses « chui qu’une merde ».
Balbutiements de la mémoire. Avant que mes nerfs ne se déchirent, j’ai pris une journée de récupération pour zoner sur mon matelas, mes draps froissés et mon oreiller jauni par mon cuir chevelu. Qui ne l’aurait pas fait ? Je sors d’un jour et j’entre dans une longue nuit. Je crois. Le fait que chacune de mes réflexions soit emplie de « je », de « moi » et de « moi-même » indique que, cette fois, je suis en phase de sortie de l’en-monde.
Tout me préoccupe. L’angoisse monte rapidement dès qu’il me faut prendre la moindre décision…
Justine s’était approchée de moi, le regard en velours, l’amour, les mains manucurées, les vêtements de dame sexy et une voix un peu rauque. À 21 ans, elle avait la voix d’une vieille fumeuse. Et c’est aussi sans doute ça qui me fit craquer, alors. Ses cheveux noirs très longs tombaient en cascade jusqu’à la cambrure ultime, le dessin/toboggan de ses fesses rondes. Les souvenirs sont intacts.
Très clairement, et très honnêtement, j’ai certainement les souvenirs de photos d’elle. Pas des images en mouvement de son corps, ses mimiques. Simplement le souvenir de sa gueule figée sur les photos : « Avec maman », « À la plage avec Franck », « Ça c’était dans les Landes, qu’est-ce qu’on s’est marrés », « Là c’était un délire à la piscine municipale avec Martine et Lucie, tu sais les copines de celui qu’on appelle d’Artagnan parce qu’il… », « Là on venait de s’engueuler et on s’était réconciliés au supermarché dans le rayon charcuterie », « Ah tiens, le mec là, c’est celui qui a essayé de se taper Justine », « Ouais Berlin c’est une super ville, sauf qu’il faisait - 12 ° et que j’avais un manteau de merde »… Des souvenirs en tonnes. L’encombrement inutile de ma boîte crânienne. Il y a peu, on avait « investi » dans un appareil photo numérique Canon. Le nec plus ultra de l’appareil aux millions de pixels, à la mise au point facile, et tout le tralala dans la gamme de prix 400-700 euros.
Avant ça, nous avions un argentique avec lequel nous photographions les moments ensemble, les instants magiques, les phases clés de notre vie de couple. Putain… ça pue. J’y pense que ça pue. Pour ne pas se planter, Justine et moi avions acheté des magazines de consommateurs, ces nouveaux supports d’information essentiels pour vivre correctement notre existence urbaine/classe/ moyenne/on/ne/sait/plus/où/mettre/de/la/tête/dans/les/rayon s.
Avec le numérique, l’ordinateur, les logiciels de retouche d’images et l’ensemble de l’arsenal des technologies nouvelles/ la/révolution, on est passé au stade : « Je prends tout en photo, je manipule l’image et je chie des œuvres d’art intimistes/autobio de qualité supérieure. » À mourir de rire. Les soirées entre amis devenaient, dès lors, des sortes de vernissages pitoyables. « Tu reprendras un petit four ? Tiens il en reste un au saumon fumé… Ah oui, ça, cette photo de Justine, je l’ai faite près du lac Léman. On a l’impression qu’elle est dans le vaisseau “Enterprise” parce que j’ai fait un montage avec Photoshop. » Putain… L’ère du tout numérique après l’ère quaternaire… Putain… Comment ai-je pu croire que j’étais un artiste ? Comment l’ensemble des « tout-numérique » s’imagine-t-il être dans la sphère de la création ? On a fait un blog, phlog pour stocker nos photos et écrire des textes pseudo-spirituels d’accompagnement pour agrémenter nos « créations ». Le monde du tout-numérique, ce sont des millions de gens qui s’imaginent devenir des grands artistes, chroniqueurs, etc.
Putain… Justine créa aussi nos Tumblr, Facebook, YouTube et Dailymotion sur lesquels nous stockions des films pourris qui la montraient se dévoilant à moitié. Une bretelle de soutien-gorge, la naissance de la raie de ses fesses. Cela provoquait des milliers de connexions chaque jour. Ça craignait vraiment.
Nous ne nous sommes pas rencontrées sur les bancs de la fac, dans une boîte de nuit ou dans une soirée entre amis… Nous nous sommes rencontrés sur un bateau-mouche… Un bateaumouche avec des têtes de Japonais et d’Allemands bavant sur Notre-Dame de Paris… J’étais guide, à l’époque, et elle était photographe indépendante. « Un p’tit sourire connasse de Japonaise ? » Et l’autre de grimacer de joie devant l’objectif. « Paris est très beau. » Ah l’accent japonais ! L’effort minimum d’une civilisation martienne.
Je me jette du lit et vais dégueuler direct dans le lavabo. Putain, plus rien. Plus de meubles nulle part. Il ne me reste qu’un gel douche presque vide, une brosse à dents, pas de dentifrice et un savon blanc craquelé (pensée de famine éthiopienne des années 1980 et les têtes de We are the world, we are the children).
Mon vomi est consistant : un mélange de bière, de whisky, de cannabis, d’anxiolytiques et de choucroute en boîte. Malgré mon apathie, j’ai une pêche terrible pour vider mon estomac. Ça n’en finit pas et ça pue. Les souvenirs sont là-dedans, dans cette bouillie stomacale blanche et mousseuse… Après l’apepsie provoquée par le choc de la rupture, c’est la gastro qui se charge de me décharger.
Et par-dessus tout, mes yeux sont cramés par une dacryadénite (diagnostique du médecin il y a une quinzaine de jours, lors d’une consultation qui devait résoudre mon problème de boulimie sexuelle : fantasmes persistants et récurrents. Incidence lourde sur mon corps lorsque je croisais une fille dans la rue…). Énucléation de la partie peace de mon esprit.
En me relevant, je vois ma gueule dans le miroir, qu’elle a tout de même daigné me laisser. Un miroir mal fixé par mes soins dans le mur/plâtre/ça/sonne/creux/alors/c’est/facile/de/percer. Le bricolage n’a jamais été mon fort. C’est haletant cette succession de pensées de toute sorte, en bordel.
En bon nombriliste dépressif occidental que je suis, j’explore méticuleusement mon visage : les rides, les ridules, les joues, les poils en haut des joues – si je les coupe, ça risque de repousser plus dru encore –, le teint jaune de la peau, le rouge du blanc des yeux, les pupilles noires bien dilatées, les petits vaisseaux éclatés totalement effrayants lorsqu’on les regarde de près, la calvitie naissante, les points noirs sur le nez/les/percer/c’est/facile/ça/sonne/ creux, les boutons souscutanés qui font un mal de chien, la bouche pâteuse, la langue chargée blanche/verte. Il n’existe plus que mon image, le dessin de mon visage, les coups de pelle du temps sur mes traits. J’ai le temps. Ne travaille ni aux champs ni à l’usine. J’ai tout mon temps pour me regarder me décomposer. Le souvenir du bonheur dans la défonce.
Dans mon monde du trop-consommé, je suis totalement paniqué par le vide et le manque. C’est un aujourd’hui où je suis. Un aujourd’hui qui n’accepte pas le mot durable, qui fait la part belle aux réseaux, aux communautés, aux groupements provisoires par affinité. Un aujourd’hui où je n’ai plus ma place. Comme des millions/milliards d’autres. Un maintenant qui signifie perdu. Complètement perdu. Où le danger est fantasmé, rarement vécu. Où l’on ne ressent plus vraiment le temps. Une longue litanie, une chaîne de lamentables complaintes… La tristesse de celui qui ne souffre ni de la soif, ni de la faim, ni de la chaleur, ni du froid, ni de la privation d’expression, de mouvement, de revendication, d’opposition… Même si ça ne sert strictement à rien. Tout est anormal. Il n’existe que des rituels que l’on s’invente. On est seul. Réellement. Tous les paramètres de mon existence sont caractérisés par l’anormalité. Mon boulot, mon couple…
Demain, je retournerai sans doute au boulot avec 3 ou 4 kg en moins. Mon visage sera creusé et mes cheveux ébouriffés s’éparpilleront partout sur mes épaules, mon dos et mon torse. Les collègues s’étonneront de mon état sans m’en parler. Les collègues, c’est l’indigestion relationnelle de ce siècle, dans les pays les plus riches.
L’alcool, la fatigue, la dépression me contraignent à la pensée. Penser à tout. Réfléchir sur tout. Tout le temps. À tout instant.
Le collègue, le faux-cul, le cul-terreux, le mec qui te tient la jambe toute la journée, partout où tu seras sur ton lieu de travail.
Ton collègue et ses problèmes familiaux. Ton collègue et les ragots sur les supérieurs et sur les autres collègues. Ton collègue et son invitation éternelle : « Un de ces soirs, faudra qu’on aille s’boire un verre ensemble. J’connais un pub excellent où il y a plus de femmes que de mecs. Tu vois l’genre. » L’genre, je le vois comme ça, chaque jour. Cette distance intérieure avec ces personnes que je croise, avec qui je dois accomplir des missions. Le collègue qui n’en fait qu’à sa tête. Le collègue qui te fait comprendre que tout ce que tu pensais sur le travail, c’était faux, complètement faux.
Je vomis encore. Les maux, les migraines et l’impression que les veines de mon front vont péter comme des tuyaux d’eau chaude bouchés. Je fais du style dans mes pensées en me vidant.
Justine était très belle, très brune, mais étrange. Elle ne plaisait pas aux mecs parce qu’elle avait plus de charme que de beauté. Dire ce genre de choses, c’est un peu se faire rire seul. Même si elle portait une jupe courte, ça ne faisait jamais pute ou salope.
(C’est la même chose peut-être. Sûrement. Mon état d’esprit m’oblige à penser que c’est pareil.) Son truc, c’était l’intelligence dans le regard. (Des conneries monumentales comme ça, j’en ai des tonnes à revendre, à refourguer, à mettre en boîte et à exporter.)
Et ça, même s’ils se défendent du contraire, la plupart des mecs n’aiment pas ça.
J’ai fini de cracher les dernières gouttes de bile récalcitrantes. Ils n’aiment pas ça parce ce qu’ils préfèrent avant tout, avec les femmes, c’est bander, ressentir ce chatouillement extraordinaire dans le bide qui rend fou, même le plus évolué des hommes/ primates. Un mec dévoré par le désir à la vue des vulgarités d’une bimbo est un personnage incroyablement drôle.
Le parquet. Une écharde dans le pied en courant. La chute en avant. Le retour sur le matelas fumant…
« Philosopher ». C’est bidon. La fenêtre de ma chambre donne sur une cour intérieure très sombre, sordide.
Justine est devenue une salope un peu plus tard. « J’ai besoin de savoir qui je suis. Il faut que je vole de mes propres ailes pour pouvoir savoir qui je suis vraiment. C’est – la voix rauque, pas oublier la voix rauque avec de l’arrogance dedans – important pour moi tu sais ? Ce n’est pas que je ne t’aime pas, mais tu es mon seul vrai premier mec, et je te trouve intelligent. Trop intelligent pour moi. Je ne te mérite pas. »
Peu importe, je crache l’amer sur le parquet qui entoure ma barque/lit comme un océan. Le film dans la tête.
C’est à ce moment-là que j’aurais dû tout laisser tomber. Ne pas tenter de la récupérer. Car à 20–25 ans, les femmes sont très romantiques. Elles y croient encore très fort et pensent que, si elles cessent d’y croire, le monde s’écroulera et leur bonheur ne sera plus qu’une idée vaine. Qui je suis pour penser des trucs pareils ?
Alors j’ai « coursé » Justine, dans tous les sens du barbarisme. Je lui ai couru après dans la rue où je l’ai saisie par le sac de voyage rempli. Et je l’ai poursuivie psychiquement avec mes « Pars pas ! »,
« Tu es tout pour moi ! », « Je te promets de te laisser faire ce que tu désireras ». Sur son visage, je lisais une forme d’inquiétude. Elle pressentait, sans doute, que, quel que soit son choix, tout était vain. Perdu d’avance. « Mais ne pars pas… » Elle est donc restée et s’est penchée sur son problème d’émancipation personnelle.
Pour ma part, c’est à ce moment-là que j’étais en pleine préparation du concours pour entrer dans la police… Parallèlement, je commençais à écrire dans des fanzines, puis magazines de musique. La logique s’intègre mal au récit de ma vie. La plupart des histoires, qu’il s’agisse de fiction ou de biographie, se tiennent, sont construites, spectaculairement attirantes par leur unité. La mienne est plus haletante, harassante, qu’unitaire. La table basse, c’est le cumul des petites choses du quotidien. Un programme/télé (Justine a fait tous les Sudoku), un coupe-ongles, un stylo bouffé, un crayon à papier non rongé sans mine, une facture EDF chiffonnée (c’est de la « nouvelle scène de la chanson française » mon fil de pensées). La table basse, c’est un carton. Il flotte sur l’océan-parquet. Je ne vois pas bien l’horizon qui se confond dans le mur blanc, le ciel imaginaire de mon salon.
Nous ne vivions pas ensemble. Elle se donnait à fond dans son métier de photographe et couchait parcimonieusement avec des types d’un soir ou d’une semaine. Et m’en parlait… Et m’expliquait sa façon de les sucer, les positions qu’ils préféraient pour la prendre… Bref, sa façon à elle de s’émanciper et de savoir qui elle était vraiment. (Ça, c’est beaucoup plus fin de siècle français, avec une femme qui virevolte sexuellement et qui rêve d’un seul homme. Écrivaine française moderne. « J’en n’ai rien à foutre. J’baise comme j’veux, mais au fond j’ai envie de m’suicider avec les hommes qui n’en sont plus. » Cumul infini de non-sens.)
En petit chien obéissant à la virilité lacunaire, j’ai accepté, supporté et relativisé ses aventures pour la garder, pour moi. « En sentiments et en amour, tu es le seul. » Ce qui, très sincèrement, me rassurait fort. Pour me venger de cette situation, je songeais souvent à aller « pécho » ailleurs. Seulement, sur le marché du mec moderne, je ne valais pas un clou. Avec ça, les filles d’un soir étaient très souvent le même type de femelle que ma Justine.
Imbues. Imbibées. Et « badineuses » du cul.
Cette situation était tellement difficile à vivre que, déjà à l’époque, j’ai commencé à vomir pour tout et pour rien. En anorexique du bonheur, je me vidais volontiers des pensées/ plaisirs qui me submergeaient en « me dégueulant ».
Ça n’est que le jour où elle me vit faire ça, pour la dixième ou onzième fois, que je lui avouais que je ne supportais plus son comportement et que ça n’était pas lié à la bouffe avariée qu’on nous vendait dans les fast-foods/mal/bouffe/ils/disent.
Sa bouche s’est ouverte et sa voix/vent/chaud/comme/ le/sirocco/plein/de/sable a lancé : « Mais pourquoi te mets-tu dans un état pareil ? » Mon sang n’a fait qu’un tour et je me suis giflé avec une violence telle que je m’en suis décroché la mâchoire. Mon corps se battait seul. Une auto-baston. Et des vrais coups de poing.
Je passais le premier écrit de mon concours le lendemain. Au lieu de travailler les derniers détails, j’étais aux urgences avec
Justine en larmes. « Je ne pensais pas que ça te faisait si mal.
Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé plus tôt ? » Son seuil d’intelligence a commencé à dégringoler à ce moment-là.
Et moi : « Tu vois pas que je souffre le martyr ? Tu ne veux pas arrêter de me faire chier avec ta fausse naïveté ? »
Dans la salle des urgences, nous étions entassés. Il y avait une télé qui diffusait des images d’attentats, de meurtres et d’opérations chirurgicales. Justine pleurait intensément, au point de faire des gargouillis suspects avec sa bouche. Ça me gênait. Les patients présents souffraient de maux et de blessures plutôt classiques, alors que j’avais des bleus, coquards, blessures diverses que je m’étais infligés seul, comme un grand. « Arrête de pleurer… C’est la honte ! » Je le chuchotai tellement fort que tout le monde se retourna vers moi. « Voilà ! Merde maint’nant, je suis humilié. »
Le sens des proportions.