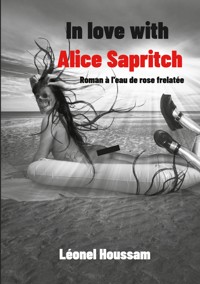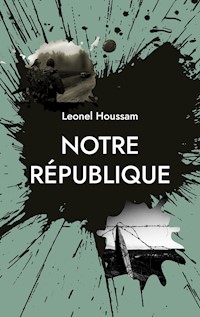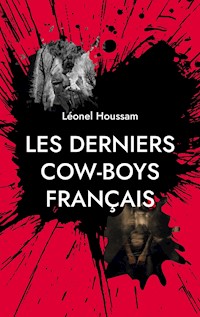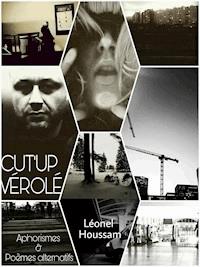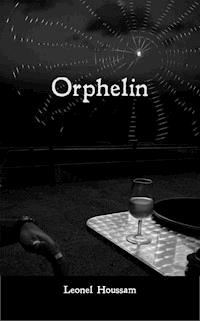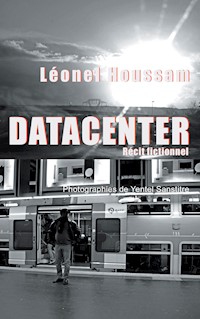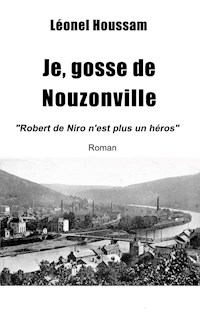
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Débuté en 2006 et achevé en 2019. 13 années pour raconter une histoire plus intime, plus terrifiante, plus lointaine aussi. J'ai appelé ça une pseudobiographie parce que ce roman intègre des éléments autobiographiques. Mais c'est très loin d'être une auto-fiction. Je dirais plutôt que c'est un roman sur les oubliés de l'Histoire mais aussi sur les déclassés que l'on utilise souvent pour se valoriser ou pour juger. Un roman sur un endroit et des vies en périphérie que l'on méprise ou que l'on efface de nos vies contemporaines hyper connectées. Un aller retour entre ce XXIe Siècle et une France du XXe siècle aux prises avec les premières crises post-Trente Glorieuses. Sans prétention et sans esprit prédictif, il y a un peu dans ce roman du ferment qui préparait aux gilets jaunes. C'est aussi l'histoire plus intime d'un homme qui se confronte à ses souvenirs, ses joies et ses souffrances durant l'enfance. Extrait: "Ma vie est celle d'un adulte consentant mis en pièces comme on désosse une bagnole dans une casse. Ce pays est devenu une casse géante où tout n'est plus que déchets. Je clique sur Google Map, j'écris "Nouzonville" dans la case recherche et je zoome. J'arrive sur la place principale avec l'immense mairie. C'est là, dans cette seigneurie retirée dans la vallée de la Meuse que j'ai bâti ce château de cartes qu'est ma vie. Les usines ont fermé après avoir été absorbées par les ogres qu'on appelle fonds de pension américains après que d'autres ogres de la bourgeoisie industrielle française aient usé jusqu'à la couenne les paysans du coin, les immigrés venus de Pologne, d'Italie puis d'Afrique." Ce qu'en dit Cristian Ronsmans - auteur - conférencier: "Chef d'oeuvre. Un livre capital à lire." Le Prix ARTSCOPE 2020 a été décerné à ce roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Je, gosse de Nouzonville
Je, Gosse de NouzonvilleChapitre I. Des souvenirs en vrac.Chapitre II. Ce pays a une tête d’assassin depuis ma naissance.Chapitre III. J’ai souvent pensé à toi.Chapitre IV. Les fantômes sont bien vivants.Chapitre V. Et là nous avons fait une promesse.Chapitre VI. Robert de Niro était bien mort.Page de copyrightJe, Gosse de Nouzonville
"Robert de Niro n'est plus un héros"
Léonel Houssam
Qu’y avait-il de pire que la mort ? Devenir adulte, bien sûr.
« Le temps perdu ne se rattrape pas ! En fait, il vit au plus profond de nous, et seuls quelques-uns de ses fragments, anesthésiés ou embaumés par une mémoire conceptuelle et intéressée, vivent dans la conscience et forment notre autobiographie. »
Les Anges distraits - Pier Paolo Pasolini
Le jour de ma mort
Dans une ville, Trieste ou Udine,
le long d’une allée de tilleuls,
au printemps quand les feuilles
changent de couleur,
je tomberai mort
sous le soleil qui brûle
blond et haut,
et je fermerai les yeux,
laissant le ciel à sa splendeur.
Sous un tilleul tiède de verdure
je tomberai dans le noir
de ma mort qui dispersera
les tilleuls et le soleil.
Les beaux jeunes garçons
courront dans cette lumière
que je viendrai de perdre,
essaimant des écoles,
les boucles sur le front.
Je serai encore jeune
en chemise claire,
les cheveux tendres en pluie
sur la poussière amère.
Je serai encore chaud,
et courant sur l’asphalte
tiède de l’allée,
un enfant posera sa main
sur mon ventre de cristal.
Poèmes de jeunesse - Pier Paolo Pasolini
Le beau se niche dans l’obscurité.
Ça m’a pris d’un coup. En voyant ce chaosdans mon cagibi, je me suis mis en tête de ranger. Toutpart de cette décision insignifiante, cet acte banal duquotidien. J’ai commencé à sortir les sacs et les valisesvides, les vieilles paires de chaussures, le synthé toutpoussiéreux, les milliers de pages noircies durant monadolescence et qui jaunissent dans des cartons. Plusloin, j’ai retrouvé les vinyles, les CD, quelques livres dela collection « La Bibliothèque Verte », l’aspirateur enpanne, des sacs à dos et de couchage, une paire deskis… C’est fou comme on accumule. Plus au fond, j’aidécouvert des classeurs de cours du lycée et de la fac etdes chemises colorées pleines à craquer de ces fanzinesque je produisais à tour de bras durant ma jeunesse.
Maintenant, je suis presque au fond du réduit. Sous unebâche bleue tachée de peinture, il y a ce petit cartonsur lequel est écrit : « Ne plus ouvrir jusqu’à mamort ». Je le regarde. Je sais ce qu’il contient. Je saisque je me dois de respecter ce que j’y ai écrit. Mais latentation est trop forte. Les années ont passé et je pensequ’il est temps. J’ai fait du chemin. J’ai résolu desénigmes et j’ai nettoyé quelques idées noires. Le scotchcède sans difficulté. J’ouvre les battants. La lumières’obscurcit. J’ai l’impression que l’ampoule du cagibia explosé… Je m’écroule sur le sol.
Le chemin du retour me pesait. L’excitation et l’hilarité causées par la dérouillée s’estompaient et laissaient place à la tristesse, à la peur et à l’angoisse. Je rebroussai chemin et me mis à courir à m’en éclater le cœur. Il faisait jour peut-être nuit, je n’avais plus la notion du temps. La Crèche se dessinait sur un ciel crépusculaire. La porte résista un peu, coincée par un monticule de terre. Il était là. Allongé. Ligoté. À même le sol. Le visage tuméfié, les yeux enflés, noircis, les narines remplies d’une émulsion de morve. La peur se mua en panique. Je m’approchai et le regardai sans le toucher. Mes yeux d’enfant sur son corps d’enfant inerte. C’était irréel, comme dans un film… En m’agenouillant, furtivement, je crus que tout n’était pas désespéré. La lueur très faible du jour déclinant m’induisit en erreur. J’étais persuadé de l’avoir vu respirer… Mais il n’en était rien, David ne respirait plus. Il était mort. C’était terrifiant et fascinant. C’était un univers nouveau qui s’ouvrait devant moi. Un monde. Je priai Dieu pour qu’il fasse un miracle, qu’il remettre son cœur en marche, pour qu’il efface cette journée, qu’il me téléporte la veille ou n’importe quand, mais qu’il me fasse disparaître de ce jour.
C’était moins difficile à vivre que ce que j’avais pensé mais c’était beaucoup moins héroïque que ce que laissait croire les films à la télé. Je me relevai et je sortis… avant de fermer la porte de la Crèche.
Ma cuillère crée un sifflement dans le fond de ma tasse.
Ma main s’est figée. Mon cœur palpite. Ce cartonouvert avec ces objets d’enfance est une sorte de boîtede pandore. Quelques livres de coloriage, des porte-clefs, une montre Albator, des 45 tours de Pierre Perretet de Carlos, et des photos. Une à une, elles ont faitémerger l’enfer…
Et la lumière (grise) fut…
Je suis né en mars, un 21, en 1973. Je crois que c’était un mercredi et qu’il y avait un match de foot important. Je le crois parce que le père m’avait dit que je lui avais gâché le plaisir. Je ne connais pas l’heure, à peine l’endroit. Une maternité dans les Ardennes, dans les cris, les liquides. Je suis né comme n’importe qui. Je suis « venu au monde » selon la formule consacrée. Je dirais pour ma part que je suis venu prendre part au massacre.
Quelques années plus tard, je faisais craquer mes doigts des dizaines de fois par jour comme pour conjurer le sort, me sentir vivant, faire de mes mains des fagots de bois qu’on brise avant de les jeter au feu. Personne ne m’approchait durant mon concerto de craquements.
J’étais enfin tranquille, tenant à l’écart la cohorte de gosses merdeux qui me voulaient du mal.
Chapitre I. Des souvenirs en vrac.
1980Robert de Niro, c’est plus un héros…
À l’époque, tu avais « de Niro ». C’était une star. En 1980, je n’avais jamais vu un seul de ses films mais lorsque je suis allé chez le dentiste pour me faire soigner une carie, sur la pile de magazines posés sur la table basse de la salle d’attente, il y avait un vieux numéro corné de Newsweek (il s’agissait du seul en langue anglaise) qui dévoilait en couverture la photo d’un homme tenant un saxophone, arborant une cravate à rayures, parfaitement peigné, raie au milieu, cheveux plaqués sur les côtés. Je demandai à tata, chez qui je vivais depuis presque deux ans :
– C’est qui, le Monsieur ?
– Chut, y’a du monde. Tu nous casses les pieds avec tes questions. Excusez-le, hein !
Elle jeta un œil aux trois pelés plongés dans la lecture de magazines qui attendaient leur tour sur le fauteuil de torture du dentiste.
– Pourquoi tu veux pas me dire qui c’est ?
– Rhoo ! Son nom, c’est Robert de Niro.
– Et c’est qui ?
– Un acteur américain et maintenant tu te tais !
La pichenette qu’elle me donna derrière la nuque fit bourdonner mes oreilles. Mais ce n’était pas grave. Je me sentais mieux en voyant ce monsieur qui avait l’air de n’avoir peur de rien.
Des souvenirs, j’en ai tellement. En ce temps-là, Tata me disait tout le temps, très souvent : « Tu manges pas la peau du saucisson ». Moi je mangeais la peau du saucisson et je regardais mes héros à la télévision. Je ne pensais pas à l’Afrique (à cette époque-là) et je trouvais ça bien la démocratie, les urnes et les discours de l’Abbé Pierre, les chansons de Pierre Perret et les petites tresses des filles.
Plus tard, durant l’adolescence, j’ai vu mon premier film de Scorsese. Tu avais Robert de Niro dans le taxi, qui va dans la foule avec la crête, il déchirait, il te retournait la tête. « Quand je serai plus grand, j’irai tuer des députés et je mangerai la peau du saucisson. »
Avec un copain, Franck, on allait au Maroc, c’était une colline couverte d’une forêt dense derrière chez tata.
Là, on torturait toujours un autre copain. On l’attachait à un arbre, on lui donnait des gros coups de pieds dans les testicules et on lui arrachait les cheveux en l’insultant. C’était comme si on était des héros, qu’on avait du pouvoir. Parce que le torturé, c’était un plus petit et plus maigre que nous, mais nous, on savait que c’était un salaud, un qui travaillait pour l’URSS qui était une saloperie de communiste des pays de l’Est, un Polonais ou un Hongrois, un truc comme ça. J’étais toujours de Niro, et l’autre c’était Hutch. Il voulait que je m’appelle Starsky mais ça faisait trop Polonais ou un truc comme ça, alors je m’appelais Robert de Niro.
J’avais du savon, je faisais la crête. Robert, ça faisait vieux Français qui picole, mais avec de Niro derrière, ça faisait caïd, chef de bande, ça faisait mec qui maîtrise le flingue et qui fait sauter un déchet de bouffe entre les dents d’un coup de langue.
Avec mon pote, on lui baissait aussi le froc au méchant attaché à l’arbre. Des fois on lui donnait tellement de coups qu’il allait à l’hosto avec ses parents après. Il ne disait rien parce qu’on lui avait dit qu’on le tuerait sinon. Moi le de Niro et Hutch, on aimait qu’il pleure bien pendant qu’on bouffait de la peau de saucisson…
« Oh le pauv’URSS de communiste il a pleuré oh ! Il fait l’bébé le méchant. »
On aimait bien les États-Unis, les séries télévisées et leur armée qui nous avait libérés des Allemands. On aimait bien aussi les États-Unis parce qu’à l’époque il s’agissait du pays où ils avaient inventé la chirurgie esthétique pour devenir beaux. Les Américains, ils faisaient l’amour à nos femmes alors que les Russes rouges et les nazis, ils les violaient. C’était un peu ça qu’on comprenait des cours d’Histoire. Le pénis USA était une crème douce et vanillée. Celui des cocos et des boches était une lame de rasoir. Hutch et moi on rigolait bien devant le méchant ligoté/bâillonné. Ensuite on descendait de la colline le Maroc avec le méchant plein de sang. On allait chez tata qui disait, faussement sévère : « Mais vous êtes allés traîner où les garnements ? Vous êtes tout cradingues… » Nous on lui disait qu’on avait chassé du communiste et ça la faisait rire parce que tonton était communiste…
C’était bien cette époque-là… et Robert de Niro, ben c’était moi…
Années 2010Banlieue-Nord de l’extra-périph’ francilien.
La ville est devenue mégapole et les frichesindustrielles sont des repères à bourgeois ou à êtresmécaniques issus de la classe moyenne. On n’y entrepas si l’on n’a pas le sou. Ce monde met du temps àm’engloutir. À quoi bon une espérance de vie dequatre-vingts ans si c’est pour croiser un nouveaumillénaire tellement mal embouché. Il n’y a plus de « Mur », il n’y a plus deux blocs, le monde estmultiforme, multimilliardaire en mode extinction.
1981
Quand j’étais petit, j’étais déjà gentil.
« Essuyez vos chaussures avant d’entrer », disait tata lorsque nous rentrions bien crottés de là-haut.
Louis, c’était un autre copain, il avait un prénom de vieux alors il se faisait appeler Vince. On se donnait des prénoms américains parce qu’on se sentait les meilleurs. Nos parents roulaient dans des Peugeot ou Renault en ferraille alors que nous rêvions des berlines Ford ou Chrysler ou Cadillac avec le design et les suspensions toutes molles. On était des héros de L’Homme qui valait les trois milliards avec Louis.
Notre version à nous. Ça consistait à se mettre aux abords d’une fourmilière, l’asperger d’essence à Zippo et allumer. Pfrroouuuu ça cramait. Les fourmis qui se recroquevillaient et les autres qui se sauvaient en boitant. D’autres qui venaient récupérer les cadavres de leurs copains et copines. On riait. On avait huit ans. On crapotait des Peter Stuyvesant en se regardant la quéquette dans les cabanes en bois. On se disait que si on avait été Américains, on aurait arraché les tee-shirts des femmes pour voir leurs seins. Comme tous les enfants, on trouve tout nouveau tout le temps, et en même temps, on a l’impression que tout ça a déjà dû exister bien avant nous.
Son père était chasseur. Moi, je l’appelais le « sale Rital », mais Vince me disait de ne pas dire ça. Alors je le murmurais seulement. « Il est rital, il est rital, il est pas Français. »
Mes yeux tournaient dans les orbites et je revenais à la normale.
Donc on prenait le fusil de son père, et dans le couloir long de sa maison, le pavillon de cité ouvrière en faillite, et on faisait mine de tirer sur des fantômes, des boches et des communistes, même sur des Arabes. Je n’en parlais jamais à Malik de ça, parce que lui m’aurait zigouillé. Malik, c’était un autre meilleur ami, mais interdit par les gens de la ville parce qu’il était Arabe. Alors avec Louis le Vince, une fois, c’est affreux, j’ai voulu le mettre en joue… Il était assez loin, mais la chevrotine, pan dans son visage, la moitié du cuir chevelu arraché et l’oreille criblée…
Des mois plus tard, quand il est sorti refait ni fait ni à faire tellement on aurait dit Freddy d’un côté de la face, on le chambrait dans la cour : « Eh Vince le moche ! Vince-Louis la face de rat. »
On rigolait bien dans la cour… Ensuite, en le laissant planté dans ses larmes de défiguré, on repartait mimer les avions de chasse comme dans les Têtes brûlées avec Bruno qui faisait Papy Boyington. C’était le meilleur. Moi je restais Robert de Niro même s’ils disaient que ça n’avait rien à voir et qu’ils n’avaient pas idée de qui ça pouvait être.
Années 2010
Banlieue-Nord de l’extra-périph’ francilien.
Ma vie est celle d’un adulte consentant mis enpièces comme on désosse une bagnole dans une casse.
Ce pays est devenu une casse géante où tout n’est plusque déchets. L’espoir réside dans une forme denostalgie crasseuse et déviante. On a des ampouleséconomiques, des rayons bio, on a la possibilité depousser le caddie comme on partait à la guerre la fleurau fusil. Des fuites chez le voisin cage à lapins dudessus s’écoulent dans mon salon cage à lapin.
L’écran me bousille les yeux. Je clique sur GoogleMaps, j’écris « Nouzonville » dans la case rechercheet je zoome. J’arrive sur la place principale avecl’immense mairie. C’est là, dans cette seigneurieretirée dans la vallée de la Meuse que j’ai bâti cechâteau de cartes qu’est ma vie. Les usines ont ferméaprès avoir été absorbées par les ogres qu’on appellefonds de pension américains après que d’autres ogresde la bourgeoisie industrielle française aient uséjusqu’à la couenne les paysans du coin, les immigrésvenus de Pologne, d’Italie puis d’Afrique.
1983 Je mangeais des chips en regardant Chips,pas toi ?
La triste récession des voisins. Mon pote Léni, dans le quartier, c’était le champion de foot. Il était pupille et remportait toutes les victoires avec l’équipe de Bogny parce qu’il était le meilleur buteur. Quand on allait vers Gespunsart à vélo à quelques kilomètres de la frontière belge, c’était seulement l’été. Léni ne m’aimait pas. Moi je l’admirais parce qu’il était le premier à avoir roulé une pelle à une fille.
Je ne savais pas trop ce que ça pouvait signifier de rouler des pelles à des filles sinon qu’ils nettoyaient peut-être les dents avec la langue et la glotte.
C’était un deal. Il arrêtait de me donner des coups derrière la nuque pendant qu’on se rangeait devant l’école, et moi je faisais ce qu’il voulait à Gespunsart.
C’était un village qui sentait le sous-bois et la bouse de vache. Un peu le chômage aussi comme un peu partout dans les Ardennes.
Elle habitait dans une grosse maison en pierre des carrières de Dom, un peu jaunâtre avec des encadrements de fenêtres sublimes façon dorures d’un château de roi… Léni me disait qu’il fallait faire le guet. Ce que je faisais… Comme si j’étais dans Mission Impossible… Puis il est sorti avec la belle. Elle était un peu obèse, mais ce qui comptait, c’est qu’elle avait des gros nichons, du haut de ses douze ans, avec un soutif de la Redoute de sa mère, qui dépassait, en pseudo-dentelle coton blanc. J’avais du mal à savoir à quoi servait les érections, mais j’y arrivais très bien quand même. On n’a pas repris les vélos après. On les a laissés devant chez la fille. Elle était trop belle avec ses vergetures de femme de trente ans, alors qu’elle en avait que douze !
Après, on a traversé Gespunsart, et j’avais encore un épisode de Starsky et Hutch et une chanson de Frankygoes to Hollywood dans la tête. Je dansais dans mon imaginaire. Il fallait que je sois rentré chez ma tante avant la nuit, mais c’était l’été, c’était bien, avec les mouches, les moustiques et Léni qui gueulait : « Oh ! T’es pas venu là pour être mon copain ». Léni, c’était son vrai prénom à ce « rital-là » du quartier. Les ouvriers étaient tous syndiqués, communistes, écoutaient du rock’n roll et adoraient les grands espaces américains, les chewing-gums et le confort venu des « US » .
« Ben allez ! »
Fallait que je creuse une tranchée dans un champ d’orties pour qu’ils puissent se rouler des patins (danseuses sur glace j’avais en tête) et se toucher le pissou sans autorisation de mater. Alors j’ai fait ça en short avec un bâton. Les jambes giflées par les irritations brûlantes dues aux orties récalcitrantes qui s’accrochaient à mes mollets. Il faisait chaud comme la pierre sur l’île déserte d’un peuple mort. Léni gueulait :
« Magne-toi ou t’auras pas ta médaille chez Nono ! ».
Il parlait comme un homme Léni, le champion de foot qui roulait des pelles et touchait les cuisses des filles avec des gros nichons énormes… Chez Nono, c’était le bar de Nouzonville où tous les papas venaient se bourrer la gueule avant d’aller frapper les mamans en rentrant. C’est dans ce bar qu’à chaque fin de saison, on remettait une médaille à chaque gamin du club de foot même si on n’avait pas mis un but. Un peu comme à
« L’école des fans » de Jacques Martin le dimanche où ils mettaient tous « 10 », qu’on disait que c’était truqué mais qu’au fond, on trouvait ça bien que tout le monde ait un cadeau. La médaille autour du cou, pour moi qui avait peur du gros ballon en cuir qui faisait mal aux tibias, aux orteils et faisait des coquards de malade quand les bourrins tiraient à bout portant dans le visage, c’était ma joie, ma Légion d’Honneur pour les nuls.
Tout le monde gagnait et ça créait la fierté d’appartenir quelques heures à cette équipe de foot de merde.
Une fois le trou creusé, il fallait aménager un espace arrondi à un endroit où y avait pas moyen de se piquer le cul avec des orties, une fois couché. Il faisait chaud, avec des mouches, des moustiques.
Je me souviens moins de la suite. Mais je restais à surveiller le champ d’orties au cas où le père de la fille ne se pointa. Puis Léni m’a dit de venir essayer. Et je suis venu. Et comme j’avais peur, que je ne savais pas vraiment ce que c’était ce truc ignoble qu’on appelle « rouler des pelles », j’ai cassé les dents à la fille avec un énorme caillou… Léni et moi, nous sommes partis en courant… après avoir dit à la fille que ses parents ne devaient pas être au courant sinon on lui crevait les yeux… Sur nos vélos, pour aller de Gespunsart à Bogny, on avait l’air d’être les motards de Chips… On a rigolé, on est arrivé joyeux juste avant la nuit tombée.
Années 2010Banlieue-Nord de l’extra-périph’ francilien.
J’utilise le curseur pour me déplacer dans la ville. Jeremonte au niveau du Cosec. J’ai le cœur qui palpited’émotion. Rien n’a changé ou presque. Là-bas, toutest exactement pareil aux années 80. Google Maps metire le long des rues d’un monde arrêté, tel un vortex depixels qui déploie mes souvenirs. Je m’y vois, et je m’ysens tout autant comme un étranger. On naît dans unespace-temps qui s’étire en longueur, d’une lenteurtelle que les mois, les semaines, les années paraissentdes siècles… Et soudain, un peu comme si une portes’ouvrait, cet espace-temps est remplacé par un autre,plus rapide, plus immense avec un horizon malgré toutbien dessiné de chaque côté.
1981Bruno, c’était papy Boyington, mais sa sœur…
Après on avait Bruno qui était un des plus costauds du quartier. C’était papy Boyington et il ne fallait pas l’emmerder. Seulement, son gros défaut à papy, c’était sa sœur. C’était une fille de quatorze ans qui avait de très gros seins qu’on appelait la « bouche à pipe », bien que son vrai prénom fut Martine. Et pour cause, quand on montait au Maroc, la colline au-dessus de chez tata, elle faisait parfois des pipes à des copains de la bande adverse. On ne voyait pas le mal à ça. On savait aussi que la mère de Martine et Bruno était une femme divorcée en mal d’argent et qui, disait-on alentour, offrait ses services contre monnaie sonnante et culbutante… Louise était une femme pas très belle mais qui portait des mini-jupes et mettait un rouge à lèvres bien vif. Cette maman divorcée d’un garagiste plus tard suicidé, ne cachait pas son attachement pour les hommes à moustache, leurs odeurs de sueurs, leurs grosses paluches d’ouvriers au chômage. Louise était une italienne, comme la moitié des gens du quartier…
Certains garçons se masturbaient dans les bois, dans des bas qu’ils avaient piqués à la « vieille pute ». On rigolait bien.
Moi j’étais-hors sujet du haut de mes huit ans. PapyBoyington était mon garde du corps pourvu que je me plie à ses ordres. Cela consistait à surveiller autour lorsqu’il léchait les tétons et doigtait des filles de notre âge, que nous avions enlevées pour quelques heures, pour satisfaire ses envies. Elles chialaient. Elles criaient parfois. Elles se débattaient. Je faisais le guet, mais ça me faisait peur toutes ces douleurs de filles. Et ça m’excitait aussi. Une fois ou deux, planqué derrière le gros chêne multi-centenaire, j’avais jeté un œil sur la fille, la culotte baissée, les doigts de Papy dedans.
Alors j’effleurais mon torse en rigolant, et je me disais :
« T’as d’la chance comme les grands ».
Années 2010Banlieue-Nord de l’extra-périph’ francilien.
Mon cheminement virtuel m’amène devantcette maison où j’ai vécu. Il y a un gros 4x4 blanc justedevant, celui du nouveau locataire (ou propriétaire,mais à l’époque, c’était des maisons type HLM classieuses) et la façade a été peinte en blanc. Maistout est là. Les maisons mitoyennes n’ont pas changé.
Seuls les arbres aux alentours ont pris trente ans, plusgrands, majestueux, encombrants. Il y a pourtantquelque chose qui a changé plus profondément. Monregard, ma vision du monde, mes souvenirs vivacesparfois et partiellement effacés d’autrefois. Finalement,on ne se rappelle que peu de choses, on a gardé cequ’on voulait bien garder, on a évacué lesencombrants. J’ai laissé tout ça derrière mais à l’heured’un bilan de fourmi usée dans une mégapolecomplètement folle, j’ai besoin de sentir, ressentir,retrouver… Car lorsqu’on atteint enfin l’horizon, lemur tout au fond qui ceinture chacune de nos vies, jesuppose que l’on rencontre une seconde fois ce jour oùnous sommes venus au monde et ces années qui lesuccédèrent.
1982Le Higgins de notre quartier, l’Américain dit « le Portos ».
John Higgins vivait à un pâté de maison de chez tata. C’était un homme obèse, avec une moustache noire et des cheveux frisés épars. Cet Américain d’une quarantaine d’années était appelé le « Portos » par les « ritals » et les « polaks » du quartier. Cela était dû au fait que son physique se rapprochait plus de celui des humains qui vivaient « dans le sud », mais aussi parce que, pour l’essentiel, l’Amérique avait été découverte par un Portugais, Christophe Colomb. Bref. Higgins vivait avec une Italienne qu’il avait mise enceinte par deux fois. La première, cela donna une fille plutôt jolie, Laura, qui avait un an de moins que moi. La seconde, un petit garçon, Michael (qu’on surnomma vite « merde au cul ») vit le jour, la nuit, les aubes, les crépuscules. Petit visage hideux, la redite du père en bambin, la morve au nez, la merde au cul et perpétuellement en sanglots du fait que nous passions à toute berzingue en kartings à pédales pour lui infliger des baffes monstrueuses qui balançaient son corps bouffi sur le sol-macadam. Il pleurait. On riait. Sa sœur nous insultait, alors on la baffait : « Les Amerloques comme vous c’est qu’une bande d’enculés. »
Personne n’aimait Higgins et sa famille. Ces « pouilleux » n’avaient rien à faire parmi nous.
Higgins était au chômage depuis des années, ce qui faisait dire à Jean-Jacques, un voisin boulanger, que « décidément la France accueille toute la merde du monde. »
En fait Higgins parvenait à survivre, avec sa famille, grâce au boursicotage. Durant ces années-là, aucun Français « d’en-bas » ne se souciait de la bourse et de ses fortunes faciles. Mais Higgins était Américain, et ledit « Portos » n’hésitait pas à jouer avec l’argent…
Sans des types comme Higgins, le capitalisme triomphant n’aurait pu se développer à une telle vitesse.
Son gros bide plein de graisse était nourri des premières spéculations de petits porteurs. Avec son air de pas en avoir l’air, le « Portos » contribuait, quasiment directement, à mettre tous les ouvriers du quartier au chômage…
Pour nous les gosses d’ouvriers bruts de décoffrage, il y avait pire que les noirs et les arabes finalement. Il y avait les « Américains qui font rien de leurs journées et qui mettent leurs gosses « merde au cul » dans la rue », à la portée de ce que l’on appellera plus tard, nos frappes chirurgicales… C’était le cas de le dire. Un jour d’été qu’il faisait une chaleur à crever, j’étais parvenu à monter mon karting à pédales en haut de la côte.
J’avais des gouttes de sueurs qui coulaient sur mes paupières, mes yeux. L’horreur, le bonheur d’un pur sprint avec, à la clef, une victoire tant espérée contre Papy Boyington.
Dès le départ, le kart était parti à fond. Il fallait négocier un léger virage à gauche avant un contre-braquage sur la droite, presque en angle droit, à toute vitesse, sans freins et un système de direction archi-bricolé… C’est seulement quand j’ai entamé l’attaque du premier virage que j’ai vu le marmot traverser la route. PapyBoyington me talonnait.
« Barre-toi d’la, merde-au-cul ! Casse-toi, sale amerloque de merde ! »
J’avais beau brailler, le merdeux ne bougeait pas. Alors ce qui devait arriver arriva… Juste au sortir du premier virage, j’ai viré à droite, à fond, essayant d’éviter Papy qui commençait à me dépasser, mais incapable de ne pas percuter le gros bambin moche… Paf ! La frappe fut chirurgicale dans le sens où mon karting déchira le mollet du marmot… Le sang, les ouin-ouin et tout le tralala pompiers flics la maman qui pleure et Higgins, impassible sur le perron, se grattant les couilles en lançant laconiquement, avec son gros accent de texan limite homeless :
« Je l’avais dit que c’petit con se ferait renverser ! »
Tout le quartier était en ébullition. Les flics nous chopaient par le bras, nous secouaient, nous insultaient pour savoir qui avait fait le coup. Mais dès que j’ai renversé « merde au cul », je me suis hâté, avec Papy, de virer mon karting des lieux du crime, avant même de vérifier si le bébé-caca était vraiment mal en point.
On a rigolé avec Papy le soir. En jouant à Pacman avec sa console Atari 2600 et en bouffant des chips Flodor, salées finement, on s’est remémoré l’explosion du baby amerloque d’un an à peine…
Années 2010Banlieue-Nord de l’extra-périph’ francilien.
Les prises de vue Google laissent apercevoirdes passants dont le visage est flouté. Ils sont lesremplaçants de mes souvenirs, le présent a pris laplace de mon passé. Ils ne savent pas que je fixe leurquartier, que j’ai foulé avant eux le sol de cette ville. Ilsvaquent, ils ont peut-être le même mode de vie. C’estloin. Mon corps se délitera bientôt et je me rappelleque dans ces rues, j’angoissais à la simple idée dedevenir adulte. Ils étaient des géants capables de toutmaîtriser : les chars, les avions de chasse, les voitures,le « travail », les courses et l’appareil génital. Ilsavaient accès à un monde mystérieux où la mort, cetteétrange état dont ils donnaient mille explications,attrapaient les plus vieux, les plus malades et parfoisdes enfants. La théorie des choux et des roses était laplus lamentable de toutes, suivie de près par celle oùun dieu distribuait les places dans un paradis, dans unenfer, dans des mondes installés bien au-dessus del’atmosphère. La plus fumeuse était celle qui expliquaitqu’après la mort, nous étions plongés dans un néant, lecorps réduit à l’état de tourbe et l’esprit coincé dans unnulle-part tout aussi grotesque qu’un paradis blanc. Ily avait dans ma tête, dans ce coin encore enfantin demon esprit, la conviction, la sensation, la certitude quel’univers était un liquide amniotique infini. J’orientemon déplacement un peu plus loin dans l’impasse desBleuets. Google Maps me prive d’un accès auxespaces hors-les-routes. Dois-je envisager de retournerphysiquement là-bas ?
1983Chez nous, Cliff Barnes et John Ross Ewing étaient potes.
Le quartier se divisait en trois. Ceux qui vivaient en bas étaient les inexistants. Ceux du milieu où je vivais, chez tata, et ceux d’en haut, nos ennemis.
Cette division du lotissement avait des répercussions sur notre quotidien. Avec Papy Boyington et Hutch, on ne s’aventurait pas en haut, à certaines heures de la journée… Nous étions en classe ensemble, mais dès que nous franchissions la sortie de l’école de la République avec ses instits et ses coups de règles en fer sur les doigts, nous reconstituions la division pseudo-communautaire… En haut, au milieu, c’était les Polonais et les Italiens, et quelques Français. En bas, c’était les Français, des propriétaires qui ne se mélangeaient jamais aux locataires…
Les guerres entre les « Hauts » et les « Milieux » étaient perpétuelles… Parfois nous étions victorieux, parfois ils étaient les maîtres. Ces combats se déroulaient durant les vacances scolaires, ou le samedi.
Nous déboulions sur le Maroc, et nous nous battions à coups de caillasses, de bâtons, de parpaings, de lance-pierres, de poings américains, de crans d’arrêt…
Généralement, cela se terminait avec un blessé ou deux. Pour ma part, j’ai échappé, à plusieurs reprises aux coups, grâce à Papy et Hutch qui me protégeaient (Je savais les manipuler pour les avoir pour gardes-du-corps). Puis nous rentrions en haillons, crottés, dégueulassés, dépités, fatigués. Gaufres au Nutella chez tata, les crêpes au sucre trempées dans un chocolat bouillant.
« Alors vous vous êtes bien amusés, les garçons ? »
Tu m’étonnes qu’on s’amusait bien…
Une fois seulement nous avions dû stopper l’une de nos batailles sans qu’un camp ne se détache. En fait nous avions été interrompus par un événement incroyable.
C’était l’été, vers 1983, il faisait une chaleur de merde, celle qui fait dégouliner de partout. Nous nous battions à coups de bâtons. Rien de plus. Une vingtaine de gosses d’en haut et une quinzaine du milieu, dont moi.
Il y a avait plein de poussière, des brindilles… Et soudain, Olivier, le chef-adjoint de la bande adverse s’est mis à gueuler : « Oh putain les pédés ! R’gardez ! » Au loin, un noisetier vibrait… Des membres, des ombres de silhouettes… Nous nous sommes tous approché, à pas de loup…
Inutile de dire que nous avons ri aux éclats lorsque nous avons vu sortir, toutes braguettes ouvertes, les pères de Julie et d’Olivier, ces deux vieux bonhommes qui se suçaient sans vergogne, dans les bois… Ceux qu’on appelait JR et Cliff Barnes, copains comme cochons, étaient en fait des homos… Ils allaient, eux et leurs familles, vivre un véritable calvaire… jusqu’à ce que JR ne se tire un coup de fusil dans la bouche et que Cliff s’en aille avec sa famille dans la R15 vers un ailleurs… Ailleurs. D’ailleurs…
Années 2010Banlieue-Nord de l’extra-périph’ francilien.
Ça me soulève les larmes et m’emplit detristesse. Tout est bouleversant dans le fait de revoir ceslieux. Et pourtant, je ressens de la colère. Les souvenirsd’enfance sont salis par ces imposteurs, ces petiteschoses venues après, qui se sont installées, qui ont poséleurs gros culs dans le salon, la cuisine, la chambre oùj’ai produit la semence de ma mémoire. Mon enfance.
Mon seul bien. Les louanges que l’on peut faire à la viene sont en fait destinées qu’à cette partie de l’existence.
Ils mangent là où j’ai mangé. Ils rient, là où j’ai pleuré.
Ils baisent là où j’ai encaissé les coups. Chaque lieu oùla genèse d’une vie fut devrait être sanctuarisé. C’estune drôle d’idée, c’est presque une folie, mais je croisbien être propriétaire de toutes les rues, toutes lesmaisons, tous les champs, les forêts et les routes où j’aiévolué durant l’enfance. Qu’est-ce qui pouvait compterle plus avant que l’orgasme sexuel ne détrône toutesjoies, quêtes et émotions de l’enfance ? La peur d’allerà l’école et de se faire humilier par l’instit ? L’extasedevant une voiture Majorette toute neuve dans sonemballage plastique fraîchement acquise à la force desréclamations auprès de Tata ? La frayeur immenselorsqu’une fois couché, les cris et les coups de Tontoncontre Tata envahissaient la maison ? Le bonheur duvent doux du printemps par la vitre de la portièrearrière au moment du départ en vacances ? Je ne saisplus vraiment. Tout ça m’a échappé, noyé sans doutedans ce sentiment de puissance et d’abandon ressentidès les premières éjaculations.
1984Papa Schultz, dans notre ville était Portugais et odieux…
On peut revenir sur le mot « racisme » et ce qu’il porte comme sens, non-sens et contradictions.
Tous les samedis, Tata passait l’aspirateur dans la grande maison locative que nous habitions sur l’Impasse des Bleuets. Comme le bruit de l’aspirateur l’agaçait, elle mettait la musique à fond, un pur « gueuloir » qu’on appelait chaîne Hi-fi. Généralement j’avais droit à Mike Brant, Richard Clayderman ou encore Michel Delpech. Enfin, je dis « j’avais droit », devrais-je dire que « nous avions droit », moi le gosse chétif et l’ensemble du quartier… ça ne dérangeait personne. Les Polonais et les Italiens savaient que, le samedi matin, c’était la culture musicale de haut vol de ma tante qui s’imposerait aux oreilles de chacun.
Tout ça pour dire un truc qui n’a strictement rien à voir.
Dans ces Ardennes de la fin des années 70, des années 80, le racisme était omniprésent. Un racisme performant, bigarré, métissé, multiculturel. On entretenait ça dans le quartier. Et bien sûr le racisme, même s’il est composé par des « souchards » et des immigrés de première, deuxième, troisième génération, génère des hiérarchies.
Le racisme de mon quartier mélangeait la xénophobie millénaire « péquenaude » des « souchards », les préjugés fascisants des italiens, la haine quasi-religieuse à l’encontre de l’étranger des Polonais et le racisme technique, industriel hérité des années d’occupation allemande des années quarante. Et très loin, au loin, un bâtiment que l’on appelait « La Caserne » cloîtrait les Arabes, tant haïs, de façon générale, par toutes les autres « ethnies ». D’ailleurs, on les haïssait tellement ces Arabes, qu’il était honteux de les nommer. C’est pourquoi, lorsque nous avions besoin d’intégrer ces « pestiférés » dans nos conversations, nous disions « ceux d’la caserne ». Dans la hiérarchie, ils étaient au plus bas avec les « manouches ». Enfin, il y avait les sempiternels juifs, que nous considérions comme un peuple sournois et vénal, comme tous nos ancêtres l’avaient pensé et ressenti et ce, malgré un massacre assez récent dont nous avions vaguement entendu parler à l’école. Quant aux noirs (négros) et aux asiatiques (chinetoques), ça n’existait quasiment pas, puisque nous n’en voyions qu’à la télé.
Celui que j’appelle Papa Schultz était un maigrichon.
Je le surnomme ainsi mais nous ne regardions pas Stalag 13 à cette époque-là. Enfin, je n’en ai pas le souvenir.
Son vrai nom, c’était Richard Rodriguez, le seul vrai Portugais du quartier. Père et mère venus de là-bas.
Accent « portuguèche » comme on disait en riant grassement et travail dans le bâtiment. Encore que ce n’était pas la seule activité de Papa Schultz. Depuis quelques années, il s’était mis à faire de l’élevage « por arrondir les fins d’mois ». Ce type était un rustre isolé, mais bien intégré, que personne n’emmerdait parce qu’on racontait qu’il avait zigouillé sa femme pour cause d’adultère. À cinquante ans, il vivait donc seul, avec ses chiens, ses poules, ses lapins et ses cochons…
Vaste dépotoir, la cour de son sale chez-lui.