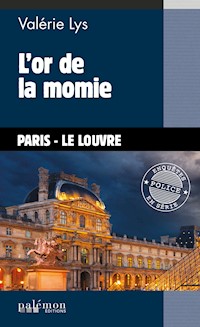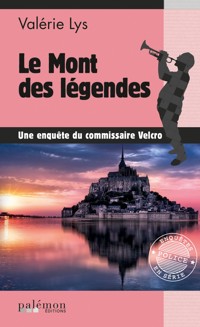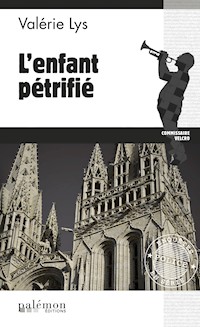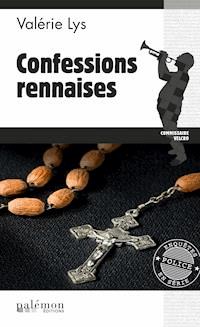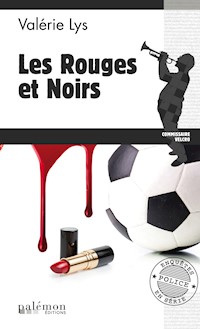
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Une enquête du commissaire Velcro
- Sprache: Französisch
Qui donc se cache derrière le meurtre d'Alice ?
La belle Alice, future esthéticienne au lycée professionnel de Guingamp, est retrouvée assassinée dans une salle de travaux pratiques, le visage défiguré par un maquillage grotesque. Confrontation entre le monde à la fois cruel et féminin de la beauté et celui viril et souvent dévoyé du football dont Guingamp est une ville symbole. Jalousie, amour et ambition sont les maîtres mots de cette nouvelle enquête menée tambour battant par le commissaire Velcro.
Découvrez sans plus attendre une enquête palpitante du commissaire Velcro dans l'univers particulier de l'esthétique et celui du football.
EXTRAIT
L’institut de médecine légale de Guingamp ne brillait pas par son activité. C’était davantage un lieu de consultation pour les expertises médicales instruites par les juges d’instruction qu’un laboratoire de criminologie. Une table métallique brinquebalante servait aux rares autopsies effectuées dans le département. Je trouvai le docteur Vignon penché sur le cadavre. Il l’avait démaquillé avec soin et avait dissous le fixateur pour faux ongles attaché aux paupières. Son visage avait retrouvé toute sa candeur, et son regard sa pudeur. L’homme leva les yeux en m’entendant arriver.
— Bonjour, Commissaire Velcro.
— Bonjour, Docteur. Quelle métamorphose ! Elle est méconnaissable. Vous êtes un ancien élève du lycée des Pénitentes, vous avez votre bac pro en poche ? Alors, vos conclusions ?
Son crâne nu était aussi luisant que les joues lisses d’Alice. Ses petites lunettes en demi-lune écaillées lui donnaient un air d’aéronef ballonné tandis que sa blouse élimée luttait contre un tour de taille qui ne connaissait pas la crise. Je remarquai qu’il lui manquait les deux dernières phalanges de son index gauche. Il suivit mon regard et répondit à la question que je ne lui posai pas.
— Un bistouri qui s’est trompé de client, Commissaire. Mal lui en a pris, il a connu une incinération des plus pénibles !
Je souriais malgré le sérieux de la situation. J’aimais ces personnages plein de paradoxes. Il se dirigea vers une sorte d’étagère où étaient entreposées une multitude de fioles colorées. Il déposa ce que je pris pour une goutte de sang de la victime sur une lame de verre puis, à l’aide d’un compte-gouttes, fit tomber une goutte d’un liquide dont l’étiquette m’indiqua qu’il s’agissait de benzidine. En l’espace d’une seconde, le mélange prit une teinte bleutée. Le docteur Vignon leva alors la tête dans ma direction. Son air soucieux tranchait avec la réussite apparente de l’expérience.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Valérie Lys est médecin biologiste et vit dans les environs de Rennes depuis une vingtaine d’années. Elle y dirige un laboratoire d’Analyses Médicales. Elle est aussi expert en réparation juridique du dommage corporel. Passionnée de peinture et de littérature, elle écrit depuis l’enfance : théâtre, nouvelles fantastiques, polars… Ses multiples voyages sont une source d’inspiration.
Elle est membre fondateur et vice-présidente du collectif rennais CALIBRE 35, dont le but est de dynamiser la scène rennaise de l’édition polar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VALÉRIE LYS
Les Rouges et Noirs
DU MÊME AUTEUR
Auxéditions du Palémon
1. Rennes, échec au fou
2. Confessions rennaises
3. Grise mine à Fougères
4. Les Rouges et Noirs
5. L’enfant pétrifié
CE LIVRE EST UN ROMAN
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,
des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant
ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
À ma fille Solenn, véritable tourbillon de vie
qui m’enchante souvent et m’ébouriffe parfois.
I
Guingamp 3 – Paris Saint-Germain 2
Les tribunes du stade du Roudourou flirtaient avec une crise d’hystérie collective. Les supporters des « En Avant de Guingamp », les EAG comme ils disent, s’étaient levés tel un seul homme hurlant le chant de victoire. Assis, siège 54 tribune est, j’assistais à ce spectacle des plus surprenants. Depuis quelques années, le club de football guingampais caracolait en tête de la première division. Il avait fallu une invitation du grand patron de la PJ pour que ce soir, mêlé à cette horde de déchaînés, je sois la victime du fessier de mon voisin de droite, grand gaillard bedonnant gesticulant dans une sorte de danse du ventre armoricaine. Moi qui détestais le foot ! Le temps était sec en cette fin de printemps. Cependant, quelques gouttes, échappées de la canette de Stella Artois mise en transe par l’ivresse de mon danseur, m’aspergeaient consciencieusement les joues. Me manifester aurait été peine perdue. Je préférai effectuer un décalage discret vers la gauche. Les événements ne me furent pas favorables, car la forme vaguement humaine qui occupait mon aile gauche me sauta au cou sans retenue. Nous ne nous connaissions ni d’Ève ni d’Adam, mais le simple fait d’une victoire sportive justifiait cette rupture de convention. La jeune femme, puisque je découvrais qu’il s’agissait d’une forme féminine, me mit le bras autour du cou et, tout en m’embrassant à pleine bouche, me secoua telle une margarita dans son shaker. Des fusées lumineuses embrasaient le stade. Dire que c’était ma femme, du fond de notre XVe arrondissement parisien, qui m’avait convaincu de faire le voyage pour assister à cette rencontre :
— Tu devrais y aller, chéri. Pense à ta promotion. Il n’y a pas que le travail pour grimper les échelons. Et puis, la Bretagne est une région très agréable. Climat vivifiant, kouign-amann, crêpes au beurre salé, cidre doux. Rien que deux jours, ce n’est pas la fin du monde…
La fin du monde peut-être pas, mais celle de mon costume sûrement… Un raz de marée de binouze venait d’inonder ma veste en lin. Les dommages collatéraux étaient considérables, car le col commençait à gondoler ainsi que les rabats de mes poches. En y regardant de plus près, je m’aperçus que je devais être le seul spectateur parmi les 18 256 supporters présents à ne pas être affublé du fameux maillot rouge et noir des Kops Rouges et des RedBoys réunis.
Je m’extirpai péniblement des bras de ma voisine et commençai à quitter ma place. J’étais habitué à la bousculade des sorties de théâtres parisiens. À peine le rideau baissé, des milliers de personnes s’engouffraient dans les escaliers de marbre souvent exigus. Ici, au contraire, les larges escaliers métalliques étaient encore déserts alors que l’arbitre avait sifflé la fin du match depuis un bon quart d’heure. Je fis un signe vaguement amical au vendeur de pop-corn qui attendait de pied ferme, en bas des marches, la marée humaine imminente. Une odeur de saucisse accompagnait ma sortie du stade, auréolée de son cortège de fumée grasse et de frites molles. Comme à chaque fin de match, toute cette faune allait se répandre dans les rues de Guingamp et fêter jusqu’à plus soif la victoire de leur équipe. Pour ma part, heureux du devoir accompli et après m’être promis de me faire cul-de-jatte plutôt que de remettre les pieds dans un stade, je me dirigeai à pas lents vers mon hôtel. De loin, j’entendais les cris et les ovations du public qui continuaient dans l’enceinte du stade. J’imaginais les joueurs victorieux exécutant des tours de terrain, applaudis tels des gladiateurs ayant vaincu des fauves sanguinaires. À la seule différence des gladiateurs qui avaient mis leur vie en jeu pour recouvrer leur liberté, les footballeurs avaient joué au ballon pour devenir riche comme Crésus ! Grandeur du sport professionnel !
Je quittai la rue du Manoir et enfilai le boulevard Mendès-France. Le stade était à moins de deux kilomètres de l’Hôtel de l’Arrivée. La nuit était belle, j’appréciais le calme des rues désertes. J’allumai une cigarette et aspirai avec bonheur. C’était la troisième de la journée. J’avais promis à ma femme de ne pas dépasser cinq cigarettes par jour et je m’y tenais depuis plus d’un mois. Je soufflai la fumée par à-coups réguliers. Des anneaux s’élevaient devant moi à la recherche de quilles invisibles. L’extrémité incandescente crépitait à chaque bouffée comme une luciole impatiente. Rue de l’Yser. Je me retrouvai rapidement devant mon hôtel. Une petite atmosphère d’Hôtel du Nord se dégageait de sa façade blanche. Des jardinières de géraniums rouges ornaient les fenêtres des étages. Je pénétrai dans le hall. Comme souvent dans ces petites villes de province, un large comptoir faisait office de bar. Une télévision braillait la victoire à qui voulait l’entendre. Deux escogriffes vautrés sur des tables en Formica hésitaient entre se plonger dans leur énième pinte de bière ou dans la joie collective, leurs yeux révulsés et rougis par une alcoolémie défiant tout alcootest. La patronne essuyait un verre derrière le zinc. Elle leva la tête en silence. Le contraste était saisissant. D’un côté l’ambiance de la salle était mortifère, de l’autre un désordre exubérant sortait de l’écran. Je m’approchai de la femme. La cinquantaine, potelée sans retenue, blonde eau oxygénée, 95 D généreux et libre de tous mouvements.
— Bonsoir Monsieur. Que puis-je pour vous ?
— Commissaire Velcro, j’ai réservé une chambre pour ce soir.
La Marilyn guingampaise posa son verre sur le comptoir et se dirigea, dans un déhanchement hollywoodien, vers un agenda en cuir. Elle l’ouvrit, s’empara d’un crayon et barra méthodiquement un nom qui, je le supposai sans difficulté, devait être le mien. Elle effectua alors une rotation de 180 degrés, décrocha une clé qu’elle me tendit langoureusement. Numéro 13.
— 1er étage, au fond du couloir à droite. Si vous avez besoin de quelque chose, Commissaire, n’hésitez pas. Petit déjeuner demain matin ?
— Bien volontiers. Bonsoir Madame.
Je me retournai vers les deux zombies, leur fis un salut poli de la tête et repérant les escaliers commençai mon ascension. Petite chambre propre sans superflue fonctionnelle et sentant le neuf. M’approchant de la fenêtre, je m’aperçus que ma chambre donnait sur la gare. Malgré l’intensité du trafic ferroviaire armoricain, je ne m’inquiétai pas de la qualité de mon sommeil à venir.
Mal m’en prit. À peine allongé, un brouhaha envahit la place. Klaxons, sirènes, cris et chahuts inondaient par vagues rapprochées mon espace vital. Je me levai précipitamment et découvris avec horreur que tous les Guingampais s’étaient donné rendez-vous sous ma fenêtre. Telle une marée d’arlequins rouge et noir, ils se trémoussaient en désordre, par centaine, pour fêter la victoire de leur équipe. En homme prévoyant, je ne voyageais jamais sans mes boules Quies. Armé de ces forteresses de coton secondées par un oreiller complice, je tentai une évasion bien méritée. Je dus compter l’équivalent d’un troupeau de moutons avant de sombrer dans un sommeil réparateur.
*
Le lendemain était un samedi des plus ordinaires. Je devais assister à une manifestation officielle organisée par le préfet des Côtes-d’Armor suite à la conduite exemplaire de nos hommes lors d’un événement dramatique qui avait coûté la vie à une quinzaine de marins bretons. J’avais été désigné pour représenter la délégation parisienne de la brigade criminelle intervenue sur les lieux. J’enfilai mon costume anthracite, nouai ma cravate gris perlé et surmontai le tout d’un pardessus demi-saison gris souris. Le ciel devait être également de la partie, car il arborait un nuancier de gris des plus officiels. La place avait retrouvé son calme habituel. Je descendis rapidement. Une odeur de pain grillé envahissait la cage d’escalier et aiguisa mon estomac. Une jeune serveuse m’accueillit derrière le bar, encore désert à cette heure matinale. Elle m’accompagna jusqu’à la salle du petit déjeuner. Quelques tables étaient occupées par des couples et des hommes seuls. Un buffet central m’attendait avec impatience. Jus de fruits, laitages variés, charcuterie, fromage et céréales en constituaient l’essentiel.
— Que désirez-vous boire, Commissaire ?
— Café noir, s’il vous plaît.
— Vous prendrez des œufs, du bacon, du fars-pod avec votre café ?
J’écarquillai les yeux. L’Angleterre, il est vrai, n’était qu’à quelques brasses de Guingamp. La serveuse sourit devant ma mine surprise. Ses dents étaient aussi blanches que ma chemise et sa spontanéité emporta mon adhésion.
— Ce n’est pas le bacon qui m’étonne, c’est le… far… Comment dites-vous ?
— Le fars-pod, Commissaire. C’est une spécialité de la région. Une sorte de bouillie de céréales faite avec de la farine, du lait et de la crème fraîche. On peut même y ajouter des oignons, des saucisses ou d’autres ingrédients selon votre goût.
— Allons pour du fars-pod, alors ! Mais épargnez-moi les oignons et les saucisses, voulez-vous ?
Elle rit d’un rire si cristallin que le gris de mon personnage officiel faillit en rougir de plaisir. Charmante, vraiment ! Je m’apprêtai à me lever pour jeter un sort au buffet lorsque je vis deux pingouins pénétrer dans l’hôtel. Ils jetaient autour d’eux des regards impatients et stressés. Visiblement, ils cherchaient quelqu’un. Ils s’adressèrent à la patronne qui venait de prendre sa place derrière le bar. Elle tendit son menton en direction de la salle à manger. J’avais compris : j’étais leur homme !
Adieu mon fars-pod ! Adieu ma bouillie de céréales !
— Commissaire Velcro ?
— Lui-même, répondis-je sans enthousiasme.
— Nous devons vous entretenir de toute urgence et en toute confidentialité. Pouvez-vous nous suivre, s’il vous plaît ?
Je pliai ma serviette, avalai in extremis une gorgée de café brûlant et suivis les deux hommes. Lorsque nous fûmes à distance de toute oreille indiscrète, ils s’immobilisèrent et le plus âgé me tendit sa carte.
— Je suis le lieutenant Daniel et voici le sous-lieutenant Josseaume, responsable du commissariat de Guingamp. Nous avons un gros problème, Commissaire.
— Je vous écoute, Lieutenant.
Celui-ci était visiblement mal à l’aise. Ce n’était pas tous les jours qu’il s’adressait à un commissaire de la PJ parisienne. Son quotidien le cantonnait dans des affaires de voisinage, de pollution porcine et de délinquance routière.
— Voilà, hier soir, nous avons reçu un coup de téléphone du directeur du lycée des Pénitentes. C’est un établissement spécialisé en esthétique et en coiffure. Il prépare les jeunes filles au bac professionnel et au BTS. Le directeur était inquiet, car les parents d’une des jeunes filles l’avaient appelé pour lui signaler que leur fille n’était pas rentrée à Rennes par le train comme chaque vendredi soir. Il faut vous dire, Commissaire, que l’internat du lycée est fermé le week-end et que les lycéennes pour la plupart n’habitent pas Guingamp. Elles rentrent dans leur famille le vendredi soir et reviennent le lundi matin.
— Avec le match d’hier soir, il n’y a rien d’étonnant. Elle a dû vouloir y assister et en ce moment elle doit dormir chez une copine, suggérai-je.
— C’est ce que nous avons cru au début. Monsieur Jacquemin, le directeur, a tenté de rassurer la famille, a vérifié qu’il n’y avait pas eu d’incident dans la soirée. Le problème, c’est que ce matin, le directeur a retrouvé la jeune fille.
— Alors, où est le problème ?
— Il l’a retrouvée au lycée… morte !
— Un accident ?
— Un crime, Commissaire, il n’y a pas le moindre doute.
Les deux hommes paraissaient soulagés. Depuis le matin, ils étaient les seuls, avec le directeur de l’établissement à être au courant du drame. Maintenant qu’ils m’avaient mis dans la confidence, ils étaient certains que j’allais prendre en main les opérations. Seulement je n’étais pas à Guingamp pour résoudre une enquête mais pour obtenir du galon. D’un autre côté, l’affaire devait être simple : une vengeance de lycéenne, un crime passionnel d’adolescent au pire une histoire de stupéfiant. Que pouvait-il se passer d’autre à Guingamp, sous-préfecture des Côtes-d’Armor, chef-lieu de canton et d’arrondissement ? En deux coups de cuillères à fars-pod, j’aurai réglé l’affaire. Belle publicité, galon assuré, promotion garantie.
— Allons-y, tranchai-je.
La représentation officielle avait lieu à 15 heures. Il me restait toute la matinée. Je jetai un regard nostalgique au buffet, saluai la serveuse d’un signe de main amical et me dirigeai d’un pas décidé vers la porte.
II
Salle de travaux pratiques d’esthétique et de cosmétique numéro 2
Vaste pièce lumineuse rectangulaire. En son centre, deux rangées de lits de massage identiques, chacun recouvert d’une serviette framboise. Chaque plan de travail était flanqué de miroirs accrochés au mur. Cinquième lit, rangée de gauche en entrant. Une jeune femme en sous-vêtements, le corps à moitié dissimulé sous une sortie-de-bain, était allongée. Plusieurs membres de la police judiciaire locale étaient déjà là. Des légistes en tunique blanche prélevaient d’éventuels indices. Des petits sacs plastiques, numérotés et disposés précautionneusement dans une valise ouverte, attendaient leur départ pour le laboratoire de médecine légale. Je m’approchai du corps. Plus que de la surprise, ce fut de l’horreur qui m’envahit. J’avais devant moi une espèce de clown aux yeux énormes et noircis par des traits d’eye-liner monstrueux. La bouche difforme remontait jusqu’aux pommettes dans un lacis de rouge à lèvres mauve et sinueux. Des traînées de mascara débordantes grimpaient le long du front mortifié, recouvert d’un masque blanc épais. Les paupières entourant des yeux bleu clair et sans tache étaient maintenues ouvertes par un produit collant, j’appris plus tard qu’il s’agissait de fixateur pour faux ongles. Le contraste entre ce regard pur posé au centre d’un visage grotesque était saisissant. Il donnait l’impression que l’âme de la jeune fille s’était réfugiée loin de son corps martyrisé. Elle méditait, résignée. Elle abandonnait son enveloppe corporelle à un sort impitoyable et inéluctable. Mon sang-froid retrouvé, je constatai qu’elle devait avoir environ seize ans, était blonde, et mesurait à peu près un mètre soixante. Ses bras étaient étendus le long du corps. Dans leur prolongement, les mains étaient soigneusement manucurées. Des ongles vermillon crispés sur la serviette framboise rappelaient le drame que la jeune fille venait de vivre. Le reste du corps ne présentait pas de trace de violence physique, aucun hématome, aucune plaie n’était visible. Je me retournai vers le médecin légiste.
— Commissaire Velcro, me présentai-je. Vos collègues m’ont demandé d’intervenir. Vous pouvez m’en dire plus ?
L’homme me tendit une poignée de main vigoureuse en guise de bienvenue.
— Enchanté, Commissaire. On m’a prévenu de votre arrivée. Sachez que je suis flatté de faire équipe avec un professionnel comme vous. Votre réputation vous a précédé. Je me présente, docteur Vignon, responsable de l’unité de médecine légale depuis vingt ans, rattaché à la section de Saint-Brieuc.
C’était un homme d’une cinquantaine d’années, au crâne chauve et lisse comme un galet breton. Une bedaine assumée après des années de galettes saucisses, quelques poils hirsutes et flamboyants sur un menton volontaire, rappelant que les Vikings n’étaient pas passés loin.
— Je ne sais pas encore ce qui est à l’origine du décès, Commissaire. En tout cas, elle est morte sur cette table, allongée sur le dos comme le prouve la présence de live dos sur chaque point d’appui, aux épaules, sur le bassin, les fesses et les talons. Il n’y a pas de marque d’asphyxie ni de strangulation. Pas de trace de lutte. Pas de plaie par arme blanche ou arme à feu. J’ai besoin d’une autopsie.
— L’heure de la mort, Docteur ?
— Je dirais vers vingt-deux heures hier soir, vu la rigidité cadavérique encore incomplète.
— À l’heure où tout le monde était au match ou devant la télévision. Le lycée devait être complètement désert, commentai-je.
— Oui. J’ai parcouru son dossier pour me faire une idée. Apparemment, c’était une fille en pleine forme. Pas d’allergie, pas de maladie chronique, pas de traitement en cours, pas d’antériorité notable. Aucun problème dans sa scolarité. Bonne conduite. Bref, une fille sans histoire !
— Jusqu’à hier soir en tout cas, conclus-je, pensif.
— Nous étions tous les deux rivés sur le visage déformé de la victime. Une blague de lycéen qui tourne mal ? Une vengeance entre adolescentes à l’âge où tout est à la fois excessif et dérisoire ? On pouvait même avoir affaire à un suicide maquillé. Maquillé, c’était le cas de le dire !
— Vous n’avez donc aucune idée de la cause de la mort, Docteur Vignon ? insistai-je.
— Aucune. L’autopsie nous en dira plus, Commissaire.
— En tout cas, c’était une fille magnifique, exprimai-je tout haut ce que je pensais tout bas en observant le cadavre.
En effet, à part la mise en scène macabre, les traits de la jeune femme étaient parfaits. Ses yeux en amande, son large front, l’ovale harmonieux de son visage et ses pommettes légèrement proéminentes lui donnaient une beauté pleine de caractère.
Le lieutenant Daniel s’était approché de moi. Il avait abandonné son sous-lieutenant aux officiers chargés d’emporter le corps et attendait que j’en aie fini avec le légiste. Je remarquai à ses côtés un homme au visage déterré et moite. Ses mains se tordaient comme les liserons autour d’une branche. L’insomnie habitait son regard hagard et vide. J’eus l’impression qu’il se serait effondré si le lieutenant ne le maintenait pas les épaules.
— Je vous présente le directeur de l’établissement, monsieur Jacquemin.
J’occultai la limace molle qu’il me tendit en guise de main et me limitai à un sourire de circonstance.
— C’est épouvantable, Commissaire. Quand les parents vont apprendre la mort d’une de nos élèves, ça va être la ruine de l’établissement.
Une gamine de seize ans venait de mourir et la seule idée du directeur était la réputation de son lycée !
— Il faut vous dire, Commissaire, intervint le lieutenant qui avait perçu ma réprobation, que le lycée des Pénitentes est un établissement privé. Il s’autofinance et bénéficie de très peu d’aide du conseil régional.
— Que sait-on de cette jeune fille, Monsieur le Directeur ? le questionnai-je en coupant court aux tentatives d’explication du lieutenant.
— Elle s’appelle Alice Tardutre, élève en classe de seconde section esthétique. Une fille sans histoire, des résultats moyens, pas de problème de discipline à ma connaissance, bien intégrée. Elle faisait partie d’une bande d’amies que l’on voyait toujours ensemble. Elle logeait à l’internat au lycée Notre-Dame avec trois autres filles.
— Il faudra que j’aille visiter sa chambre.
— Bien sûr Commissaire.
— Rien d’autre, monsieur Jacquemin ?
— Si, elle participait au concours de présélection pour l’élection de Miss Bretagne. Elle avait déjà franchi beaucoup d’échelons, elle en était au quart de finale. C’était une des favorites. C’était une très jolie fille, Commissaire, avant…
Le directeur ne put terminer sa phrase, l’émotion trop forte lui étreignait la gorge.
— Vous pensez que la jalousie peut être un motif, une rivale un peu trop ambitieuse ?
— Je réfléchissais à voix haute pendant que les deux hommes me plantaient le décor.
— Ou un petit ami ? Une belle fille comme ça devait avoir du succès auprès des garçons, continuai-je.
— Je crois, oui, mais je n’en suis pas certain, Commissaire. Il faudrait demander à ses copines d’internat. Je la vois parfois le mercredi après-midi rentrer au lycée avec un élève de terminal du lycée Notre-Dame. Un gars en classe professionnelle sportive, footeux bien sûr !
— Vous avez des classes spécialisées pour devenir footballeur professionnel ici ? m’étonnai-je.
— Bien sûr Commissaire, et les places sont chères. Le lycée Notre-Dame refuse plus d’une centaine de jeunes chaque année. Ça fait partie des retombées économiques de notre équipe professionnelle. Ajoutez-y les commerces qui vivent grâce aux matchs et aux jeunes des lycées, les rentrées financières directement liées aux rencontres locales, les dons des fans, les aides de l’État suite aux bons résultats de l’équipe. Guingamp vit grâce à son foot, Commissaire.
— Ah dites donc !
Nous sortîmes de la salle de cours d’esthétique. Le lycée Notre-Dame se situait à quelques centaines de mètres du lycée des Pénitentes. Nous décidâmes de nous rendre à pied jusqu’à l’internat. À peine sortis de la salle où reposait le corps, nous nous heurtâmes à un chariot de ménage. Un homme était accroupi et paraissait ranger une bassine sur son niveau inférieur. Il parut surpris de notre présence, se releva brusquement et nous sourit d’un air forcé.
— Bonjour Ferdinand. Il est interdit de rentrer dans cette salle pour le moment, lui ordonna le directeur. Vous ferez le ménage demain. Il n’y aura de toute façon aucun cours aujourd’hui. C’est compris ?
Ferdinand, puisque tel semblait être son prénom, se redressa dans un genre de garde à vous maladroit, mi-comique mi-arrogant.
— Ya, mat-tre1, lança-t-il fièrement.
Je regardai, interloqué, le directeur du lycée.
— Eh oui, Commissaire Velcro ! Bon nombre de Bretons d’origine parlent encore la langue bretonne. Ferdinand est employé dans l’établissement depuis plusieurs années. C’est un garçon simple mais travailleur. Originaire de Landerneau. Il utilise souvent des expressions bretonnes dans la conversation, selon son humeur.
Travailleur peut-être, mais sans-gêne certainement. L’homme était visiblement en train d’écouter derrière la porte. Il avait la trentaine, un cou de taureau, des épaules de lutteur et des lèvres avides et gourmandes. Un être tel que lui réduit à une fonction d’homme de ménage me paraissait grotesque.
Sans un mot, Ferdinand empoigna son chariot avec fermeté et s’éloigna de notre groupe. Nous reprîmes notre route. J’appris que les deux établissements avaient passé un accord et travaillaient la main dans la main. La majorité des élèves du lycée des Pénitentes habitaient en dehors de Guingamp, aussi l’internat de l’établissement n’était pas suffisant. Une partie des jeunes filles était logée dans un bâtiment qui leur était réservé dans l’enceinte du lycée Notre-Dame. Un système de navettes, malgré la proximité des deux établissements, avait été mis en place. Chaque matin un bus venait prendre les internes, les emmenait au lycée des Pénitentes et les ramenait le soir. Ainsi, l’encadrement évitait toute dérive facilement imaginable à ces âges-là.
Il fallait emprunter un dédale de chemins, plus tortueux les uns que les autres, dans l’enceinte même du lycée des Pénitentes. Nous passâmes devant l’internat. C’était un ancien presbytère granitique. Un jardin de curé auquel on accédait par un escalier de vieilles pierres en gardait l’entrée. Un puits, à la margelle rénovée, trônait devant l’entrée. Bâtiment austère mais magnifique, reflet d’un siècle de discipline et d’ordre. J’imaginais sans difficulté des religieuses circuler en silence dans ce havre de paix, leurs chasubles frôlant les allées, auréolées d’une foi soumise. Nous continuâmes notre déambulation. Au bout de quelques minutes nous arrivâmes au niveau d’un portail qui marquait les limites du lycée.
— C’est là que la navette attend les jeunes filles, Commissaire.
Le directeur nous servait de guide. Il ouvrit maladroitement la grille et nous nous retrouvâmes dans la rue. Trottoirs étroits, maisons de granit collées tels des dolmens siamois, calme angoissant pour le Parisien que j’étais. Seul, un chat tout de blanc poilu nous accompagna quelque temps avant de disparaître en haut d’un muret de pierres. Au bout d’un moment, un parc apparut sur notre droite. Une allée de gravillons desservait plusieurs chemins qui s’enfonçaient sous les arbres. Un peu plus loin, nous longeâmes une bâtisse blanche et sans style qui tranchait avec le gris du granit omniprésent.
— La caserne des pompiers, Commissaire.
Puis ce fut le tour des pompes funèbres. En grosses lettres, on pouvait lire : Chambre funéraire BERNARD. Beau bâtiment d’angle au fronton arrondi. J’aperçus derrière les baies vitrées des salons au coloris orangé agrémenté de fauteuils en cuir noir. Nous quittâmes la rue Auguste-Pavie et rapidement atteignîmes la rue des Capucins. Là, un important complexe nous fit face. Nous étions arrivés au lycée Notre-Dame.
Le directeur prenait son rôle au sérieux.
— C’est un grand établissement, Commissaire. Il fait aussi collège. De nombreuses spécialités sont possibles ici, depuis le breton, le chinois et bien sûr le football et le basket.
Ah, la Bretagne, pensai-je, un monde à part ! Si Stevenson l’avait connue, c’est ici qu’il aurait fait échouer son Robinson.
— L’internat de nos jeunes filles est dans un bâtiment à part, là-bas, Commissaire.
Tout en parlant, monsieur Jacquemin nous montrait du doigt une bâtisse moderne de quatre étages sans aucune élégance. D’ailleurs le complexe dans sa totalité n’avait aucun cachet contrairement au lycée des Pénitentes. Je me trouvais face à une architecture des années soixante-dix comme tous les établissements de cette époque, construits à la hâte devant l’augmentation rapide des effectifs et de la scolarisation. Le directeur nous ouvrit la porte et s’effaça pour nous laisser passer. Depuis le début de notre balade, le lieutenant Daniel n’avait pas ouvert la bouche. Il était visiblement inquiet des conséquences prévisibles du drame qui venait de se dérouler. Sa carrière, bien que sans panache, était jusque-là irréprochable et lui avait valu des gratifications régulières. Un imprévu de cette taille le dépassait. C’est ce que je déchiffrai dans les nombreux plis qui ornaient son front.
— La chambre de mademoiselle Tardutre est au troisième étage, Commissaire. Suivez-moi.
L’établissement était désert comme tous les samedis après-midi. L’internat ne rouvrait ses portes que le lundi matin. Arrivés sur le palier du troisième, nous nous trouvâmes devant un long couloir. Monsieur Jacquemin, le directeur, nous entraîna vers la quatrième porte à gauche. Il avait pris soin de se munir du passe et ouvrit ainsi sans difficulté. C’était une chambre pour quatre. Quatre lits, quatre armoires identiques et quatre tables-bureaux en constituaient le mobilier. La pièce était rangée à la perfection. Les consignes devaient être strictes. Je m’approchai des armoires. Sur un des battants, une étiquette indiquait le nom de la jeune fille qui l’occupait. C’est ainsi que j’appris que Marie Charmand, Solenn Syl et Laura Guesno étaient les camarades de chambrée d’Alice Tardutre. J’entrouvris chacune des armoires. Sans surprise, des vêtements attendaient le retour de leurs propriétaires. Dans le bas, un large espace sans étagères permettait de loger la valise indispensable aux migrations hebdomadaires des lycéennes. Je me dirigeai vers l’armoire d’Alice Tardutre. Je soulevai les pulls, remuai des portemanteaux, m’attardai même sur la lingerie qui me parut déjà bien suggestive malgré le jeune âge de la victime. Le linge de toilette avait été disposé sur une étagère dédiée. Une paire de baskets et des chaussons occupaient le bas de l’armoire. Étonné, je constatai l’absence de bagage.
— Comment expliquez-vous que la valise d’Alice ne soit plus là alors que la jeune fille n’est pas partie ?
La moue de surprise du lieutenant Daniel me confirma que je n’avais décidément pas affaire à un fin limier.
— Vous avez raison Commissaire Velcro. Je ne l’avais pas remarqué. Où peut donc être passée cette valise ?
— Je n’en ai aucune idée, mais nous devons la retrouver. Peut-être contient-elle des indices, confirmai-je.
Je me dirigeai vers la salle de bains attenante. Une salle de bains unique pour quatre adolescentes futures esthéticiennes, je m’attendais au pire. En effet, bien qu’aucune trace de savon ou de dentifrice ne gâtât le lavabo immaculé, une multitude de pots, de tubes et de brosses avaient été abandonnés à leur triste sort l’espace d’un week-end. Même amoncellement sur les bords de la douche sur lesquels les shampoings, après-shampoings, soins capillaires, lisseurs, friseurs et produits dérivés me donnèrent le tournis. Je n’imaginais pas que les crinières de ces belles puissent leur donner tant de soucis. Je n’aperçus aucune trousse de toilette, brosse à dents, peigne ou autre ustensile indispensable au quotidien. Les résidentes devaient les emporter avec elles chaque semaine. La jeune Alice s’était donc bien préparée à rentrer chez elle comme d’habitude. Elle avait emporté ses affaires. C’est après que les choses avaient dû mal tourner. Je me retournai vers les bureaux. Un tiroir, un sous-main et une lampe d’appoint pour les soirées d’hiver studieuses. J’ouvris machinalement les quatre tiroirs, mais comme je m’y attendais, je ne découvris que des stylos, des dessins de maquillages et des brouillons.
— Bien, mis à part la disparition de la valise, la chambre ne paraît pas révéler de choses très intéressantes.
— Rien d’anormal en effet, Commissaire.
C’était le directeur qui s’autorisait à confirmer mes propos. Depuis notre départ du lycée des Pénitentes, il paraissait plus à l’aise. L’action lui était salutaire. Il s’apprêtait à refermer la porte du dortoir, lorsque j’aperçus une feuille de papier qui dépassait de dessous un matelas. C’était le lit de Marie Charmand. Je le soulevai et découvris une photo format A4. Il s’agissait du portrait d’Alice, à ce que je crusse reconnaître tout du moins, car le visage de la jeune fille avait été sauvagement balafré par des traits de crayon noir qui traversaient de long en large toute la feuille. Je tins délicatement la photographie par l’une de ses extrémités afin de ne pas abîmer des empreintes éventuelles. Fier de ma trouvaille, je la mis sous le nez du lieutenant Daniel qui ne tarda pas à appeler son sous-lieutenant pour le transfert de la pièce à conviction.