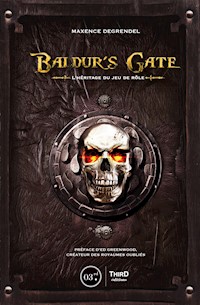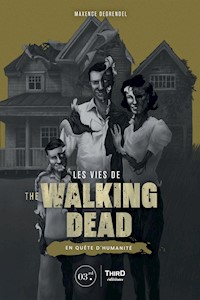
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Véritable phénomène de la pop culture, The Walking Dead n’est pas tant une histoire qui traite de morts-vivants : il est question de drames humains avant tout. Les trahisons, la violence, la maladie et la mort jalonnent l’épopée crasseuse de Rick, son protagoniste. Plus encore, ce récit n’est pas seulement le sien ou celui de ses compagnons : il est également le nôtre. Puisqu’il soulève des sujets actuels et ô combien douloureux tels que l’effondrement de la civilisation ou le deuil, il cristallise nos peurs contemporaines. Or, The Walking Dead demeure, malgré toute sa noirceur, une œuvre profondément optimiste.
À travers Les Vies de The Walking Dead - En quête d’humanité, l’auteur Maxence Degrendel revient en détail sur les coulisses de l’œuvre et de ses différentes itérations (comics, séries télévisées, jeux vidéo…), avant d’analyser ses thématiques et la manière dont elles résonnent avec notre actualité, avec ce qui fait de nous des êtres humains.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préface
The Walking Dead, vous connaissez ?
Si vous lisez ces lignes, il y a fort à parier que vous en ayez, pour le moins, entendu parler.
Ces trois mots se sont imposés auprès des fans de pop culture en l’espace de quelques années. Il est d’ailleurs étonnant de voir de quelle manière une création de ce type – que rien ne destinait initialement à devenir le phénomène que l’on sait – s’est propagée bien au-delà du public ciblé, ici les amateurs de BD et de cinéma de genre ; en l’occurrence, celui des univers de zombies.
En effet, lorsque le scénariste Robert Kirkman et son compère, le dessinateur Tony Moore, proposent ce concept au responsable éditorial d’Image Comics aux États-Unis, leur intention est, à l’époque, de tenter de vivre de leur travail d’auteur de comics. Ni plus ni moins. Ils n’en sont d’ailleurs pas à leur coup d’essai, puisque cela fait quelques années qu’ils cherchent la reconnaissance dans un domaine où l’on compte généralement beaucoup plus d’appelés que d’élus, à savoir de personnes capables d’en vivre. Ils ont tenté de percer avec Battle Pope (une série parodique et iconoclaste dans laquelle Dieu transforme le pape en super-héros), puis avec Invincible… qui deviendra également le succès que nous lui connaissons.
Cependant, devant le peu d’enthousiasme initial du responsable éditorial en question, Robert Kirkman, malin, présente son projet d’histoire de zombies en maquillant quelque peu ses intentions. Il s’agirait bien d’une épidémie qui transforme les humains en créatures affamées de chair, mais qui aurait été délibérément propagée par des extraterrestres pour préparer une invasion.
Ce postulat scénaristique est très vite évacué au bout de quelques numéros, et il n’en sera plus question devant l’intérêt grandissant suscité par la série.
En effet, un public sans cesse plus important se met à suivre The Walking Dead, au point que ces comics deviennent une réussite éditoriale et commerciale avérée, bien au-delà du succès de niche auquel on aurait pu s’attendre venant d’une série traitant d’une apocalypse zombie. Il faut quelques mois encore, ainsi que l’élan considérable apporté par son adaptation sous la forme de série télévisée, pour que The Walking Dead connaisse une réussite à l’échelle planétaire.
En revanche, nos « morts qui marchent » ne vont pas se contenter d’envahir les étals des librairies. Très vite, le succès de la série télévisée crée un cercle vertueux qui entraîne notre groupe de survivants dans un tourbillon multimédia, avec pêle-mêle des magazines, des jeux vidéo et de plateau, etc.
C’est l’ampleur de ce succès que Maxence Degrendel se propose de décrypter dans l’ouvrage que vous tenez entre les mains, avec notamment le making of de la série de comics avec laquelle tout a commencé. Surtout, ce sont les thèmes majeurs de la saga, ainsi que les aspects sociologiques et philosophiques qui la traversent, qu’il va explorer pour vous.
Il aura donc fallu un peu plus de cinq années pour qu’un quasi-inconnu, Robert Kirkman – devenu depuis lors un véritable Midas des comics –, aidé d’un extra-ordinaire dessinateur et narrateur, Charlie Adlard1, impose The Walking Dead en tant que phénomène de pop culture. Il ne vous reste plus maintenant qu’à vous (re)plonger dans cet univers aux multiples facettes.
Bonne lecture !
Thierry Mornet
BIOGRAPHIE
Thierry Mornet est le responsable éditorial comics aux Éditions Delcourt. Il est également l’éditeur de la série de comics The Walking Dead.
1. Qui remplaça Tony Moore dès le septième numéro, sur les près de deux cents – toutes publications confondues – que compte la série.
Avant-propos
AVOUONS-LE d’entrée de jeu, les pages du livre que vous vous apprêtez à sillonner ont été écrites dans un contexte pour ainsi dire cocasse. Alors que le monde est frappé par la pandémie de COVID-19 qui éprouve durement les fondations de notre société, que la méfiance de l’autre et de son corps, qui apparaît soudain comme hautement contagieux, devient une norme, et que, pour application officielle à cela, une succession de confinements sont déclarés dans de nombreux pays, l’auteur s’est dit que ce serait une excellente idée d’écrire un livre sur The Walking Dead.
Les ressemblances entre cet univers, originellement publié sous la forme d’un comics, et notre propre quotidien sont nombreuses et troublantes. Il suffirait d’un rien pour faire de cette fiction à succès une anticipation pour notre réalité. Certes, il n’est pas encore question de zombie mangeur de chair humaine par chez nous. Cependant, The Walking Dead n’est pas tant une histoire qui traite de morts-vivants. Bien sûr, ils existent et sont même présents en grand nombre. Il est pourtant probable que si son scénariste, Robert Kirkman, s’était décidé à les remplacer par des rats mutants enragés ou des plantes carnivores anthropomorphes, son récit serait resté sensiblement le même. Parce qu’ici, il est question de drames humains avant tout. Les trahisons, la violence, la maladie et la mort jalonnent l’épopée crasseuse de Rick, son protagoniste. Le rôdeur – l’appellation de ces créatures délabrées qui ont été des femmes, des hommes et des enfants, et qui déambulent désormais dans les villes et les campagnes – constitue certes un ressort dramatique central prenant l’apparence du miroir de notre humanité, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un ressort parmi tant d’autres, comme Robert Kirkman l’a clamé à de nombreuses reprises. Nous nous ferons une joie d’explorer ici toute la richesse de ces thématiques.
Néanmoins, plonger dans les méandres de The Walking Dead peut se révéler anxiogène. S’il ne s’agit que d’une fiction, elle tend à avoir l’odeur et le goût du réel. À une époque où le simple fait de prendre un bain de foule à l’occasion des courses au supermarché devient un risque de contamination, avec tout le stress que cela occasionne, comment ne pas faire un parallèle avec la terreur que ressentent les survivants à l’idée d’être mordus par un rôdeur ? Que ce soit dans la bande dessinée ou dans ses déclinaisons en séries télévisées et en jeux vidéo, toutes les histoires de The Walking Dead partagent une scène commune. Badigeonnés de viscères de zombies pour se confondre parmi eux, les personnages traversent une horde de rôdeurs incontournable. Le moindre faux pas, le moindre éclat de voix et les créatures se retournent immédiatement contre les vivants pour les mordre, les transformant en monstres cannibales.
Le récit dont traite ce livre n’est pas seulement celui de Rick, Glenn, Michonne, Maggie et les autres. C’est également le nôtre. Puisqu’il soulève des sujets actuels et ô combien douloureux tels que l’effondrement de la civilisation ou le deuil, il cristallise nos peurs contemporaines. Il ravive cette appréhension au sujet de notre société, cette possibilité qu’elle ne tienne bientôt plus le choc face au dérèglement du climat, aux catastrophes naturelles, aux pandémies, etc. Et par-dessus tout cela, The Walking Dead nous ramène à ce sentiment de perte, que ce soit au sujet d’êtres chers certes, mais aussi de notre mode de vie, le confort de notre foyer ou encore la sécurité vis-à-vis de nos besoins fondamentaux comme l’accès à l’eau ou à la nourriture.
Cela étant dit, et pour ne pas nous enfoncer dans le désespoir sans un filet de sécurité, The Walking Dead est, malgré toute sa noirceur, une œuvre profondément optimiste. Il atteste qu’une catastrophe de cette ampleur n’est pas la fin du monde, seulement la fin d’un monde. Certes, le cheminement est douloureux, mais comme Rick nous l’enseignera au terme de son périple, c’est en construisant une vision d’avenir commune que l’humanité sera en mesure de se relever après avoir été jetée à terre.
Chers lecteurs avisés, nous espérons que ce présent ouvrage, dédié à l’une des plus formidables œuvres de la bande dessinée américaine et de ses ramifications, saura vous offrir toutes les réflexions et les émotions que l’auteur a lui-même traversées au cours de son exploration de l’univers de The Walking Dead.
L’AUTEUR
Maxence Degrendel est un amoureux des histoires : celles qui font rire, celles qui font pleurer, celles qui questionnent et, bien sûr, celles qui font peur. Le format ne lui importe pas et, que ce soit à travers un livre, une bande dessinée ou un comics, un film, une série télévisée ou un jeu vidéo, il se passionne avant tout pour les personnages qui peuplent ces récits. Game master en escape game, rédacteur spécialisé jeux vidéo, écrivain à ses heures perdues, rôliste, Maxence adore partager ses propres histoires. Il est notamment l’auteur de Baldur’s Gate. L’héritage du jeu de rôle publié chez Third Éditions.
PREMIÈRE PARTIE :LES COULISSES DE LA CRÉATION
Chapitre 1 : Le comics
« Rick Grimes et son partenaire Shane sont planqués derrière leur voiture de police. Shane est un redneck massif et athlétique façon Patrick Warburton2. Ils ont tous les deux leur pistolet à la main. Ils sont baissés à côté du véhicule, comme s’ils étaient sortis précipitamment pour se mettre à l’abri du côté passager. Au fond, nous pouvons voir un homme debout derrière la portière ouverte du côté conducteur d’un pick-up, et dont il se sert comme couverture. Le pare-brise est fêlé et la camionnette a l’air endommagée. L’homme l’a volée, a traversé la ville et a été stoppé par la police. Peut-être s’est-il échappé de prison – il a toujours les menottes aux chevilles. Le gars tire sur les policiers, ce qui troue le capot de la voiture juste au-dessus d’eux. Sur le côté de la route, nous pouvons voir une clôture avec quelques chevaux dans le champ au loin. »
Ainsi commence The Walking Dead, tel qu’il a été décrit par l’auteur, Robert Kirkman, dans un script à destination de son illustrateur Tony Moore. Cette première case du premier numéro paru le 8 octobre 2003 est le point de départ d’une longue série ayant cheminé jusqu’au 3 juillet 2019, date à laquelle les créateurs ont surpris le monde entier en annonçant brutalement la fin de ce périple.
Pendant près de seize ans, nous avons suivi le quotidien de Rick, shérif d’une petite ville du Kentucky qui, face à une apocalypse zombie, lutte de toutes ses forces pour survivre et protéger ses proches au point de renoncer à une part de son humanité. Rien d’original à première vue dans ce pitch. Pourtant, à mesure que The Walking Dead déploie sa narration, il parvient à surprendre, notamment grâce à la complexité de ses personnages et à la maturité de ses thèmes. Après tout, combien d’histoires impliquant des morts-vivants peuvent se targuer d’explorer à ce point la psyché humaine sur un scénario aussi étendu ?
Certes, nous avons bien eu des tentatives très satisfaisantes avant The Walking Dead, comme l’excellent 28 jours plus tard en 2003. Nous permettre d’assister à la métamorphose de son protagoniste, de livreur tout juste sorti du coma à l’homme rompu à la survie, est l’une des grandes forces du film. Toutefois, le format long-métrage est concis, limité dans sa durée. De ce fait, le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Alex Garland ne montrent que l’essentiel concernant l’évolution du héros tout en se restreignant à une courte tranche de sa vie.
De son côté, Robert Kirkman a eu tout le temps d’approfondir ses personnages comme il le désirait : « Je voulais essayer de faire de The Walking Dead le film de zombies qui ne finit jamais », explique-t-il dans une interview publiée à la fin du tome trente-trois. C’est en effet un regret de l’auteur, lui qui est fan du genre. Dans la plupart des œuvres mettant en scène une invasion de macchabées ambulants, nous suivons une bande de héros au cours d’un long-métrage. Après quelques péripéties, les survivants semblent continuer leur route et le générique défile. Pour Kirkman, cela ne ressemble pas à la fin, mais au tout début. « Et si l’un de ces récits se poursuivait indéfiniment ? » raconte-t-il à Rolling Stone en 2013. C’est en partant de ce principe directeur qu’a été écrit The Walking Dead. Bien que le comics ait finalement trouvé une conclusion avec le #193, nous avons malgré tout été témoins des errances de Rick Grimes au début de l’apocalypse jusqu’à la reconstruction d’un nouveau monde dont il a été l’initiateur.
Pour amorcer ce livre comme il se doit, revenons aux origines de l’œuvre, à savoir le récit de la création de The Walking Dead.
Qui sont les auteurs de The Walking Dead ?
ROBERT KIRKMAN, LE SCÉNARISTE
DE L’HORREUR ET DES COMICS
Les zombies mangeurs de chair humaine, voilà un sujet que Robert Kirkman maîtrise depuis sa plus tendre enfance. Né le 30 novembre 1978 à Lexington dans le Kentucky aux États-Unis, il se passionne tôt pour le cinéma d’horreur. Seulement, ses parents ne sont pas particulièrement enclins à laisser leur fils devant des films gorgés de sang et de tripes. C’est pourquoi le garçon se faufile le soir derrière le canapé pour regarder la télévision par-dessus l’épaule des adultes et se faire quelques frayeurs. Une fois par an, pour Halloween, il est autorisé à voir un film d’épouvante de son choix. Le reste du temps, le jeune Robert passe une enfance simple à Cynthiana, une petite ville rurale d’un peu plus de six mille habitants du Kentucky. Sa mère travaille comme femme de ménage tandis que son père est entrepreneur. Quand il n’a pas école, le garçon explore les environs de Cynthiana et notamment sa forêt. Ses aventures le poussent à s’intéresser à la survie en milieu naturel, un thème central de The Walking Dead. Pendant un temps, sa famille fréquente une église pentecôtiste3, ce qui conduit Kirkman à assister à une pratique relativement courante de cette religion : une séance d’exorcisme. Cette expérience ne le rend pas croyant, mais lui inspirera des années plus tard le scénario d’une bande dessinée publiée pour la première fois en 2014 : Outcast.
En ce qui concerne les études, Robert Kirkman n’est pas un élève particulièrement modèle. En revanche, c’est au collège qu’il se prend de passion pour les comics. Vivant dans une petite ville de campagne, il ne peut s’en procurer que dans un Walmart4 situé à une bonne heure de route de chez lui. Étant donné que le magasin en question ne vend que des Marvel, le jeune garçon construit son imaginaire autour des X-Men ou de Captain America et s’abreuve de toutes ces histoires de super-héros aux pouvoirs fantastiques. Il est particulièrement marqué par Spider-Man, au point qu’à la naissance de son fils en 2006, il le baptisera Peter Parker Kirkman en hommage au célèbre tisseur.
Toujours au collège, Kirkman rencontre un certain Tony Moore, qui raffole lui aussi de comics. Ces deux-là s’entendent à merveille et commencent à nourrir le désir de faire carrière dans la bande dessinée. Kirkman rêve déjà d’écrire ses propres scénarios, mais également de les dessiner. C’est pourquoi à son entrée au Harrison County High School de Cynthiana, il se tourne vers les arts. À ce propos, il explique au magazine RollingStone : « Ma dernière année au lycée, je ne faisais plus rien. J’étais étudiant en art et je disais à mon professeur d’anglais que je m’absentais pour travailler sur mon projet artistique. Alors, je sortais du lycée, je traînais dehors et j’allais manger au Long John Silver’s5. J’avais des notes passables, mais je savais que l’école, ce n’était pas pour moi. »
Après le lycée, Robert Kirkman abandonne les études et enchaîne les boulots alimentaires. Après avoir été livreur de pizza et même vendeur de bandes dessinées à la fin des années 1990, il trouve un emploi chez un commerçant en luminaires et décorations d’intérieur. C’est à ce moment qu’il passe son permis, ce qui lui ouvre de nouvelles lectures, puisqu’il peut se rendre dans les boutiques de bandes dessinées de sa région. Bien que fan de Marvel, il considère désormais les autres créateurs. C’est à cette occasion qu’il développe un intérêt prononcé pour les héros d’Image Comics, une maison d’édition fondée en 1992. Savage Dragon, d’Erik Larsen, retient particulièrement son attention, mais tout le catalogue d’Image le passionne, que ce soit Youngblood de Rob Liefeld ou WildCATS de Jim Lee.
Kirkman, des étoiles plein les yeux à la lecture de toutes ces histoires épiques, se lance à son tour. Lors de ses temps libres, il s’attaque à son premier projet personnel, Between the Ropes. Seulement, il en prend conscience très vite : produire une bande dessinée est une activité chronophage. C’est la raison pour laquelle Kirkman démissionne de son travail pour se vouer à sa nouvelle ambition. Car c’est décidé, le jeune homme fera carrière en tant qu’auteur de comics.
PREMIERS PAS DANS LA BANDE DESSINÉE
Between the Ropes prend place dans le milieu du catch, un sport de lutte très populaire aux États-Unis. Pendant deux ans, Kirkman s’y consacre pleinement. Il écrit le scénario et en réalise également les illustrations. Il se fait aider à la colorisation par son ami Tony Moore. Afin de ne pas inquiéter ses parents, il leur assure qu’il est toujours salarié alors qu’en vérité, il ne touche pas un seul centime. C’est à cette époque que le jeune homme commence à accumuler les dettes. Malgré cette pression financière, Kirkman persévère jusqu’à achever le premier numéro de sa bande dessinée. Nous sommes en 1999, notre aspirant scénariste a 21 ans. Plein d’espoir, il soumet son projet à Diamond Comic Distributors, le plus grand distributeur de comics d’Amérique du Nord, qui travaille aussi bien avec les éditeurs qu’avec les auteurs indépendants. Quelques semaines s’écoulent avant que la sentence ne tombe par courrier : DCD refuse Between the Ropes, car ce dernier n’atteint pas la qualité nécessaire. Plus tard, Robert Kirkman admettra que cette première tentative n’était pas une franche réussite, la qualifiant lui-même de « merdique ». Cet échec lui permet de comprendre qu’il n’a pas les épaules pour être illustrateur, comme il le dit en 2013 dans une interview pour Rolling Stone : « Quand j’ai compris que j’étais un mauvais artiste et que je n’avais pas les capacités pour poursuivre dans cette voie, j’étais un peu déçu. Et puis je me suis rendu compte qu’écrire est plus amusant et moins chronophage. »
Sans se décourager, Kirkman abandonne définitivement les crayons et les pinceaux afin de se concentrer sur le texte d’un second projet : Battle Pope. Terminé le catch, l’auteur raconte ici l’histoire d’un pape alcoolique qui apprend les arts martiaux avec Bruce Lee, avant de combattre des légions de démons envahissant la Terre après que Dieu a condamné l’humanité. Un scénario qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait mouche grâce à son humour. Il fait appel à Tony Moore pour l’illustrer. Ensemble, ils tentent leur chance auprès d’Image Comics après avoir achevé le premier volet. Hélas, ils essuient un refus. C’est pourquoi, loin de se démonter, ils créent leur maison d’édition. DCD valide cette fois le projet et leur accorde une avance afin qu’ils impriment Battle Pope6 sous leur propre label : Funk-O-Tron.
Sans que le comics soit un succès à sa sortie en juin 2000, les auteurs parviennent à rembourser leur prêt grâce aux ventes et à toucher en prime la bagatelle de… 100 dollars. Vivre en tant qu’auteur paraît décidément utopique. À ce stade, abandonner cette voie semble donc raisonnable. Il est fort probable que Robert Kirkman l’ait envisagé d’ailleurs, ses dettes ne cessant de se creuser. Alors qu’il s’occupe de toute la ligne de production de sa bande dessinée, de l’impression à la promotion par des publicités qu’il réalise lui-même, jusqu’aux déplacements coûteux en convention, il n’est toujours pas en mesure de gagner de l’argent. Pourtant, et l’avenir lui donnera raison, le jeune auteur persiste.
UN TICK ET D’ENTRÉE CHEZ IMAGE COMICS
Si Robert Kirkman a bien une qualité, c’est le culot. Afin de percer dans ce milieu difficile, il a conscience que le talent ne suffit pas. Il faut également un réseau. Lorsqu’il apprend qu’un ami à lui, rédacteur en chef d’un site d’actualité de la bande dessinée, cherche quelqu’un pour interviewer Erik Larsen, il bondit sur l’occasion. Rien ne le prédispose à le faire, puisqu’il n’a aucune formation en journalisme. En revanche, il connaît parfaitement le travail de Larsen, cet ancien scénariste de chez Marvel et cofondateur d’Image Comics. L’affaire est entendue, et c’est ainsi qu’il récupère le numéro de téléphone de l’auteur. Cette interview, en réalité, se révèle pour Kirkman une excuse toute trouvée pour approcher Larsen et sympathiser avec lui. Après l’entretien, les deux hommes restent en contact et s’appellent de temps en temps pour bavarder autour de leur passion commune pour les super-héros.
Afin de poursuivre Battle Pope, Kirkman cherche un second artiste, Tony Moore étant peu disponible du fait de ses études. En traînant sur un forum de discussion, il découvre les travaux de Cory Walker. Conquis par son style, il aborde ce dernier et lui propose de collaborer, ce qu’il accepte. Il commence par dessiner quelques pages de Battle Pope avant d’œuvrer sur un tout nouveau projet imaginé par Kirkman : Science Dog. Cette fois, pas question de verser à nouveau dans l’autoédition. Les deux créateurs soumettent leur livre à Image Comics une fois la première ébauche finalisée, mais peinent à convaincre. Pendant ce temps, Cory Walker réalise un fan art de SuperPatriot, un héros signé Erik Larsen. Kirkman, qui continue d’échanger régulièrement avec ce dernier, lui montre le dessin, qu’il apprécie et propose de le publier dans Savage Dragon #93. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Seulement, le fan art de Walker attire l’attention de deux personnes clefs d’Image : Jim Valentino, autre cofondateur de la maison d’édition et Eric Stephenson, le directeur marketing. Tous deux impressionnés, ils suggèrent à Larsen de laisser à l’illustrateur et à son scénariste les rênes d’une minisérie afin de les mettre à l’épreuve.
C’est ainsi que Robert Kirkman écrit SuperPatriot : America’s Fighting Force. Composé de quatre épisodes, le premier numéro est diffusé en juillet 2002 et s’écoule à près de dix mille exemplaires le mois de sa sortie. Dans un article paru sur le site CBR, Kirkman encense largement Cory Walker, puisque c’est en grande partie grâce à lui qu’il a pu obtenir ce contrat chez Image. Par la suite, les deux comparses auront l’occasion de travailler sur leur propre série, Invincible, tandis que Kirkman enchaîne les projets comme Tech Jacket, Cloudfall, Brit ou encore Capes. Tout semble aller pour le mieux pour notre scénariste, car les occasions favorables se succèdent. Seul bémol : l’argent continue de lui échapper des mains.
UNE CARRIÈRE QUI DÉCOLLE
Publier des comics chez un éditeur ne signifie que très rarement en vivre convenablement. De nombreux créateurs sont en dessous du seuil de pauvreté aux États-Unis, et Kirkman ne fait pas exception à ce stade de sa carrière. Ses dettes culminent à plusieurs dizaines de milliers de dollars, et il ne parvient toujours pas à se dégager un salaire décent pour les rembourser. Seule solution : continuer d’avancer, cumuler les projets et espérer se faire un nom dans l’industrie. Pour quelqu’un qui, bien plus jeune, se voyait avoir une vie tranquille, Kirkman doit travailler comme un forcené afin d’alimenter son maigre compte en banque.
En 2003, il est contacté par Brian Michael Bendis, un auteur réputé ayant majoritairement œuvré pour des séries Marvel comme Daredevil ou encore Spider-Man. Ce dernier le félicite à propos d’Invincible, ce à quoi Kirkman lui répond, avec son habituel aplomb : « Donne-moi un boulot chez Marvel. » Sans pour autant abandonner ses projets auprès d’Image Comics, il signe donc un contrat avec le célèbre éditeur. Sa première mission est de réhabiliter un ancien super-héros nommé Sleepwalker, mais devant les ventes décevantes du premier numéro, Marvel l’annule. Cela n’empêchera pas Robert Kirkman de poursuivre sa carrière pendant plusieurs années chez eux, où il écrira notamment pour X-Men, Captain America et Les Quatre Fantastiques.
En parallèle, les graines d’une autre série germent dans son esprit. Fasciné depuis tout jeune par les films d’horreur, et plus particulièrement par les zombies, il se tourne vers son ami d’enfance Tony Moore, fin 2002, pour creuser une idée. Ensemble, ils s’attellent au scénario et au dessin de cinq pages d’un pitch mettant en scène un couple regardant la télévision et se faisant soudainement agresser par un mort-vivant. Vous vous en doutez, cette proposition est la première ébauche de The Walking Dead.
TONY MOORE, L’ILLUSTRATEUR DES DÉBUTS
DES HISTOIRES POUR SE FAIRE PEUR
Né le 20 décembre 1978, Michael Anthony « Tony » Moore passe lui aussi sa jeunesse à Cynthiana. Issu d’une famille séparée, il est élevé par sa mère. Moore se plonge dans les bandes dessinées avant même de savoir lire. Alors qu’il n’a pas encore cinq ans, il découvre notamment l’univers d’EC Comics7 grâce à des magazines comme Mad. Un illustrateur œuvrant dans les colonnes de ce dernier le fascine particulièrement : Jack Davis. D’un coup d’œil, le garçon est capable de reconnaître son style, qui peut aussi bien verser dans la caricature et l’humour que l’horreur. C’est avec Tales from the Crypt, un comics dédié à l’effroi et pour lequel Davis a donné au célèbre Gardien de la Crypte son aspect emblématique, que Moore se révèle avoir un goût prononcé pour les contes d’épouvante. Le soir, il dessine des monstres qu’il affiche aux murs de sa chambre grâce à un petit projecteur puis joue à se faire peur tout seul.
Au collège, le jeune Tony est introverti et timide. Lors d’un cours d’histoire, l’enseignant le fait s’asseoir à côté d’un élève de sa classe, Robert Kirkman. Rapidement, ils deviennent amis. Outre les comics, les deux adolescents ont un sérieux penchant pour les films d’horreur. Ponctuellement, ils se retrouvent chez l’un ou l’autre pour se faire des séances de cinéma à la maison. Si Kirkman parle souvent de La Nuit des morts-vivants de George A. Romero dans ses références, Moore évoque volontiers Braindead de Peter Jackson. Dans ce film, le futur réalisateur du Seigneur des anneaux déploie un récit à la fois gore et déjanté dans lequel il se permet toutes les libertés. La scène de sexe entre deux zombies, qui débouche plus tard sur la naissance d’un bébé monstrueux, se révèle aussi invraisemblable qu’insolite.
À travers ces sessions d’épouvantes entre copains, Moore confirme sa passion pour les créatures mangeuses de chair humaine et pour l’hémoglobine qui va de pair. En conjuguant cette fascination et son amour du comics, il s’imagine donner vie à ses propres récits. C’est donc tout naturellement qu’il se lance par la suite dans des études d’art.
PREMIERS CONTRATS
Tony Moore étudie le dessin et la peinture à l’université de Louisville à partir de 1996. Bien que séparés par plus de cent kilomètres, lui et Robert Kirkman restent proches. Après lui avoir donné un coup de main sur Between the Ropes, il planche sérieusement sur Battle Pope en 1999. Peu après, et avant même de décrocher son diplôme, Moore abandonne les études pour se lancer dans une carrière d’illustrateur de comics à plein temps. Grâce au réseau de Kirkman, il obtient un contrat officiel chez Image Comics. Conjointement, ils réalisent un numéro spécial de Masters of the Universe sous-titré Icons of Evil, qui se focalise sur les origines d’un antagoniste, Beast Man. La bande dessinée est distribuée à partir de juin 2003 et se vend à plus de 15 000 exemplaires, un chiffre correct, mais très loin des poids lourds de l’époque. En comparaison, le crossover8 de G.I. Joe et de Transformers, également publié par Image Comics, s’écoule sur cette période à presque 100 000 unités.
La même année, Moore et Kirkman créent conjointement Brit, un comics de super-héros édité par Image et dont le premier fascicule sort en juillet 2003. Composé de trois volumes au total, il ne rencontre pas le succès escompté puisqu’il stagne à moins de 5 000 ventes par épisode. D’ailleurs, pour le dernier d’entre eux, Moore est remplacé par Cliff Rathburn, un artiste qui contribuera à The Walking Dead. Toujours est-il que Tony Moore enchaîne les heures de travail pour Image Comics sans que sa carrière ne démarre véritablement. Rien de surprenant : rares sont les illustrateurs à faire un carton dès les premières parutions. Mais bien que légèrement mieux rémunéré que Robert Kirkman9, Moore vit lui aussi avec des ressources financières limitées tout en multipliant les projets. La fatigue s’accumule, de même que la pression des factures à payer.
INCURSION EN TERRITOIRE ZOMBIE
Comme nous l’avons déjà évoqué, c’est à partir de fin 2002 qu’un comics en collaboration avec Kirkman se déroulant dans un univers apocalyptique zombie commence à sortir de terre. Après un premier pitch refusé par Image, les deux associés finissent par convaincre l’éditeur. C’est en octobre 2003 que le premier numéro de The Walking Dead voit le jour après un an de maturation. Contrairement à Brit, qui avait été pensé comme une succession de one shots10, l’ambition de TWD est de proposer un scénario unique raconté par plusieurs épisodes et qui doit s’inscrire dans la durée, pourvu que les ventes suivent. Nous savons aujourd’hui que cela a été le cas, mais il est important de comprendre qu’en 2003, impossible de deviner si la série trouverait son public ou finirait par s’éteindre après quelques numéros.
L’accueil face au démarrage de The Walking Dead est chaleureux. Seulement, comme nous le verrons par la suite dans ce chapitre, les bénéfices ne sont pas assez importants pour permettre à Tony Moore de toucher un salaire décent. C’est à cette période que l’illustrateur tombe en dépression, ce qui, logiquement, nuit à sa productivité. Il peine de plus en plus à suivre le rythme de parution, car chaque mois, il doit dessiner plus de vingt planches. Bien qu’il soit bientôt assisté par Cliff Rathburn sur les niveaux de gris11, il décroche peu à peu. Après l’épisode #6, il continue de réaliser les couvertures des #7 à #24 avant de se retirer définitivement du projet. Toutefois, son rôle ne s’arrête pas là puisque des démêlés judiciaires entre lui et Kirkman interviendront à partir de 2012. Nous développerons ce point plus loin dans ce chapitre.
Pour sa part, Robert Kirkman, inquiet, veut poursuivre l’aventure à tout prix. « Dès que j’ai compris que Tony n’allait pas pouvoir tenir le rythme et dessiner cette histoire que j’écrivais et que je comptais faire durer des années et des années, je me suis mis à chercher quelqu’un. » Difficile dans l’industrie du comics de trouver un artiste qui est en mesure de répondre à ses attentes. Après réflexion, le scénariste de The Walking Dead tente sa chance sans y croire auprès de Charlie Adlard, dont il a pu admirer le trait sur des bandes dessinées comme Astronauts in Trouble ou encore X-Files, et avec qui il a déjà eu l’occasion d’échanger auparavant. Par un heureux coup du sort, Adlard se trouve entre deux projets et accepte l’offre alors qu’il n’a jamais dessiné un seul zombie de sa vie.
CHARLIE ADLARD, L’ILLUSTRATEUR DE LA DURÉE
CARRIÈRES MANQUÉES
Charlie Adlard est originaire de Shrewsbury, une ville britannique voisine du Pays de Galles. Né le 4 août 1966, c’est avec la bande dessinée franco-belge qu’il fonde les prémices de son imaginaire. Il est particulièrement happé par les aventures d’une bande de Gaulois résistant encore et toujours à l’envahisseur, Astérix et Obélix. Il goûte également depuis son plus jeune âge à Tintin ou à Blueberry. Dans les années 1970, son père lui offre The Mighty World of Marvel. Dans ces bandes dessinées mettant en scène les super-héros de Marvel comme Spider-Man ou Hulk, il découvre des univers graphiques et des scénarios radicalement différents de ceux qu’il connaissait jusque-là. Alors qu’il commence à collectionner ces magazines, il se prend de passion pour le dessin.
Au cours de ses études, Charlie Adlard se tourne plutôt vers le cinéma, laissant de côté sa curiosité pour les crayons. Il quitte Shrewsbury pour le comté de Kent afin de rejoindre le Maidstone Arts College. Une fois son diplôme en main, il déménage à Londres pour maximiser ses chances de trouver un emploi dans l’industrie cinématographique. Peine perdue, car excepté des postes d’assistant en logistique qui ne l’intéressent pas, aucune porte ne s’ouvre à lui. Déçu, il tente de gagner sa vie pendant un temps grâce à la musique en étant batteur dans un groupe, mais cette voie débouche également sur une impasse. Sans argent, il retourne chez ses parents et se questionne sur son avenir professionnel. Il renoue avec les vieux comics de son enfance et, après réflexion, il se lance véritablement dans la bande dessinée.
UN LONG CHEMINEMENT VERS LA RECONNAISSANCE
Après avoir réalisé son portfolio, il écume les conventions dans l’espoir de dénicher un travail. Mois après mois, il compile les critiques pour améliorer son trait et se forger un style bien à lui. Après trois ans de passage à vide, une rencontre avec un scénariste du nom de Tim Quinn lui permet finalement de décrocher le Saint Graal en 1992 : un contrat pour Judge Dredd Megazine, dans lequel il œuvre pour Armitage, une série de science-fiction dans l’univers de Judge Dredd. La joie est cependant fugace, car Adlard n’est pas à l’aise. « Il s’agissait de planches en couleurs, et cela prenait une éternité à dessiner et à peindre plutôt que de se contenter du noir et blanc. J’ai dû apprendre à peindre sur le tas, et à peindre rapidement », se confie-t-il sur le site du journal Shropshire Star. Par ailleurs, les délais sont si courts entre chaque parution du magazine qu’il ne peut pas peaufiner ses illustrations, ce qui occasionne de la frustration.
Malgré ces premières difficultés, il tient bon et les projets se succèdent pour Judge Dredd Megazine ainsi que pour une revue parente à cette dernière, 2000 AD. Bien qu’il songe à se tourner par la suite vers la bande dessinée franco-belge – son coup de cœur d’enfant –, il signe en 1995 un contrat majeur pour la suite de sa carrière. En effet, il devient le principal artiste, contractuellement jusqu’en 1998, d’une adaptation en comics de la célèbre série télévisée X-Files pour le compte de l’éditeur Topps. Chaque numéro se vend à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires et Adlard vit confortablement de son métier. Seulement, lorsque sa mission prend fin, il est inquiet. Après tout, X-Files est avant tout suivi pour la licence, pas pour ses auteurs. Pendant quelques années, il vogue de projet en projet pour le magazine 2000 AD puis Marvel et DC Comics. Il prête notamment ses crayons pour Batman et pour Thunderbolts12 en 2001. À la même période, il illustre Codeflesh, une bande dessinée écrite par Joe Casey et publiée par la maison d’édition AiT/Planet Lar. Alors qu’elle est annulée au bout de cinq épisodes, les deux acolytes cherchent à publier les trois derniers afin d’achever la série. Charlie Adlard se tourne vers un petit éditeur que nous avons déjà présenté plus tôt dans ce chapitre : Funk-O-Tron. Son fondateur, nous le connaissons bien, puisqu’il s’agit de Robert Kirkman.
UNE RENCONTRE QUI CHANGE UNE VIE
Funk-O-Tron a été créé par Kirkman afin d’héberger sa première bande dessinée, Battle Pope. Pourtant, en 2001, après que lui et Charlie Adlard se sont rencontrés à une convention de comics à San Diego, ils signent un contrat d’édition dans l’optique de publier les ultimes épisodes de Codeflesh sous cette bannière. Bien que le succès ne soit pas au rendez-vous, Kirkman conserve précieusement ses coordonnées. On ne sait jamais après tout, peut-être aura-t-il besoin d’un illustrateur aussi talentueux et expérimenté à l’avenir. Les années passent, et pour sa part, Adlard continue les projets de courte durée pour Marvel et 2000 AD sans quitter son Angleterre natale.
En 2004, alors qu’il se trouve entre deux missions, il reçoit un étrange courriel dont l’objet ressemble à une mauvaise publicité : « Veux-tu gagner de l’argent ? » L’expéditeur étant un certain Robert Kirkman, il l’ouvre par curiosité. Ce dernier lui explique que son comics, The Walking Dead, commence à être bénéficiaire, mais qu’il doit trouver un nouvel illustrateur pour remplacer Tony Moore. Adlard n’a jamais réellement travaillé pour une bande dessinée d’horreur, mais il apprécie suffisamment la plume de Kirkman et l’univers graphique mis en place par Moore pour accepter. C’est ainsi que Charlie Adlard se retrouve embarqué dans la plus longue série de sa vie puisqu’il en sera l’artiste du #7 jusqu’au #193, l’ultime épisode. Une constance rare dans l’industrie du comics.
À présent que nous avons fait connaissance avec les principaux artisans de The Walking Dead, penchons-nous sur sa genèse à proprement parler.
Les coulisses d’un comics à la renommée mondiale
UNE SUITE À LA NUIT DES MORTS-VIVANTS?
Qu’on se le dise, l’artiste qui est traversé d’une soudaine illumination tandis qu’il somnole sous un cerisier par une belle après-midi d’été est un fantasme. Entre une idée et sa réalisation concrète, il peut se passer des mois, voire des années. Et dans le processus, des avis extérieurs – relecteurs, éditeurs – s’immiscent dans le récit afin d’en pointer les faiblesses ou les incohérences, et rendre ainsi l’œuvre viable sur le plan commercial. The Walking Dead ne fait pas exception. Il est d’ailleurs fort à parier que si Robert Kirkman n’avait pas bénéficié de bons conseils, cette bande dessinée n’aurait probablement pas vu le jour.
Retour en 2002. Nous approchons de la fin de l’année et Kirkman commence à se faire un nom sans parvenir à percer concrètement toutefois. Afin d’éponger ses dettes, il lui faut multiplier les idées. Le premier numéro d’Invincible, son hommage aux super-héros, et notamment à Spider-Man, est prévu pour décembre 2002. L’écriture étant moins chronophage que l’illustration, Kirkman explore de nouvelles pistes de scénario pour lancer un autre comics avec Tony Moore. Après un premier pitch de science-fiction refusé par Image et nommé Death Planet, un second projet se dessine autour du mythe du zombie.
En effet, Kirkman a dans sa jeunesse été particulièrement bluffé par La Nuit des morts-vivants, un long-métrage en noir et blanc réalisé par George Romero en 1968. Nous reviendrons plus en détail sur ce film dans le chapitre 5 puisqu’il est considéré comme l’œuvre fondatrice du zombie moderne. Toujours est-il que l’une de ses spécificités est qu’à sa sortie, le distributeur devait modifier le premier titre qui avait été retenu, Night of the Flesh Eaters, jugé trop ressemblant avec un autre film d’horreur de l’époque13. Cependant, au montage, l’équipe oublie purement et simplement de reporter l’indication de copyright sur le titre. Résultat : Night of the Living Dead tombe immédiatement dans le domaine public puisqu’il ne bénéficie d’aucune protection légale. Cette maladresse a certainement provoqué des pertes financières difficiles à quantifier. Toutefois, George Romero relativise dans une interview donnée au New York Times en 2016 : « Que tout le monde soit en mesure de montrer le film gratuitement, que n’importe qui puisse le distribuer, cela a permis à des tas de gens de le voir et, finalement, de le garder en vie. » Qu’un film de zombies ait été à ce point piraté ou projeté à tout va, lui assurant au passage une longévité exceptionnelle, est cocasse tant l’analogie entre le sujet de l’œuvre et son destin paraît évidente.
Robert Kirkman sait que cette licence encensée est disponible sans dépenser un seul centime. C’est pourquoi le premier pitch de son script illustré par Tony Moore se nomme tout simplement Night of the Living Dead et se situe dans les années 1960, comme dans le film. Pour Kirkman, ce choix coule de source. Lancer un nouveau comics ne se fait pas sans risque. Obtenir l’attention des lecteurs est une longue route qui peut prendre fin subitement si l’éditeur, insatisfait des ventes, annule la série. En s’appropriant l’univers déjà bien établi de Romero, l’auteur s’imagine qu’il va maximiser ses chances d’être remarqué. C’est donc en novembre 2002 que Kirkman et Moore font parvenir ce pitch à Eric Stephenson, le directeur marketing d’Image Comics ainsi qu’à Jim Valentino, l’éditeur. Or, le concept est refusé. Motif ? Le scénario est jugé trop « faiblard » pour faire une bonne histoire d’horreur.
LA SUPERCHERIE DE KIRKMAN
Bien qu’il symbolise les fondations de ce que deviendra plus tard The Walking Dead, ce pitch a énormément évolué pour aboutir au comics que nous connaissons désormais. En octobre 2013, à l’occasion de la parution d’un épisode spécial dixième anniversaire14, les fans de TWD ont pu découvrir les cinq pages de ce Night of the Living Dead signées par Kirkman et Moore. La première planche nous montre le présentateur d’un journal télévisé qui annonce l’effondrement du monde puisque les morts se relèvent et attaquent les vivants. Nous voyons ensuite Rick en compagnie de sa femme – nommée Carol à l’époque – regardant l’émission d’actualité en question. Rick est plus jeune et surtout beaucoup plus musclé que dans sa version finale. Carol, qui deviendra Lori, est restée physiquement la même. Alors que Rick est sceptique et cherche à rassurer Carol, quelqu’un frappe à la porte. À peine est-elle ouverte qu’un zombie s’y engouffre pour s’attaquer à Rick. Jeté à terre, le policier a tout juste le temps d’attraper son revolver et de tirer dans la bouche de la créature pour se défendre.
En recevant le pitch tel quel, Stephenson et Valentino donnent quelques pistes à Kirkman pour améliorer son comics, car une simple histoire d’apocalypse zombie ne fonctionnera pas selon eux, le genre n’étant pas tellement populaire. Et dans la foulée, ils suggèrent à l’auteur de trouver un intitulé original qu’il pourra légalement déposer et protéger. Un peu plus tard, Kirkman revient vers Image avec un titre définitif, The Walking Dead donc, et une accroche singulière : il garde les zombies, mais ancre le scénario dans une époque moderne tout en expliquant que derrière la maladie qui ressuscite les morts se cache en réalité une invasion… extraterrestre ! L’idée séduit les décideurs de la maison d’édition et le nouveau pitch, structuré autour du coma de Rick, est validé et publié en octobre 2003.
Alors qu’il parcourt le #1, Stephenson guette les indices qui permettraient aux lecteurs de comprendre les causes de la pandémie, sans rien repérer. Il passe un coup de téléphone à Kirkman afin de le féliciter tout en lui demandant à partir de quand les extraterrestres entreront en scène. Le comics étant déjà diffusé et bien accueilli, Kirkman lui révèle qu’en réalité, il n’y en aura jamais. « J’ai imaginé une version alternative de l’histoire qui n’était pas tout à fait véridique. Pour ça, le terme technique est “mensonge”, mais c’est moins drôle. » Étant donné qu’Image est une maison d’édition qui laisse énormément de libertés à ses auteurs tant que les ventes sont suffisantes, la duperie de Kirkman est sans conséquence et sa série se poursuit.
UN LANCEMENT TIMIDE, MAIS ENCOURAGEANT
D’après les chiffres fournis par Comichron, le premier The Walking Dead s’écoule à environ 7 200 exemplaires, ce qui en fait un démarrage honnête sans être un carton. À titre de comparaison et sur le même mois d’octobre 2003, le lancement de la série Cursed, parue également sous la bannière Image, se vend à plus de 14 000 copies. Compte tenu du faible coût du comics, à savoir 2,95 dollars, ainsi que des frais d’impression et de distribution, The Walking Dead n’est pas encore le succès commercial escompté. Il est d’ailleurs classé 233e dans le top 300 aux États-Unis. Les critiques sont toutefois élogieuses. Silver Bullet Comics15, notamment, vante à la fois le travail d’écriture de Robert Kirkman et les illustrations de Tony Moore. Le webzine aime tout particulièrement qu’une histoire de zombies soit réalisée en nuances de gris, ce qui permet de mettre l’accent sur l’ambiance et non sur le gore.
À ce moment, les deux auteurs sont encore loin de toucher de l’argent sur The Walking Dead et le manque de revenus n’est pas sans conséquences sur le moral de Moore, comme nous l’avons vu. En ce qui le concerne, Kirkman s’accroche, car les retours sont encourageants, et il bénéficie toujours du soutien d’Image. Le premier arc narratif doit durer six numéros et raconte le réveil de Rick, sa découverte du monde ravagé, son périple sur les traces de sa femme Lori et de son fils Carl vers Atlanta, leurs retrouvailles au campement de Shane, jusqu’à la mort de ce dernier. Bien qu’optimiste, Kirkman est convaincu que sa série sera annulée après le sixième épisode. Après tout, depuis ses débuts dans l’industrie trois ans plus tôt, ses comics ne s’arrachent pas dans les librairies. Pourtant, cela ne l’empêche pas de voir loin et de prévoir un plan sur le long terme pour son histoire.
Petit à petit, une communauté se forme autour de l’œuvre. À partir du #2, Kirkman inaugure une rubrique située en dernière page, intitulée Letter Hacks et dans laquelle il invite ses lecteurs à lui écrire. Outre des remerciements et des compliments, de nombreuses questions pertinentes sont posées. C’est dans ces colonnes que l’on apprend certaines informations cruciales sur l’univers de The Walking Dead. Par exemple dans le #7, un lecteur se demande si les morts d’avant la catastrophe peuvent se relever, ce à quoi Kirkman lui répond que ce n’est pas le cas. Il est également plusieurs fois répété qu’il ne donnerait pas d’explication en ce qui concerne l’origine de l’épidémie. Dans le #10, nous apprenons que seuls les humains peuvent devenir des rôdeurs. Enfin pour l’anecdote, Simon Pegg, l’un des acteurs principaux du film Shaun of the Dead (Edgar Wright, 2004), écrit à Kirkman dans le Letter Hacks du #12 pour lui faire part de son admiration pour sa bande dessinée.
TONY MOORE QUITTE LE NAVIRE
En avril 2004 paraît le septième épisode des mésaventures de Rick et de sa bande. Sur sa couverture, une information située en haut à gauche du comics est différente. Habituellement, juste en dessous de la date sont mentionnés les auteurs, à savoir Kirkman et Moore. Mais ici, ce dernier est remplacé par Charlie Adlard. De plus, Cliff Rathburn, l’artiste responsable des nuances de gris, apparaît pour la première fois. En ouvrant la bande dessinée, les lecteurs constatent un style graphique sensiblement moins réaliste et aux contrastes beaucoup plus marqués. Le monde de The Walking Dead devient plus sombre, plus dangereux, plus inquiétant. Dans le Letter Hacks, Robert Kirkman explique le pourquoi de ce changement, que nous avons déjà évoqué plus haut. Ainsi, après avoir illustré les couvertures du #7 au #24, Moore quitte définitivement The Walking Dead en novembre 2005.
Pour la suite de sa carrière, il multiplie les contrats avec Marvel, pour lequel il dessine notamment des comics comme Ghost Rider ou The Punisher. Il lance également deux nouvelles séries : Les Exterminateurs, scénarisée par Simon Olivier, et Fear Agent, écrite par Rick Remender. Moore fait également un retour en tant que dessinateur d’une des six couvertures du #150 de The Walking Dead.
L’ASCENSION DES MARCHEURS MORTS
Bien qu’il ne s’agisse que d’une coïncidence – les illustrations de Moore ayant été largement plébiscitées –, l’arrivée de Charlie Adlard marque un cap fondamental pour The Walking Dead, car le septième fascicule est le premier à dépasser les 10 000 ventes durant son mois de commercialisation. Ce cap n’est pas soudain puisqu’au fil des épisodes parus, la popularité du comics à la sauce zombie s’est accrue doucement, mais sûrement. Toutefois, il faut bien comprendre que c’est une réussite discrète. En dehors de quelques sites web et blogs spécialisés dans la critique de bandes dessinées, comme Silver Bullet, Fourth Rail ou Comic Book Resources, les médias en parlent peu. Il s’agit donc d’une œuvre de niche, c’est-à-dire qui ne trouve son public que dans un cercle de connaisseurs.
Cependant, The Walking Dead se propage telle une épidémie. Après la parution du #7, un roman graphique16 intitulé Days Gone Bye incluant les six premiers numéros de la série est publié par Image en mai 2004. S’il ne s’écoule qu’à hauteur de 5 372 copies le premier mois, ce recueil vendu 9,95 dollars est conçu pour perdurer dans les rayons des librairies. De ce fait, il attire un nouveau lectorat, moins fidèle aux comics mensuels et plus enclin à patienter pour suivre le rythme fixé à deux fois par an. Au même moment, certains pays commencent à découvrir cette bande dessinée singulière qui ne raconte pas son apocalypse zombie comme les autres. C’est notamment le cas en France avec une maison d’édition qui s’intéresse très tôt au futur phénomène.
PREMIER PÉTARD MOUILLÉ EN FRANCE
Quelques années avant que Delcourt achète la licence pour publier durablement The Walking Dead en France, un autre éditeur tente de se frotter aux morts-vivants de Kirkman. Il s’agit de Semic qui, à partir de sa création en 1989, s’est spécialisé dans la bande dessinée et plus précisément dans le comics. Semic traduit de nombreuses œuvres renommées en provenance des États-Unis, comme Superman, Batman ou Daredevil. Il prend également des risques en important des séries pratiquement inconnues en France, dont une partie provient tout droit du catalogue d’Image Comics et de ses studios affiliés, Top Crown ou Wildstorm. L’éditeur français publie notamment WildCATS de Jim Lee et Witchblade de Marc Silvestri, deux des illustrateurs fondateurs d’Image.
C’est ainsi que naturellement, Semic s’intéresse à une autre série de son partenaire, The Walking Dead. Intérêt qui ne vient pas de nulle part puisque parmi les salariés, un certain Thierry Mornet, recruté en 1998, est un passionné de bandes dessinées. Dès la première parution en 2003, il se régale des planches de Kirkman et de Moore. Sous son impulsion sort donc en mars 2005 le premier roman graphique, qui regroupe les épisodes #1 à #6 du comics, traduit en français et intitulé La Mort en marche. La couverture retenue est celle du #4 avec un gros plan sur une main ensanglantée tenant un pistolet et faisant face à une nuée de rôdeurs. Malheureusement, la bande dessinée ne rencontre pas son public et n’en aura jamais l’occasion avec Semic. En effet, l’éditeur appartenant au groupe Tournon depuis son rachat en 1998 est dissous par ce dernier en août 2005.
SECONDE VAGUE
Entre-temps, Thierry Mornet, licencié par Semic, est recruté par Delcourt. Malgré l’échec commercial de The Walking Dead chez son précédent employeur, il est persuadé que le lectorat français est assez mûr pour tenter à nouveau le coup. Après tout, la popularité du récit de Kirkman, Moore et Adlard est grandissante aux États-Unis. En France comme un peu partout dans le monde, le mythe du zombie se fait de plus en plus présent dans le paysage culturel. Au cinéma, un remake du Dawn of the Dead de George Romero par Zack Snyder sort en salle en 2004, sous le nom de L’Armée des morts en France, avec un accueil globalement positif. La même année, la licence vidéoludique Resident Evil est portée pour la seconde fois sur grand écran. Fortement critiqué pour son scénario, le film rencontre toutefois son public. L’année suivante, le quatrième chapitre de la saga des zombies de Romero, Land of the Dead, est diffusé. Sans être un carton, il est malgré tout bien accueilli. Du côté du jeu vidéo, 2005 est une année particulière puisque l’éditeur japonais Capcom déploie le quatrième épisode de Resident Evil. Profondément transformé dans son gameplay et dans son ambiance vis-à-vis des volets précédents, RE4 est un véritable triomphe à l’échelle mondiale. Ainsi, quand Thierry Mornet pressent que le zombie sort de sa tombe, il ne se fie pas seulement à son instinct, mais à une tendance générale. Pour résumer, le mort-vivant devient cool.
Nommé responsable éditorial de la branche comics de Delcourt à partir de début 2005, Mornet consacre une partie de son énergie à persuader Guy Delcourt, fondateur de la maison d’édition, de publier The Walking Dead. Il va même jusqu’à coller des Post-it dans les couloirs des bureaux sur lesquels il demande à son employeur d’acheter les droits. Celui-ci finit par faire confiance à Mornet, et c’est en 2007 que la série fait son retour dans les librairies françaises. Si éditer une bande dessinée ayant connu l’échec est déjà un risque élevé, Delcourt prend la décision de commercialiser deux recueils à la fois, le tome un intitulé Passé décomposé et le tome deux baptisé Cette vie derrière nous. Après un démarrage longuet, la licence s’installe solidement dans l’Hexagone, comme l’explique Thierry Mornet : « On a rapidement dû réimprimer, c’est ce qui nous a permis de poursuivre l’édition de la série, au rythme de deux à trois albums par an. Et nous a amenés à un premier succès commercial. »
DU ZOMBIE SUR PETIT ÉCRAN
Revenons aux États-Unis, en 2005. The Walking Dead poursuit, telle une horde de rôdeurs, sa lente et implacable marche vers les plus hauts sommets. Le comics, dont chaque parution se vend désormais à plus de 15 000 exemplaires, rapporte suffisamment d’argent à ses auteurs pour assurer un avenir pérenne à la série. Dans les boutiques spécialisées, il s’installe confortablement dans les rayons grâce à un atout de taille : la régularité de son rythme de publication. À titre de comparaison, Hellboy, imaginé par Mike Mignola et John Byrne, dépasse à peine les cent numéros actuellement, bien que sa naissance remonte à 1994. Il faudra seulement neuf ans à The Walking Dead pour atteindre ce cap à trois chiffres puisqu’en dehors de quelques exceptions, les lecteurs retrouvent chaque mois leur dose de zombies. Cette ponctualité participe largement à créer un public fidèle et de plus en plus étendu. Appuyé par les recueils semestriels, TWD devient donc incontournable.
Parmi ces lecteurs, l’un va d’ailleurs contribuer à lui faire prendre un tournant majeur et radical. En 2005 à Burbank en Californie, Frank Darabont passe le pas de la porte de House of Secrets, une librairie spécialisée dans la bande dessinée. Darabont est un réalisateur, scénariste et producteur de films et de séries télévisées qui s’est taillé une jolie réputation en adaptant trois livres de Stephen King au cinéma : Les Évadés, La Ligne verte ainsi que The Mist. Il a également touché au film d’horreur classique en écrivant le script de Freddy 3, Le Blob ou encore Frankenstein. Ce jour-là, alors qu’il furète entre les rayons de la librairie de Burbank, Frank Darabont tombe sur le volume un du recueil de The Walking Dead. Il l’achète dans la foulée, et le lendemain, après avoir passé une partie de la nuit à le dévorer, il appelle son agent afin d’entamer les négociations pour en acquérir les droits. Bien que plus familier avec le cinéma, c’est pour la télévision que le réalisateur s’imagine porter l’œuvre de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. À partir de là, Frank Darabont bataille pour que son nouveau projet trouve des financeurs et puisse devenir une réalité. Entre son premier contact avec les créateurs de The Walking Dead et la diffusion du pilote17 de la série en 2010, cinq années s’écoulent18.
LA PROMOTION SURPRISE DE ROBERT KIRKMAN
Dans l’intervalle, la bande dessinée The Walking Dead continue de croître. En 2006, chacun des comics au format semestriel dépasse désormais les 20 000 exemplaires vendus. Le volume cinq des recueils, Monstrueux, se vend à plus de 10 000 unités le premier mois de sa publication, en septembre de la même année. Pourtant, lorsque l’on porte un regard global sur l’industrie du comics aux États-Unis, ces chiffres paraissent faibles en comparaison des poids lourds. Par exemple, en novembre 2006, The Walking Dead #32 trouve un peu moins de 20 000 lecteurs. Civil War écoule pour sa part plus de 250 000 exemplaires de son cinquième numéro. Toutefois, il est important de comparer ce qui est comparable. Image Comics est un éditeur bien implanté, mais largement devancé par les Big Two, à savoir les deux principales maisons d’édition que sont Marvel et DC Comics. Les critères pour juger d’une réussite commerciale ne sont pas les mêmes pour Image que pour ses imposants concurrents.
D’ailleurs, si The Walking Dead est rentable financièrement parlant, il ne rapporte pas encore énormément d’argent à ses auteurs. À cette époque, Kirkman est donc investi dans de nombreux projets en parallèle pour gagner sa vie, comme Invincible ou The Astounding Wolf-Man chez Image. Pour Marvel, avec qui il signe régulièrement des scripts depuis 2004, il écrit pour Spider-Man, Ant-Man ou les X-Men. Sans surprise, il apporte également sa contribution à Marvel Zombies, une série prenant place dans un univers alternatif où les humains ainsi qu’une grande partie des héros Marvel sont contaminés par un virus les transformant en morts-vivants mangeurs de chair.
Quoi qu’il en soit, Robert Kirkman a le vent en poupe. Il se bâtit au fil des années une solide réputation et ses œuvres se vendent de mieux en mieux, en partie grâce à une base de fans qui le suit d’une bande dessinée à une autre. Si bien qu’en 2008, fort de ses exploits, Image Comics propose à Kirkman de rejoindre le rang des associés de la maison d’édition et de prendre part à son développement et à sa ligne éditoriale. C’est un événement déterminant chez Image puisque depuis sa création en 1992, c’est la première fois que les fondateurs accueillent un nouveau membre à leurs côtés.
Image Comics est bien moins renommé à l’international que Marvel ou DC Comics en dehors de la sphère des connaisseurs, ne bénéficiant pas de l’aura cinématographique d’adaptations cartonnant au box-office. Pourtant, avec ses publications diversifiées et des ventes actuelles lui permettant de se hisser à la troisième place des maisons d’édition de bandes dessinées aux États-Unis, c’est un acteur majeur dans le paysage culturel américain. Étant donné que The Walking Dead est intrinsèquement lié à cet éditeur au fonctionnement singulier, intéressons-nous donc à sa genèse, reflet d’une époque où le marché du comics subissait de plein fouet l’éclatement d’une bulle spéculative19 et où certains de ses créateurs, lassés d’être bridés artistiquement et lésés financièrement, inventèrent un tout nouveau modèle éditorial.
IMAGE COMICS, L’OUTSIDER AUX GRANDS DESSEINS
Traditionnellement, et notamment chez les Big Two, auteurs et illustrateurs de bandes dessinées sont payés soit à la page, soit par une rémunération régulière. En parallèle, l’éditeur s’approprie l’intégralité des droits sur les œuvres produites sous contrat. Ainsi, lorsqu’un créateur quitte une maison d’édition, il est contraint d’abandonner ses réalisations. De plus, étant donné que les licences en question appartiennent à l’éditeur, les scénaristes et les artistes sont facilement remplaçables, ce qui limite leur champ d’action en cas de tentative de négociation de salaire ou des conditions de travail qui, précisons-le, peuvent être extrêmement pénibles du fait du rythme de parution soutenu d’un comics.
C’est pour ces raisons qu’en décembre 1991, trois créateurs de chez Marvel – Todd McFarlane, Jim Lee et Rob Liefeld – s’entretiennent avec son président, Terry Stewart. Ils ne sont pas venus pour marchander quoi que ce soit, mais pour informer Stewart de leur décision de démissionner afin de fonder leur propre maison d’édition. Quatre autres artistes sont de la partie, bien qu’ils n’aient pas assisté à cette réunion : Erik Larsen, Marc Silvestri, Whilce Portacio et Jim Valentino. Puisqu’à eux sept, ils représentent les créateurs les plus lucratifs de Marvel, ces départs ne sont pas sans conséquences, comme nous le verrons20.
Début février 1992, le collectif fraîchement assemblé annonce la naissance d’Image Comics. Une maison d’édition constituée exclusivement d’anciens artistes d’un des plus grands poids lourds de comics aux États-Unis fait nécessairement du bruit. La presse écrite et les chaînes d’information couvrant l’événement, il en résulte quelques jours plus tard une chute des actions en bourse de Marvel. Si d’autres facteurs, comme l’éclatement de la bulle spéculative que nous aborderons plus bas, entrent en ligne de compte, la formation d’Image Comics est l’un des facteurs ayant entraîné la faillite de Marvel en 1996.
Toujours est-il que pour les sept créateurs, l’aventure est certes palpitante, mais également effrayante. Quitter un emploi stable pour le vaste inconnu, il y a de quoi prendre peur. Toutefois, cette liberté est grisante. Excepté Portacio qui, pour des raisons personnelles, met entre parenthèses sa carrière, chacun des fondateurs constitue son propre studio sous l’étendard d’Image. Bientôt, les nouvelles séries s’enchaînent : Youngblood de Liefeld en avril 1992, Spawn de McFarlane en mai ou encore Savage Dragon de Larsen en juillet. Soutenu par une excellente couverture médiatique et un solide capital sympathie du public, chaque comics sorti des presses d’Image se vend au minimum à 500 000 exemplaires. Le triomphe est tel qu’en août de son année de création et après huit mois d’existence, le collectif devient le deuxième éditeur de comics aux États-Unis, et ce, avec seulement six parutions. En comparaison, DC Comics est recalé au troisième rang, malgré une soixantaine de bandes dessinées commercialisées sur cette période. Pour ainsi dire, Image Comics est une étoile qui brille vite et qui brille fort.