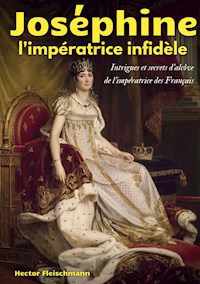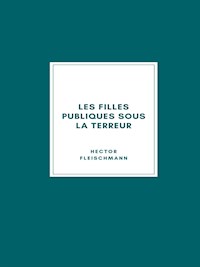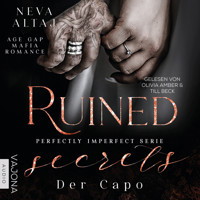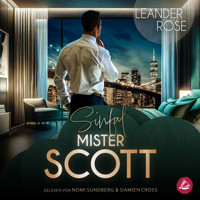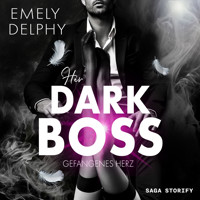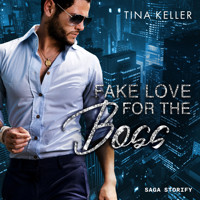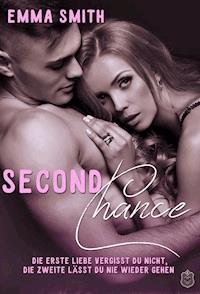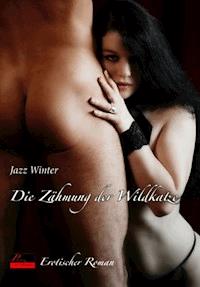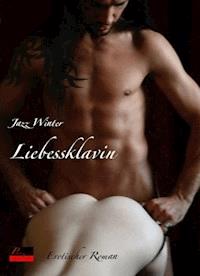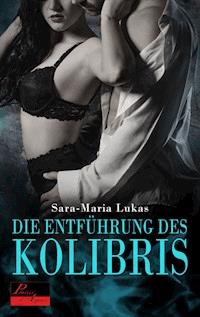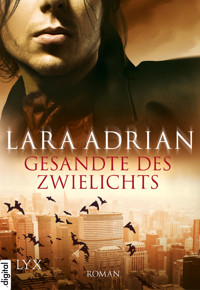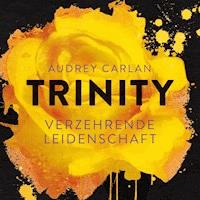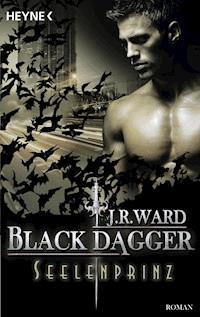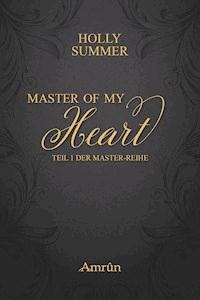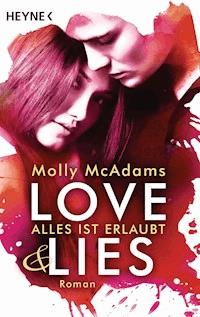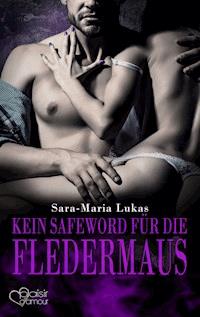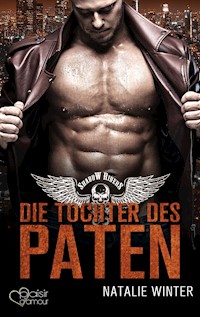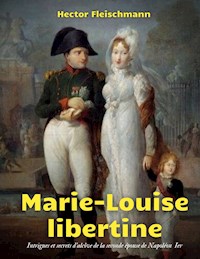
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Marie-Louise libertine : intrigues et secrets d'alcôve" est une oeuvre captivante qui plonge le lecteur dans les méandres de la vie intime et politique de Marie-Louise d'Autriche, seconde épouse de Napoléon Bonaparte. Ce livre explore les facettes cachées de cette impératrice, souvent éclipsée par son illustre mari. À travers une narration riche en détails historiques, l'auteur Hector Fleischmann nous offre une vision nuancée de Marie-Louise, dévoilant ses luttes personnelles et ses ambitions dans une époque dominée par les hommes. Le récit s'articule autour des nombreuses intrigues de cour et des secrets d'alcôve qui ont jalonné la vie de Marie-Louise, révélant une femme complexe, tiraillée entre ses devoirs impériaux et ses désirs personnels. Fleischmann, avec une plume acérée et un sens aigu de la dramaturgie, nous entraîne dans un voyage à travers les salons feutrés des palais impériaux, où se jouent des jeux de pouvoir subtils et impitoyables. Ce livre n'est pas seulement une biographie, mais une véritable exploration des dynamiques de pouvoir et des relations humaines au coeur de l'Empire napoléonien. En mettant en lumière les aspects méconnus de la vie de Marie-Louise, l'auteur nous incite à reconsidérer notre compréhension de cette figure historique souvent sous-estimée. L'AUTEUR : Hector Fleischmann est un auteur et historien spécialisé dans l'étude des figures historiques du XIXe siècle. Bien que peu connu du grand public, ses travaux se distinguent par une rigueur académique et une capacité à rendre accessibles des sujets complexes. Fleischmann s'est particulièrement intéressé à la période napoléonienne, un champ d'étude qu'il a exploré avec minutie à travers plusieurs ouvrages. Il a su redonner vie à des personnages historiques en les présentant sous un jour nouveau, souvent en s'appuyant sur des documents d'archives peu exploités. Ses écrits se caractérisent par une approche narrative qui mêle analyse historique et récit vivant, permettant au lecteur de plonger dans les intrigues et les enjeux de l'époque. En dehors de "Marie-Louise libertine", ses autres oeuvres incluent des études sur des figures telles que Joséphine de Beauharnais et Talleyrand, où il s'efforce de démystifier les mythes et de révéler les vérités cachées derrière les légendes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
AVANT=PROPOS
LIVRE I : La Femme de César
Chapitre I : L’ORGUEIL DE LA SURVIE DYNASTIQUE
CHAPELLE : TRIBUNES BASSES
Chapitre II : LE « VENTRE » AUTRICHIEN
Chapitre III : LA VICTIME DU « CORSICAIN »
Chapitre IV : LA DESCENTE A LA TRAHISON
LIVRE II : La Femme du Borgne
Chapitre I : MANIÈRE DE DIVORCER SUIVANT LA RAISON D’ÉTAT
NOUVELLES IMPORTANTES DE L’ARMÉE : CINQUIÈME BULLETIN
Chapitre II : LES BATARDS PARMESANS
Chapitre III : « NOTRE ILLUSTRISSIME CONJOINT »
LE GÉNÉRAL BERTRAND : A MONSIEUR PERROTIN.
Chapitre IV : LA FIN DU « TERRIBLE MASLE »
LIVRE III : La Femme du Jésuite
Chapitre I : LOISIRS BADINS DE LA DÉVOTION
Chapitre II : LES INTERMÈDES GALANTS DE LA VIEILLE DAME
Chapitre III: LA MORT DE LA CI-DEVANT IMPÉRATRICE
APPENDICES
Chapitre I : LE RETOUR DE MARIE-LOUISE EN AUTRICHE EN 1814
Chapitre II : LA « VEUVE D’HECTOR » ET LE POÈTE SENSIBLE
AVANT=PROPOS
De l’enquête psychologique, commencée avec Napoléon adultère, continuée par Joséphine infidèle, voici le dernier livre. Aux yeux de ceux qui ont lu les deux premiers, nous n’avons point à ex cuser la violence de celui-ci, à nous disculper de la froide colère avec lequel nous y avons condensé l’essentiel des reproches de la France napoléonienne, contre cette archiduchesse venue d’Autriche, en croupe avec le Malheur. C’est que nous touchions à l’instant de la chute du grand Empire, au moment où le désastre sacre véritablement César, mieux encore que ne l’a pu faire ce Pape venu du fond des Romagnes pour attester de la justice de son élévation. C’est qu’aussi, dans les hordes barbares, franchissant le Rhin, mettant le pied sur la noble terre de la liberté révolutionnaire, nous avons vu marcher, au premier rang, pennons hauts, lances droites, les soldats et les pandours de cette même Autriche dont une fille assumait le rôle de Régente, de gage de paix et de fidélité aux serments solennels des jours heureux de la puissance. C’est que nous avons vu la Famille étrangère marcher sur la Famille française, la prendre à la gorge dans la stupeur de son étonnement, la terrasser et lui arracher ce que, librement, fièrement, elle avait été trop heureuse et trop honorée de lui voir accepter, moins de quatre ans auparavant.
Ah ! l’Histoire doit être impartiale, solennelle, froide et impassible ! Ah ! il faut calmement enregistrer l’agonie du plus noble et du plus digne régime qui veilla aux destinées nationales ! Sans tremblement, il faut noter les trahisons, exposer les indignes défaites, les outrageantes soumissions. D’un œil sec, il faut regarder les cadavres, et d’une main posée dresser le bilan du charnier ! Il faut raisonner la trahison, ergoter sur la forfaiture ! Au nom d’une faiblesse féminine, de raisons sentimentales, on doit excuser ou amoindrir le plus éclatant abaissement que l’Histoire ait à enregistrer ! Allons donc ! Si une excuse peut consoler l’amertume de cette colère, c’est qu’on doit se dire que ce n’est point une femme française qui a assumé, devant les temps, devant les mémoires fidèles, la honte fameuse d’une telle dégradation morale et physique.
« On a cherché, a-t-on excellemment écrit, à mettre sur le compte de la faiblesse de son caractère, l’indigne conduite de Marie-Louise. La faiblesse peut encore inspirer de la pitié ; nulle indulgence ne saurait être acquise au cynisme des sentiments1. »
Cette indulgence, pourtant, de nos jours, il s’est trouvé quelqu’un pour en faire bénéficier, sans mesure, l’Autrichienne, et le nom de qui absolva ainsi, est bien fait pour surprendre dans l’occurrence. C’est de M. Frédéric Masson que nous entendons parler ici. Les sentiments que nous lui avons voués, que nous lui gardons, nous mettent fort à l’aise pour parler, une fois, du moins, sans ambages.
On sait avec quelle juste sévérité, M. Frédéric Masson a instruit le procès de Joséphine et le jugement accablant et mérité qu’il a rendu, la cause plaidée et entendue. Mais, par une suite d’esprit où nous échappe la ligne de la logique, il a fait bénéficier Marie-Louise de tout ce qu’il avait eu le droit et l’obligation de refuser à Joséphine. Il n’a voulu considérer en elle qu’une sorte de victime résignée de la politique autrichienne, un pantin aux mains des oligarques. A l’entendre, l’Autriche a tout fait, a décidé à elle seule de l’abandon de l’Empereur par l’Impératrice, de sa trahison des serments les plus essentiels, de son outrageant et avilissant adultère enfin. Sans doute, et, dans une large mesure, les déductions de ce raisonnement doivent être acceptées. Mais est-ce pour excuser Marie-Louise ? N’est-elle donc pour rien dans tout cela ? Contrainte à l’abandon de son mari, a-t-elle crié sa volonté de le rejoindre, de courir avec lui les suprêmes chances de la Fortune ou les hasards du malheur ? Un mot, une ligne, un geste, la montrent-ils fidèle à son mari ? Quand la voit-on protester contre cet arrachement, contre le vol de sa couronne et l’assassinat de sa tendresse ? Vers la voix, la convoquant au nouveau foyer de l’île d’Elbe, a-t-elle, une fois, une seule fois, tourné la tête ? On lui a imposé un amant. Soit. Mais a-t-elle été violée ? Cet amant, elle l’a accepté parce que c’était son bon plaisir et un plaisir tel que, Neipperg mort, elle s’est hâtée de grimper au lit de Bombelles. Donc elle a tout accepté, tout voulu, sans révolte, sans que sa chair cabrée et son esprit rebelle se soient élevés contre l’abjection où on la poussait. Dans tout cela quelle place pour l’indulgence ? Le moyen d’excuser, s’il vous plaît ?
Nous savons bien que M. Frédéric Masson s’en tire par un tour indigne de lui et sa franchise coutumière. « L’Impératrice des Français m’appartient, dit-il, je ne m’occupepas de la duchesse de Parme2. »
C’est esquiver un des points capitaux de l’enquête. On juge un accusé tout autant sur ses paroles que sur ses actes. Ce sont les actes de Marie-Louise que nous allons examiner ici.
Ils montreront Napoléon trahi, une fois de plus, trahi comme il le fut par Joséphine, mais avec un éclat certes bien plus outrageant. La créole n’a trahi que le général en chef, le Premier Consul. Elle a respecté l’Empereur. Si, de quelque indulgence elle doit bénéficier, c’est au nom de ce respect seul qu’on la lui peut impartir. Et c’est au nom de ce respect qu’elle devait à l’Empereur, en tant que chef d’une grande nation, en tant qu’époux, que Marie-Louise doit être, implacablement, frappée d’un jugement sans appel.
L’excuser ? Tenir compte d’une sentimentalité bêlante ? Il est des cas où ceux qui relèvent de l’Histoire sont sans sexe.
A l’heure de ces suprêmes trahisons, Lui, le Héros, apparaît plus grand encore, dressé dans l’éclat de son apothéose funèbre et triomphale. Sa femme arrachée de lui, ses maréchaux traîtres à leurs titres de victoires, abandonné de sa valetaille, celle du haut et celle du bas, seul, dans ses palais déserts et loin de ses armées trompées et désarmées, il se hausse à la gloire, plus grand d’être solitaire. Ce sont ces malheurs qui obligent à l’agenouillement devant son Nom, à la religion à sa Mémoire. Puissant, honoré et craint, il touche moins la sensibilité française, l’émotion nationale, que, déchu, blasphémé et ridiculisé. Par les courageuses vertus de la race qui s’épanouissent alors en lui, par le renoncement fier, par la soumission majestueuse, il donne le plus haut exemple de grandeur et de noble force. Il domine les écrasements, les agenouillements et les platitudes. Par sa marche solennelle et prisonnière au Ténare de la vie hélénoise, il propose aux siècles la consolation des rancœurs contemporaines. En survivant au reniement de sa femme, aux fourberies de sa noblesse, il offre l’image de l’homme fort, du Surhomme. Pour montrer ce qu’il a de si haut, il faut montrer ce que les autres ont de si bas. Voici ce qui y tâche.
De la chambre de l’humble logis où cette page s’achève, se développe à nos yeux l’horizon marin de la Manche.
Déjà les nuées violettes du crépuscule traînent leurs écharpes au ras des flots cabrés et retentissants. Et là, sous nous, unie et jaune, s’étend la plage. De vieilles poutres vermoulues, cerclées de mousses et constellées de coquillages, attestent des embarcadères construits jadis pour la flotte de la descente en Angleterre. Lentement, une à une, la mer a arraché les planches des estacades de l’an XIV, et c’est maintenant, dans la solitude du port déserté, qu’elle monte à l’assaut des vieilles poutres héroïques. Bientôt tout sera renversé, balayé, emporté. Il ne demeurera rien de l’autrefois, dans ce coin de France où veille la colonne triomphale de Boulogne, il ne demeurera rien du titanesque projet de 1804, si ce n’est que le souvenir de ce havre disparu et la vision du vaisseau, cinglant, dans la haute mer, vers Sainte-Hélène...
Ambleteuse, 1910.
H.F.
1 ARTHUR LÉVY, Napoléon intime ; Paris, 1897, in-8, p. 230.
2 FRÉDÉRIC MASSON, L’Impératrice Marie-Louise (1809-1815) ; Paris, 1906, in-8, intr. II.
LIVRE I
La Femme de César
I
L’ORGUEIL DE LA SURVIE DYNASTIQUE
Dès que Joséphine est reconnue stérile, que l’Empereur est certain que ce n’est point par elle que sa postérité sera maîtresse de l’avenir, l’idée du divorce prend racine, grandit et devient irrévocable. En 1807, c’est chose arrêtée. Les guerres, les circonstances, tout cela conspire à en retarder l’exécution, mais peu importe. L’Empereur divorcera.
Dix-huit princesses sont offertes à son choix. Avec leurs filiations, âges et religions, elles sont portées sur un tableau en tête duquel figure Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche, âgée de seize ans. Il en est de plus jeunes, Anne-Paulowna, par exemple, sœur de l’Empereur de Russie, âgée de douze ans et onze mois, et Marie-Amélie-Frédérique-Augusta, nièce du Roi de Saxe, qui a, à peine, atteint ses treize ans et huit mois. Toutes les maisons souveraines figurent là, la Bavière avec l’Espagne, le Portugal et la Russie, les quatre Saxe, le Danemark, et, perdue parmi elles, la maison princière d’Anhalt-Dessau1.
Dans tout cela, dans cette corbeille de jeunesses roses et blanches, qui choisir ? Sans doute, il ne saurait être question ici d’affaires de cœur. L’intérêt seul du grand Empire doit régler le choix de l’Empereur. Sans cela, n’est-il point en France, même, de familles dignes de fournir au trône l’épouse souveraine ? A l’heure où il est le maître du destin de dix monarchies, la question ne se pose point pour Napoléon. Il aspire plus haut qu’à une médiocre union. Celle de la veuve Beauharnais a donné des fruits trop amers. Il se sent donc instinctivement, et par une tare de son génie miraculeux, porté vers les noblesses de haute lignée, les noblesses dynastiques étrangères, puisque, cette alliance, ainsi que le dit Méneval, doit calmer l’« inquiétude des puissances » effrayées par la propagande révolutionnaire, et qu’elle sera le « gage d’une paix durable2 ». Napoléon, en cet instant, semble donc oublier qu’il est, vivant et puissant, cette propagande même, qu’Empereur sacré par le Pape, il ne demeure pas moins l’Empereur de la Révolution rentrée dans ses voies naturelles, canalisée, disciplinée. Il va, pendant quatre ans, tenter l’expérience, la redoutable et funeste expérience de la noblesse.
Trop tard — et ce sera 1814, et ce sera 1815 — il reviendra à ce peuple dont il est sorti, aux couches révolutionnaires dont il tient sa puissance et dont il est l’expression. Pour le présent, il va à ces familles, qu’il trouve de « belle race », ainsi qu’il le dit à Larrey, et qui se sont montrées souvent si lamentablement plates devant lui3. « Il se laissa glisser à cette illusion fatale, que, par la puissance, on peut suppléer à l’inégalité de la naissance4. » Mieux encore, cette illusion, il la veut tangible, imposée, acceptée, naturelle pour tous. Depuis le sacre, il n’est plus d’étonnements pour la France.
Puisque le mariage doit constituer en même temps une alliance politique, c’est vers celle-là qui lui semble la meilleure pour l’Empire qu’il se tourne. A vrai dire, il n’en est que deux pour son choix : celle de la Russie et celle de l’Autriche. C’est pour la première qu’opinent les conseils extraordinaires qu’il a réuni pour en discuter5. Les raisons de cette unanimité sont certainement diverses et contradictoires. Pour l’Empereur, l’alliance avec la Russie constituait assurément l’équilibre de sa puissance. A l’Occident, lui ; à l’Orient, le tzar ; entre eux, l’Europe, quasi-vasale de leur double souveraineté. Pour les ministres, Cambacérès entre autres, le mariage russe paraissait un gage de paix prudente. « Nous aurons inévitablement la guerre, disait-il, avec le souverain dont nous n’aurons pas épousé la fille ou la sœur, et la guerre avec l’Autriche m’effrayerait moins qu’avec la Russie6. » Dans ces paroles, la part de devination égalait la part de justesse pratique. « Un système d’alliance, écrit M. Frédéric Masson, si resserré qu’on l’imagine par les liens de famille, est mort-né s’il n’a pas pour base les intérêts propres et permanents des nations associées7. » Dans le principe de la politique napoléonienne, l’intérêt de la Russie était évident et n’échappait point à l’œil de l’Empereur. Et, approuvé dans son dessein, par les lucides intelligences de ses conseils extraordinaires, il donna ordre, à Caulaincourt, son ambassadeur à Pétersbourg, de commencer la « causerie ».
Le duc de Vicence, négociateur du mariage russe.
On y attendait, au surplus, des ouvertures. A Erfurth, Alexandre n’avait-il pas parlé en ce sens à Napoléon8 ? De cette alliance n’y avait-on pas discuté les préliminaires ? La condition tacite du tzar n’avait-elle pas été, autant qu’on peut le deviner à travers les réticences et les contradictions, la renonciation de Napoléon aux affaires de Pologne ? On peut le croire, à la réponse de l’Empereur, le 3 août 1809, à la députation de Galicie : « Vous sentez que le rétablissement de Pologne dans ce moment-ci est impossible pour la France... Je ne veux pas faire la guerre à la Russie9. » Les jalons ainsi posés, la besogne était simplifiée à Caulaincourt.
La marche à suivre lui fut nettement et sommairement indiquée. « Dans toutes vos combinaisons, partez du principe que ce sont des enfants qu’on veut », lui écrivait Champagny, le 13 décembre 180910, au moment où la nouvelle du mariage de Napoléon avec une princesse russe commençait à filtrer dans le public11. C’était là la confirmation des instructions données, moins d’un mois auparavant, le 22 novembre : « Il vous restera à nous faire connaître les qualités de la jeune princesse, et surtout l’époque où elle peut être mère, car dans les calculs actuels, six mois de différence sont un objet12. » Ainsi, par les dépêches de Champagny, se confirment les causes premières du divorce impérial.
Caulaincourt exécuta à la lettre ces instructions et procéda à une enquête attentive sur la future fiancée. De la grande-duchesse Anne, le prince de Schwarzenberg13 faisait le portrait le plus flatteur. « Elle n’a pas quinze ans, disait-il, n’est point formée et est encore très petite, mais elle annonce devoir être un jour jolie... la forme de son visage n’a rien de l’air kalmouk de la famille14. » Les renseignements de Caulaincourt, naturellement, sont plus précis et abondants. Le 5 janvier 1810, il écrit à Champagny une longue dépêche où il dit de la grande duchesse :
V.E. sait par l’Almanach de la cour que Mme la grande-duchesse Anne n’entre dans sa seizième année que demain, 7 janvier. C’est exact. Elle est grande pour son âge, et plus précoce qu’on ne l’est ordinairement ici ; car, au dire des gens qui vont à la cour de sa mère, elle est formée depuis cinq mois ; sa taille, sa poitrine, tout l’annonce aussi. Elle est grande pour son âge, elle a de beaux yeux, une physionomie douce, un extérieur prévenant et agréable, sans être belle, et un regard plein de bonté. Son caractère est calme, on la dit fort douce, on vante plus sa bonté que son esprit. Elle diffère entièrement, sous ce rapport, de sa sœur, qui passait pour impérieuse et décidée15. Comme toutes les grandes-duchesses, elle est bien élevée, instruite, elle a déjà le maintien d’une princesse et le ton et l’aplomb nécessaire pour tenir sa cour16.
Ces détails s’étaient, vraisemblablement, fait trop longtemps attendre, car, parallèlement à Caulaincourt, Savary, cet « admirable chef de gendarmerie17 » menait une enquête trop peu discrète à Paris. Venu aux renseignements chez Labinski, le consul général de Russie, à Paris18, il avait laissé deviner son jeu. Le consul en écrivit à Pétersbourg. « L’Empereur, mande Caulaincourt à Champagny, le 15 janvier 1810, l’Empereur m’a dit que M. le duc de Rovigo avait été faire une visite à Labinski, chez qui, ajoute-t-on, il n’allait jamais, qu’il lui avait parlé de la grande-duchesse et lui avait demandé son âge et des renseignements sur elle, sur sa tournure. Tout cela a choqué le consul qui, embarrassé pour répondre, m’a-t-on ajouté, a couru chez l’ambassadeur pour tout lui conter19. » Entre temps, cependant, Caulaincourt avait envoyé des détails plus précis. Ils étaient de nature à satisfaire l’Empereur dans ses espérances de postérité. C’est le 5 janvier 1810, que l’ambassadeur écrivait :
L’arc de triomple élevé à la barrière de l’Étoile pour l’entrée de LL. MM. à Paris, le 2 avril 1810.
Une réflexion générale, c’est que le sang qui coule dans les veines de la famille impériale est beaucoup plus précoce que celui des Russes. A en juger par la chronique de la cour, la nature s’y développe de bonne heure. Les fils, tiennent en général, de leur mère et les filles de l’empereur Paul. Quant à la constitution, les princesses ont l’air, ainsi que le tempérament, sec ; Mme la. grande-duchesse Anne fait exception à cette règle ; elle tient, comme ses frères, de sa mère, tout annonce qu’elle en aura le port et les formes. On sait que l’impératrice est encore maintenant, malgré ses cinquante ans, un moule à enfants20.
Enfin, le 15 janvier, Caulaincourt confirme ces détails et ajoute : « On convient que Mme la grande-duchesse est nubile, qu’il y en a eu des marques prononcées, quoique légères21 ». Mais, de là même viennent les difficultés dont nous aurons à parler. En attendant, Champagny répond, le 5 février : « S.M. a été frappée d’apprendre que la nubilité de la jeune princesse n’avait encore été annoncée que par des marques légères. Elle sait qu’entre ce moment et celui où une jeune personne peut devenir mère, plusieurs années peuvent s’écouler, et ainsi elle a à craindre d’être peut-être trois ans sans espérance d’avoir des enfants22. » Pétersbourg s’était, précédemment, demandé : « L’empereur Napoléon peut-il avoir des enfants ? » C’est par ces craintes que répondait le futur mari.
L’affaire, cependant, traînait en longueur. Un obstacle inattendu surgissait pour en empêcher la conclusion. L’Impératrice douairière de Russie, née Marie de Wurtemberg, opposait, non un veto formel, mais la résistance de l’inertie, à l’achèvement des pourparlers. C’était d’abord la question de religion. Caulaincourt la trancha en affirmant que Napoléon autoriserait à Paris, aux Tuileries, l’installation d’une chapelle orthodoxe et desservie par un pope23. Ce fut ensuite l’affaire de l’ukase de Paul Ier. Par cet ukase, l’empereur assassiné remettait à l’impératrice douairière la libre et entière disposition de l’établissement de ses filles. Quoique convenant que les idées de l’impératrice n’étaient pas toujours d’accord avec ses vœux, ni avec la politique, ni même avec la raison, Alexandre n’osait s’élever contre cette prérogative de sa mère24. Il réclamait des délais, « dix jours au moins ». Caulaincourt, néanmoins, demeurait optimiste. « Les préjugés lui lient les mains, disait-il, mais mille choses portent à croire que l’impératrice partagera son opinion25. » Et de nouveaux délais étaient réclamés, qui durent, vraisemblablement, exaspérer Napoléon et rendent plausible son apostrophe à l’ambassadeur : « Monsieur le Russe, l’empereur Alexandre est un enchanteur qui vous a brouillé la cervelle26. »
L’illusion de Caulaincourt, au sujet des bonnes dispositions de l’impératrice, semble avoir duré jusqu’à la fin de janvier. Le 21, il écrivait encore à Champagny : « L’impératrice ne met aucune opposition réelle, mais en même temps, et par une suite naturelle de son caractère, elle ne sort pas de son indécision27. » Les discussions autour de la nubilité de la princesse eussent dû l’éclairer, cependant. Le 15 janvier il mentionnait les objections de l’impératrice relativement à l’âge de la grande-duchesse. A l’entendre, n’était-ce pas à un satyre qu’elle allait livrer sa fille ? « On cite les deux [filles] aînées : la Palatine mariée à seize ans, qui est morte, dit-on, pour l’avoir été trop jeune ; la princesse de Mecklembourg aussi28. » Le 5 février, l’ambassadeur revient sur cette délicate et quelque peu outrageante question :
L’âge est le seul obstacle que l’impératrice mère trouve au mariage. L’exemple malheureux de ses deux filles aînées fait qu’elle ne pourrait y consentir que dans deux ans. Mme la grande-duchesse Anne ne pourrait, comme ses sœurs Marie et Catherine, se marier avant dix-huit ans. L’impératrice est flattée de cette idée, m’a dit encore l’empereur, mais aucune raison n’a pu la déterminer à passer sur la crainte d’exposer la vie de sa fille en la mariant plus tôt29.
Napoléon et Marie-Louise d’après une médaille frappée en 1810.
On ne se résignait donc pas à livrer cette pitoyable victime à « l’ogre corse ». On craignait pour elle le sort que firent subir à ses deux sœurs les lourds Allemands, brutaux et acharnés, auxquels on les livra. A tout cela, au surplus, on mêlait la question des enfants. De la paternité possible de Napoléon, on doutait, à Pétersbourg. Alexandre, seul, protestait du contraire30. « Si l’empereur Napoléon, disait-on, dans les milieux de la cour, n’a point d’enfants, comme cela est probable, puisqu’il n’en a pas eu même avec ses maîtresses, ne prendra-t-il pas ce prétexte pour répudier cette princesse31 ? » Ce disant, les milieux bien informés de Pétersbourg, bavardent sottement, car, depuis le 13 décembre 1806, Napoléon est père d’un fils, celui qui sera le comte Léon, et dans trois mois, le 4 mai 1810, la comtesse Walewska lui donnera un second fils32. A la vérité, ce ne sont là que des manœuvres pour retarder et reculer la réponse définitive qu’attend l’Empereur, qu’il va exiger. « De tels détails paraissent plus déplacés qu’un refus, » fait écrire, le 8 février, Napoléon par Champagny. Et, dans ce qui suit, on reconnaît son coup de griffe. Ces atermoiements, ces demandes de délais, l’ajournement, enfin, tout cela l’a blessé au vif. « L’ajournement, dit-il, a paru pire qu’un refus. Avait-il pour but de faire penser que la France mettait à cette alliance un prix extraordinaire33 ? » Lui, qui s’est conduit, dans cette affaire, « avec sa circonspection ordinaire34 », y a, avant tout, donné place à son amitié pour Alexandre, trouve qu’il n’a pas été payé de retour. Au surplus, il suffit, il lui serait dégradant d’insister. C’est vers l’autre alliance qu’il se tourne.
On ne lui demande rien de plus. C’est la solution désirée par le ministre Roumantzof35, imposée par l’impératrice douairière. C’est elle, elle surtout, qui n’a point voulu de ce mariage, qui a repoussé cette alliance. Cette Allemande tenace, forte de toute sa haine anti-française, a tenu tête à l’Empereur et a remporté sur sa confiance cette hypocrite victoire. « Ce qu’elle veut pour ses filles, ce n’est point un despote jacobin, si puissant qu’il soit, mais des princes, des princes vrais, qui aient du sang bleu aux veines et qui descendent des races de dynastes36. » Et ce qu’elle a voulu, elle l’a obtenu, et, par sa résistance, elle a dérobé à l’Empire sa seule alliance naturelle37.
L’Autriche n’avait point attendu la rupture des négociations du mariage russe, pour faire, habilement, des propositions. A en croire Champagny, les premières ouvertures de l’ambassadeur Schwarzenberg n’auraient été faites que dans la matinée du 7 février38. A vrai dire, les préliminaires dataient de plus loin. Le ballon d’essai, si on peut dire, avait été lancé par le premier secrétaire de l’ambassade autrichienne, M. de Floret. Il affirmait que si Napoléon s’adressait, pour son mariage, à l’empereur François, qu’il n’aurait point à craindre de refus. Le propos fut aussitôt répété au duc de Bassano39. On en fit son profit en haut lieu. Dans la nuit du 6 au 7 février, l’Empereur appela Louis-Eugène de Beauharnais, le cardinal Fesch, les grands dignitaires, les ministres, les présidents du Sénat et du Corps législatif, en conseil extraordinaire. Il y fit lire la correspondance de Caulaincourt, exposer les propositions autrichiennes et voter sur la décision à prendre. « Le conseil a voté presque à l’unanimité pour que l’Empereur épousât Mme l’archiduchesse d’Autriche40. » Le motif déterminant fut que, depuis trois ans Marie-Louise était nubile. Ainsi toutes les craintes sur la fécondité de la future impératrice se trouvèrent réglées. « La réputation des archiduchesses à cet égard était passée en proverbe41 ». Le 23 février, Napoléon adressait à François II la demande officielle en mariage, et le lendemain Berthier, prince de Neuchâtel et de Wagram, partait épouser à Vienne la fille du vaincu d’hier.
La promptitude de ces arrangements ne laissa pas que de surprendre. « Ils s’étaient faits en un tour de main », écrit Mac Donald encore surpris42. A Pétersbourg, elle causa une colère mêlée de stupeur. « Ce mariage, dit Caulaincourt dans une dépêche à Talleyrand, a fait ici une drôle de révolution. Les plus grognons, les plus opposés au système, jettent la pierre à l’impératrice mère... Vous ne pouvez vous faire une idée du déchaînement qu’il y a pour cela contre l’impératrice, même de la part de ses affidés43. » Un mécontentement, d’un ordre différent, pénétrait la population française. Le mariage y fut mal accueilli : « La majorité de la population voyait avec inquiétude et méfiance recommencer le règne d’une Autrichienne44. » L’armée, qui considérait en le nouveau mariage le résultat de l’armistice de Znaïm45, grognait de même. « Si l’Empereur était content de nous, nous n’étions pas contents de lui, » dit avec sa joviale naïveté le brave Coignet46. Mais, le déplaisir montait plus haut encore. Chez certains, il s’y mêlait quelque inquiétude, et cet état d’esprit se manifesta clairement par la non-unanimité du vote au sujet du mariage autrichien, dans le conseil extraordinaire du 7 février.
C’est que ce mariage paraissait lourd de menaces aux régicides de 1793, devenu fonctionnaires ou dignitaires impériaux. Cambacérès et Fouché se devinaient particulièrement menacés. Le premier, ayant, par mégarde, donné un bal le 21 janvier, fut prié d’aller admirer les beautés de Rome47. L’inquiétude d’une possible vengeance autrichienne avait gagné jusqu’aux départements. « D’Aix-la-Chapelle le préfet de la Roër demandait s’il était vrai que l’Empereur éloignerait de sa personne, de la capitale et des emplois publics, les conventionnels et ceux dont la cour de Louis XVI avait eu à se plaindre. C’était, assurait-on, un article secret du contrat de mariage48. » Terreurs inutiles ! En 1810, l’Autriche ne songeait pas plus qu’en 1793 à venger l’exécution de Marie-Antoinette. C’eût été, au surplus, une singulière prétention. L’Empereur, à la vérité, n’y avait pensé qu’un seul instant et avait passé outre49. N’avait-il pas employé la plupart des hommes de la Terreur ? Il avait fait Cambacérès, prince50. Il avait doté Fouché d’un duché. Il ne songeait à disgracier ni l’un ni l’autre, encore que depuis sa décision d’épouser une archiduchesse, il fut pris d’une brusque pitié pour le malheur des Bourbons. A la veille d’enter la racine corse sur la souche autrichienne, de s’allier aux Capétiens et aux Valois, il se sentait envahi d’une singulière mansuétude pour cette race qu’il combattit en ses jeunes années, et sur laquelle il remporta ses premiers lauriers. Marie-Antoinette lui parut « une femme charmante51 ». Plus tard, à Dresde, il plaignit Louis XVI, « son pauvre oncle52 ». En juin 1810, il fit interdire la tragédie de Raynouard, les États de Blois, à cause du rôle du duc de Guise, un parent de l’impératrice, dit-il, un « prince de la maison d’Autriche avec qui nous sommes en amitié53 ». Ce ne fut que sur le tard, à l’heure de ses désastres qu’il parut désabusé, conservant cependant encore une pointe de commisération. « Les Bourbons, pauvres diables ! » disait-il54. Pour le présent, il faisait exhumer le cérémonial en honneur à leurs mariages. Sur celui de Marie-Antoinette il faisait régler celui de l’Empereur des Français avec une archiduchesse d’Autriche. Il y mêlait cependant l’élément des temps nouveaux disciplinés par lui, et ce fut pourquoi Marie-Louise, petite-nièce de Marie-Antoinette, joua, à son arrivée à Paris, sa première partie de whist avec Fouché et Cambacérès, lesquels, tous deux, avaient, dans les orages de fièvre et de fureur de la Convention nationale, voté la mort du « dernier tyran des Français ».
« Marie-Louise, amenée d’Autriche au Corse. » (D’après une caricature anglaise de 1810.)
Le dépit de Pétersbourg trouva un écho à Vienne, dans les salons anti-français. Les émigrés de 1789 avaient fait là souche. De leurs vieilles haines demeurées vivaces, ils n’avaient rien abdiqué. Bonaparte était l’usurpateur, et son mariage « semblait mettre le sceau à la révolution et à l’usurpation55 ». Ce n’était, dans ces pétaudières, qu’un cri contre le « monstre ». Personne qui ne fut d’accord, là, sur « l’inconvenance et la lâcheté de l’alliance qui mettait au pouvoir de l’infâme usurpateur la première princesse de l’Europe56 ». Les dames en eurent des syncopes et des attaques de nerfs57. Quelques-unes d’entre elles prouvaient « par des faits prétendus incontestables que le monstre était poltron et que bientôt il deviendrait imbécile, vu qu’il tombait du mal caduc58 ».
Peltier, le stupide Peltier, directeur de l’Ambigu59, petite feuille royaliste de Londres, avait fait de la chose un quatrain :
Savez-vous pourquoi l’archiduc60
Du grand Napoléon doit épouser la femme ?
C’est pour accoutumer la jeune et noble dame
Aux attaques du mal caduc61.
Et, de feuille en feuille, c’était, de sa part, mille détails ridicules sur « l’Iphigénie autrichienne », la « seconde madame Bonaparte », la « rose du Danube », appelée à remplacer aux Tuileries la « marjolaine de la Malmaison ». Avec beaucoup de grâce, elle avait placé sur son sein le portrait de son « ogre », elle lisait avec attention les épîtres de son « vert-galant », mais en secret elle versait les larmes les plus amères.
De tant de bonheur, les clans royalistes de Vienne déclaraient que « Napoléon allait devenir fou de joie62 » car « le ciel ne permettait un tel scandale que pour foudroyer de plus haut le moderne Nabuchodonosor63 ». Et quel mépris indigné contre Berthier, « ce soldat parvenu, ce prince de la veille64 ! » Mais la police ayant mis le nez dans ces conciliabules, il fallut se taire et prendre, en silence, son parti de cette « brillante mésalliance65 ».
Seul, le peuple de Vienne montrait quelque joie, sincère celle-là. Les blessures de la campagne de 1809 lui saignaient encore douloureusement au flanc. Par cette alliance inespérée, inattendue, il escomptait quelque adoucissement aux conditions draconiennes du traité de Vienne. L’indemnité de guerre de 85 millions demeurait à payer à la France. Les remparts de Vienne démolis, jetés bas par la mine, attestaient de la terrible défaite. Le vainqueur avait arraché à l’Autriche les plus belles de ses provinces : le pays de Salzbourg, Berchtesgaden, la Haute-Autriche, Goritz, la Carniole, la Haute-Ca-rinthie, Trieste, Fiume, des lambeaux de Bohême et de Galicie, libéralement distribués par Napoléon entre la Bavière, à l’Italie, à la Saxe. C’était le baume à toutes ces plaies vives et brûlantes qu’on espérait, de celui qui allait apporter, en dot à sa fiancée, l’assurance que sa patrie était garantie de toute nouvelle dépossession de territoire66.
Au-dessus de toutes ces contingences, un seul triomphait avec superbe : M. de Metternich. « Il est ivre de joie, disait Gentz, son homme à tout écrire ; voyant à quel point la grande nouvelle réussit, il ne craint pas d’attribuer à son art et à son mérite, la totalité de cet événement67. » C’était d’une autre joie qu’il devait demeurer grisé pour le reste de sa vie, quatre ans plus tard !
Mais une promptitude égale à celle des pourparlers régla les cérémonies du mariage par procuration. Comme le premier après l’Empereur, Berthier, l’ancien espion de Joséphine68, assuma la délicate tâche de ramener l’Impératrice en France69. Le 24 février 1810, il quitta Paris avec une suite brillante : M. le comte de Laborde, secrétaire d’ambassade ; le colonel aide de camp comte de Girardin, premier cavalier d’ambassade ; le colonel aide de camp comte de Lagrange ; le colonel aide de camp Edmond de Périgord ; le chef d’escadron aide de camp baron de Sopransi ; le chevalier de Lespérut, gouverneur de Neufchâtel, maître des cérémonies ; le chevalier Le Duc, secrétaire des commandements du prince de Wagram ; tous ou presque tous porteurs de beaux noms d’ancien régime, des grands noms de l’ancienne France. Mais, dès le départ, un incident manque de tout retarder. De hardis filous tentent de voler la caisse des bijoux, envoyés par Napoléon à sa fiancée, ladite caisse placée sur le carrosse du trésorier Peyrusse. Le coup manque par hasard, le carrosse de Peyrusse ayant heurté une voiture de vidange dans la rue de la Jussienne70. Sans autre aventure, la mission touche aux frontières autrichiennes, où Berthier est reçu par le prince Paul-Antoine Esterhazy de Galantha, le même qui mourut en 1866, après avoir été ambassadeur à Dresde et à Londres.
CHAPELLE
TRIBUNES BASSES
LE Grand-Maître des cérémonies, conformément aux ordres de S.M. L’EMPEREUR et ROI, a l’honneur de vous prévenir que la cérémonie du Mariage de S.M. avec S.A.I. et R. l’Archiduchesse MARIE-LOUISE, sera célébré dans le grand salon du Louvre.
Ce Billet est personne ! : on est invité à le représenter ouvert en entrant.
On entrera par la porte du Musée de sculpture, place du Louvre.
La porte sera ouverte à neuf heures, et fermée à midi.
Carte d’entrée pour la cérémonie du mariage de l’Empereur (Musée Carnavalet.)
A Vienne, Berthier entré par un pont jeté sur les glacis démantelés et les remparts ruinés, alla gîter à la chancellerie du Palais. Des honneurs princiers l’attendaient. Il les étale avec complaisance dans ses dépêches. On l’y voit revenir à plusieurs reprises, sur le fait qu’il semble trouver de la plus haute importance : il a parlé à François II chapeau en tête, ne se découvrant qu’au nom des deux empereurs. Le 9 mars, il signa le contrat. La signature apposée, un officier entra, porteur d’une cassette : c’étaient les 500.000 francs, en ducats d’or, de la dot de Marie-Louise71. Berthier en donna le reçu. Le lendemain eut lieu le mariage par procuration, ce mariage que l’armée croyait devoir être poussé, par Berthier, jusqu’à sa complète consommation72. L’archevêque de Vienne avait accordé, après des démarches quelque peu irritantes, la dispense souveraine des trois publications légales nécessaires pour la validité du mariage civil73. Ce fut l’archiduc Charles, le vaincu de Wagram, qui épousa l’archiduchesse au nom de son vainqueur. Le soir, Vienne brilla de ses mille lumières triomphales dans le vent nocturne.
Ex unione pax, opes, tranquillitas populorum ! De cette union naîtront la paix, la richesse Et la tranquillité des peuples !
proclamait le jeu savant des lampions. Ce fut presque avec leurs feux éteints et déclinants que la consolante et trompeuse illusion s’en effaça.
Le 13 mars, on plia bagages. Berthier avait mené « cette conquête de la façon dont son maître menait celle des empires74. L’Impératrice avec son cortège alla coucher à Saint-Polten. Le 14, elle gîtait à Ems. Le lendemain l’étape la menait à Reid.
Comme à sa sortie de Vienne, par la porte du Burg, c’était toujours le fracas des artilleries joyeuses, la volée de cloches en fête, les acclamations triomphales. Elle, cependant, les yeux plus rouges des larmes versées chaque nuit, sentait, à tout nouveau relai, se déchirer en elle son autrefois de paix indifférente. De Braunau, où se devait faire sa remise à sa suite française, elle écrivait à son père une lettre lamentable et éplorée. « Ah ! Dieu, gémissait-elle, comme je regrette les bons moments que j’ai passés auprès de vous ! Maintenant, seulement je les apprécie. Je vous affirme, mon cher papa, que je suis triste et inconsolable75. » Et, victime résignée, Iphigénie teutonne, elle s’abandonnait à ses horrifiques destins. Claquant des dents, elle devinait au delà des villes à franchir, dans l’éloignement des pacifiques horizons de France, l’Ogre et le Corsicain, à qui on la sacrifiait. Les préliminaires du sacrifice lui étaient légers. On admirait son vaste et juvénile appétit. Le 22 mars, le Rhin franchi, elle entrait à Strasbourg76. Rues pavoisées de branchages, fenêtres ornées de fleurs, oriflammes aux pignons aigus des toits, la ville était pareille en ce jour à celui d’autrefois où la dauphine Marie-Antoinette y fit son entrée. Pour la seconde fois, le destin de la France s’en venait d’Autriche, les mains lourdes des radieuses palmes de l’espérance populaire. Une fois encore, les images heureuses des pacifiques avenirs faisaient escorte au cortège. Les mêmes cloches chantaient dans les tours ; le même écho tonnait de l’aboi des canons joyeux. Par la même route, l’Impératrice gagna, comme sa grand’tante, la décapitée de Vendémiaire, le rendez-vous fixé à l’amoureuse rencontre. Partie le 24 mars, elle se dirigea vers Saverne, Lunéville, Nancy, Vitry-le-François et Soissons. A quelques lieues de là, l’Empereur attendait.
Décoration de l’entrée du ministère des Relations extérieures, lors des fêtes du mariage autrichien.
Les nouveaux destins de l’Empire commençaient77.
1 Cf. ce tableau dans HENRI WELSCHINGER, Le Divorce de Napoléon ; Paris, 1889, in-12, pp. 270, 271.
2 BARON DE MÉNEVAL, ancien secrétaire particulier de Napoléon, premier Consul et empereur, ancien secrétaire des commandements de l’impératrice régente, Napoléon et Marie-Louise ; Souvenirs historiques ; Bruxelles, 1845, in-18, t. II, pp. 55, 56. — Claude-François Méneval, secrétaire du portefeuille, fut créé baron de l’Empire le 13 août 1810. Cf. ÉMILE CAMPARDON, Liste des membres de la noblesse impériale dressée d’après les registres des lettres patentes conservées aux Archives nationales ;